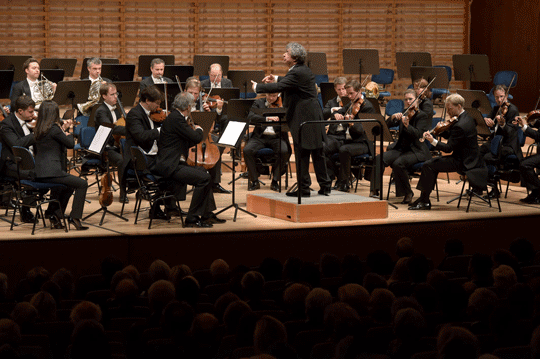Ce texte est le développement et l’adaptation d’un article paru le 15 septembre 2016 dans Platea Magazine (Madrid)
Kirill Petrenko est un mystère. Fuyant les médias, communiquant peu, il n’est pas dans les circuits glamour des chefs à page Facebook ou compte Twitter. Dans les excellents documents offerts au public lors du concert de Paris, il signe quelques textes, ce qui est exceptionnel. Travailleur infatigable, il ne donne que quelques concerts dans l’année, et fouille les partitions d’une manière chirurgicale, les essayant avec tel ou tel orchestre pour parfaire son approche. Il donnera en décembre à Turin par exemple (avec l’orchestre de la RAI) le programme prévu avec les Berliner. Mais là où il passe avec un orchestre, il déchaîne les salles, les passions, les interrogations. À Lucerne, comme à Paris, à peine terminée l’ouverture de Meistersinger, il y avait déjà des hurlements. Deux programmes voisins entre Lucerne et Paris, mais à Lucerne, la dominante était Richard Strauss, puisque l’ouverture de Meistersinger était suivie des Vier letzte Lieder, et en deuxième partie de la très rare Sinfonia domestica, une découverte pour de très nombreux auditeurs. Ce n’était pas pour Lucerne un choix « facile », puisque et l’orchestre, le Bayerisches Staatsorchester, et son chef faisaient leur première apparition. Mais on a considéré sans doute le public de Lucerne plus aguerri pour supporter un programme un peu moins grand public. À Paris, le programme affichait la Symphonie n°5 de Tchaïkovski, bien plus connue. Kirill Petrenko, à l’écart des circuits jusqu’à maintenant, est devenu objet de curiosité depuis que les Berliner l’ont élu comme successeur de Sir Simon Rattle. Lui-même a dû se soumettre quelque peu à l’exigence médiatique, bien vite refermée, et donne cette saison des concerts divers (Berlin, Amsterdam, Turin).
À peine passé le premier accord des Meistersinger, l’affaire était conclue : un accord à la fois plein et subtil, avec une très légère modulation et puis une dynamique incroyable, plus que la solennité habituelle et attendue. Évidemment ce n’était pas l’ouverture habituelle en forme de « pezzo chiuso » destinée à faire sonner l’orchestre sans trop fatiguer le public. L’orchestre sonne évidemment, mais avec une belle dynamique, une très grande fluidité, certes avec des accents , mais à peine sont-ils effleurés qu’on passe à autre chose comme une « toccata e fuga », une rencontre brève avec la note qui va de l’avant, dans un raffinement tout particulier, y compris de la part des cuivres qu’on a souvent entendu d’une lourdeur grasse dans cette pièce. Incroyable aussi le sens des équilibres, et la couleur de l’ensemble, les couleurs devrais-je dire tant tout cela est miroitant, va plutôt vers la comédie que les drames de la maturité : les sectateurs d’un Wagner bien gras et bien lourd repasseront. Ce Wagner-là n’est pas gras, mais gracile, mais élégant, mais limpide, et semble courir alors que le tempo n’est pas différent que chez d’autres chefs. Ce Wagner nous raconte déjà l’histoire qui suit et a déjà la couleur de l’humanité extraordinaire qui court tout l’opéra. L’orchestre habitué à son chef en suit le moindre signe, la moindre indication donnée du doigt, de la main, du bras, de la tête, du corps tout entier. Pour certains chefs, c’est un mode très démonstratif de diriger, pour le spectacle, mais pas ici. C’est un corps dédié, dédié à la partition, comme possédé par la musique, immergé dans la musique qui communique rythmes et dynamique à un orchestre qui donne tout, de sorte que même si nous connaissons désormais (depuis les fabuleuses représentations de ce printemps et de juillet dernier) l’approche de cette œuvre par Kirill Petrenko, tout nous semble neuf, divers, comme une perpétuelle surprise et ainsi la double écoute de Lucerne et de Paris nous fait encore aller plus loin, sans jamais se répéter, mais faisant briller des lumières nouvelles.
Avec les Vier letzte Lieder de Strauss, nous passons à une toute autre ambiance, celle crépusculaire de la fin du jour qui est aussi fin de la vie: mélancolie, nostalgie, dernier regard sur le spectacle de la nature. L’opposé de la joyeuse humanité de Meistersinger. C’est pour Diana Damrau une première fois. La célèbre chanteuse allemande familière du répertoire belcantiste aborde l’univers mordoré de ces Vier letzte Lieder, que toutes les stars du chant mettent à leur répertoire. C’est pourquoi évidemment elle est attendue au tournant par les opiomanes de la voix, parce qu’il s’agit immédiatement de mettre en perspective, avec les vivantes (Harteros…), et surtout avec les disparues : la confrontation avec le souvenir ou le disque est souvent délétère pour l’artiste qui se produit hic et nunc. Le goût de Richard Strauss pour les voix féminines, la doxa straussienne qui privilégie voix capiteuses et rondes va un peu à l’encontre d’une prestation destinée avec le temps sans doute à évoluer : en matière de chant, le coup d’essai est rarement un coup de maître. Damrau était une colorature. Elle devient un soprano lyrique : la voix a pris de l’assise, s’est élargie, l’expansion est magnifique, la ligne de chant stupéfiante, les aigus splendides et sûrs. On sent qu’il y a dans ce registre encore de la réserve. Dans le registre grave, c’est plus discutable (mais l’acoustique parisienne…). Certains graves semblent disparaître dans l’orchestre, ou se détimbrent. Mais ce qui frappe, c’est le naturel d’une expression qui ne veut rien faire de trop. Pas trop d’accents, pas de volonté de faire du style ou de minauder: on aurait pu s’y attendre sur « Tod » mais le mot est dit, comme ça, parce qu’il se suffit à lui-même. Dit la force du mot ! Le mot jamais surinterprété, jamais vraiment souligné plus que ce que n’indique la musique. En ce sens, Damrau est en phase totale avec Petrenko et peut-être pas en phase avec les attentes de certains auditeurs…nous sommes peut-être habitués à des voix plus rondes, moins droites, moins « simples ». C’était pour moi déjà passionnant car elle se place dans une autre perspective, et donc se singularise. À Lucerne, l’abord était peut-être un peu froid, et un peu trop droit, sans la souplesse à laquelle on est habitué dans Strauss ; à Paris, il était déjà plus souple, notamment dans les deux derniers, Beim Schlafengehen (Hermann Hesse) et Im Abendrot (Eichendorff) les plus vibrants à mon avis. Il en résulte une extraordinaire unité avec l’orchestre : l’orchestre ne propose pas à la voix un écrin dans lequel elle se réfugierait confortablement, mais compose avec la voix quelque chose de tressé, un réseau unique de musique comme si l’orchestre se comportait en « accompagnateur » au sens piano du terme, dans ces moments suspendus où pianiste et voix semblent se reprendre le discours musical dans une continuité à deux voix. Ce n’est pas la voix qui décide d’une couleur, ce n’est pas l’orchestre qui impose un rythme, c’est un discours unique à deux, comme deux voix qui se comprennent et qui se reprennent tour à tour le discours. On reste fasciné de la manière dont Kirill Petrenko traite le texte : il donne toujours l’importance primaire au mot. C’est vrai dans ces Lieder (il l’écrit d’ailleurs dans un des textes du programme : « chez Strauss, on peut et on doit jouer avec le texte »), c’est vrai à l’opéra, quel qu’en soit le livret (c’est même vrai dans Tosca, ce qui indispose les soi-disant amateurs…), d’où quelquefois l’impression de platitude : mais il en va ici de la platitude comme de la canopé : la surface cache le réseau de ramifications, la profondeur ou l’épaisseur de la forêt . Car jamais l’orchestre ne paraît plat tant il est riche et foisonnant, tant il dit, soit en mettant en relief tel ou tel instrument, soit en allégeant au maximum (les cordes) pour mieux faire ressortir soit la voix soit les bois…C’est un fil raffiné à l’extrême de sons, doué d’une extraordinaire précision, syllabe par syllabe, soulignant les mots, mais ne prenant jamais le pouvoir, même si, tout attentif qu’il soit à la prééminence du mot, il laisse le violon solo (dans Beim Schlafengehen) libre de chanter en duo avec la voix, comme en suspension, comme dans une intimité préservée: un des moments sublimes de la soirée.
Pour la chanteuse, c’est une situation d’un très grand confort parce qu’elle n’est jamais couverte par l’orchestre, toujours accompagnée et soutenue, sans qu’on puisse accuser l’orchestre d’être trop discret, parce que de l’orchestre on entend absolument tout, présent tout comme la voix et à parts égales. Pour l’auditeur, c’est un parti pris très différent de ces interprétations où l’orchestre souligne commente et encadre : c’est très sensible dans l’introduction à « Im Abendrot » où l’orchestre pourrait se mirer dans la propre splendeur, et qui ici introduit, simplement, sans se pavaner. Mais reste cette mer de couleurs qui répond à la mer de couleurs proposée par le/les texte(s), ça miroite, cela n’aveugle jamais sinon par touches pointillistes. Mais la réception par l’auditeur dépend non seulement de l’interprétation, mais aussi de la salle : celle de Lucerne à cet égard a une acoustique plus chaude et incroyablement précise, celle du Théâtre des Champs Elysées reste sèche, moins précise, plus ramassée et plus difficile pour la voix et la limpidité de l’orchestre.
Un océan de couleurs, voilà ce qu’il en a été à Lucerne de la Sinfonia domestica, un poème symphonique qui n’est pas l’un des plus connus de Strauss, ni l’un des plus appréciés. Beaucoup soulignent l’ennui, l’absence de ligne, la pauvreté mélodique, le faux modernisme ou disent simplement que la musique en est « laide ». La pièce voulait soulever de manière souriante le voile sur l’intimité de la famille Strauss, mais en même temps en faire une comédie de l’intime avec ses petits drames et ses petites joies. De cette intimité les premiers accord in medias res sont témoins, sur un mode léger. Nous sommes au théâtre, théâtre d’appartement où la clarinette et les bois jouent un dialogue souriant, un bavardage presque pépiant où tout semble danser, dans une danse discrète avec des rythmes qui donnent à cette musique un aspect pictural, celle des miniatures figuratives qui décrivent des scènes de famille dans les gravures XIXème ou les petits tableaux XVIIIème dont la peinture vénitienne (entre autres) est gourmande. Petrenko a choisi l’ironie et le sourire, il a choisi aussi de représenter le petit théâtre de la vie avec son gros orchestre ! Certains moments composent une symphonie de couleurs dont les ruptures de rythme et de phrases instrumentales rappellent très clairement le début du troisième acte de son incroyable Rosenkavalier munichois en juillet dernier. Comme si Strauss écrivait une « Komödie für Familie ». On découvre alors l’incroyable richesse de l’écriture, qui se révèle grâce à la limpidité du rendu orchestral avec les moindres détails que Petrenko met en valeur. On reste stupéfait de cette vision, qui fait de la symphonie un caléidoscope de sons divers, presque une pièce impressionniste (est-ce un signe si la Sinfonia domestica est presque contemporaine de Pelléas ?) avec une palette de couleurs et de nuances infinie, d’une richesse toujours renouvelée. On constate d’ailleurs sur les visages la joie des musiciens à jouer cette musique – lorsqu’il sont en fosse, c’est évidemment quasi impossible – qui met en valeur leur engagement et leur qualité. Ils sont aux mains de leur chef, comme dédiés, et répondent avec justesse à la moindre des impulsions. Bien sûr, cet orchestre est straussien par antonomase, mais pour ce Strauss moins connu et surtout un peu considéré de seconde zone, ils réussissent à dessiner un paysage, un univers d’abord intérieur, puis plus large, qui va du tableau de l’intimité familiale au jeu interne des rapports avec leurs conflits, leurs tension, leur apaisement, leur intimité et leur légèreté, leur lourdeur ironique aussi, mais qui dans l’univers d’une famille prennent une place marquante, presque épique. Alors la pièce qui croyait-on serait ennuyeuse, devient alors un feu d’artifice tout neuf, une magie orchestrée : alors, du premier violon au triangle, la musique bat au rythme du corps du chef d’orchestre, dans une vaste mosaïque de couleurs et de sons et d’expressions, comme si cette Sinfonia domestica devenait une sorte de sinfonia universalis.
À Paris (le 12 septembre), c’était au tour de Tchaikovski (Symphonie n°5), donné jusque-là deux fois dans la longue tournée (à Dortmund et Bonn). Si l’on connaît bien le Strauss de Petrenko, on découvrait son Tchaïkovski orchestral. Les lyonnais connaissent son Tchaikovski lyrique puisque Kirill Petrenko a été le chef de la série des trois opéras pouchkiniens donnés à Lyon à partir de 2006. Le choix interprétatif est clair, c’est celui du romantisme. Un romantisme qui n’a rien de policé, mais dramatique et exempt de pathos, sans rien de mellifère, avec même des audaces comme ce contraste entre un instrument seul, un peu rêche (la clarinette ou le basson) et l’ensemble de l’orchestre, comme on en rencontre chez Berlioz, un romantisme qui par moments rappelle certains moments inquiétants de la Pastorale : un romantisme de l’inquiétude. La mise en relief des bois, qui court le premier mouvement fait (presque) penser à un concerto pour bois et orchestre tant Petrenko organise la confrontation. Cette mise sous les feux des bois splendides (clarinette, hautbois, basson, flûte) qui se reprennent la parole dans un dialogue hypertendu avec les cordes est un moment assez saisissant de l’ambiance installée par Kirill Petrenko. Il est difficile d’obtenir des sonorités plus claires et plus précises, des pianissimi plus subtils, des cordes plus chaudes dans les parties plus romantiques. Ce qui l’intéresse, c’est de faire émerger les conflits de l’âme, d’évoquer ce qui est rêve tout en soulignant l’agitation intérieure par la dureté de certains sons. Ce qui surprend, c’est la profondeur de l’analyse, par exemple à la fin du premier mouvement, qui n’est pas un final, mais plus une interruption du son, une rupture de construction, suivie du silence de l’intervalle, et la reprise des premières notes graves, obscures, du second mouvement renvoie à un univers intérieur angoissé, jusqu’à l’intervention du cor en forme de lamento, suivie de cordes qui tirent les larmes dans une ambiance qui rappelle la Pathétique, sans jamais être justement pathétique et souligner les effets. Comment ne pas aussi évoquer la valse, allégée, aérée, évidemment dansante, qui marque les différents états d’âme de ce paysage intérieur.
Et puis il y a ce dernier mouvement en forme de crescendo, une sorte de marche au destin soutenue à un rythme infernal jusqu’au vertige, qui porte les musiciens à l’incandescence et le public à l’apnée. Faite ainsi, la symphonie n°5 de Tchaïkovski devient une sorte de référence absolue du concept de « symphonique », traduction musicale de l’univers d’une âme troublée, prise entre désir de mort et désir de lumière qui laisse abasourdi l’auditeur. Bis en forme de tourbillon infernal, l’ouverture de Rouslan et Ludmila de Glinka. Saisi de surprise, le public sort, étourdi.
C’est alors le temps des commentaires et des remarques critiques : que dire devant cette performance ? Que commenter ? Qui invoquer ? Il y a là une virtuosité et une dynamique qui laisse pantois, une analyse de la partition d’une acuité inouïe, un échange exceptionnel avec l’orchestre, dans un climat de confiance, voire de dévouement absolu qui étonne. Certains y laissent quelques regrets, notamment celui d’une absence d’âme, ou de sensibilité, ou même d’un peu – rien qu’un peu- de pathos.
D’abord, on ne peut vraiment émettre de jugements définitifs sur la performance d’un chef de 44 ans : à 44 ans (en 1977), Claudio Abbado en France n’était pas considéré comme une référence en matière de culture symphonique, mais bien plus d’opéra italien. On connaît la suite. À génération plus ou moins voisine, et à niveau égal, on se trouve aux antipodes d’un Andris Nelsons qui est d’abord partage de sensibilité. Mais le public qui a des oreilles ne peut que constater ce côté “hors normes” de l’approche de Petrenko, marqué par un rapport charnel et corporel à la musique, par une lecture incroyablement précise et répétée de la partition . L’effet sur le public pourtant est total, absolu : il y a bien communication d’un monde, partage d’un univers et donc transmission forcément sensible: je me souviens en écoutant la symphonie écossaise de Mendelssohn à Munich ce printemps avoir eu des palpitations rien qu’à l’écoute du premier mouvement. Il y a un effet physique de cette approche, qui est partage presque animal : Petrenko a une approche musicale qui joue sur l’effet physique du son, sans négliger l’effet intellectuel et poétique du texte : il y a un effet physique, y compris de la poésie… Mais pas de froideur analytique, et c’est bien justement le paradoxe : un entre deux entre refus de la complaisance et du sentimentalisme et refus de l’analyse froide. Autrement dit on ne sait où l’on est mais on est pris voire englouti. J’y vois là une preuve de nouveauté, d’inattendu, c’est là la surprise du chef.[wpsr_facebook]