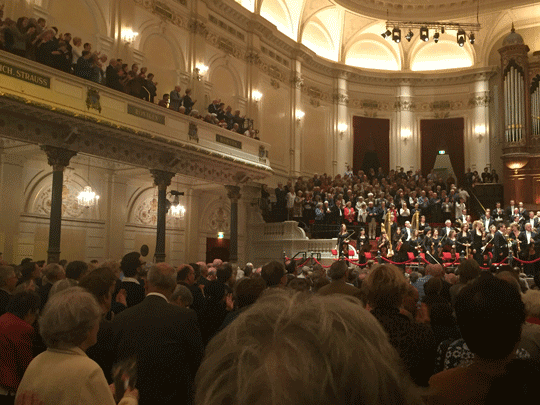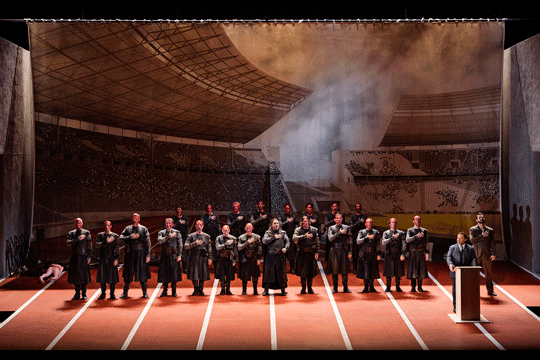Daniele Gatti en ouverture de saison 2016-2017 propose la Symphonie n°2 de Mahler « Résurrection », un passage obligé pour le nouveau Chef-Dirigent de l’orchestre du Concertgebouw, tant Mahler est consubstantiel à l’orchestre. À Amsterdam, il a déjà dirigé la 6, la 9, la 3. La symphonie n°2 est de plus l’un des attendus du public, l’une des symphonies de Mahler les plus populaires, qui emporte le public dans une sphère céleste, et donc tout le monde attend les derniers mouvements ascendants et épanouis.
Dans ma vie de mélomane, la pierre miliaire de cette symphonie en est l’exécution par Claudio Abbado en 2003, avec le Lucerne Festival Orchestra dans sa première saison, qui nous laissa sonnés pour des années. Un enregistrement CD et un DVD existent de ce moment unique. Unique en effet dans une vie : sans doute n’existe-t-il pas d’exécution plus forte ni plus sentie de cette symphonie. Mais ce temps n’est plus ; ce sont les souvenirs mythiques de moments uniques d’une vie faite bien sûr de ces diamants, mais aussi des exécutions du moment, qui n’en sont pas moins passionnantes, du moins pour certaines.
Il reste que j’ai écouté peu de symphonies « Résurrection » depuis, une fois par Gustavo Dudamel à Lucerne, et ce fut une lourde déception, une autre fois par Andris Nelsons, c’était nettement plus intéressant, mais rien qui ne rapprochât de l’exécution « princeps ».
Daniele Gatti est un explorateur de Mahler, qu’il dirige un peu partout, et qui fut l’occasion d’un cycle à Paris. Il propose un travail passionnant, convaincant qui se place d’emblée dans les très grandes exécutions
Commencer par la Symphonie n°2 la saison de concerts à Amsterdam, c’est à la fois obéir à la grande tradition de cet orchestre depuis 8 décennies au moins, et donc se profiler à la suite des anciens directeurs musicaux, tous mahlériens de premier ordre, Jansons, Chailly, Haitink et les plus anciens encore. La Symphonie « Résurrection », est à la fois spectaculaire, marque une aspiration vers un univers éthéré et d’une largeur qui aspire le spectateur, mais aussi un aspect particulièrement terrestre, chtonien, notamment dans les trois premiers mouvements. Que privilégier dans ce programme mahlérien entre vie et mort, funèbre et céleste, un programme qui ne veut pas exactement dire son nom qui veut décrire le passage entre vie et mort, ce presque rien qui fait tout basculer.
Daniele Gatti explore de tout autres espaces. Dans une exécution qui à mon avis fera date, il en fait la symphonie une tragédie humaine, où la Résurrection n’est pas donnée, mais doit se mériter : l’homme est donc au centre de cet univers, avec sa foi, ses doutes, et son attachement irrépressible aux forces de la terre… C’est ce chemin rude qui est escaladé encore une fois ici. Ce n’est pas tant au niveau du tempo, mais surtout par cette impression d’effort, de masse, par ces silences insistants, en forme d’interrogation qui se retrouvent à plusieurs moments, par ces contrastes entre un univers marqué par l’appel menaçant de la mort et le souvenir des joies terrestres (2ème mouvement). Le premier mouvement dans cette perspective prend une allure encore plus dramatique : l’attaque initiale sonne déjà comme un avertissement, avec un Royal Concertgebouw Orchestra aux sonorités pleines, charnues, et en même temps incroyablement limpides. Il n’y a rien de lourd, et ce qui est pesant ne l’est que pour l’âme mais pas le son.
Le quatrième mouvement, avec les cuivres extérieurs, qui entourent la salle, situés dans les couloirs adjacents, est à la fois angoissant et pétrifiant. Il n’y a pas encore de crescendo, mais une sorte de maintien forcé à la terre, ou de lutte immanente. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, comme dit le titre d’une chanson grecque fameuse. La vie tire vers le haut et ce haut-là se mérite et exige des efforts. C’est bien cette vision du monde qui ici s’impose.
Ainsi l’interprétation de Gatti retarde volontairement toute élévation, en installant de longs moments méditatifs, des silences appuyés, une première partie à la fois imposante et marquée, contrastée, intérieure. Vision de l’élévation, vue du bas.
Le Mahler de Gatti en général a une couleur essentiellement tellurique, c’était le cas dans sa neuvième avec le même orchestre, que j’avais appelé « chtonienne », attaché aux forces terrestres et aussi à l’amour de la terre : c’était aussi le cas pour sa troisième.
Rien n’est facile dans ce Mahler-là, qui sonnerait presque pessimiste et noir par certains côtés.
Cela n’empêche aucunement l’approche d’être essentiellement spirituelle : elle procède d’abord d’un travail approfondi sur la partition, jamais refermée. Chaque concert ou chaque programme est relu à l’aune de l’orchestre, de ses possibilités. Les options même les plus surprenantes sont pensées, et osées parce que pensées. Alors, avec des orchestres comme celui du Concertgebouw, on peut aller très loin dans la recherche de nuances particulières, ou d’une couleur qui répond au ressenti.
Voilà qui garantit toujours des approches neuves, des tentatives : mettre au programme un tel monument signifie chercher en même temps un point de vue différent. Il ne s’agirait pas de proposer une version « tout venant » qui alors n’aurait aucun intérêt, d’autant avec un orchestre qui possède Mahler dans son ADN.
Alors évidemment, Gatti a retravaillé avec le Concertgebouw et orienté avec d’autres univers, avec une tension plus marquée, moins « séraphique », où la recherche sur le son est d’abord une recherche sur l’expression, voire l’expressivité. Ce qui porte la réflexion, c’est le souci de signifier, de ne jamais se laisser aller à un son qui ne soit que son, aussi merveilleux soit-il (et l’orchestre de ce point de vue ménage des moments prodigieux).
Il y a donc dans ce travail deux moments très marqués, toute la première partie (les quatre premiers mouvements), puissante, quelquefois douloureuse, marquée par une vision presque janséniste, pascalienne, et donc tragique du monde. Petitesse de l’homme et situation tragique devant l’infini, et difficulté à embrasser cet infini, mais qui ferait le pari de Dieu, malgré tout. Et puis une dernière partie en élévation, en aspiration vers le haut, qui pourrait être symbolisée par cette levée tardive du chœur extraordinaire de la radio néerlandaise (Groot Omroepkoor) dirigé par Klaas Stok, qui reste assis jusqu’aux derniers moments, comme cloué, et subitement tiré vers le haut dans l’envol des dernières minutes. Moment prodigieux où les éléments « humains » se déchainent et volent vers le Divin. Pour s’y hisser le chemin a été rude, mais c’est la récompense.
Werd’ ich entschwebenZum Licht,
zu dem kein Aug’ gedrungen!
Ce qu’il faut évidemment souligner c’est la perfection de l’interprétation et l’incroyable réponse de l’orchestre du Concertgebouw aux sollicitations du chef. L’attaque initiale des cordes en trémolo et notamment des violoncelles sonne immédiatement la tension dont il était question plus haut, et le tragique est déjà là. Violoncelles et contrebasses forment un tout homogène (le pupitre des contrebasses est exceptionnel), le premier mouvement est marqué par cette inquiétude presque métaphysique, quand tout semble s’éteindre après les interventions de la flûte (sublime) et que l’on entend remonter comme un pas lourd (percussion) en sourdine, à la reprise du thème initial et puis un crescendo lent, pesant, presque angoissant, sombre et fatigué qui émerge du silence, avec une intervention presque résignée du hautbois : c’est un des moments les plus étonnants du concert, qui se termine presque en pandemonium, une explosion qui retourne au (presque) silence, la sourdine des cordes pour retrouver le thème initial. A d’autres moments, l’apaisement gagne, les cordes s’allègent jusqu’à l’impalpable avant d’aborder le mouvement final, toujours scandé, cette fois par les harpes (troublé par un intempestif téléphone mobile), à peine plus lumineux (les trompettes !), et le fameux decrescendo aux cordes qui finit dans une sorte d’obscurité inquiète.
Le deuxième mouvement est moins sombre. Mais sans vraie légèreté, on danse une sorte de danse retenue et prudente. L’intervention des bois (la flûte) les sourdines aux cordes donnent l’impression d’une sorte de cérémonie clandestine, comme si cette apparente légèreté était incongrue.
Les extraordinaires pizzicati sont la marque des orchestres exceptionnels quand ils sont réussis (et c’est le cas ici) en dialogue avec les bois, qui ouvrent enfin sur tout l’orchestre dans une sorte d’apaisement sans aucune ironie, sans cette distance amère qu’on trouvera dans des symphonies plus tardives. Gatti ralentit le tempo et joue une atténuation progressive du volume jusqu’à l’impalpable, le presque rien qui va contraster avec le coup de timbale initial du troisième mouvement, troisième moment, qui lui aussi est plutôt dansant, mais une danse cette fois mâtinée d’étrange qui n’est pas très loin de faire penser à Berlioz.
Les interventions des cuivres déjà évoqués plus haut en coulisse, disséminés le long des corridors qui font le tour de la salle, donnaient une double impression contradictoire, mais non dépourvue de magie : ils semblaient à la fois éloignés, étouffés, mais en même temps proches et incroyablement clairs, il en est résulté un des moments magiques de la soirée, où le son fut complètement spatialisé, emportant l’auditeur et donnant l’impression de dilution des volumes dans une sorte de linceul sonore, profondément marquant.
Ce qui frappe aussi, et notamment dans la partie finale, c’est la manière dont Gatti conduit l’orchestre, avec une attention et une précision incroyables, avec une manière de diriger qui est plus accompagnement que direction, soulignant la nuance par des gestes du corps très lisibles, avec une main gauche particulièrement ductile, comme si il estimait nécessaire pour obtenir ce qu’il voulait de souligner encore plus la précision des indications, non pas parce que l’orchestre ne connaît pas ce répertoire qu’il a dans le sang, mais parce que justement, il a des habitudes de jeu que Gatti voudrait sans doute infléchir. C’est un chef qui n’a jamais rien de routinier, pour qui relire une partition, c’est forcément la redécouvrir. L’enjeu Mahler est important à Amsterdam, et en particulier dans une symphonie certes connue, mais en même temps difficile à appréhender, coincée entre la symphonie à programme et les grands espaces libertaires de l’interprétation, qui peut-être sirupeuse comme une viennoiserie complaisante.
Ce qui frappe dans ce travail, c’est qu’il est traversé par des échos issus du romantisme notamment brucknérien, et par une extraordinaire humanité. Abbado aimait à évoquer les souffrances explicites et implicites de Mahler, il aimait en souligner aussi les traits d’amertume ; Gatti affiche aussi un espoir, le grand espoir de tout humain, et souligne ici plus les efforts que les souffrances, d’où le tempo lent, d’où les larges plages de silence, d’où aussi les contrastes de plus en plus marqués vers la fin, avec une sorte d’affirmation du son qui souligne les solennités, mais aussi les respirations : l’homme y gagne chèrement son paradis, mais il le gagne et mérite sa résurrection.
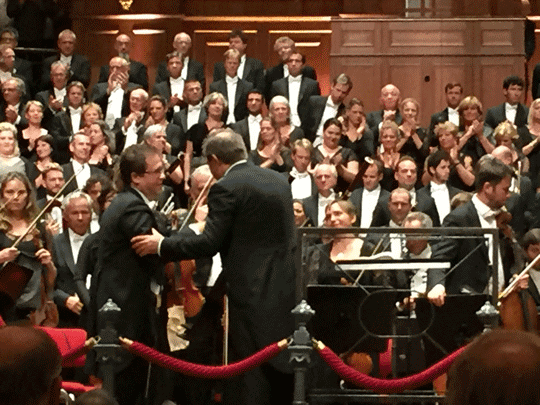
En deux concerts, nous avons pu entendre trois solistes, Annette Dasch, Chen Reiss qui l’a remplacée lors du concert du 18 septembre, et la mezzo Karen Cargill. Cette dernière aussi bien dans Urlicht que dans ses interventions finales, fait entendre une très belle ligne, bien appuyée sur souffle, et une voix qui régulièrement s’élargit, du grave à l’aigu, tout en réussissant à bien s’intégrer au son de l’orchestre : une prestation qui confirme les qualités de cette artiste entendue naguère dans Götterdämmerung à New York où elle avait un peu manqué du charisme scénique nécessaire, mais où elle avait déjà démontré de notables qualités vocales.
Annette Dasch en revanche, qui a annulé sa participation au 18 septembre, avait chanté le 16 : comme toujours, une pose de voix solide, comme toujours, une certaine sensibilité, mais il manquait une incarnation, il manquait aussi une continuité de la ligne (sans doute était-elle déjà fatiguée) qui laissait insatisfait. Chen Reiss, qui l’a remplacée au pied levé, n’a pas la largeur vocale nécessaire (Eteri Gvazava, une étoile filante du chant qui l’avait chantée avec Abbado ne l’avait pas non plus et sans sensibilité, ni incarnation) mais elle a la ligne de chant, l’élégance, et aussi l’émotion : chanteuse sensible, elle a réussi à s’imposer par une jolie couleur qui convenait bien ici et par un chant sans scorie aucune.
Ainsi peut-on affirmer sans aucune hésitation que ce premier programme, un test essentiel pour un chef qui embrasse cet orchestre en tant que Chef Dirigent pour la première fois est un pari gagné. En affichant la deuxième de Mahler, il prenait un risque, mais le triomphe public, les longs applaudissements, la satisfaction visible et palpable de l’orchestre montrent la satisfaction de tous. Le Mahler de Gatti va s’imposer, après celui de Jansons, de Chailly, de Haitink et des autres. Daniele Gatti, Chef Dirigent de l’orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, a démontré combien choix de l’orchestre est à la fois cohérent et justifié, et qu’il est déjà bien installé dans la place. Que pouvait-on souhaiter de mieux ? [wpsr_facebook]