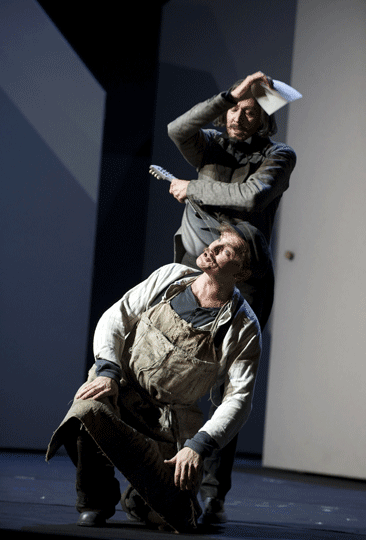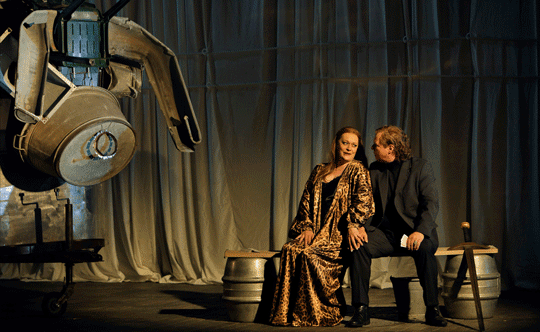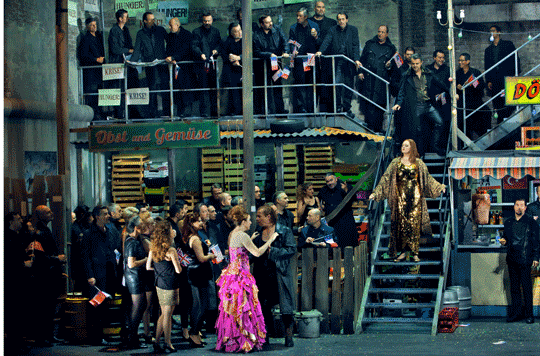Voir le compte rendu (David Verdier ) de cette même représentation dans Wanderer
Les souvenirs sont si vifs de cette production qui marqua tant le Festival de Bayreuth qu’on ne peut réprimer une surprise au lever de rideau. Certes, on retrouve les éclairages si troubles, si pâles, on retrouve cette impression de vide et en même temps d’enfermement, on retrouve ce hiératisme des figures, mais elles ne sont plus lointaines, et la scène n’est plus ce halo qu’on voyait de la salle de Bayreuth, et elle ne nous semblait pas si pentue.
La salle de Bayreuth n’est pas l’Opéra de Lyon, et le rapport scène-salle n’a rien à voir.
À Lyon, les effets voulus par le metteur en scène Heiner Müller et le décorateur Erich Wonder (décors reconstruits par Kaspar Glarner), ne peuvent coïncider puisque la salle est à l’italienne avec fort rapport de proximité. Le travail de Müller joue sur l’éloignement, sur des figures entrevues, presque translucides : ainsi à Lyon voyons-nous au contraire les chanteurs très près, les petits gestes, les mouvements infimes, tout ce qu’on ne voyait pas ou presque pas à Bayreuth. Il faut donc se réhabituer et ne pas superposer les images.
La question de ce festival, celle de faire revivre des productions disparues (qui fera l’objet d’une réflexion dans ce blog) était au centre des regards divers sur ce Tristan und Isolde de Heiner Müller, qui a tant marqué les mémoires des spectateurs du Festival de Bayreuth. Car il y avait à la fois dans les discussions d’entracte ceux qui avaient vu le spectacle à Bayreuth, et ceux qui n’y étaient pas : le sens du défi de Serge Dorny était bien de proposer cette production à ces derniers, évidemment en majorité (écrasante) dans la salle de l’Opéra de Lyon. Il reste qu’un certain nombre de journalistes plus mûrs avaient le souvenir de Bayreuth, ce qui ne manque pas de perturber le regard critique sur le travail de Müller vu aujourd’hui.
C’est cette idée qui pervertit le regard. La production de Müller, conçue visuellement pour une salle en amphithéâtre à vision exclusivement frontale, avec un recul physique important de la majorité des spectateurs (aussi bien au parterre que dans les loges, balcon et galerie du Festspielhaus), ne répond pas de la même manière dans une salle aussi intime (1100 spectateurs) que celle de l’opéra de Lyon, avec ses visions latérales en grande hauteur, et son parterre réduit, rapproché, à la pendance légère quand Bayreuth a une pendance forte. Car là-aussi les choses diffèrent : alors que les dimensions de la scène en largeur et hauteur sont proches de celles de Bayreuth (même si la profondeur est très différente), la pendance de la salle de Bayreuth est forte et détermine des perspectives à corriger sur la scène (en modifiant la pendance de la scène) pour avoir l’effet de plat en vision du plateau.
Dernière remarque, la mémoire pouvait être aussi pervertie par la distribution de Bayreuth, étincelante (Waltraud Meier, Siegfried Jerusalem, Daniel Barenboim). Que ces noms soient liés à une vision, à un contexte, à des souvenirs émus, c’est évident. Mais comme les chanteurs ne peuvent plus chanter ces rôles et que Daniel Barenboim est sur d’autres projets, forcément la question de savoir comment d’autres prendraient le relais se posait.
La direction de Hartmut Haenchen n’a franchement rien à envier à celle d’autres chefs, aussi (sinon plus) prestigieux. Au niveau du concept, de l’approche, de l’effet produit, nous sommes aussi sur des sommets. C’est alors une affaire de goût, une « Geschmacksache » qui n’a rien à voir ni avec la production ni avec le rendu réel de l’œuvre. Enfin, l’insertion de nouveau chanteurs dans la production, avec le niveau pointilleux de la reconstitution à laquelle a procédé l’Opéra de Lyon, n’a pas été à mon avis problématique, c’est je le répète, la position relative du spectateur à Lyon qui peut faire penser que la direction d’acteurs et que le jeu sont différents. Mais les chanteurs se sont bien insérés dans l’exigence de Heiner Müller, retranscrite par son collaborateur de toujours Stephan Suschke à qui avaient déjà été confiées les reprises de la production à Bayreuth après la disparition de Heiner Müller en 1995.
Les regrets éternels ne peuvent faire office de critique : je suis moi-même traversé par les images de Bayreuth, et j’ai par ailleurs d’autres souvenirs tenaces qui pervertissent quelquefois mon jugement (Nilsson dans Elektra par exemple). Fallait-il laisser inviolée une production qui avait autant frappé, musicalement et scéniquement, au nom de l’œuvre d’art éphémère qu’on emporte avec soi dans les labyrinthes de sa mémoire ? C’est une discussion possible, mais le spectacle que nous avons vu à Lyon est aussi fascinant tout en étant autre. Pour moi la réponse est donc claire.
Ce qui marque dans cette production, c’est justement son caractère lointain et éthéré, une manière de reproposer le mythe sans rien qui soit anecdotique ou trivial. À peine un meuble (le fauteuil éculé sur lequel git Tristan au troisième acte), et pour le reste des signes. L’espace est clos, mais en même temps translucide et vaporeux, léger, avec des éclairages (l’immense Manfred Voss, repris ici par Ulrich Niepel) qui jouent sur de faibles, très faibles contrastes, et qui caressent la scène plutôt que l’éclairer, et des matériaux qu’on suppose très peu « matérialisés » justement (tissu, tulle) qui rappelleraient l’architecture japonaise. On a souvent interrogé Heiner Müller sur son rapport au travail de Wieland Wagner, dont il disait n’avoir vu que des photos, mais ce rapport est bien ce qui ressort dans l’imaginaire du spectateur qui n’a pas vu les mises en scène bayreuthiennes de Wieland.
 On avait le souvenir d’êtres tout aussi lointains, désincarnés, comme dans un univers déjà au-delà, comme dans ce deuxième acte nocturne où la lumière d’un bleu profond épouse et caresse une armée de cuirasses, témoins muets, rappelant un monde de chevalerie que la légende même de Tristan met à mal, dont la variation des éclairages montre quelquefois, émergeant, trois ou quatre cuirasses qui figureraient ces témoins tapis. La cuirasse, un objet particulièrement identifiable, qui pourrait renvoyer à quelque concrétude, est ici elle aussi désincarnée, abstraite : les personnages circulent dans cet univers d’une manière géométrique et semblent émerger d’un champ (cela m’a fait penser en revoyant la scène, au magnifique champ de coquelicots du Prince Igor vu par Tcherniakov) comme si ces cuirasses n’étaient plus que des traces d’un monde jadis végétal, mais aujourd’hui métallisé d’où toute nature s’est envolée. La puissance de l’image est telle que le souvenir qu’on en a de Bayreuth et ce qu’on en voit sont ici presque congruentes.
On avait le souvenir d’êtres tout aussi lointains, désincarnés, comme dans un univers déjà au-delà, comme dans ce deuxième acte nocturne où la lumière d’un bleu profond épouse et caresse une armée de cuirasses, témoins muets, rappelant un monde de chevalerie que la légende même de Tristan met à mal, dont la variation des éclairages montre quelquefois, émergeant, trois ou quatre cuirasses qui figureraient ces témoins tapis. La cuirasse, un objet particulièrement identifiable, qui pourrait renvoyer à quelque concrétude, est ici elle aussi désincarnée, abstraite : les personnages circulent dans cet univers d’une manière géométrique et semblent émerger d’un champ (cela m’a fait penser en revoyant la scène, au magnifique champ de coquelicots du Prince Igor vu par Tcherniakov) comme si ces cuirasses n’étaient plus que des traces d’un monde jadis végétal, mais aujourd’hui métallisé d’où toute nature s’est envolée. La puissance de l’image est telle que le souvenir qu’on en a de Bayreuth et ce qu’on en voit sont ici presque congruentes.
On avait oublié un premier acte dont les espaces de jeu sont délimités par des rais de lumière et des taches de couleur, par des espaces géométriques seulement tracés par la lumière comme si les personnages étaient enfermés, certes, mais par des lois, des règles indistinctes et impossibles à figurer. Cette fixité, la manière aussi dont les personnages se meuvent, la lumière pâle d’un soleil qui n’ose être franc contribue à cette ambiance étrange, qui rappelle quelque chose du théâtre Nô (les costumes sont d’ailleurs du japonais Yohji Yamamoto). Les personnages sont-ils d’ailleurs des personnages, tant le jeu des ombres et des lumières nous empêche de les toucher, tant les mouvements sont contraints et limités, tant tout charnel est absent de cette vision, qui pourtant est bouleversante, parce que dans cette fixité, tout mouvement prend un relief immédiat. L’apparition de Tristan à l’acte II, dans l’ombre, côté jardin, semble être une apparition en transparence, par la subtilité des éclairages, et peu à peu la silhouette se précise et entre dans le champ.

Le lever de rideau à l’acte III est un moment magnifique « comme avant »: le rideau se lève très lentement, sur un univers uniformément gris, au sol jonché de gravats, au point que le fauteuil où gît Tristan semble être un rocher. Le costume de Tristan et de Kurwenal, les mêmes, mais l’un noir (Kurwenal) l’autre gris (Tristan) se fondent avec l’ensemble. On avait le souvenir de cette scène terrible, et elle surgit de nouveau, telle quelle, dans sa misère qui repend à la gorge. On a du mal à identifier les costumes à première vue, et de loin à Bayreuth ils n’apparaissaient pas avec cette précision, ce sont des redingotes déchirées (avec gilet et chemise) qui furent des « habits », et qui ne sont plus que haillons de ce qui fut : constat d’une déchéance qui ferait presque surgir les deux personnages d’un univers à la Beckett. Entre l’image noble des cuirasses de l’acte II, image d’ordre, image rangée, référencée, colorée et les gravats universels du III, il y a toute la béance du malheur.
Seule l’apparition d’Isolde va changer cet univers au final, d’abord revêtue d’un lourd manteau gris – encore – dont elle va recouvrir le cadavre de Tristan, puis d’une robe grise aussi, pendant la bataille finale où elle reste d’une fixité statufiée, comme déjà abstraite. Pour la Liebestod, le décor prend des couleurs dorées (magnifique impression du mur qui discrètement passe du gris à l’or), et Isolde se débarrasse de sa robe terrestre pour ne garder que sa robe dorée et céleste, éclairée, cérémonielle, qui brille au loin, couleur d’un soleil qui accueille les morts chez les égyptiens ou les incas, couleur d’une transfiguration finale dont on gardera longtemps l’image. Un deuil qui entre de plain-pied dans le mythe.
C’est bien ces univers à la fois différents et unifiés par la forme et les matières utilisées, et surtout par des éclairages qui déterminent complètement une ambiance, par leur imprécision (comme la différence entre peinture au dessin et peinture à la couleur) qui donnent unité à l’ensemble. Alors, on rentre peu à peu dans cet univers, très inhabituel, et qui propose un spectacle autre par la nature différente des deux salles, et semblable parce qu’il prend le spectateur à la gorge, comme il le prenait à Bayreuth.
L’autre gageure était d’oser une autre distribution, tant celle de Bayreuth avait marqué, avait incarné cette production. Il fallait oser une autre Isolde que celle mythique de Waltraud Meier, un autre Tristan et oser un autre chef. À la luxuriance, la tension dramatique, la couleur de Daniel Barenboim, succède le hiératisme de Hartmut Haenchen. Hiératisme parce que Haenchen comme pour son Elektra travaille la partition, sans y ajouter des intentions, mais laissant la musique dire ce qu’elle a à dire, en n’accélérant jamais le tempo, en veillant à une très grande clarté de la lecture, où l’on constate une fois de plus le travail approfondi mené avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, qui sonne comme rarement on l’a entendu. Cette fois-ci dans la fosse, car contrairement à ce qu’on pense, point n’est besoin d’un orchestre géant pour Tristan, l’acoustique relativement sèche de la salle correspond trait pour trait à la direction musicale. Une direction qui ne laisse pas échapper une note ni un instrument, qui soigne le fil continu, sans exagérer jamais les aspects dramatiques, mais sans jamais rendre l’œuvre plate ou uniforme (si l’on peut rendre plat un Tristan). Par rapport à Parsifal, Haenchen a peu dirigé Tristan et d’une certaine manière son approche est encore neuve, elle est au moins autre, et sans doute pour mon goût plus convaincante que son Parsifal (aussi bien à Paris qu’à Bayreuth d’ailleurs), dès le premier accord, celui si fameux, les choses sont en place et on comprend que ce sera une grande chose. Peut-être le moment le plus réussi, celui qui est le plus lacérant aussi est le prélude du troisième acte, tout à fait extraordinaire. Une chose est sûre en tous cas, Hartmut Haenchen a réussi à mener l’orchestre de l’Opéra de Lyon à des sommets, aux cordes extraordinaires, avec un son très maîtrisé, sans scories aucunes, et une remarquable précision. Un orchestre cristallin, limpide, d’une clarté qui fait contraste avec l’univers indécis de la scène, cet univers où les personnages évoluent sans se regarder, marchent comme des automates (Tristan au premier acte), dans un espace vide où les formes font lumière, et d’où résonne d’un son franc, net, et d’où émergent les merveilles de la partition. C’est ce système de correspondance baudelairienne, où les couleurs et les sons se répondent chacun dans leur ordre, qui fascine, comme si l’un alimentait l’autre en une ténébreuse et profonde unité.
Très différent de l’approche de Kirill Petrenko dans cette même salle, avec un orchestre qui a magnifiquement progressé grâce au travail de Kazushi Ono, Hartmut Haenchen propose donc un Tristan complètement convaincant parce qu’une fois de plus jamais narcissique, jamais sirupeux, préférant le Bauhaus à l’univers du Palais Garnier et n’invitant jamais l’auditeur à se rouler dans les volutes sonores et moirés d’un Wagner bourgeois à la Thielemann. Et il en sort un Tristan d’une grandeur simple, d’une infinie tristesse et d’une infinie lumière.
On attendait aussi la distribution, qui proposait l’Isolde et le Roi Marke de 2011, Ann Petersen et Christof Fischesser, et une prise de rôle dans Tristan, celle de Daniel Kirch, ainsi que dans Brangäne chantée par Eve-Maud Hubeaux, jeune et valeureuse chanteuse française dont on entendra parler. Une distribution qui a montré qu’il est inutile d’afficher les gloires du moment pour faire un bon Tristan.
Annoncée souffrante, Ann Petersen a donné un exemple à suivre de chant maîtrisé, jamais pris en défaut même si çà et là on sentait que la voix n’était pas au mieux de sa forme, mais sans jamais rater un aigu ou faire défaut de projection ou de couleur. Les difficultés d’ailleurs ne se notaient pas aux aigus, clairs, bien projetés, maîtrisés, mais plutôt à la ductilité dans les parties centrales. Peu importe au fond, tant elle a su donner au personnage son poids, avec l’avantage, pour ceux qui avaient déjà vu le spectacle à Bayreuth, ou même en vidéo, d’avoir physiquement certaines ressemblances avec Waltraud Meier… On est surtout admiratif du travail sur le texte effectué avec le chef, qui donne à son interprétation une grande profondeur et une très grande expressivité. Dans une mise en scène où le corps s’exprime a minima, tout le poids doit être donné par le dire : et chaque nuance, chaque intention est donnée, chaque mot est sculpté, dans un chant jamais hurlé, jamais excessif. Nul doute qu’Ann Petersen, qui propose une interprétation plus élaborée et encore plus approfondie qu’il y a six ans avec Kirill Petrenko, peut être considérée parmi les Isolde qui comptent, plus dignes d’intérêt que celles de certaines stars plus en vue parce que plus appuyées sur la couleur et le texte que sur la puissance vocale.
La distribution telle qu’elle a été constituée est contrastée, et peut-être moins homogène que ce à quoi l’Opéra de Lyon nous a accoutumés. Le choix de Daniel Kirch comme Tristan (une prise de rôle) pouvait se justifier car c’est un chanteur qui fait une honorable carrière en Allemagne ; je l’avais vu dans Die Meistersinger von Nürnberg à Karlsruhe et sa prestation était convaincante. Mais Walther n’est pas Tristan.
D’abord, se préparant sans doute au redoutable troisième acte, il semble être un peu inhibé dans les deux premiers, avec une voix moins projetée, qui provoque un décalage avec la voix d’Ann Petersen notamment pendant le duo du deuxième acte, et surtout sans vraiment colorer, sans vraiment interpréter ni travailler sur le texte, souvent monocorde et inexpressif. Certes il chante, sans scories, mais sans personnalité, d’une manière très grisâtre et sans grande imagination, malgré un joli timbre et un grain vocal intéressant.
Au troisième acte, la voix est indiscutablement mieux projetée, mais le long texte reste dit de manière plutôt plate, sans vrais accents, et presque un peu ennuyeuse. Je le souligne à nouveau : il ne fait pas de faute de chant particulière, mais il propose un chant sans particularité ni caractère, et c’est évidemment problématique dans une mise en scène où le dire est si important.
De plus Daniel Kirch manque un peu de cette tenue scénique, qui exige une raideur qui marque l’Isolde d’Ann Petersen, et qui marquait aussi jadis l’attitude de Siegfried Jerusalem, presque statufié. Ainsi donc, même scéniquement, notamment au premier acte, il semble mal s’insérer dans l’ambiance voulue par la mise en scène, mal se conformer à cette rigidité qui doit être le caractère de ce début.
Magnifique surprise en revanche la Brangäne d’Eve-Maud Hubeaux, jeune mezzo française née à Genève, à la voix vibrante, magnifiquement projetée, au timbre plutôt clair (qui lui permettra de chanter Eboli la saison prochaine sur la scène de Lyon) qui paraît au premier acte un peu hésitante, mais qui prend de l’assurance dans un magnifique deuxième acte. Le texte est dit avec grande précision, le volume est réel, mais jamais exagéré. Tout cela est bien contrôlé. Une chanteuse qu’on va suivre avec beaucoup d’intérêt.
Le Marke de Christof Fischesser est remarquable, qui travaille le texte avec une grande finesse et une grande intelligence, dont la voix jeune donne au personnage une couleur inattendue sur toute la tessiture. La prestation est aussi bien du point de vue de l’interprétation et de l’expression que du point de vue strictement musical un modèle de contrôle et de raffinement. Il me semble aujourd’hui encore supérieur qu’à Lyon lors de la dernière production de Tristan en 2011, où il était déjà un Marke notable. Il a moins chanté Marke que d’autres rôles (on l’a vu notamment en Pogner à Munich dans les derniers Meistersinger), mais nul doute qu’il va vite devenir un Marke de référence.
Alejandro Marco-Buhrmester, le Günther de Castorf, annoncé aussi souffrant, était Kurwenal. Certes, la voix n’avait peut-être pas face à l’orchestre la projection habituelle et l’artiste s’est un peu ménagé. Il reste que là où peut-être la force manquait – et encore-, l’intelligence du chant a suppléé car ce Kurwenal était très attentif à chaque mot : il faut saluer l’expressivité, notamment pendant le magnifique troisième acte où il est presque un double de Tristan, dans le même costume en haillons, partageant avec lui la misère et l’attente. La question du double qui se pose au troisième acte était d’ailleurs aussi centrale au premier acte, où à Brangäne/Isolde au premier plan, répondait dans l’ombre au fond de la scène Kurwenal/Tristan, aux attitudes similaires, accroupis au fond dos à dos tels un groupe sculpté d’une statuaire antiquisante. Alejandro Marco-Buhrmester est un artiste remarquable, doué d’une voix au timbre chaud, d’une émission impeccable et faisant toujours preuve d’un souci notable de la couleur. Malgré le refroidissement, la prestation fut à la hauteur de l’enjeu.
Thomas Piffka était Melot ; très souvent dans les distributions, le rôle est un peu sacrifié : c’est le méchant, le traître et il intervient au total de manière très limitée. Mais on sait que quelquefois ce type de rôle peut déparer une distribution par ailleurs construite et soignée. C’est ici ce qui se passe, où ce Melot à la voix grinçante, à la limite de la justesse, aux attaques hasardeuses et à l’expressivité inexistante gâche un peu l’ensemble par des interventions décalées (deuxième acte !). Autant la veille dans Aegisth cela pouvait passer, car Aegisth est un rôle de caractère auquel on peut donner une couleur vraiment caricaturale, autant dans Melot cela ne passe pas et on a vu la différence quand un Melot est vraiment bon (au TCE et à Rome par exemple, la saison dernière avec le Melot de Andrew Rees). En revanche, rien à redire des « petits » rôles, Patrick Grahl (ein Hirt, ein junger Seeman) et Paolo Stupenengo (qui appartient au chœur) dans le Steuermann.
Il reste qu’en dépit de quelques problèmes de distribution, tant le rendu de l’orchestre que la force de la production font de ce Tristan un très grand moment d’opéra avant que de nostalgie, et que l’opération, difficile est une réussite à porter au crédit de la magnifique idée de ce Festival.[wpsr_facebook]