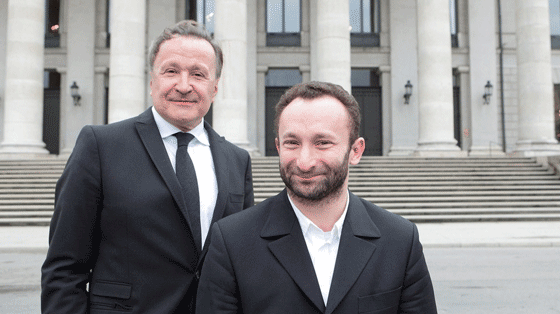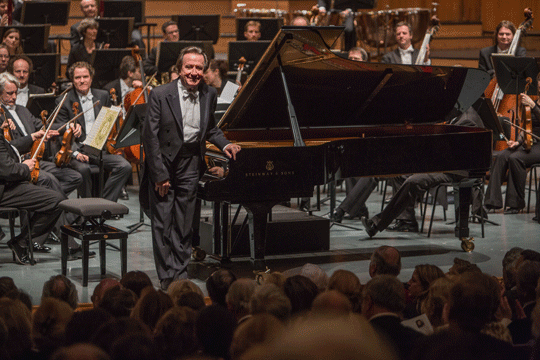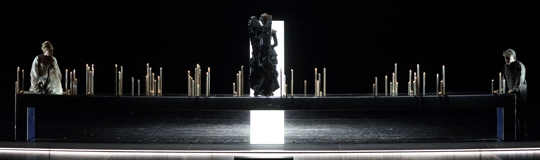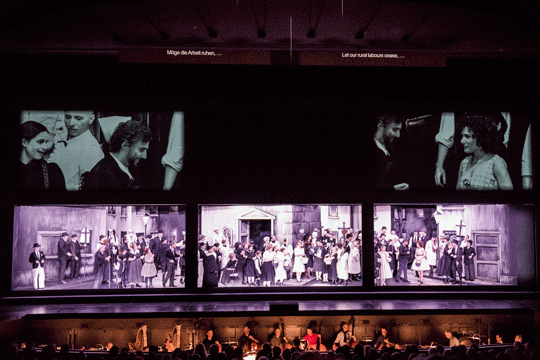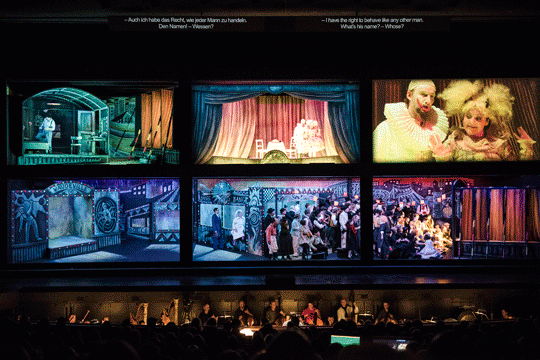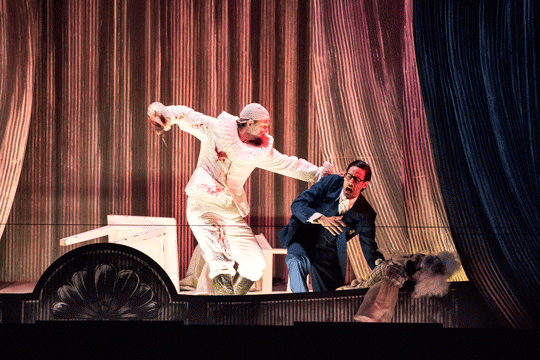Un festival né pour les épiphanies d’un dieu nommé Karajan
Dans l’univers des grands festivals européens, le Festival de Pâques de Salzbourg occupe une place très particulière due aux conditions de sa naissance, en 1967, à l’initiative d’Herbert von Karajan. Cette particularité est son lien indéfectible et quasi religieux à son créateur de 1967 à 1989. Le Festival de Pâques de Salzbourg était le lieu régulier des épiphanies du Dieu vivant qu’était Karajan à l’époque (les spectateurs plus jeunes ne peuvent imaginer ce qu’était Herbert von Karajan dans le monde musical de ces années-là et le culte dont il était l’objet). C’était aussi le Festival le plus exclusif qui soit, fondé sur l’adhésion à la « Förderung », sorte de ticket d’entrée qui garantissait le droit au Saint des saints. Sans la « Förderung » (droit au mécénat), point de salut pour le spectateur. Le festival vivait exclusivement de ses « sponsors », et jouait chaque année à guichets fermés, malgré des prix stratosphériques. En comparaison le festival d’été (pourtant dirigé par Karajan), c’était Carrefour par rapport à Fauchon.
Le deuxième argument d’exclusivité était l’Orchestre Philharmonique de Berlin, l’outil de Karajan, forgé à son image, l’orchestre chavirant, reconnaissable entre tous, capable de produire les sons les plus éthérés, les plus infimes, les plus charnus, les plus somptueux, qui jouait alors en salle exactement comme au disque.
Et en 1989, Karajan mourut.
Comme les institutions exclusivement appuyées sur le fondateur (cf le Lucerne Festival Orchestra aujourd’hui après la mort d’Abbado), l’Osterfestspiele Salzburg dut se réveiller d’un long rêve qui faisait croire que Dieu était éternel. Et pendant quelques années ce fut le brouillard où Sir Georg Solti, à l’époque considéré comme le second après Dieu (quand on pense comme Solti est aujourd’hui un peu oublié, on croit rêver) fut l’espace de deux saisons (1992-1993) le directeur artistique, puis, l’arrivée d’Abbado aux rênes des Berlinois stabilisa la situation en 1994. Abbado avait été élu en 1989, avait pris ses fonctions en 1991 et avait un peu assis sa direction avant d’arriver à Salzbourg .
Après la mort de Dieu

Et ainsi, même avec un Abbado, à l’époque moins adulé qu’aujourd’hui, et même contesté par les veufs et veuves Karajan, le Festival de Pâques de Salzbourg rentra dans une sorte de normalité. Il ne retrouva jamais son aura karajanesque, malgré le prestige et le charisme du chef italien, et malgré un bon nombre de mécènes notamment italiens (La Grappa Nonnino par exemple).
Ce qui ne changea pas, ce fut l’ordonnancement entre les week-ends des Rameaux et de Pâques :
- Un opéra
- Un concert choral
- Deux concerts symphoniques, dont un dirigé par un autre chef.
Ce qui changea en revanche, ce fut non le répertoire symphonique, classique et référentiel, mais plutôt le répertoire d’opéra, plus ouvert et l’appel à des metteurs en scène plus « modernes », Herbert Wernicke, Peter Stein, Klaus Michael Grüber par exemple, qui restaient la fine fleur de la mise en scène, avec des spectacles qui marquèrent comme le sublime Boris Godounov de Herbert Wernicke ou le Wozzeck de Peter Stein. Abbado encouragea aussi l’ouverture à d’autres formes, plus petites, comme les concerts « Kontrapunkte » où les berlinois se fragmentaient en autant de formations de chambre et une ambiance incontestablement un peu plus détendue.
Au départ d’Abbado, Sir Simon Rattle, nouveau directeur artistique et musical, ne changea pas grand-chose, sinon qu’il proposa des décennies après le Ring fondateur de Karajan, un nouveau Ring en coproduction avec Aix-en-Provence (MeS : Stéphane Braunschweig) qui ne resta pas trop dans les mémoires, notamment celles de la mise en scène.
Mais les évolutions, les changements de public, la disparition des chefs divo-charismatiques ont changé de loin en loin le modèle économique d’un festival né comme la propriété quasi-privée du chef fondateur et du public qui le suivait.
Peu à peu, il a fallu aller chercher le public, qui n’était plus captif, et ce n’était pas chose facile.
Abbado avait réussi à stabiliser un public fidèle et voué au chef italien, son départ provoqua une crise : Sir Simon Rattle n’était pas encore divinisé et les concerts perdaient leur caractère exclusif. Les choix des opéras et les distributions, pas toujours heureuses, firent aussi le reste. A part le Ring assez médiocre, de cette période, on garde le souvenir d’un beau Cosi fan Tutte, production de K.E et U. Herrmann avec Cecilia Bartoli.
Crise économique, crise d’identité, le festival de Pâques de Salzbourg avait perdu son caractère exclusif sans rien gagner de neuf ou de stimulant, il restait un rendez-vous mondain sans plus être un rendez-vous artistique qui valait le détour (c’est exactement ce qui frappe le Lucerne Festival Orchestra aujourd’hui : destins parallèles et pour les mêmes raisons).
La question économique ne tient pas aux concerts, mais aux opéras, qui coûtent cher et qui ne sont affichés que pour deux représentations : il faut donc trouver des coproducteurs.
Sous Karajan systématiquement et sous Abbado partiellement, le co-producteur naturel était à Salzbourg le Festival d’été, Festival consanguin dont la coproduction ne nécessitait aucun frais ni de transports ni d’adaptation : même lieu, même salle. Quant au metteur en scène, c’était Karajan soi-même la plupart du temps : dans cette communion musicale il était et le pain et le vin.
Déjà les choses devenaient plus âpres sous Abbado, avec Gérard Mortier, au goût arrêté, et pas forcément ami avec un Abbado qui s’en méfiait beaucoup, mais bon an mal an on s’en est sorti. Mais déjà Otello (production Paolo Olmi) fut coproduit avec Turin, Simon Boccanegra avec Vienne (où l’on peut encore voir la production de Peter Stein), Elektra (production Lev Dodine) avec Florence ; le festival de Pâques dut chercher des coproducteurs à l’extérieur de Salzbourg et cela se développa (ou pas) à l’époque de Sir Simon Rattle.
Une production d’opéra sans co-producteur à Sazlbourg (comme à Baden-Baden d’ailleurs) suppose que le Festival assume seul les frais, et donc souvent une production aux moyens limités est un spectacle un peu plus cheap.
Actuellement, sous le règne de Christian Thielemann, la solution est assez simple avec les coproductions avec la Semperoper de Dresde, dont le directeur musical est Christian Thielemann : ça aide.
Les crises

On aura compris que ce Festival dont les Intendants passent sans qu’on connaisse leur nom dépend en réalité du chef d’orchestre qui en est le directeur artistique; qui connaît dans le grand public Michael Dewitte (avec Abbado et Rattle), Peter Alward (avec Rattle et Thielemann), Peter Ruzicka (avec Thielemann). Pourtant, un scandale financier avec des malversations touchant l’intendant en titre en 2009-2010 éclata qui incite à changer la « gouvernance » de l’institution. Désormais, et c’est important à savoir, la Fondation Herbert von Karajan Osterfestspiele Salzburg (25 %), la ville de Salzbourg (20 %), le Land de Salzbourg (20 %), Salzburger Land Tourismus GmbH (l’office de tourisme) (20 %), Verein der Förderer der Osterfestspiele in Salzburg (l’association des mécènes) (15 %) se partagent la gouvernance du Festival et veillent à sa santé financières et aux retombées…
Toutes ces secousses firent que d’autres sirènes se profilèrent.
A Baden-Baden, il y avait plus d’argent, et après de multiples discussions, la décision tomba : les Berlinois, aux racines du festival de Pâques émigrèrent en Baden-Württemberg, au festival de Baden-Baden, dans son Festspielhaus à l’acoustique douteuse d’un hall de foire du luxe : les Berliner estimaient que les retombées financières étaient insuffisantes pour eux. Cette histoire de gros sous, où le Festival de Baden-Baden en la personne de son intendant Andreas Mölich Zebhauser faisait des offres plus alléchantes, aboutit au départ des Berliner pour Baden-Baden après le Festival 2012, et à l’arrivée de la prestigieuse Staatskapelle Dresden et de son chef Christian Thielemann en 2013. Ainsi donc ce Festival né pour dieu (Karajan) et ses prophètes (les Berliner) avait déjà perdu Dieu, et une vingtaine d’année après, perdait aussi ses prophètes en place depuis 1967. Il devenait un festival parmi d’autres, à un moment où les festivals de Pâques allaient en se multipliant: Salzbourg, Baden-Baden, Lucerne, Berlin, Aix-en-Provence…
L’ère Thielemann
L’arrivée de Thielemann, ex-assistant de Karajan, constitua un peu une filiation par la bande, mais rompit avec les habitudes, avec la crainte que le public du festival ne passe à l’ennemi, à Baden-Baden. Mais les deux institutions ne se ressemblent pas et Baden-Baden, le seul Festival où les places chères partent avant les places les plus abordables, n’a ni la même ambiance, ni le même public : il n’y a pas de grosse fuite des spectateurs. Et le comportement des Berlinois froissa ce public habitudinaire et ritualisé: le passage à Pâques à Salzbourg était en effet une sorte de rite.
Mais d’un côté comme de l’autre aucune des deux entités désormais rivales ne réussit à imposer sur le plan médiatique et artistique une image forte, d’un côté comme de l’autre les productions, certes de grande qualité musicales, ne sont vraiment convaincantes comme devraient l’être des productions de tels Festivals, avec leur côté exclusif. Et puis, le public capable de payer plus de 400 € une place d’orchestre n’est pas extensible à l’infini.
Bref, ni Salzbourg, ni Baden-Baden ne peuvent aujourd’hui se vanter de résultats mirobolants. Et après cinq ans, on commence à évaluer les résultats de ces changements.

Or, entre 2020 et 2021 se pose dans de multiples institutions la question de la succession : Munich va changer de mains et passer de Bachler-Petrenko à Dorny-Vl.Jurowski, Vienne change de mains et écarte Dominique Meyer pour Bogdan Roscic. Paris change de mains sans qu’on sache encore dans quelles mains il va tomber, la Scala aussi devrait changer d’intendant en 2020 et à cette grande valse s’ajoute le Festival de Pâques de Salzbourg qui voit le départ de son intendant actuel Peter Ruzicka à qui l’on doit l’ajout annuel d’un opéra contemporain de chambre, une initiative très heureuse. Quant à Christian Thielemann, on ne sait s’il prolongera son contrat avec Dresde.
Dresden et après…
Le festival de Pâques de Salzbourg est donc à la croisée des chemins (ce n’est pas moi qui l’écrit c’est le journal salzbourgeois Salzburger Nachrichten), car si le petit monde musical bruisse de la succession de Ruzicka à Salzbourg, c’est que se profile l’arrivée de l’autrichien Nikolaus Bachler, actuel intendant à Munich. Sa personnalité, son passé aussi bien à Munich qu’à Vienne en font une personnalité forte du monde musical germanique. Et avec lui à Pâques, et Hinterhäuser à Salzbourg-Eté le management redeviendrait tout autrichien.
Mais si l’on s’intéresse autant à cette succession, (qui s’est ému de l’arrivé de Alward, ou de Ruzicka par le passé ?) c’est que derrière Bachler, à Salzbourg-Pâques, il faut un chef : c’est en effet le chef (et l’orchestre qu’il représente) qui fait le Festival de Pâques, lui seul compte et c’est la gloire musicale de Christian Thielemann qui a maintenu le public à Salzbourg. Or tout le monde sait que l’arrivée de Bachler, c’est avoir par derrière la possibilité de l’île Petrenko, néo directeur musical et artistique des Berliner en 2019. Comme de son côté Mölich-Zebhauser part en 2019 de Baden-Baden remplacé par Benedikt Stampa, l’intendant très apprécié du Konzerthaus de Dortmund, les cartes peuvent être rebattues.
Il est évident qu’en appelant Bachler, le conseil de surveillance du festival de Pâques de Salzbourg espère dans un futur proche un éventuel retour à Salzbourg des Berliner, dont bien des membres n’étaient pas favorables au transfert, ce qui serait une relance médiatique en grand style, parce que dans les valises arriverait Kirill Petrenko, pour un nouveau tandem Bachler-Petrenko. Kirill Petrenko a sans nul doute le charisme musical suffisant pour drainer de nouveau à Salzbourg les mécènes et les trompettes de la renommée qui vont avec.
Mais ni Thielemann, ni la Staatskapelle Dresden, ni Baden-Baden (qui ne laissera pas filer la poule aux œufs d’or aussi facilement) n’ont dit leurs derniers mots. Mais un couple Bachler – Thielemann suscite de nombreux doutes. On connaît de plus la manière dont Bachler a poussé Nagano dehors à Munich pour imposer Petrenko. Bachler, est-ce la naganisation programmée de Thielemann ?
Ce qui se profile est donc un combat qui doit impliquer les financiers, les mécènes, les politiques, avec un jeu subtil sur les échéances des contrats des uns et des autres: si Bachler, comme tout le monde le dit, est le successeur de Ruzicka au Festival de Pâques de Salzbourg, un avis de grand frais à tous les niveaux se profile.