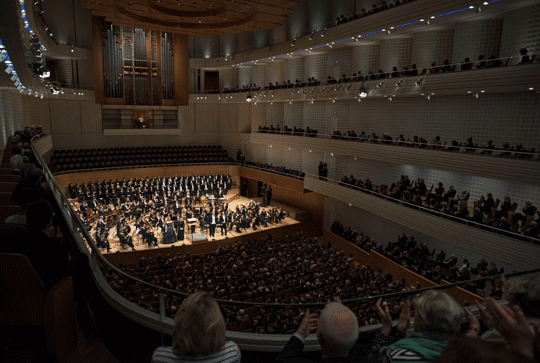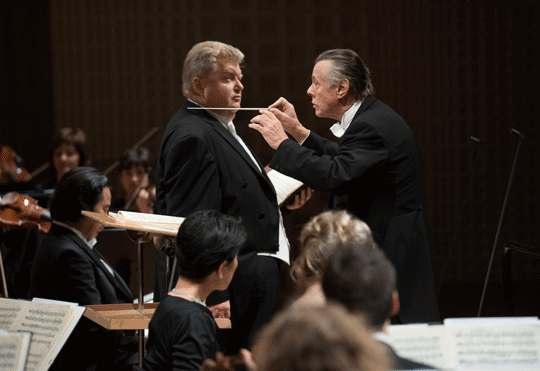10 ans que MET HD existe. C’est sans doute le succès le plus marquant de Peter Gelb puisque l’idée a essaimé dans la plupart des grands théâtres, même si seul le MET a vraiment une saison structurée de projections en direct ou en léger différé. Dans une ville comme Grenoble, avec une vraie tradition théâtrale et chorégraphique, mais sans tradition d’opéra et sans opéra digne de ce nom depuis que Minkowski a quitté le navire, les projections du MET sont les seules possibilités, à moins de parcourir les 100 km qui séparent de Lyon.
Pourtant, le MET a des problèmes de remplissage, de répertoire et de public, plus que d’autres théâtres comparables. Peter Gelb a des difficultés à renouveler un public vieillissant, malgré ses efforts (même s’ils sont localement critiqués) pour rajeunir les productions et ouvrir vers un théâtre moins traditionnel ou poussiéreux. Que les deux dernières productions de Patrice Chéreau, De la maison des morts et Elektra aient été proposées sur la scène du MET est un signe notable d’évolution. On verra prochainement l’effet de la production Trelinski (Baden-Baden) du Tristan und Isolde auprès du public.
Elektra de Chéreau est la production devenue son testament artistique: elle a tourné à Aix, à la Scala, au MET, et s’apprête à gagner Helsinki, Berlin et Barcelone. Partout, elle « tourne » avec l’essentiel des participants à la production originale d’Aix. À New York, consommateur de grands noms, c’est Nina Stemme qui a repris le rôle créé par Evelyn Herlitzius, pratiquement inconnue du public américain.
Patrice Chéreau, je l’ai écrit souvent, détestait ne pas être associé à une reprise de ses spectacles et avait l’habitude d’assister plus ou moins à toutes les représentations. Il ne fait pas de doute qu’il aurait longuement travaillé avec Nina Stemme pour cette reprise et que le seul fait que Nina Stemme ait embrassé la production sans jamais avoir travaillé avec Patrice Chéreau est contradictoire avec ce qui était la philosophie même de son travail théâtral. Mais le destin et les exigences des coproductions ont fait le reste. Même si la production a été reprise dans ses détails, même si il en existe une vidéo d’Aix, rien ne pourrait remplacer le travail avec le metteur en scène, dont on sait quelles impressions et quelles traces il laissait auprès des artistes qui travaillaient avec lui. Le physique, les gestes, le visage même de Nina Stemme n’ont rien à voir avec ce qu’est et ce que fait Herlitzius; Chéreau, j’en suis intimement persuadé, aurait adapté et changé bien des moments, pour coller au mieux à la personnalité de la chanteuse. C’est ce qu’a tenté Vincent Huguet chargé de reprendre la mise en scène après avoir assisté Chéreau à Aix, avec une équipe partiellement renouvelée.
J’ai longuement rendu compte de ce spectacle en son temps (Je renvoie le lecteur aux comptes rendus de Aix et Milan) et il est évidemment hors de question de revenir en détails sur ce travail ; par ailleurs, une vision sur grand écran, même en direct, ne saurait remplacer l’expérience de spectateur en salle, Néanmoins, il y a suffisamment « d’indices » pour tenter d’émettre une opinion qui pour n’être que partielle, s’efforce de rendre justice au spectacle magnifique du MET.
Car c’est un magnifique spectacle et la production reste fascinante à bien des égards. Le premier point c’est que – et c’était déjà vrai à Aix – c’est une production de pur théâtre et de pure « Personenregie » : il y a un incroyable travail sur les personnages et sur les ambiances, aidé en cela par les éclairages de Dominique Bruguière et le décor à la fois épuré et varié de Richard Peduzzi, un espace tragique avec ses deux niveaux (Appia…), celui d’Elektra et celui de la Reine comme un second espace théâtral . De fait, Elektra ne piétine cet espace qu’à la mort de Clytemnestre, dont le royal cadavre occupe la scène en son centre de gravité alors que celui d’Egisthe gît au niveau « bas », des médiocres ou des chiens…(amusant d’ailleurs comment la traduction des sous titres atténue la portée du texte original en plusieurs points, traduisant notamment « chiens » par « les plus humbles »). Quand Clytemnestre descend au niveau d’Elektra, cela prend évidemment tout son sens; quant au niveau d’Elektra, il est le sol et le sous sol, le sol et la terre, monde humain et monde des morts…
Chéreau créé une ambiance aussi en multipliant les personnages muets ou secondaires : la première scène avec son bruit de balai obsessionnel, les moments où les autres comme un chœur muet, regardent les affrontements sont essentiels pour créer une atmosphère : cette « technique » rend très lourde l’ambiance, car elle se reflète sur les autres, sur leurs gestes, sur leur manière de se cacher dans l’ombre ou d’être rejetés le long des murs, et c’est à eux qu’on mesure le degré de tension. Chéreau l’avait d’ailleurs utilisée dans Die Walküre à Bayreuth lors de l’entrée de Hunding accompagné de sa « meute » de compagnons, qui immédiatement isolait Siegmund et Sieglinde. Cela suppose aussi qu’un travail très précis a été effectué sur chaque personnage, même muet, sur chaque servante, dans une sorte de chorégraphie de second plan jouant avec les ombres et lumières qui donne la mesure de la profondeur du travail théâtral effectué. En effet, rien n’est laissé au hasard dans le travail de Chéreau dans la mesure où chaque personnage fait partie du projet global et contribue à la construction de l’œuvre, il n’y a ni hasard, ni éléments négligés en scène. En 2013, voire en 2016, on peut encore faire un théâtre total qui ne soit « que » théâtre, rien que théâtre, mais tout le théâtre, avec ses trois murs et son quatrième, sans les technologies du jour. Rassurant.

Mais bien évidemment, ce sont d’abord les trois personnages centraux qui intéressent. La prise de vue permet de se concentrer sur les visages et sur des détails de jeu que l’on peut difficilement remarquer dans une salle aussi vaste que le MET, mais qui pouvaient aussi échapper à la Scala ou même à Aix. La Chrysothémis d’Adrianne Pieczonka qui n’a rien à voir avec l’incroyable Rysanek à Paris avec Böhm en 1974 et 1975, mais aussi ailleurs, fait preuve ici d’un engagement et d’une humanité confondantes. Bien plus à l’aise qu’à Aix, et aussi présente, émouvante, bouleversante qu’à la Scala, Pieczonka désormais domine tout le rôle, où elle est époustouflante notamment dans les derniers moments. Il faut évidemment jouer la différence avec Elektra, différence de style et de personnage, différence vocale aussi, avec plus de lyrisme et de jeunesse. Entre Nilsson et Rysanek, c’était un combat de monstres, inoubliables, mais elles étaient (presque) interchangeables, et d’ailleurs, Rysanek fut – une fois, au cinéma- Elektra avec le même Böhm. Ici les deux voix sont différentes, moins sans doute entre Stemme et Pieczonka qu’avec Herlitzius à l’organe plus métallique et un peu déglingué (!). Il reste que Pieczonka est vraiment magnifique, tendue, et qu’elle joue de son corps et de son visage avec une précision telle qu’on voit qu’elle a travaillé depuis le départ avec Chéreau.

Waltraud Meier est dans ce rôle simplement incroyable. Celui qui affirmerait (il y en a…) qu’elle n’est pas une Clytemnestre me fait sourire, sinon rire aux éclats. Elle est une Clytemnestre particulière, comme l’a voulue Chéreau, une femme et pas un monstre, avec ses angoisses, son humanité (oui, elle ! maman Atride, elle est humanité), elle exprime tout, parole après parole, une parole mâchée, distillée, pesée et soupesée, avec des regards d’une indulgence lisible envers sa fille, et en même temps, la crainte, la tension : alors oui, elle n’est jamais extérieure, ce n’est pas la Clytemnestre expressionniste digne d’un tableau de Munch, c’est une Clytemnestre royale, mais hésitante, mais apeurée, – et donc dangereuse -, une mère qui hésite entre distance et affection (voir comme elle caresse les cheveux d’electra !) et une chanteuse dans la pleine possession de ses moyens vocaux, sans une scorie, sans une hésitation, sans un blanc dans la ligne de chant ; simplement un chef d’œuvre, qui sans doute ne serait pas ce personnage-là sans l’osmose profonde et vivante avec le travail de Chéreau, mais Waltraud Meier a un sens inné du théâtre et de la parole, ainsi que de la force d’un corps posé sur une scène. Un personnage unique.

Nina Stemme était Elektra. Vocalement, il n’y a rien a reprocher à cette voix franche, ronde, à l’étendue incroyable, et que la stimulation du jeu entraîne vers des sommets qu’on ne lui connaissait pas, vocalement plus que convaincant. Est-ce pour autant une Elektra ? J’avoue nourrir non des doutes (ce serait ridicule) mais des réserves par rapport aux Elektra aimées (Behrens, Jones, Nilsson). J’ai écouté avec attention, j’ai été impressionné par certains mouvements et certains moments de climax, mais jamais ni secoué ni ému. D’abord, et là, on voit que Chéreau manque, ses expressions de visage, regardant dans le lointain, tendues sont répétitives au point qu’on se demande si, Chéreau ou pas, elle ne propose pas le même personnage interchangeable à toutes ses Elektra. Ensuite, elle est sans conteste plus distante, moins prête corporellement à tout comme pouvait l’être une Herlitzius. Son rapport à Clytemnestre est moins charnel, moins affectif, moins fusionnel parfois, ses échanges avec Chrysothémis moins physiques. Elle joue très bien, elle chante magnifiquement mais elle n’est pas une incarnation, comme pouvaient l’être ses deux autres collègues. La personnalité est tellement différente de celle d’Herlitzius qu’il faut vraiment créer pour elle des mouvements nouveaux, parce qu’elle est plus froide et plus perceptiblement réservée, Herlitzius livrait ses tripes et tout son corps au service de l’incarnation, elle chantait, hurlait, grinçait, dans une folie étourdissante. Stemme est moins « tripale ». Si je rassemble mes souvenirs, Nilsson jouait bien plus qu’on ne croit, elle savait avoir des gestes, des mouvements, une émotion qui accompagnaient son incroyable voix dont nul disque ne saura rendre compte. Behrens avait une réserve plus grande, mais avec une puissance intérieure que Stemme n’a pas, tant on la sent « jouer » et non « être ». Son chant est exceptionnel, mais dans Elektra, il faut aller tout le temps au-delà des notes et au-delà du chant.
Et puis il y avait autour de ces trois monstres un entourage sensiblement modifié. On a retrouvé avec plaisir et émotion la 5ème servante-nourrice de Roberta Alexander, merveilleuse d’humanité par les gestes, par l’allure, par la simplicité bouleversante. Orest n’est plus ni l’immense René Pape, ni la figure de jeunesse qu’était Mikhail Petrenko, mais une sorte de figure de l’Autre, de celui qui veut rester extérieur à cette famille, et en ce sens, un Orest noir et son serviteur noir servent cette altérité dans ce monde monstrueux mais uniforme.

On comprend de suite qu’Orest ne pourra rester dans cette ambiance étouffante et fermée, simplement parce qu’il n’est plus de ce monde-là et qu’il ne veut pas y appartenir. Mais ce qui frappe chez Eric Owens, outre la voix de basse somptueuse qui en fait sans doute le meilleur Alberich d’aujourd’hui, c’est l’incroyable émotion qu’il diffuse, notamment par les gestes hésitants, par les regards furtifs et indulgents, par une infinie tendresse, visible, qui contraste avec le « devoir » meurtrier qui l’appelle. La scène avec Elektra est grâce à lui, grâce à cette sorte de gaucherie qu’il affiche, l’une des plus belles et des plus sensibles qu’il m’ait été donné de voir. Un grand Orest.
J’ai un peu plus de réserves sur l’Aegisth de Burkhard Ulrich, qui articule et dit très bien le texte, mais qui n’a peut-être pas la couleur voulue, pour un rôle court mais où un ténor de caractère doit dessiner en peu de mots le pouvoir, la méchanceté et la veulerie. Il est presque trop bien, cet Aegisth!
Pas de remarques particulières pour les rôles de complément sinon qu’évidemment on regrette les ombres du passé que sont Mazura et Mac Intyre, mais on ne peut tout avoir. On reverra Franz Mazura cet automne à Berlin.
Esa Pekka Salonen était à la tête du bel orchestre du MET. Sans avoir toujours la tension nerveuse que savait imposer un Karl Böhm à cette partition, qui reste pour moi un absolu, totalement incomparable à quiconque, même à Abbado qui signa de grandes Elektra des trente dernières années (à Vienne, Salzbourg, Florence), Esa Pekka Salonen a la précision, la clarté qui révèle la construction instrumentale, bien sûr tirant vers la seconde école de Vienne, mais pas seulement : il y a des moments où l’instrument est seul, au milieu du silence, qui sont particulièrement marquants. Enfin, le chef a travaillé avec Chéreau et connaît la pulsation de la mise en scène et son rythme, auquel il colle. Grand moment musical, même si le son, émergeant seulement de l’écran, manquait du relief qu’il a habituellement dans ce type de projection, et donc qu’on ne put profiter pleinement de cet orchestre.
Cette projection confirme la force d’une production qui reste en dépit des modifications de cast, un emblème de ce que doit être un travail de théâtre à l’opéra. Que la mort qui est passée par là ait fixé pour toujours ce spectacle comme LE spectacle-marque de Chéreau, c’est évidemment un effet hélas « médiatique » qui va permettre de gloser longtemps dessus. Il reste que ce spectacle, par sa perfection-même et sa puissance évocatoire et émotive, marque la fin d’un type d’approche au-delà de laquelle on ne peut aller et donne la mesure de l’infinie médiocrité de certaines autres productions.
Que l’Elektra de Chéreau fasse le tour de la terre, et soit en même temps et théâtre et mémoire, est sans doute une chance, cela montre ce que Chéreau fut, et la puissance de ses spectacles par delà la vie et la mort.
Patrice…Patrice, wo bist du ? [wpsr_facebook]