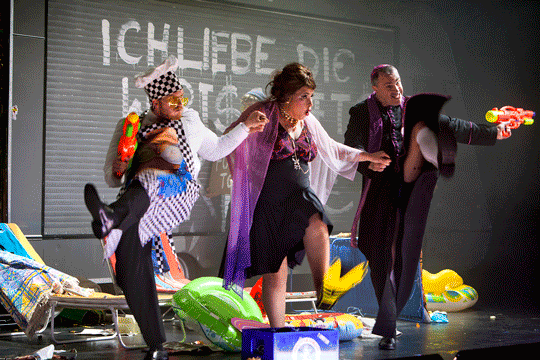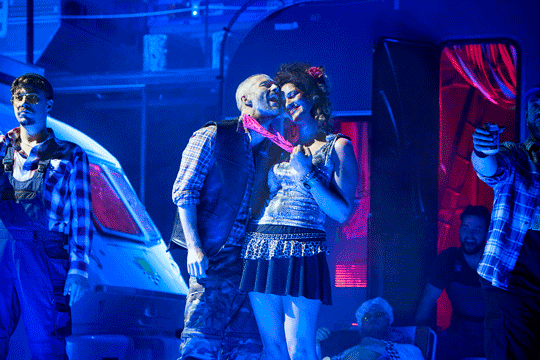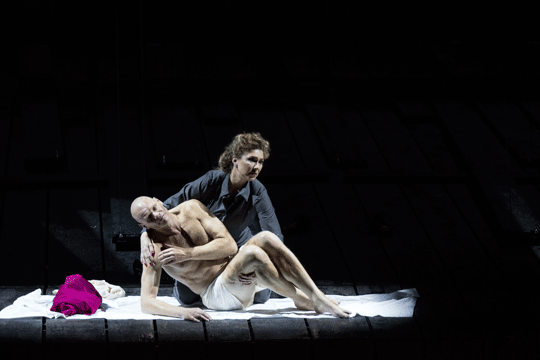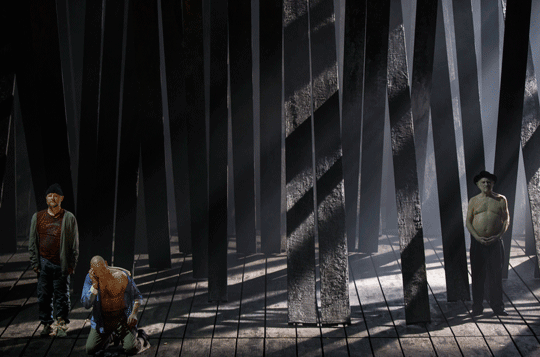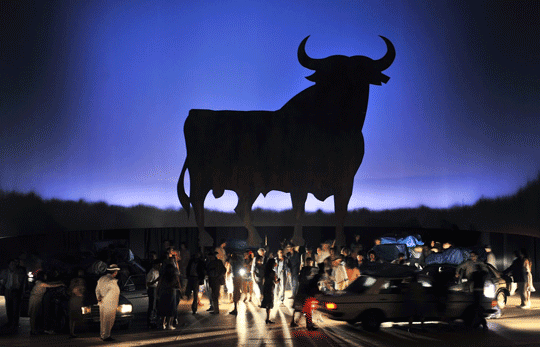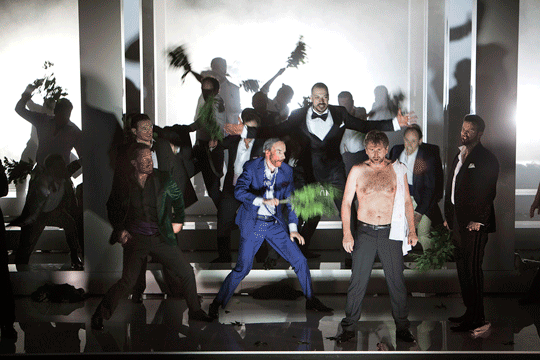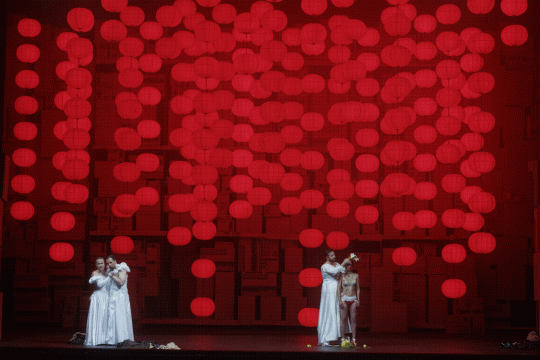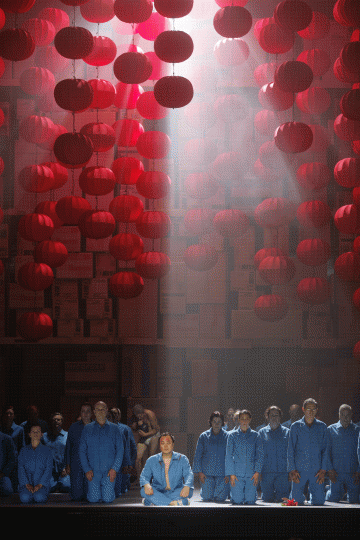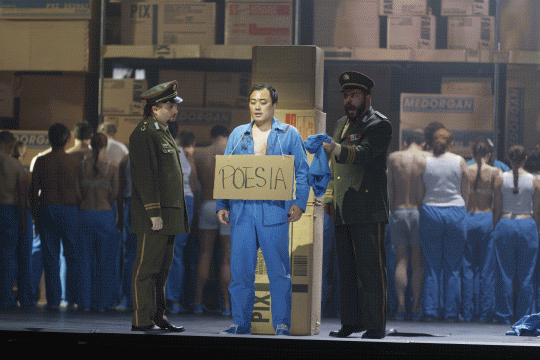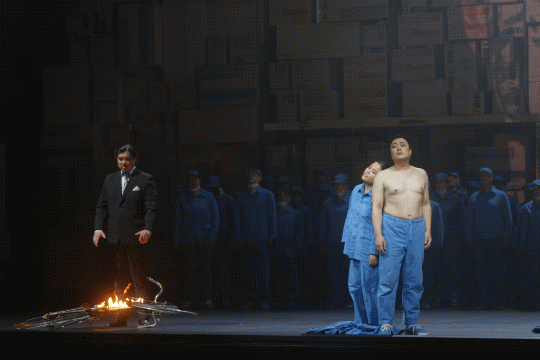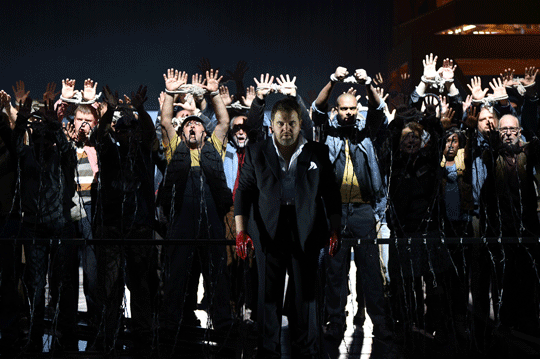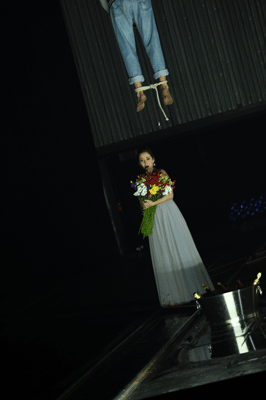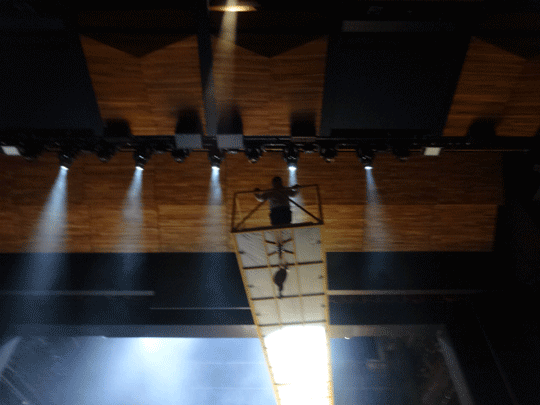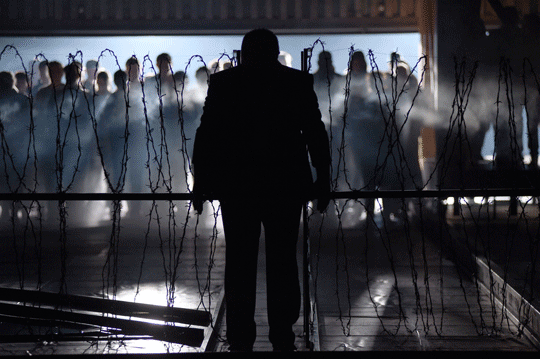La réflexion sur l’avenir à plus long terme de notre plus grande scène nationale ne doit pas cacher le regard sur le futur immédiat de la programmation. Le programme est paru depuis plusieurs mois, et notre regard est aujourd’hui moins sensible à la surprise et aux feux des réactions immédiates en bien comme en mal.
La réflexion sur l’avenir à plus long terme de notre plus grande scène nationale ne doit pas cacher le regard sur le futur immédiat de la programmation. Le programme est paru depuis plusieurs mois, et notre regard est aujourd’hui moins sensible à la surprise et aux feux des réactions immédiates en bien comme en mal.
Au préalable, il me semble important de (re) poser un certain nombre de principes qui doivent gouverner la programmation de notre Opéra national.
L’Opéra de Paris, c’est deux salles qui sont chacune des grandes salles d’opéra : la seule jauge de Garnier est équivalente à la jauge de Covent Garden, la Scala, Vienne, Bolchoi et Munich. Le MET est la seule salle avec ses 3800 places qui dépasse largement cette jauge, avec les problèmes de remplissage que l’on sait actuellement.
Mais Paris a en plus une salle de 2700 places (Bastille) à remplir, c’est à peu près chaque soir en tout 4700 places à offrir, ce qui implique évidemment des dispositions de programmation particulières. On ne peut faire salle(s) pleine(s) chaque soir, et Jonas Kaufmann ne chante pas tous les jours…
Malgré toutes les critiques, c’est tout de même un exploit (quand on regarde les problèmes de remplissage d’autres salles européennes à commencer par la Scala) de remplir deux salles géantes. C’est en effet toujours un étonnement de ma part que Garnier soir considéré comme la « petite » salle, où l’on fait du ballet, quelques Mozart et du baroque, alors que la critique dans les années soixante-dix hurlait quand Liebermann programmait Così fan Tutte à Garnier (même avec Josef Krips en fosse) parce qu’une œuvre aussi intime allait être noyée dans ce grand vaisseau.
On ne peut programmer chaque soir Traviata, Bohème ou Le Lac des cygnes : l’opéra de Paris, comme grande institution publique est censée offrir au public une vision diversifiée du répertoire, modulant entre contemporain, classique, entre grosses machines et pièces intimes, entre mises en scènes « classiques » et « modernes », (j’emploie ces mots à regret parce qu’il n’y a que des mises en scènes bonnes ou mauvaises, mais ils traduisent la pensée de nombreux spectateurs) entre stars et moins stars, entre œuvres connues et moins connues. Autrement dit, tout et son contraire.
Ainsi les Directeurs généraux donnent un flanc facile aux critiques, parce qu’ils doivent naviguer (quels qu’ils soient) entre tous ces écueils.
Or si la Scala pourrait se contenter d’une douzaine de productions lyriques annuelles parce que c’est ce que son public très local peut supporter (elle en affiche quand même 15), Paris doit afficher au bas mot au moins une vingtaine de productions lyriques annuelles (20 exactement en 2018-2019) et les productions du ballet, mais ces dernières sont moins coûteuses puisque le ballet est géré par un système de troupe, alors que le lyrique est géré par le système stagione, dont les coûts de production sont plus élevés, évidemment.
Vingt-quatre productions annuelles, cela veut dire alchimie délicate entre tous les éléments rappelés plus haut, cela veut dire aussi quelquefois des distributions au kilo (plusieurs centaines de rôles à distribuer), cela signifie une alternance entre opéras avec chœur et opéra sans (ou avec peu de) chœur, pour permettre aux artistes des chœurs de travailler sans pression et en profondeur, de même pour l’orchestre qui doit avoir le temps d’étudier les œuvres nouvelles qui entrent au répertoire ou qui en avaient disparu depuis belle lurette (Les Huguenots par exemple).
Or le système stagione auquel le public est habitué, exige son lot de nouveautés qui vont faire courir les foules, ce qui coûte le plus cher. Dans un système de répertoire, les nouveautés sont au nombre de 5 ou 6 par saison, mais à côté on peut puiser et reprendre avec des distributions variées jusqu’à 40 (à Munich) ou 50 productions (à Vienne) .
La reprise en système stagione doit être limitée (la Scala par exemple qui affiche peu de reprises traditionnellement, 4 pour la saison 2018-2019), motivée (titre pas affiché depuis longtemps, titre rare mais existant dans les réserves, ou titre alimentaire tiroir-caisse comme Bohème). Pour l’Opéra-Bastille, par le nombre même de représentations annuelles, la reprise (au ballet comme à l’opéra) est ce qui fait fonds de commerce et il faut saluer le travail d’Hugues Gall qui a eu pour objectif, tout au long de ses neuf années d’exercice, de constituer ce matelas de sécurité d’œuvres de répertoire qui vont permettre de reprendre des titres populaires, de reprendre des mises en scène de réserve suite à des échecs de nouvelles productions, bref de donner de la souplesse au système pour (normalement) limiter les coûts. Il reste qu’on a tourné le problème dans tous les sens et depuis longtemps à Paris comme ailleurs, énarques ou pas énarques, l’opéra est un art qui coûte cher, qui a toujours coûté cher depuis ses origines, et qui vit sur grand pied pour satisfaire le public. L’idée de réduire les coûts à l’opéra fait rire les poules comme disent les italiens, et déjà rentrer dans le budget imparti sans gabegie est un minimum dont on devrait se contenter. Et Paris coûte d’autant plus cher qu’il y deux salles importantes, à la technicité très différente et aux coûts de manutention et de maintenance importants, matériellement et humainement. Ce sont des données de départ qu’il faut accepter.
Dans ce cadre, la programmation de l’opéra de Paris en 2018-2019 affiche 20 titres (même si son programme annonce des titres de la saison 2019-2020), ce qui est déjà important (le MET en affichera 26 et Covent Garden 19) dont 7 nouvelles productions in loco et une à l’extérieur (MC93) et donc 12 reprises. C’est en outre la saison des 350 ans de l’Opéra (fondé en 1669 comme Académie Royale de Musique) : on se souvient que l’Opéra de Paris a une histoire, quelle surprise !
Tristan und Isolde (Wagner)
Reprise de la production de Peter Sellars, dont on connaît la qualité, production devnue culte, dirigée par Philippe Jordan avec Andreas Schager (Excellent choix) et Martine Serafin (moins intéressante), René Pape (Marke) et Matthias Goerne (Kurwenal). Pas de quoi se plaindre. (9 repr. du 11 sept au 9 oct à Bastille)
Les Huguenots (Meyerbeer) (NP)
L’opéra de Paris se souvient de son répertoire, Les Huguenots ayant fait les beaux jours de la maison pendant un siècle environ. La relative Meyerbeer renaissance (née en Allemagne) profite à Paris, qui depuis les années 80 n’a affiché que Robert le Diable (saison 1985-1985). La mise en scène est confiée à Andreas Kriegenburg (Le Ring de Munich, Die Soldaten à Munich Lady Macbeth de Mzensk à Salzbourg) qui met en scène pour la première fois à Paris, et la direction musicale à Michele Mariotti (sauf le 24 oct. Łukasz Borowicz) qui a triomphé à Berlin dans la même œuvre, très à l’aise dans ce répertoire. La riche distribution est conduite par Diana Damrau et Brian Hymel, et on trouve aussi Ermonela Jaho et Karine Deshayes, ainsi que ce que le chant français produit de mieux, Nisolas Testé, Cyrille Dubois, Florian Sempey et bien d‘autres. Pour son retour à Paris, il était temps, l’œuvre est bien défendue. Optimisme. 10 repr. Du 24 sept au 24 oct à Bastille
Bérénice (Jarrell) (NP)
Création mondiale de Michael Jarrell qui a écrit aussi le livret d’après Racine, au Palais Garnier, avec une distribution soignée comprenant Bo Skovhus, Barbara Hannigan Florian Boesch, Alastair Miles et Julien Behr le jeune ténor français sous la direction de Philippe Jordan, et dans une mise en scène de Claus Guth. Sur le papier, c’est remarquable, comme souvent les Premières mondiales…reste à savoir si des reprises sont programmées…8 repr. du 26 septembre au 17 octobre à Garnier.
La Traviata (Verdi)
Reprise pour la dernière fois de la production Benoît Jacquot (puisqu’est prévue dès sept.2019 une nouvelle production confiée à Simon Stone) sous la direction du jeune Giacomo Sagripanti, bien aimé à Paris (sept.oct) et de Karel Mark Chichon, qu’on voit beaucoup en Allemagne et peu en France (déc.) avec trois ténors qui rempliront sans problème la salle, Roberto Alagna, Jean-François Borras et Charles Castronovo, deux sopranos qui auront le même effet sur la fréquentation Alexandra Kurzak (sept.oct) et Ermonela Jaho (décembre), et trois barytons en grande carrière Georges Gagnidze, jusqu’au 17 octobre (moui pour ma part), Luca Salsi (4 représentations en octobre) et Ludovic Tézier qui remplira les salles en décembre. 17 représentations en sept., oct., et décembre à Bastille. C’est la série tiroir-caisse, – il faut sans doute compenser Bérénice pendant la même période – mais le spectateur n’est pas méprisé, les distributions prévues sont très attirantes.
L’Elisir d’amore (Donizetti)
Autre série de représentations qui devraient attirer le spectateur, l’œuvre de Donizetti reprise dans la mise en scène de Laurent Pelly (2006) pour la sixième saison, une opération économiquement rentable. Distribution dominée par Vittorio Grigolo (Paolo Fanale le 10 novembre ce qui est une très belle alternative) et Lisette Oropesa alternant fin novembre avec Valentina Naforniţă et complétée par Etienne Dupuis et Gabriele Viviani. Le tout dirigé par Giacomo Sagripanti cumulant ainsi Traviata et Elisir, soit une vingtaine de représentations. 10 repr. Du 25 oct. au 25 nov à Bastille.
Simon Boccanegra (Verdi) (NP)
Depuis les représentations de la production de Giorgio Strehler dans les saisons 1978 et 1979, c’est la quatrième production du chef d’œuvre de Verdi. Outre Strehler, au paradis des productions, Nicolas Brieger repris trois fois, et Johan Simons appelé par Mortier, avec des décors de Bert Neumann, qui n’a connu que la série de 10 représentations en 2006. Depuis, pas de nouvelle production. Une reprise de la production assez radicale et ironique de Johan Simons n’aurait sans doute pas plu au public parisien et Lissner opte pour une nouvelle production confiée à Calixto Bieito. Certains diront « pas mieux »…mais Bieito s’est assagi notamment à Paris…
La distribution est évidemment dominée par Ludovic Tézier qui brillera dans un rôle fait pour lui, Amelia étant chanté par Maria Agresta dont les prestations n’ont pas toujours convaincu alternant pour deux représentations avec Anita Hartig (1 et 4 décembre). Mika Kares sera Fiesco, une des voix émergentes ces dernières années (les curieux pourront l’entendre dans Ferrando de Trovatore en début d’été 2018) et Francesco Demuro sera Gabriele, pendant que Paolo Albiani le traître sera Nicola Alaimo. Un cast qui à part Tézier n’est pas totalement convaincant. Mais au pupitre montera Fabio Luisi, qui est une garantie à la fois idiomatique et technique. A voir de toute manière. 10 repr. du 12 novembre au 13 décembre à Bastille .
La Cenerentola (Rossini)
Pour dix représentations entre le 23 novembre et le 26 décembre, à Garnier, l’Opéra trouve un de ses spectacles de fin d’année, dans la production de Guillaume Gallienne et les décors d’Eric Ruf, qui n’avait pas convaincu dans sa première édition la saison dernière.
Depuis la création à l’Opéra de Paris en 1977 (mise en scène assez médiocre de Jacques Rosner), l’œuvre de Rossini a été servie par Jérôme Savary dans une production Gall toute fraîche venue de Genève (meilleure que la précédente), puis Nicolas Joel a proposé celle de Ponnelle (venue de Munich) pendant trois saisons qui n’est pas une de ses pires idées.
La production actuelle est le typique spectacle pour grand public, qui convient bien aux fêtes, avec un metteur en scène (?) connu et aimé pour ses qualités de comédien. Elle est confiée à la baguette consommée d’Evelino Pidò, avec une distribution dominée par Lawrence Brownlee et Marianne Crebassa (un vrai bonheur) un Alessandro Corbelli rossinien consommé en Don Magnifico, et deux solides promesses, Adam Plachetka en Alidoro et Florian Sempey en Dandini. Voilà qui est fait pour garantir la réussite d’une soirée de décembre. Il faudra attendre cependant pour une grande production.
Il primo omicidio (Cain) (Scarlatti) (NP)
Nouvelle production d’un répertoire baroque réservé à Garnier (pour 13 représentations entre le 22 janvier et le 23 février) et premier opéra de Scarlatti représenté à l’Opéra de Paris, qui fera courir non par passion trop longtemps réprimée pour le compositeur napolitain, mais pour la mise en scène de Roméo Castellucci toujours passionné par les mythes bibliques et la direction ô combien experte de René Jacobs. Avec une distribution spécialiste de ce répertoire, Kristina Hammarström (Caino) , Olivia Vermeulen (Abel) et Birgitte Christensen Thomas Walker Benno Schachtner Robert Gleadow. À noter dans ses tablettes.
Les Troyens (Berlioz) (NP)
Opéra symbole de l’Opéra-Bastille puisque le titre a inauguré la nouvelle salle en 1990 dans une mise en scène de Pier Luigi Pizzi et les inoubliables Grace Bumbry et Shirley Verrett. Il faudra attendre 2006 pour que Mortier importe de Salzbourg la belle production de Herbert Wernicke. Et c’est tout…
Alors on ne va pas bouder son plaisir : ces Troyens sont bienvenus, dans une production qui va sans doute provoquer des commentaires (amers ?) à cause de la production confiée à Dmitri Tcherniakov. C’est Philippe Jordan qui s’est réservé la direction musicale, qu’on espère plus colorée que le Benvenuto Cellini musicalement pâle de cette saison.
Distribution dominée par l’Énée de Brian Hymel, désormais titulaire référent du rôle depuis plusieurs années et par la Cassandre de Stéphanie d’Oustrac, à qui fera écho la Didon de Elīna Garanča. À leurs côtés une distribution de toute première importance, Stéphane Degout, Michèle Losier, Cyrille Dubois, quelques noms moins connus comme l’excellent baryton-basse américain Christian van Horn et le jeune ténor prometteur Bror Magnus Tødenes. Notons enfin un vétéran, Paata Burchuladze en Priam, basse vedette des années 80 et 90. 8 représentations du 22 janvier au 12 février (Bastille).
Rusalka (Dvořák)
Reprise de la production de Robert Carsen, qui remonte à l’ère Gall (2002), pour la quatrième fois et elle a toujours bénéficié de distributions notables. C’est le cas ici puisqu’on y entendra pour 5 représentations en février et mars à Bastille (tout plaisir doit être mesuré…) autour de la Rusalka de Camilla Nylund, son rôle fétiche, Klaus Florian Vogt, Karita Mattila, Thomas Johannes Meyer, Ekaterina Semenchuk, c’est à dire ce qui peut se trouver de mieux aujourd’hui. Et l’orchestre sera dirigé par Susanna Mälkki, qui confirme à chacune de ses apparitions qu’elle une des cheffes (?) les plus passionnantes du paysage musical. Il y aura peu de représentations, mais retenez cette reprise, elle vaut au moins musicalement le détour.
Otello (Verdi)
Reprise de la production de Andrei Șerban qui remonte à la dernière saison de Hugues Gall pour la quatrième fois. Finalement Otello n’est pas servi si souvent à l’Opéra de Paris, c’est depuis 1976 (Sir Georg Solti, Terry Hands, Placido Domingo et Margaret Price), la troisième production qui vient après celle de Petrika Ionesco qui aura duré deux saisons au tout début de l’ère Bastille (1990-91 et 1991-92).
Ce n’est pas une des meilleurs de Andrei Șerban mais ce n’est pas l’intérêt de cette reprise construite autour de l’Otello de Roberto Alagna qui chantera huit représentations en mars 2019 et qui naturellement (et justement) attirera les foules. Sa Desdemona sera Alexandra Kurzak (on n’est jamais mieux servi que par son épouse) et Iago Georges Gagnidze, un baryton qui ne m’a jamais convaincu. Plus intéressant le Cassio de Frédéric Antoun. L’orchestre sera confié à Bertrand de Billy.
Une reprise motivée par Roberto Alagna, seul véritable intérêt de la distribution pour 11 représentations en mars et avril dont les trois dernières (en avril) seront chantées par Aleksandr Antonenko, le professionnel du rôle, qui ne m’a jamais convaincu.
Die Fledermaus (J.Strauss) (NP)
Pour six représentations en mars 2019, l’Opéra coproduit avec la MC93 de Bobigny une version de chambre pour sept instruments (de Didier Puntos) de l’opérette de Johann Strauss confiée à Célie Pauthe qui dirige le Centre dramatique national de Besançon-Franche Comté, et aux chanteurs de l’Académie en résidence à l’Opéra de Paris, avec les musiciens de l’orchestre-Atelier Ostinato et le chœur Unikanti. L’intérêt serait que cette production tourne en France aussi.
Don Pasquale (Donizetti)
Deuxième opéra bouffe de Donizetti de la saison et reprise de la mise en scène de Damiano Michieletto qui va être créée à Garnier en juin-juillet 2018 pour marquer l’entrée au répertoire de l’Opéra de Paris de cette œuvre. Nouveauté : à Evelino Pidò succèdera Michele Mariotti et la distribution sera sensiblement changée : à Nadine Sierra succédera Pretty Yende, à Lawrence Browlee Javier Camarena, à Florian Sempey Mariusz Kwiecień mais Michele Pertusi restera Don Pasquale. (Garnier, 9 représentations en mars-avril 2019)
À noter qu’on aimerait quand même voir à l’Opéra de Paris d’autres Donizetti, et notamment les « opéras des reines », et les œuvres créées à Paris en français ou non qui aillent au-delà de Lucia di Lammermoor. L’Opéra de Paris s’est timidement aventuré dans le vérisme, qui était un trou dans son répertoire mais bien peu dans le bel canto.
Lady Macbeth de Mzensk (Chostakovitch) (NP)
Pour 7 représentations du 2 au 25 avril 2019, cette nouvelle production du chef d’œuvre de Chostakovitch est la troisième après celle d’André Engel présentée au début de l’Opéra-Bastille (1991-92 et 1993-94) et celle de Martin Kušej, venue d’Amsterdam en 2008-2009 pour la dernière saison de Gérard Mortier.
Après Munich (Kupfer), après Salzbourg (Kriegenburg), l’œuvre de Chostakovitch a l’honneur d’un metteur en scène à la fois à la mode et qui est en train de devenir mythe, Krzysztof Warlikowski, et d’un des très bons chefs familiers de répertoire, Ingo Metzmacher. C’est Aušrinė Stundytė qui sera Katerina Ismailova et l’entoureront l’excellent Dmitry Ulianov (Boris), John Daszak sera Zinovy, choix surprenant pour un spécialiste du rôle de Serguei, qui sera quant à lui chanté par Pavel Černoch, très bon ténor qui est lui aussi une surprise dans ce rôle. C’est d’autant plus stimulant, ils seront très bien entourés. À voir, évidemment.
Carmen (Bizet)
Reprise de la production Bieito, créée pour Paris en 2016-2017 après avoir fait le tour d’Europe (la production a une vingtaine d’années). Une production de bonne facture, qui change de la précédente, d’une rare faiblesse (Yves Beaunesne). Le regard sur le destin de Carmen à l’Opéra de Paris montre qu’on a eu des difficultés à trouver une production solide pour ce pilier du répertoire qui draine toujours un nombreux public, comme le montrent les 14 représentations prévues entre avril et mai 2019. Le chef appelé est le très talentueux Lorenzo Viotti, un des phares des jeunes générations de chefs. La distribution est très attirante dominée par Anita Rashvelishvili, qui avec Elīna Garanča se partage la vedette dans le rôle dans les grandes scènes du monde, les dernières représentations à partir du 8 mai étant confiées à Ksenia Dudnikova. Deux Don José, Roberto Alagna assurera les quatre premières représentations, le reste étant confié à Jean-François Borras, ce qui n’est pas mal non plus. Escamillo sera comme la saison dernière Roberto Tagliavini et dans Micaela seront affichées Nicole Car et Anett Fritsch. Sans mettre en cause le talent de ces chanteuses, bien connues, on aurait peut-être pu trouver quelques Micaela françaises…
A priori une reprise évidemment alimentaire (comme toujours Carmen) mais qui propose un cast et un chef intéressants ).
Die Zauberflöte (Mozart)
Autre reprise alimentaire courant d’avril à juin à Bastille pour 12 représentations, cette reprise de la (bonne) production de Robert Carsen est intéressante dans la mesure où elle est confiée presque exclusivement à des voix francophones, preuve de la vitalité du chant en français : Tamino est Julien Behr, Pamina la jeune Vannina Santoni, Papageno Florian Sempey, Papagena Chloé Briot et Sarastro Nicolas Testé, et la reine de la nuit sera Jodie Devos. Les enfants en revanche seront des solistes des Aurelius Sängerknaben Calw, l’un des chœurs d’enfants les plus remarquables en Allemagne. Henrik Nánási dirigera les forces de l’Opéra, un très bon chef qui a montré naguère à la Komische Oper de Berlin qu’il avait bien en main la partition de Mozart.
Iolanta/Casse-Noisette (Tchaïkovski)
Première reprise du spectacle original mis en scène par Dmitri Tcherniakov accouplant comme à la création en 1892, Iolanta et le ballet Casse-Noisette reviennent dans une direction musicale du très bon Tomáš Hanus. Casse-Noisette est confié au chorégraphe Sidi-Larbi Cherkaoui qu’on ne présente plus, et la distribution de Iolanta est sensiblement différente de celle affichée en 2015-16, dominée par la Iolanta de Valentina Naforniţă entourée notamment de Dmytro Popov, Artur Ruciński, Ain Anger, Johannes Martin Kränzle, Vasily Efimov, autant dire un groupe d’excellents chanteurs.
Vaudra de nouveau le détour, pour 9 représentations en mai 2019 au Palais Garnier.
Tosca (Puccini)
Tosca a connu à Paris une production qui a duré de 1994 à 2012, soit 18 ans ce qui est exceptionnel dans cette maison, celle de Werner Schroeter créée sous l’ère (brève mais intéressante) Blanchard et qui été reprise aussi bien par Hugues Gall, Gérard Mortier que Nicolas Joel. Un exploit à saluer.
Cette production n’était pas très dérangeante, mais très correcte. La production de Pierre Audi qui lui a succédé en 2014 est moins intéressante et d’une rare platitude.
C’est cette production qui est reprise, pour 12 représentations à Bastille en mai et juin 2019, avec une distribution faite pour attirer les foules : Jonas Kaufmann en Mario pour 7 représentations le reste étant assuré par le ténor montant qu’on voit désormais un peu partout, l’argentin Marcelo Puente. Du côté des Tosca on note Anja Harteros pour 4 représentations en mai, puis Martina Serafin pour 6 représentations et Sonia Yoncheva pour deux malheureuses représentations les 1er et 5 juin (aux côtés de Kaufmann), deux Scarpia se succèderont, Željko Lučić d’abord aux côtés d’Harteros et Luca Salsi ensuite à partir du 29 mai. C’est Dan Ettinger qui dirigera l’ensemble de ces représentations purement alimentaires où l’on guettera les éventuelles annulations…
La Forza del destino (Verdi)
Reprise de la très médiocre production de Jean-Claude Auvray, créée sous l’ère Nicolas Joel qui fait suite à la production de John Dexter, pas très excitante non plus, qui était celle de l’entrée au répertoire de l’Opéra de Paris sous l’ère Liebermann puis Lefort, car ce must de l’opéra verdien n’a pas été affiché entre 1981 et 2011…
Proposer la Forza del destino se justifie donc d’autant que la distribution évidemment intéresse avec Anja Harteros pour 4 représentations du 6 au 18 juin, à qui succèdera l’émergente Elena Stikhina. Željko Lučić sera Don Carlos di Vargas, tandis qu’Alvaro est confié au jeune américain Brian Jagde qu’on lance sur le marché (il faudra donc aller l’écouter), et tous deux pour l’ensemble des représentations. Ils sont entourés de Rafal Siwek (Padre Guardiano) Gabriele Viviani (Melitone) et Varduhi Abrahamyan (Preziosilla).
Bien sûr, c’est une reprise alimentaire, mais quelquefois le repas est bon, d’autant que l’orchestre est confié à Nicola Luisotti.
Don Giovanni (Mozart) (NP)
Signe de la difficulté de trouver une production idéale du chef d’œuvre de Mozart où tant de metteurs en scène se sont frottés et ont échoué (un seul exemple, Chéreau à Salzbourg), on en est à Paris depuis 1975 à la septième production (dont une en version concertante). Même si la production d’Everding était médiocre en 1975, on évoquera en ancien combattant Margaret Price (Anna), Kiri te Kanawa (Elvira) Roger Soyer (Don Giovanni) José Van Dam (Leporello) Jane Berbié (Zerlina)…et l’orchestre de Sir Georg Solti…
Depuis, aucun souvenir marquant jusqu’à la production de Michael Haneke, qui est pour moi ce qui s’est fait de plus intéressant sur une scène d’opéra dans cette œuvre depuis longtemps.
C’est donc pour moi une erreur de Lissner de vouloir en changer. La production de Haneke gardait sa force et pouvait encore durer.
Si encore il était demandé à Ivo van Hove qui va assurer cette nouvelle production, l’ensemble de la trilogie Da Ponte, cela pourrait avoir un sens, mais puisque Cosi fan tutte a fait l’objet d’une nouvelle production d’Anna Teresa de Keersmaker la saison dernière, cela ne semble pas d’actualité.
Plus généralement, à part les fameuses Nozze de Strehler (et pour ma part – certains lecteurs vont hurler- la production de Marthaler à Garnier qui a duré le temps d’une rose) rien d’intéressant n’est sorti de l’Opéra de Paris en matière de production des opéras de Da Ponte/Mozart.
J’ai donc des doutes sur l’opération Don Giovanni, pour moi inutile, malgré Ivo van Hove, et sans lien avec une ligne de programmation réelle, même si on y ose une distribution jeune et stimulante, élément vraiment digne d’intérêt : Etienne Dupuis (Don Giovanni) Ain Anger (Commendatore) Philippe Sly (Leporello), Jacquelyn Wagner (Anna), Stanislas de Barbeyrac (Ottavio), Nicole Car (Elvira), Elsa Dreisig (Zerlina) et Mikhail Timoschenko (Masetto).
L’orchestre est dirigé par Philippe Jordan, sauf le 13 juillet (Guillermo García Calvo). Pour 13 représentations à Garnier entre le 8 juin et le 13 juillet.
—
D’autres productions pour l’automne 2019 sont annoncées, mais considérons qu’elles appartiennent à 2019-2020 (Traviata, Les Indes Galantes, Madrigaux de Monteverdi, Prince Igor).
Au bilan, la saison 2018-2019 affiche : Wagner(1), Meyerbeer(1), Berlioz (1), Jarrell(1), Tchaikovski(1), Dvořák(1), J.Strauss(1), Puccini(1), Rossini(1) Chostakovitch(1), Bizet(1), Scarlatti(1) Donizetti(2), Mozart(2), Verdi (4).
C’est une saison qui présente toujours un certain intérêt au niveau des distributions; au niveau des chefs cela reste contrasté, et au niveau des mises en scènes, les nouvelles productions affichent les metteurs en scène en vogue (Warlikowski, Tcherniakov, Van Hove, Kriegenburg, Castellucci, Guth, Bieito) sans chercher de nouvelles têtes ou des metteurs en scène remarqués ailleurs qu’on n’a pas vu à Paris (David Bösch, Tobias Kratzer, David Herrmann – Simon Stone débutera à l’Opéra de Paris la saison suivante dans Traviata- ).
Disons que dans l’ensemble, sans être un feu d’artifice, tout cela est très respectable, sans afficher de ligne claire cependant, notamment et malgré Huguenots, Troyens et Carmen, sur le répertoire historique de la maison (encore que Carmen ait été plutôt du répertoire de l’Opéra-Comique…), La Juive (Halévy, mise en scène Pierre Audi) et Louise (Charpentier , mise en scène André Engel) sont au répertoire, et pourraient mériter des reprises avec de nouvelles distributions car ce ne sont pas des spectacles détestables.
2 galas en outre célèbrent banalement les 350 ans de l’Opéra, l’un composé d’extraits de ballets et d’opéras, et l’autre affiche Anna Netrebko et Monsieur, c’est une originalité folle, merci d’avance pour ce moment.
Sans vouloir suggérer des choix aux professionnels de la programmation, une grande production d’un Lully eût pu être une manière de célébrer le lointain prédécesseur de Stéphane Lissner, il y a quelques 350 ans.
Des concerts complètent la programmation musicale, de nombreux concerts de chambre et récitals à l’amphithéâtre et au studio et deux concerts symphoniques dirigés par Philippe Jordan, un concert Bruckner (Symphonie n°8) le 19 octobre et Mahler (Symphonie n°3) le 30 janvier complètent cette programmation.