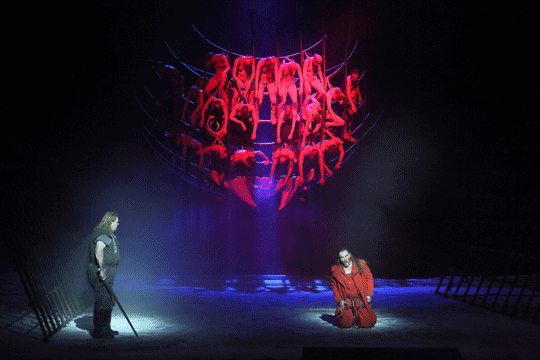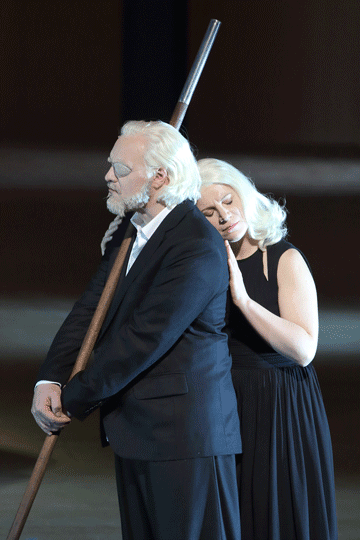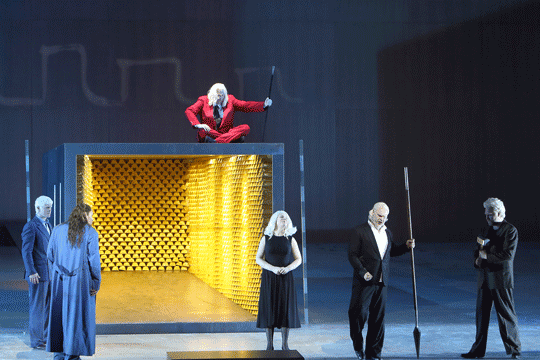On se référera au compte rendu de janvier 2013 qui contient une description très précise de la mise en scène http://wanderer.blog.lemonde.fr/?p=4971 et d’une représentation exceptionnelle, l’un des sommets du Ring présenté en 2013.
Du prologue et des trois journées du Ring, Siegfried est sans doute le plus optimiste, le seul opéra en tous cas qui se termine positivement, par une perspective azuréenne, et le seul qui soit proche d’un conte de fées, où les méchants sont vaincus et le héros vainqueur. C’est aussi le noyau de l’œuvre, car Siegfried est le héros par lequel Wagner a commencé l’élaboration de son poème.
Aussi Andreas Kriegenburg en a-t-il fait en quelque sorte le sommet de son travail et du système scénique imaginé dans cette grande boite à merveilles : c’est dans Siegfried qu’il y a les images les plus souriantes, les plus rafraichissantes, les trouvailles les plus séduisantes dans la veine héritée de Rheingold et qui renvoie le plus clairement aux contes et légendes. C’est par ailleurs aussi dans Siegfried que Wagner est le plus fidèle à la tradition.

Andreas Kriegenburg va donc mener à fond son idée d’utiliser des corps de figurants ou de danseurs pour figurer les choses, dragon, forêt, oiseau, mais aussi la forge, devenue une sorte de mécanisme primitif, presque un artifice circassien.
Il faut rappeler que Rheingold, Walküre et Siegfried forment dans la conception de Kriegenburg cet ensemble que Wotan réussit à maîtriser. Comme il le sait depuis l’apparition d’Erda, dès Rheingold, et comme il le vérifie, dès que sa lance sera brisée, les héros iront leur chemin qu’il ne pourra plus arrêter.
Ainsi Götterdämmerung, sorte de chute dans le monde des hommes, sera d’une esthétique et d’une inspiration complètement différente : Le Götterdämmerung de Kriegenburg est une chute dans un monde post-Fukushima, gouverné par le commerce, l’argent, le bling-bling, en bref, notre monde : l’homme-enfant, naïf et souriant, n’y peut résister. Et s’y noie. Et y meurt.
C’est ma troisième vision de Siegfried dans cette production et je reste toujours aussi émerveillé, en remarquant çà et là des points oubliés : le rôle de l’oiseau au troisième acte, qui pousse Siegfried au lit, le jeu de Siegfried dans ce même troisième acte, d’abord timide et fuyant, puis au contraire envahi de désir, le jeu ironique du Wanderer au deuxième acte contre Alberich, en le mimant dans la même attitude que dans Rheingold (crucifié par la lance) et surtout la grande précision du travail des acteurs et la maîtrise du jeu. C’est une vraie mise en scène de théâtre, qui travaille à la fois sur les relations entre les personnages et sur les images, je dirai une imagerie qui tout en illustrant le récit à la manière d’un livre d’enfants ou de ces livres qui s’ouvrent en proposant des images en relief.
En 2013, Siegfried était Lance Ryan, avec ses immenses qualités et son engagement et en janvier, il était dans un très bon soir vocal tout comme Catherine Naglestad d’ailleurs (le duo était exceptionnel). Cette fois-ci, au milieu d’une distribution assez proche de celle de 2013, Siegfried, c’est Stephen Gould, auréolé de ses derniers Tristan triomphaux. Ce qui fait que certains attendent de lui LA prestation définitive…Mais Tristan n’est pas Siegfried.
Quand finira-t-on par comprendre que les rôles de Heldentenor ne sont pas superposables, et que de Heldentenor aujourd’hui, il y en a pas, ou si peu.
La plupart des Heldentenor aujourd’hui sont des ténors dramatiques qui forcent leur voix ou qui s’y essaient. C’est vrai que Stephen Gould s’en rapprocherait, mais son Siegfried a montré malgré bien des moments magnifiques et d’indéniables qualités vocales que nous n’y étions pas tout à fait ce soir.
Stephen Gould, découvert à Bayreuth à l’occasion d’un mémorable Tannhäuser dirigé par un non moins mémorable Christian Thielemann, est aussi un mémorable Tristan. Il est vrai que Tristan comme Siegfried est un rôle qui nécessite toute l’étendue du spectre, mais malgré tout plus homogène mais surtout exigeant moins d’engagement physique : Siegfried doit jouer, bouger, sauter sans cesse et sur l’ensemble de la soirée. Tristan beaucoup moins.
Forcément, la fatigue propre au chant (un effort physique notable) se double d’une fatigue scénique importante (c’est d’ailleurs ce qui fait le prix d’un Lance Ryan, toujours unique dans son incarnation du rôle malgré des problèmes vocaux maintes fois soulignés). C’est aussi ce qui fait l’une des différences entre Siegfried de Siegfried et Siegfried du Götterdämmerung, bien moins sollicité physiquement et donc plus accessible à certains ténors qui ont chanté l’un sans jamais s’attaquer à l’autre.
Stephen Gould a pour lui un timbre magnifique, une puissance et un volume d’une largeur notables. Pour affronter le rôle, et notamment au début, au premier acte, il chante en gonflant le registre grave, lui donnant une importance inhabituelle chez lui, et ce souci des graves nuit à l’homogénéité de la voix : tout le début du premier acte est d’ailleurs un peu hésitant, peut-être aussi à cause d’un tempo soutenu du chef. Il reste que ses Nothung neidliches Schwert et toute la scène de la forge sont un des moments les plus impressionnants de la soirée. Le deuxième acte, plus lyrique, est aussi particulièrement réussi (les murmures de la forêt, moment splendide) malgré une fatigue visible dans les dernières minutes où Wagner a placé quelques aigus piégeux.
Toute la première partie du troisième acte est remarquable de lyrisme, d’expressivité, d’intelligence. Kirill Petrenko ralentit le tempo dans le duo avec Brünnhilde, en faisant une sorte de méditation lyrique, très intériorisée, mais qui contraint en même temps à appuyer sur les sons, gonfler le volume et contribue à la fatigue finale où la plupart des aigus les plus attendus des cinq dernières minutes sont soigneusement savonnés, ou ratés (il est vrai en duo…).
Par ailleurs, on sent que le travail de mise en scène n’a pas été jusqu’au bout, parce que bien des éléments présents en 2013 ont disparu ou restent esquissés (le jeu avec l’image de sa mère accouchant, sublime en 2013, ou le jeu avec le cor au moment de l’appel du 2ème acte par exemple) et il clair que Stephen Gould qui n’est pas un bout de bois sur scène, n’a pas tout à fait les qualités d’acteur exigées par ce genre de mise en scène. Disons qu’il n’a pas le jeu dans le sang : il joue mais n’incarne pas.
Au total, sans doute ceux qui sont persuadés qu’aujourd’hui un Siegfried se trouve sous le sabot d’un cheval, ou que, parce qu’on trouve des chanteurs pour le chanter, il y a de vrais Siegfried auront trouvé ce soir la prestation de Stephen Gould moins satisfaisante qu’attendu. On peut en douter et sourire d’une telle naïveté ou d’une telle ignorance. Stephen Gould a offert une prestation très largement convaincante musicalement, même si il n’a pu masquer sa fatigue en fin de parcours. C’est un superbe chanteur, doué de surcroît d’une parfaite diction et d’un joli sens du texte et de la couleur, usant de sa voix avec une rare intelligence, il reste largement à la hauteur du défi.

Il en est de même pour Catherine Naglestad. La chanteuse américaine était malgré tout nettement moins en forme qu’il y a deux ans. Il est vrai aussi que le tempo imposé par Kirill Petrenko, plus lent, privilégie l’intériorité dans ce duo plutôt que l’urgence de la passion et a pu mettre en difficulté sur certains aigus. Il est clair qu’elle n’avait pas l’aigu triomphant, dans un monologue qu’on sait redoutable puisque pris à froid avec des aigus difficiles qu’elle avait bien réussis il y a deux ans et qui ici manquaient d’éclat, de puissance aussi, voire manquaient tout court (le dernier…).
C’est la loi très humaine du chant, et ce soir, le chant de madame Naglestad n’était sans doute pas complètement exceptionnel . Pas de quoi néanmoins faire le moindre reproche lourd ou des remarques amères: Catherine Naglestad n’était pas dans un de ses meilleurs soirs, mais elle a été scéniquement sans reproche et vocalement intense, même si moins accomplie que je ne l’attendais.

Thomas Johannes Mayer était un Wanderer magnifique scéniquement, très présent, très engagé avec ses qualités d’intelligence et de diction, avec un sens du texte et de la couleur, même si là aussi il y avait des moments où la voix ne surmontait pas le volume de l’orchestre : c’était fort net dans le duo avec Alberich où le timbre apparaissait opaque et la voix quelquefois blanche, ça l’était dans une moindre mesure au premier acte face au Mime d’Andreas Conrad, et paradoxalement ça l’était moins au troisième acte. Il reste que le personnage était là, un personnage fouillé, parfaitement lisible (sinon audible). Le lecteur qui n’a pas entendu la représentation doit se demander comment cette soirée peut-elle avoir été un triomphe à peu près comparable aux précédentes…je suis en train de décrire des voix qui n’étaient pas ce soir au sommet, certes, mais elles avaient toute la présence suffisante pour faire fonctionner l’ensemble, comme souvent chez Wagner, voire bien plus pour Gould, à qui l’on ne peut reprocher dix minutes un peu faibles sur trois heures trente de spectacle où il fut souvent remarquable.

Le Mime d’Andreas Conrad en revanche avait la voix et le style, et a proposé un Mime nettement plus présent que celui d’Ulrich Reβ il y a deux ans. Il propose un personnage moins caricatural que d’autres aujourd’hui (Ablinger-Sperrhacke) un peu plus « normal », un peu moins joué ou surjoué. Bien sûr, qui n’a pas en tête Heinz Zednik avec Chéreau, ou même Graham Clark ? Conrad est un Mime très respectable, et un personnage qui sans être inoubliable réussit à s’imposer avec une diction et un sens de la parole particulièrement notables, ce qui pour Mime est essentiel mais qui est aussi partagé sur le plateau.
Une nouvelle venue dans le Waldvogel, la jeune roumaine Iulia Maria Dan, qui appartient à la troupe. Un personnage d’une grâce et d’une élégance évidentes, d’une fraîcheur communicative, avec ses deux éventails gracieusement balancés. La voix n’est pas à l’avenant. Un joli medium, mais pas les aigus nécessaires pour le rôle. Ils sont systématiquement à la limite de la justesse, ou ratés. C’est dommage car le personnage est vraiment campé.
La Erda de Qiulin Zhang bénéficie d’un des moments les plus stupéfiants de la mise en scène, apparaissant au milieu de corps terreux grouillants comme des gros scarabées, sorte d’armée des ombres et qui en se retournant ont des jambes blanches et apparaissent presque comme des vers tout aussi grouillants, images stupéfiantes parmi les plus frappantes de la soirée. Avec des graves impressionnants et des aigus marqués par un certain vibrato, moins cependant qu’il y a deux ans, la prestation reste un peu froide (ce qui sied à Erda, dira-t-on) mais cette ultime entrevue avec Wotan plus personnelle et plus sentie que celle de Rheingold, devrait communiquer quelque frémissement. Qiulin Zhang ne communique jamais cette vibration-là.
Christof Fischesser, Fafner comme dans Rheingold propose un monologue très propre, avec un très beau timbre, même si la voix manque de profondeur. L’aspect monitoire des paroles de Fafner manquent de poids pour mon goût bien que ce chanteur soit l’une des basses de référence en Allemagne.

Enfin, Tomasz Konieczny en Alberich, tout comme il y a deux ans, est impressionnant dans son duo avec le Wanderer. Habillé comme un bourgeois cravaté un peu négligé il tranche avec un Wanderer vieilli qui joue d’ailleurs avec sa cravate en un très beau mouvement. La voix est éclatante, le timbre sonore, le style n’est pas dépourvu d’une certaine élégance, Andreas Kriegenburg dans cette scène joue le travail du miroir : les deux arrivent et se pointent l’un l’autre le même pistolet, comme dans une scène à la Sergio Leone et ils sont symétriques, l’un jeune, l’autre vieux, l’un un peu plus élégant, l’autre négligé, l’un plein d’énergie, l’autre fatigué, tous deux avec de longs cheveux, noirs pour l’un blancs pour l’autre. Schwarz-Alberich face à Weiss-Alberich, comme le dit le texte. C’est là un des sommets de la soirée, aussi bien par le chant de Konieczny décidément l’un des grands chanteurs wagnériens de ce temps, que par la tension qu’elle diffuse et pour l’intensité de Thomas-Johannes Mayer.
Au total une distribution avec des fortunes diverses, et des voix un peu irrégulières et fatiguées, même si l’ensemble reste de haut niveau. En me relisant, je me trouve même un peu sévère avec Stephen Gould et Catherine Naglestad, mais je dois dire en même temps que cela ne m’a pas vraiment gêné, parce que d’un côté la mise en scène captive, et de l’autre la direction passionne par ses choix.
Plus que pour Walküre, Kirill Petrenko prend le public à revers, faisant des choix de volume et de tempo inattendus, j’ai parlé du 3ème acte pris assez lentement, du 1er acte pris très vite au début qui semble un peu désarçonner les chanteurs, mais les contrastes de tempo ne sont rien à côté des contrastes de volume, avec des moments particulièrement extraordinaires, comme un prélude du 2ème acte stupéfiant par les ruptures d’équilibre, notamment l’insistance des cuivres presque obsédante, imposant musicalement le dragon comme protagoniste, et faisant surgir musicalement avec une clarté incroyable tous les éléments du drame qui va se jouer à un point tel qu’on a l’impression de découvrir cette musique qui est l’un de mes moments préférés de l’œuvre (avec des cors en crescendo doublés par des timbales qui explosent avec une force inouïe) préparant l’intervention initiale d’Alberich qui s’impose alors presque « naturellement » comme un élément du prélude.
Le troisième acte est de bout en bout complètement kaléidoscopique au niveau musical : tout est mis en relief tour à tour, avec un réveil de Brünnhilde époustouflant de douceur, de retenue, de chair, de soleil et en même temps jamais vraiment complaisant avec ce qui peut vite devenir sirupeux. Le dialogue entre les instruments solistes (notamment les bois) avec les voix est stupéfiant. Il faut dire que ce soir l’orchestre n’a pas eu d’accident et qu’il a été de bout en bout exemplaire.
Kirill Petrenko a imposé un Siegfried très dramatique, au volume plus marqué que dans les deux autres opéras, et sans jamais se soumettre à ce qui pourrait être du sentimentalisme, on est dans un Siegfried « Sachlichkeit », d’une prodigieuse dynamique (la forge !!) qui peut même déranger: on pourrait le comprendre tant certains moments sont inhabituels. C’est brutal quelquefois, c’est sec à d’autres, c’est quelquefois même volontairement inexpressif comme si on ne suivait que les notes sans y mettre autre chose (prélude du troisième); bref, on ne sort pas indemne de ces moments complètement reconstruits à neuf et qui renvoient certaines interprétations plus « conformes » à l’univers de la fadeur et de la platitude.
Vie, Intensité, parti pris, choix assumés : c’est complètement ailleurs et en même temps c’est prenant, passionnant, étonnant.
Il reste difficile de qualifier une soirée aussi contrastée, avec un plateau très correct sans être aussi tourneboulant qu’il ne le fut il y a deux ans, avec un orchestre surprenant et qui laisse rêveur tellement certains moments sont radicalement différents de ce qu’on entend habituellement et tellement ça fonctionne, et avec une mise en scène particulièrement réussie, d’où on sort émerveillé : on a l’impression que Kriegenburg montre le monde avec les yeux de Siegfried, des yeux encore innocents qui le parent de qualités qu’il n’a pas. Oui, ce Ring vaut toujours et encore le voyage…[wpsr_facebook]