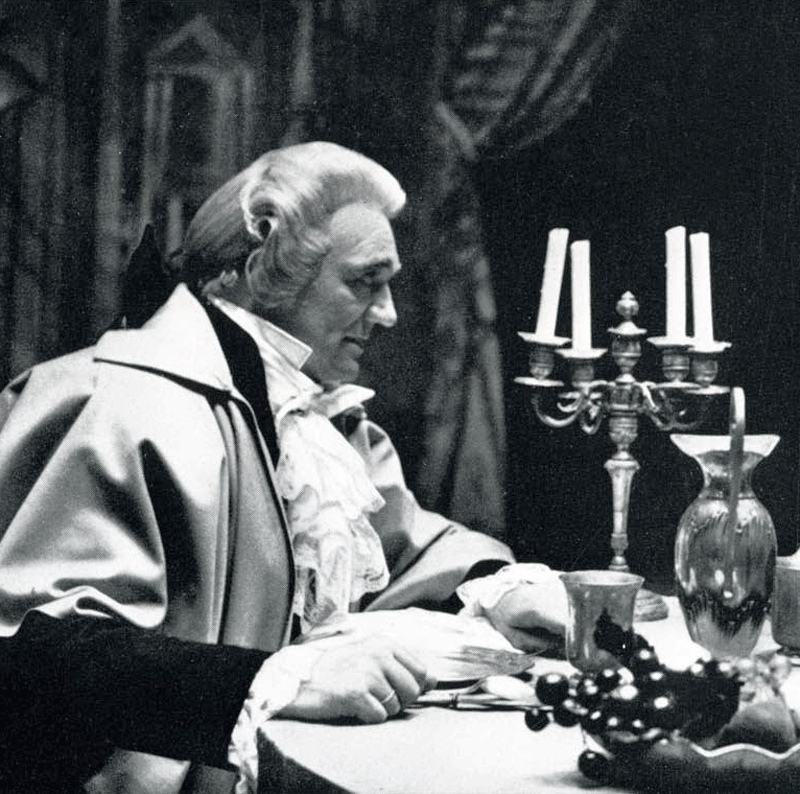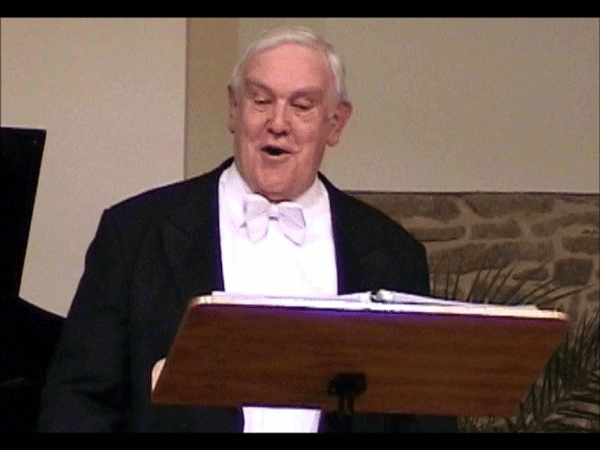Petit essai sur les conséquences connues et induites du développement du streaming dans nos maisons de plaisir
Esquisse de panorama
C’est la nouvelle du moment : l’Opéra de Paris vient d’ouvrir « L’Opéra chez soi » une plateforme pour retransmettre ses spectacles en direct puis en archive, moyennant une somme modique et variable selon le spectacle choisi, certains programmes à visée éducative restant gratuits, d’autres payants : « La plateforme « l’Opéra chez soi », lancée le 8 décembre dernier, vous propose d’ores et déjà une sélection de contenus et captations audiovisuels gratuits, ainsi qu’un catalogue de 20 spectacles et concerts en paiement à l’acte » comme le dit le message d’Alexander Neef, employant l’expression « paiement à l’acte » qui sonne singulièrement médical, sans doute parce que la plateforme panse nos plaies béantes d’amateurs frustrés.
Ce n’est pas la seule maison d’Opéra à avoir opéré sa mue, elle vient même après bien d’autres. La Bayerische Staatsoper avec sa Staatsoper.tv a lancé le mouvement depuis plusieurs années, mais vient d’ouvrir à cause de la fermeture des salles un système de V.O.D (vidéo on demand) lui aussi tarifé, les Berliner Philharmoniker ont aussi leur « Digital Concert Hall », particulièrement efficace, sur abonnement, mais d’autres maisons aussi ont peu à peu ouvert leurs archives audiovisuelles.
Qu’ils soient gratuits sur des plateformes dédiées comme ArteConcert, Operavision, voire YouTube, ou payants, les spectacles d’opéra ont désormais droit à la vision à distance (je me refuse aux termes barbares et inutiles distanciel/présentiel ) et le phénomène s’est étendu à la faveur des mesures de fermeture des salles, à peu près générales en Europe occidentale.
Prises au dépourvu ce printemps, les salles ont pris leurs précautions cet automne et se sont adaptées : dernier exemple en date, la nouvelle production de l’Opéra de Lyon Béatrice et Bénédict, a été l’objet d’un enregistrement TV par précaution devenu à la nouvelle de la fermeture, le seul témoignage du travail de Damiano Michieletto, Daniele Rustioni et de l’ensemble du plateau. Cet enregistrement sera programmé en 2021, à une date non encore fixée. Des maisons plus petites s’y sont mises aussi, comme Nice, ou comme l’Opéra de Rennes pour La Dame Blanche de Boieldieu dont le site Wanderersite.com a rendu compte.
Comme souvent, notamment quand un événement extérieur vient rebattre les cartes, c’est le cas depuis mars 2020, les choses se font en ordre dispersé, mais prennent de plus en plus d’importance, au point que çà et là une réflexion prend corps sur la suite à envisager.
Comme je l’ai souligné, depuis cet automne, la plupart des théâtres se sont mis au « streaming », et peu à peu on a pu voir en ligne des productions récentes de différentes salles européennes, importantes ou non, qu’elles aient été présentées au public ou non.
Plusieurs modes se partagent le marché, en dehors des éditions DVD qui continuent du publier bon an mal an un certain nombre de produits :
- Les plateformes en ligne gérées directement par les institutions, c’est notamment le cas des Berliner Philharmoniker, de la Bayerische Staatsoper, de l’Opéra de Paris désormais, mais aussi du MET, de Vienne et d’autres.
- Les plateformes gérées par des chaines TV, comme Arte, avec ArteConcert, mais aussi des plateformes externes comme operavision qui est un pool de maisons d’opéra ou YouTube par laquelle passent certains théâtres (comme le Bolchoï).
- Enfin, les retransmissions TV sur de grandes chaines nationales (comme la RAI, Arte, ou France-Télévisions) devenues plus rares depuis que l’accès aux œuvres s’est diversifié, offrant au public de niche des accès auxquels on ne pensait même pas il y a quelques années encore.
Chaque système a ses avantages, et les spectacles retransmis font quelquefois ensuite l’objet de publications DVD, comme à Bayreuth (le dernier Tannhäuser par exemple).
À chaque système aussi répondent des problèmes de droits de diffusion différents, ce qui explique par exemple que la RAI ait l’exclusivité de la diffusion du dernier (et excellent) Barbiere di Siviglia romain dirigé par Daniele Gatti, limitée stupidement à l’Italie, tout comme d ‘ailleurs le concert de Noël de l’Orchestre de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Kirill Petrenko – Igor Levit).
À l’heure de la globalisation des ondes, pour un art aussi partagé et aussi international que la musique, de telles dispositions sont devenues obsolètes et demandent des aménagements, voire une totale remise à plat.
C’est clair, la pandémie de Covid 19 a accéléré le processus, et il y a fort à parier que dans le monde d’après, les productions des maisons d’opéra seront sans doute toutes ou presque accessibles en ligne, par un moyen ou l’autre et qu’il faudra trouver des réponses aux questions de droits de diffusion, équiper les maisons d’opéra de matériel technique qui aille au-delà du simple dispositif de reprise de travail avec caméra fixe, créer des services adéquats pour gérer les enregistrements, la diffusion, mais aussi l’archivage. Certes, les TV continueront à enregistrer certains (rares) spectacles, mais le reste sera à discrétion des politiques internes des maisons d’opéra, constituant sans doute aussi un élément supplémentaire de concurrence, notamment entre les grandes maisons, mais aussi de propriété intellectuelle.
Récemment la ministre Roselyne Bachelot a annoncé une négociation avec les plateformes pour les amener à participer au financement des créations, ce type de négociation va sans doute s’étendre. En effet, à chaque fois qu’un nouveau mode de transmission se fait jour, les questions de droits suivent à plus ou moins brève échéance.
Brève histoire des retransmissions
Si le Covid a accéléré cette prise de conscience, il convient de revenir rapidement sur l’histoire des retransmissions de spectacle, et notamment d’opéra.
J’y tiens beaucoup pour une raison très personnelle, c’est ainsi en effet que l’opéra est entré dans ma vie : j’avais douze ans quand j’ai découvert au milieu des années 1960 l’Opéra grâce aux retransmissions TV du Festival d’Aix, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Falstaff… en noir et blanc, avec déjà Bacquier en Don Giovanni dans l’historique production de Cassandre. Je dois à ces retransmissions la ravageuse passion d’une vie.
Avant 1970, on dispose de très peu d’enregistrements directs, quelques éléments de Callas dont l’acte II de Tosca, un Tristan de Wieland Wagner dirigé par Pierre Boulez au Japon., quelques opéras filmés par Herbert von Karajan, précurseur et visionnaire en la matière, notamment La Bohème de Zeffirelli (1965), ou Cavalleria rusticana signée Strehler (1968), ou une Carmen avec Grace Bumbry, Jon Vickers et Mirella Freni (1969). Il y a quelques autres très beaux produits comme un Wozzeck venu de Hambourg (supervisé par Rolf Liebermann et dirigé par Bruno Maderna)[1] ou un Don Giovanni salzbourgeois légendaire de Furtwängler (1954).
À partir des années 1970, on commence à voir des retransmissions TV plus nombreuses, par exemple le fameux Tristan d’Orange (Böhm, Nilsson, Vickers) mais aussi des retransmissions de l’Opéra de Paris, qui pour d’obscures questions de droits non résolues, ont croupi ensuite dans des archives sans jamais plus faire l’objet de rediffusions ou de distribution en VHS par exemple, on y trouve une douzaine de titres dont Simon Boccanegra (Strehler Abbado), L’incoronazione di Poppea (Avec Gwyneth Jones et Jon Vickers), Lulu (Chéreau Boulez) Le nozze di Figaro dans la mise en scène originale de Strehler 1973, télévisés en direct le 14 juillet 1980, matinée gratuite avec Solti, Janowitz Bacquier, Popp, Von Stade, Van Dam, Moll, Berbié. Certaines vidéos sont repérables sur YouTube dont cette dernière, qui a valu au jeune fan que j’étais 10 heures de queue à Garnier. D’autres dorment, moisissent encore on ne sait où, ou bien ont carrément disparu corps et biens.
Là encore, le Festival de Bayreuth fut précurseur, puisqu’il mit en boite au tout début des années 1980 le Ring de Chéreau-Boulez et le Fliegende Holländer de Kupfer, Die Meistersinger von Nürnberg (Wolfgang Wagner, Horst Stein) et le sublime Tristan de Ponnelle-Barenboim. Parallèlement le MET commençait aussi à diffuser. C’est donc depuis une grosse quarantaine d’années qu’on dispose d’enregistrements de productions d’opéra scéniquement intéressantes ou non, mais la plupart du temps musicalement marquantes. Depuis lors, Bayreuth met régulièrement en boite ses productions, et la production de VHS d’abord, puis de DVD s’est largement diffusée, notamment à la Scala, en compagnonnage avec la RAI, mais aujourd’hui souvent peu distribuées ou peu repérables sinon à un prix prohibitif. C’était l’époque où l’on hésitait sur les formats, Unitel avait publié par exemple des Vidéodisques (beau matériel tout doré) d’un format de 33 tours, un peu encombrant et vite disparu au profit du plus souple VHS.
il ne s’agit pas ici de pleurer sur les disparus ou s’émouvoir sur l’âge d’or des pionniers, mais de montrer à la fois une évolution et de réfléchir à toutes ses conséquences du développement actuel, y compris sur ces « vieilles cires (?) »
Il est clair que désormais, la plupart des théâtres et en premier lieu les plus importants, retransmettront en streaming ou archiveront pour un public potentiel leurs nouvelles productions « en direct », et en salle ; mais sans doute aussi des spectacles en reprise qui en valent la peine. C’est ce qu’ont fait les Berliner Philharmoniker qui à travers leur Digital Concert Hall, proposent l’archive des reprises TV des concerts des Berliner depuis l’époque du Karajan (on y trouve par exemple le fameux film de Clouzot sur la 5ème de Beethoven) et un classement par chef, par année, par compositeur, par époque, par saison, par soliste…
C’est très efficace et permet au mélomane de se plonger dans des écoutes diverses, dans tous les genres, moyennant un abonnement d’environ 150 € annuels, ou avec une offre à l’unité ou au mois et ainsi de se faire un panorama de l’histoire de l’interprétation.
En effet à partir du moment où le numérique entre régulièrement dans le processus de diffusion, il faut en organiser l’accessibilité et les modalités, mais aussi les objectifs et les financements.
Les visées
Ne viser que la possibilité de voir des spectacles ou des concerts qu’on n’aurait pas sinon l’occasion de voir est assez vite réducteur. Cela convient au discours politique qui va ainsi résoudre la question de l’accessibilité aux spectacles, vantant la possibilité pour tous d’accéder à l’offre lyrique (on verra plus loin que le théâtre parlé est très concerné aussi).
C’est aussi ce que le MET avait mis en avant avec la diffusion mondiale de ses spectacles via les salles de cinéma, à un tarif certes inférieur au prix du billet en salle, mais très supérieur à celui d’une place de cinéma (près de 30€ le billet), et l’on s’est vite aperçu que loin de gagner un nouveau public, ces projections étaient fréquentées par le public lyrique habituel.
Le seul avantage de l’affaire, c’est la qualité de la production sur grand écran et surtout en public, ce qui change évidemment le rapport au spectacle. Le système a d’ailleurs essaimé et les grandes salles, de l’Opéra de Paris au Bolchoï, et même la Comédie Française, en ont usé. Mais il n’est pas sûr que cela survive longtemps à la généralisation du streaming post-Covid, et ce serait délétère pour certains théâtres moins prestigieux et moins fortunés.
L’accessibilité à des spectacles de grandes institutions est un enjeu à la fois économique et politique dans la mesure où ces institutions sont la plupart du temps financées par de l’argent public, le paysan du Larzac contribuant au subventionnement de la place du spectateur parisien qui fréquente Opéra et Comédie Française, sans grand-chose en retour. On a connu il y a plusieurs dizaines d’années le système des tournées, ou des échanges : Scala-Opéra de Paris en 1979, ou Bolchoï-Scala. En 1978 eut lieu une immense tournée aux USA de la plupart des opéras d’Europe pour fêter le bicentenaire de l’indépendance des États-Unis. Il y a encore quelques échanges, sporadiques (notamment des ballets, moins coûteux), comme des tournées d’opéras au Japon, ou venues du Bolchoï en France (2008) ou plus fréquemment en Italie, mais les choses se sont raréfiées et s’affichent seulement symboliquement. De toute façon, les dites tournées s’adressent au public ordinaire des opéras et ne visent qu’au prestige, mais pas vraiment à la diffusion à tous et je n’ai jamais vu l’Opéra de Paris faire tourner une de ses productions en France.
Le numérique est donc évidemment une réponse efficace à la question de la diffusion. En France et en Allemagne existe Arte, dont le rôle est aussi de diffuser des spectacles tout comme les chaines nationales: France Télévisions qui a aussi le souci de la diffusion culturelle a proposé je ne sais combien de fois Carmen, horizon d’écoute du téléspectateur moyen selon les analystes et algorithmes savants de la diffusion, à moins que ce ne soit l’horizon de savoir lyrique du producteur télévisuel moyen.
Avec le numérique et les plateformes de diffusion de chaque théâtre, les choses s’acheminent vers une solution qui devrait satisfaire au moins le politique, débarrassé de la lancinante question-sparadrap de l’accessibilité de tous à un spectacle qui en réalité par les prix pratiqués (malgré les subventions) est réservé à quelques-uns. La réflexion sur les coûts (toujours démentiels et excessifs – c’est leur définition-refrain) de l’opéra et leur rapport au nombre réduit de spectateurs ne date pas d’aujourd’hui, mais fait toujours beugler le Landerneau politico-médiatique (voir le feuilleton Lissner-Opéra de Paris). Ainsi le streaming et la diffusion numérique viendraient étouffer des polémiques éventuelles toujours prêtes à surgir.
L’impérieuse nécessité d’un spectacle vivant et de salles ouvertes
Or, la diffusion des productions par des voies numériques ne peut se substituer à la diffusion en direct. Le spectacle en direct, le contact direct du spectateur avec l’orchestre, le chef, la scène est irremplaçable dans l’expérience de spectateur. Et c’est la même chose au théâtre parlé.
L’expérience en salle, l’expérience théâtrale (on pourrait aussi dire de même du cinéma en salle), l’expérience du groupe réuni, le contact social, le mélange des spectateurs, est un bien irremplaçable et millénaire. L’expérience du théâtre est une expérience fondamentale de citoyen, membre d’une Cité qui a pour mission d’y pourvoir. C’est aujourd’hui un des seuls lieux où les groupes sociaux se mélangent, où les individus peuvent échanger collectivement. C’est un des seuls lieux de réunion sociale. Oublier cet aspect en pensant que le spectacle n’est que jouissance individuelle, que plaisir solitaire, que cerise sur un triste gâteau est un contresens profond, qui ignore l’histoire millénaire du spectacle et de sa fonction civique.
C’est pourquoi d’une part subventionner le spectacle vivant est un devoir sinon d’État, du moins de toute puissance publique, et en assurer le fonctionnement une obligation qui ne souffre pas la discussion. Louis XIV a inventé le théâtre public et l’Opéra public, et ce n’était pas par souci de ses seuls propres menus plaisirs.
Dans la situation actuelle, l’État (français) assure fort généreusement un minimum vital aux individus qui font fonctionner la machine, artistes et techniciens, mais a considéré (par la voix du Conseil d’État) qu’assurer les cultes était plus essentiel qu’assurer un minimum de culture publique (le spectacle vivant), sans doute parce que la religion revient au petit trot (au petit trop ?) dans la vie publique. Le conseil d’État vient d’ailleurs de débouter de leur plainte ceux qui voulaient faire rouvrir les salles de spectacle. C’est affirmer une sorte de version poliade (de polis, la Cité) de la religion, et rejeter le spectacle dans le superfétatoire. Mais historiquement, le théâtre est lui-même manifestation d’une religion poliade depuis l’Athènes classique. Ranger le théâtre au rang des distractions ou des choix individuels est simplement une hérésie au regard des besoins publics (et pas du public). Comme je l’ai souvent affirmé, dans la plupart des villes moyennes ou grandes, on trouve souvent église, mairie et théâtre dans le même périmètre et ce n’est pas un hasard. On a barré le théâtre du périmètre en ce moment et c’est criminel.
La question n’est pas seulement la nécessité pour le public de divertissement parce que mot sonne trop voisin du mot superflu, mais de la nécessité sociale voire politique de se retrouver ensemble et de faire société. C’est là évidemment où le bât blesse sanitairement. Mais il blesse tout autant dans tous les lieux autorisés où des agrégats hétéroclites d’individus sont réunis avec des objectifs divers, dilués dans leurs besoins et obligations personnelles.
Au théâtre, comme dans un lieu de culte, la réunion du groupe a au contraire une visée collective, un objectif unique et dans les deux cas, hautement symbolique parce que c’est une cérémonie du collectif. Pourquoi avoir rouvert l’un et pas l’autre ? Il y a là pour moi erreur de visée, ou simplement opportunisme, satisfaction d’un groupe de pression plus bruyant qu’un autre : un évêque (ou tout autre ministre d’un culte) pèserait-il plus lourd qu’un directeur de théâtre ? Pas pour moi. Car tous deux représentent des institutions sociales et politiques, exclusivement humaines et produits de l’humanité, de droit humain et non divin. Il est donc indispensable d’affirmer sans cesse la nécessité des salles, la nécessité d’une réunion sociale, la nécessité de la cérémonie du spectacle, en obéissant bien évidemment aux contextes imposés par le Covid.
Naissance d’un nouvel espace
Il reste qu’en dehors de la fonction première des théâtres qui est de représenter en public une œuvre, le numérique fait naître un nouvel espace dans les structures de spectacle vivant, en dehors de la fonction sacrale de la représentation. Un espace d’exploitation profane qui nécessitera sans doute des transformations diverses que nous allons essayer d’entrevoir, car le paysage est pour le moins touffus et contrasté, en France et ailleurs, selon les institutions et selon les genres.
– En France, la danse qui y est un genre bien plus développé et populaire qu’ailleurs, est plutôt assez bien pourvue avec la plateforme numéridanse, portée par la Maison de la Danse de Lyon. Tous les genres du spectacle vivant devraient en prendre de la graine.
– Rien de comparable sur le théâtre parlé, alors que le genre est l’un des emblèmes proclamés de la soi-disant identité culturelle française. Il suffit faire l’expérience de l’accessibilité du fonds de la Comédie Française : allez donc si vous en avez envie, chercher à regarder la Bérénice mise en scène par Klaus Michael Grüber avec Didier Sandre et Ludmila Mikael (diffusée une fois pendant le premier confinement)… Sans doute y-a-t-il en arrière-plan des problèmes de droit et de propriété intellectuelle, mais aussi de lieux de dépôt et d’archives. En France, l’INA est dépositaire des archives audio-visuelles de nos institutions nationales et c’est une forêt touffue.
Il reste que la Comédie Française est le théâtre public le plus emblématique, qui a une mission de répertoire et de patrimoine, son site offre d’ailleurs une masse de documents à disposition, images de spectacles, affiches etc.. ; avec des titres transmettre, patrimoine, qui sont effectivement des sources très estimables et très exploitables. L’institution clame d’ailleurs haut et fort ce rôle de conservatoire du patrimoine théâtral. Mais pas de vidéos de spectacles à disposition, en consultation ou même en VOD payante. Il faut pour l’instant acheter les rares DVD en vente sur son site ou sur le site de l’INA.
Les choses ne peuvent aujourd’hui en rester à ce stade. Tout est à repenser.
D’ailleurs, la course aux captations de théâtre est un sport que les professeurs de lettres connaissent bien, avec des coûts d’achats de DVD assez élevés, pour se constituer une vidéothèque de classe ou d’établissement, dans des productions qui ne sont pas toujours inoubliables. Or la multiplication des fonds, la nécessité imposée par le Covid d’accéder à des spectacles enregistrés, l’attente désormais évidente du public amateur, mais aussi professionnel (enseignants, étudiants etc…) montre la nécessité d’organisations plus solides et plus fiables. Un seul exemple : L’Ecole des Femmes de Didier Besace, au programme de l’option Théâtre en Terminale, ne semble plus disponible sinon par extraits, en vidéo. Elle l’était sur la plateforme d’Arte, c’est terminé : Vérifier ici.
Il est clair que la question de l’accessibilité aux archives vidéo du spectacle vivant dans les institutions publiques devra assez vite faire l’objet d’une réflexion globale car la demande va sans doute s’élargir. Et pour l’instant chacun a sa politique. La structure juridique des théâtres publics d’État (EPIC, établissement public industriel et commercial) leur donne une autonomie financière, l’accès au marché, la possibilité de vendre leurs produits, à côté bien sûr d’une mission « éducative » dans leur cahier des charges.
Il faudra sans doute réfléchir à une armature juridique nouvelle sur les droits, les contrats des productions de ces théâtres… L’aventure des retransmissions télévisées de l’Opéra de Paris sous Liebermann est un contre-exemple qui a fait perdre des trésors. Mais surtout, chacun ayant ses pratiques, il faudra simplifier et peut-être modéliser l’accès : c’est pour le quidam une forêt profonde, et pour le professionnel, l’enseignant ou le chercheur par exemple, un parcours à obstacles qui va à l’encontre d’une vraie diffusion culturelle. Un portail commun des archives audio visuelles du théâtre public de type Numéridanse ne serait peut-être pas inutile, mais ça coûte cher… et il est difficile de communiquer là-dessus parce que c’est du travail de fourmi et pas les paillettes habituelles.
Il y a donc deux chemins à ouvrir
- Un travail un peu cohérent sur les archives audio-visuelles des théâtres publics nationaux qui permettent d’arriver à produire un fonds cohérent d’archives, répertorié, organisé, que ce soit à l’Opéra ou dans le théâtre parlé. C’est l’idée du portail.
- Un travail que chaque institution doit mener sur son propre fonds (c’est à dire les productions récentes), selon une méthodologie concertée entre les différents établissements : il suffit de jeter un œil sur le site du TNP, de la Comédie Française, de l’Opéra de Paris et d’autres pour comprendre que tout est à faire.
Et puis il faudra aussi déterminer les accès aux différents usagers, des individuels aux professionnels, les élèves, les étudiants, les publics étrangers, avec une politique de tarification cohérente sinon uniforme.
On pourrait méditer longtemps sur la manière dont le politique considère le monde du spectacle et de la culture. Ce que l’État donne aux institutions qu’il subventionne doit être entendu comme un investissement, au même titre que l’éducation ou la santé. Comme nous ne cessons de le répéter, les théâtres publics sont des institutions qui ont le seul devoir de produire, et désormais aussi un devoir de diffusion élargi par les phénomènes nés de la pandémie, qui contraindront à repenser tous les aspects de la diffusion : droit (s), organisation (s), accessibilité, lisibilité et clarté de l’offre. Ces dispositions doivent être aussi liées aux lieux de conservation, physiques ou numériques, car bien des documents historiques sont aujourd’hui détenus par l’autres (Bibliothèques, INA, fonds divers)[2]. Ces institutions devront orienter leur public curieux vers les détenteurs des documents.
La question de la conservation est à mon avis déterminante : quand une production sort du répertoire, elle devient archive. Où vont les documents, qui la concernent, maquettes, notes, vidéos de travail, retransmissions ?
C’est cette réflexion qui me semble-t-il doit se poser et s’élargir, si l’on veut que le théâtre au-delà d’un lieu de représentation, soit un lieu de stratification culturelle et de savoir. Que le théâtre mette à disposition du public ses spectacles récents, et que les institutions dépositaires des documents historiques les mettent à disposition du public de manière plus aisée selon des règles à définir, cela me semble une nécessité.
Le théâtre comme lieu d’un savoir et d’une histoire
Je plaide depuis longtemps pour une inscription des grandes maisons d’opéra (mais pas seulement) dans leur histoire et dans l’Histoire. Combien de fois dans les pages de ce blog n’ai-je pas pesté contre les pubs pour Citroën ou Chanel dans les foyers de l’Opéra-Bastille au lieu de vieilles affiches, ou documents extraits du très riche fonds de la Bibliothèque de l’Opéra (c’est à dire la Bibliothèque nationale de France) documents, affiches programmes, maquettes de spectacles anciens pourraient agrémenter les espaces publics lamentables de Bastille, et évidemment encore plus ceux de Garnier, dont bien des salons et rotondes n’attendent que ces expositions permanentes d’un passé quand même glorieux.
En une période où l’ignorance historique générale est tout de même surprenante sinon affligeante, l’Histoire semble ne pas être prise en compte ou simplement lue au prisme de l’actualité du jour, c’est à dire souvent à contresens et de manière erratique, il faut que le public qui fréquente ces lieux ait conscience du parcours de ces maisons, de leur épaisseur, de ce qui en fait des structures publiques et des grands symboles nationaux.
Les opéras et théâtres sont des lieux de culture, et financés par l’État ou les collectivités ad hoc, mais aussi des lieux de conservation et de diffusion d’un savoir. Déjà il existe en ligne des archives de certains grands théâtres d’Opéra, comme le MET, comme Vienne, comme la Scala ou Rome, comme Paris (qui ne remonte pas encore au-delà de 1973 cependant), mais aussi comme Lyon. D’autres institutions dont l’histoire est riche (Munich) n’ont pas encore franchi le pas, mais c’est un outil passionnant pour qui s’intéresse en amateur ou en professionnel à l’histoire du spectacle et à l’histoire des lieux qu’il fréquente.
En dehors des archives de la programmation, la constitution d’archives numériques, accessibles à tous soit pour le simple divertissement, soit pour des recherches personnelles ou universitaires est évidemment la conséquence de ce développement subit du spectacle lyrique, ou musical ou théâtral en ligne.
Combien d’archives du ballet de l’Opéra en réserve, combien d’opéras diffusés et de production dont on a déjà la possible disposition? Ce que fait YouTube, pourquoi les maisons d’opéra ne le feraient-elles pas ?
On a vu la Comédie Française sortir de son coffre aux merveilles (chichement) des documents inestimables de son répertoire ou de son histoire des cinquante dernières années pendant le premier confinement.
Il s’agit de constituer simplement des archives en ligne de spectacles passés et présents, pour faire culture, pour faire plaisir, pour faire savoir.
Investir dans de nouvelles formes de création avec le numérique
Mais au-delà de l’archive, et à l’instar du « film opéra » qui a vécu, mais laissé des œuvres assez fascinantes comme le Parsifal de Hans Jürgen Syberberg, ou le Don Giovanni de Joseph Losey, il faudra aussi que les maisons d’opéra – et pas seulement elles, inventent des « produits » spécifiques à voir exclusivement en ligne, ce qu’esquisse un peu timidement la « troisième scène » de l’Opéra de Paris.
Bien sûr on pourrait voir des opéras ou des ballets faits exclusivement pour la transmission (c’était le cas au début de la TV pour du théâtre ou des «dramatiques » dont le Don Juan de Bluwal est un exemple emblématique non encore détrôné) : il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais d’utiliser les formidables possibilités de l’outil pour des réalisations particulières, mais aussi des formats différents, des produits originaux qui puissent séduire le public de demain, car un champ s’ouvre à la création, parallèlement à la programmation en salle. Il ne s’agit pas seulement d’archiver et mettre à disposition des archives, mais d’élargir grâce au numérique la gamme des produits à montrer, réfléchir à d’autres voies de la création pour aller chercher de nouveaux publics qui puissent être séduits par ces nouvelles formes ou formats. C’est un domaine complètement inexploré actuellement, mais que des musiciens, des interprètes ou des managers devraient investir. Il y a là de nouveaux univers à conquérir que tout manager de théâtre devra dans un avenir proche commencer d’explorer.
Conclusion
C’est un lieu commun, mais l’accélération de la diffusion en ligne, par les plateformes ou par tout autre outil, change complètement la physionomie du cinéma et des produits TV (séries etc…) ; on a vu combien la sortie exclusive « en ligne » de films a secoué les habitudes et la profession.
Pour le spectacle « vivant », c’est le même défi qui s’annonce. À la fois pour diffuser des productions de manière plus développée qu’aujourd’hui et donner la possibilité au quidam curieux de voir tous les spectacles d’une saison, pour créer des archives ordonnées accessibles et disponibles pour un public d’amateurs ou de professionnels, mais aussi pour labourer de nouveaux espaces pour la création, espaces esquissés il y a déjà des lustres par des personnalités comme Pierre Schaeffer, fondateur du service de la recherche de la RTF. Mais il ne s’agit plus de faire de la recherche, bien plutôt de créer de nouveaux produits, outils attrayants permettant au public potentiel d’entrer dans un univers chorégraphique, lyrique ou théâtral et au public “captif ” de découvrir aussi de nouvelles formes et pourquoi pas de nouvelles œuvres ad-hoc.
Je ne vois pas une grande institution désormais sans un service audiovisuel développé : dans un contexte actuel de fermeture des salles, on voit de plus en plus les productions naître malgré tout, mais ça reste essentiellement du théâtre filmé. Il reste que la grande nouveauté de l’automne est l’esquisse d’une sorte de continuité productive. C’est cette continuité qu’il faut inventer avec le numérique, pour qu’on aille au-delà du spectacle filmé et qu’on invente de nouveaux produits, de nouveaux formats, de nouvelles interactions avec le public. Tout est ouvert, et il ne faut pas attendre le prochain virus.
[1] Que je découvris sur un immense écran à Garnier lors d’une projection spéciale.
[2] Le TNP a remis ses archives à la Bibliothèque nationale de France en 2003, et ses archives audiovisuelles à l’INA en 2006.