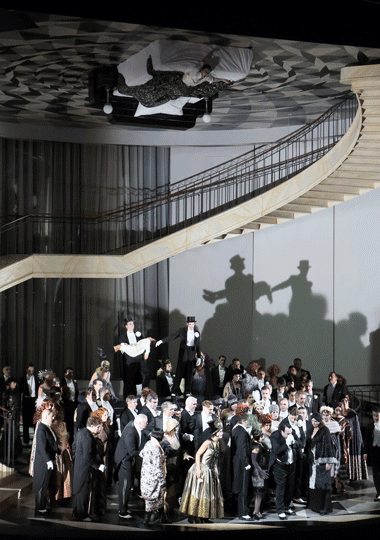Photos de l’édition 2015-2016 (Juin 2016) ©Judith Schlosser
Le hasard a voulu qu’entre un Requiem de Verdi scénique et un Entführung aus dem Serail sans sérail ni dialogues de David Hermann qui excitait ma curiosité (voir le site Wanderer), Zürich affichait une première reprise de la très récente production (2016) d’Andreas Homoki de I Puritani de Bellini. Comme il arrive quelquefois dans les représentations de répertoire, on annonce une Elvira (en l’occurrence Nadine Sierra) et c’est une autre qui chante, une chanteuse totalement inconnue, venue de république tchèque mais issue de l’Opéra Studio du Comunale de Bologne, Zuzana Markóvá, la trouvaille de la soirée. Pour le reste, une représentation de haute tenue, avec Javier Camarena dans Lord Arturo Talbo, George Petean dans Sir Riccardo Forth et Michel Pertusi dans Sir Giorgio. C’est à dire du très beau monde.

La production de Andreas Homoki était dirigée la saison dernière par Fabio Luisi et interprétée par la jeune sud-africaine Pretty Yende, nouvelle coqueluche des scènes (elle a récemment triomphé dans Lucia à Paris), Lawrence Brownlee, et déjà Michele Pertusi et George Petean. La mise en scène à décor unique, comme souvent chez Homoki, ici un énorme cylindre installé sur un plateau tournant, laisse apparaître des images successives, soit réelles, soit fantasmées pendant que l’intrigue se déroule sur le proscenium, autour du cylindre fait de lattes noires à l’extérieur et éclairées violemment à l’intérieur: un décor très essentiel, de bois avec quelques chaises et des cierges quelquefois, qui correspond à l’idéal de simplicité et de religiosité qu’on suppose être celui des puritains.

La scène s’ouvre sur un couple, qu’on comprendra plus tard être le couple royal, pourchassé, puis pris, l’homme (Charles 1er) est supplicié et décapité, la femme prisonnière et violée, images de guerre civile ordinaire, qui se répèteront durant l’opéra, avec ses monceaux de cadavres et ses femmes pendues.
À ce contexte politique violent et sanguinaire s’ajoute le conflit privé qui fait l’intrigue réelle : aussitôt après la scène d’ouverture, place aux joies d’un mariage, mais à la vue de son futur, la jeune fille (Elvira) fuit et se réfugie dans les bras de son oncle qui lui explique que finalement son père a cédé à ses prières et qu’elle pourra épouser celui qu’elle aime, Lord Arturo Talbo (Javier Camarena), du clan ennemi défenseur des Stuart. On comprend alors que la scène de mariage était un cauchemar que la jeune fille refusait de vivre.
Les conflits politique et privé, traités par la mise en scène sur le même plan, opposent Lord Arturo Talbo (ténor) partisan des Stuart et Sir Riccardo Forth (baryton, George Petean), chef des puritains qui soutiennent Cromwell. C’est que baryton (méchant) et ténor (gentil) aiment Elvira, et le méchant baryton va vivre sa jalousie en jouant des conflits politiques, cherchant à perdre le ténor-gentil en profitant de la position de faiblesse des défenseurs des Stuart.
Quand Arturo reconnaît en la prisonnière violée de la première scène la Reine Henriette de France, son sang (noble) ne fait qu’un tour et il entreprend de la sauver, au péril de sa vie, et surtout de son mariage : il fuit avec la reine avant même la cérémonie, mais sur le chemin ils croisent le méchant Riccardo, qui, croyant en une fuite amoureuse, les laisse partir, ravi de l’aubaine.
Voilà l’intrigue : Arturo est poursuivi, pour trahison d’état et pour trahison privée : la jeune promise sous le coup devient folle, et Riccardo va chercher à en tirer avantage pour se débarrasser du rival. Il reste que l’oncle, Sir Giorgio (Michele Pertusi) essaie de calmer les esprits, de ramener Riccardo a des sentiments plus humains et de protéger sa nièce sans succès.
Arturo revient, et tout semble se résoudre, mais Riccardo malgré l’ordre de clémence venu de Londres envers les défenseurs des Stuart fait décapiter Arturo: la scène initiale qu’on avait vu pendant le prologue se répète, mais les motivations ne sont plus celles, politiques d’une guerre civile, mais des motivations d’ordre privé : un simple drame de la jalousie.
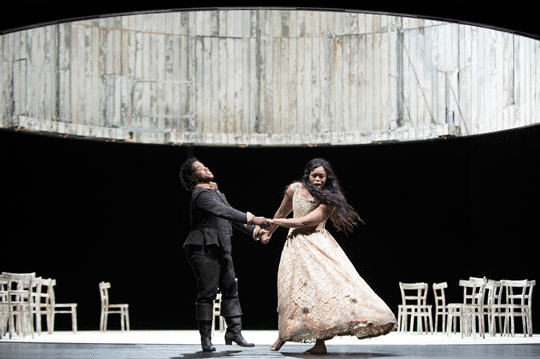
Public et privé, tout se mélange comme souvent à l’opéra, mais dans une sorte de linéarité marquée par une mise en scène répétitive : le cylindre conçu par Henrik Ahr ne cesse de tourner, laissant voir des scènes réelles ou fantasmées, des montées d’images au sens psychanalytique, pendant que l’intrigue au-devant de la scène se déroule d’une manière très traditionnelle et conforme, tandis que les costumes de Barbara Drosihn, noir uniforme pour les hommes, beige et jaunâtre pour les femmes, donnent une image d’uniformité assez cohérente avec le monde du puritanisme et l’ascétisme du décor.
La mise en scène est plutôt faite de ces images, et moins de prises de position dramaturgique, sauf la fin tragique où au happy end traditionnel, Homoki substitue la tragédie, où le méchant a vaincu. Le goût de la vengeance est plus doux encore que l’amour.
Rien de bien dérangeant dans cette mise en scène qui laisse le drame se dérouler et les chanteurs prendre la main, comme attendu dans la plupart des mises en scène de bel canto romantique.
Comme certaines œuvres du jeune Verdi ou la plupart des opéras romantiques, les choix de mise en scène sont délicats : l’approche Regietheater se heurte à des livrets la plupart du temps assez passepartout et conformes et les mises en scènes sont souvent réduites à un habillage plus ou moins habile : dans ce répertoire, le public ne vient pas pour la mise en scène, même pas pour le chef mais pour les chanteurs.
À écouter cette œuvre, la dernière de Bellini, pour le Théâtre Italien de Paris en 1835 quelques mois avant sa mort, on reste stupéfait de la manière dont l’histoire est racontée, dont la musique sonne avec une couleur souvent pré-verdienne. A dire vrai, on constate combien Verdi a puisé dans ces ensembles, dans ces cabalettes rythmées, dans ces marches (Suoni la tromba, par exemple) et qu’au moins dans les premières années, il n’invente rien que Bellini n’ait déjà inventé. On est en effet toujours frappé par la variété, la vivacité de cette musique, par son énergie aussi, et par l’impossible qui est demandé au quatuor vocal principal (soprano, ténor, baryton et basse).
Le rôle d’Arturo est sans doute le plus tendu du répertoire romantique avec ses aigus stratosphériques et Javier Camarena stupéfie par son aisance, par la qualité du phrasé, par l’intensité du chant et par la chaleur du timbre (un A te o cara étourdissant, tout comme credeasi misera). La voix n’a aucune faille, et le timbre n’est jamais nasal comme c’est quelquefois le cas, avec une simplicité dans l’émission qui laisse confondu et une très grande modestie dans les attitudes : il n’a certes pas des qualités d’acteur exceptionnelles, mais pas moins que la majorité des chanteurs. Le chant est à un tel niveau de perfection qu’on peut largement compenser et même dépasser. De toute manière, la mise en scène laisse chacun gérer sans vraiment travailler les caractères des personnages, qui demeurent sculptés dans la tradition de l’opéra italien ordinaire. Javier Camarena a en tous cas une sûreté et une pureté de timbre qui laisse rêveur, c’est sans doute aujourd’hui l’un des meilleurs, sinon le meilleur belcantiste qu’on puisse trouver.
Sous ce rapport, George Petean n’est pas non plus une référence en matière de jeu : c’est un jeu habituel de méchant d’opéra, et indifféremment du rôle, les gestes et attitudes sont les mêmes : mais là aussi, le contrôle sur la voix et le volume sont tels qu’on peut fermer les yeux. Petean néanmoins a sans doute une couleur plus verdienne que belcantiste ; tout en soignant le contrôle et la diction, son chant n’a pas tout à fait l’élégance requise : c’est un peu plus lâché que retenu. Néanmoins, ce baryton devient l’un des incontournables de la scène lyrique, sans bruit mais avec constance et régularité : il avait déjà impressionné dans Renato du Ballo in maschera à Munich. Mais il faut ici un peu moins de feu verdien.
C’est Michele Pertusi qui est Sir Giorgio. Le personnage le plus positif de l’œuvre, humain, ouvert, modéré. Pertusi s’est spécialisé dans les basses rossiniennes et belcantistes, parce qu’il a une technique de fer, un beau contrôle, et que cette technique lui permet de durer dans des rôles souvent exposés. Je le suis depuis la fin des années 80, et il a immédiatement été l’un des chanteurs rossiniens de référence, notamment dans les opéras seria. La voix n’a peut-être plus tout à fait l’éclat d’antan ni le timbre sa singularité, mais il reste un des chanteurs les plus intenses dans ce répertoire et des plus justes. Les ensembles avec Riccardo et notamment le duo Suoni la tromba font un effet encore marqué sur l’auditeur. Pertusi y est exceptionnel. C’est en tous cas une garantie pour le style et le respect de l’œuvre.
C’était la jeune Nadine Sierra qui devait succéder à Pretty Yende dans Elvira, le mystère des remplacements a encore frappé, et c’est une autre jeune chanteuse, Zuzana Markóvá, née à Prague, issue de l’Opéra Studio de Bologne, et donc préparée au répertoire italien qui assume le rôle difficile d’Elvira, sur qui repose grande part de l’opéra. La voix n’est pas très grande, mais cette jeune femme a une véritable présence scénique, c’est une très belle actrice et elle donne au rôle une formidable présence dramatique, elle sait passer de la jeune fille heureuse et légère qui va épouser son aimé à la femme dont l’âme est ravagée en un instant, et avec la même crédibilité et le même pouvoir sur le spectateur. La voix est petite, mais la salle de Zurich aux dimensions moyennes est idéale pour ce répertoire qui nécessite un rapport scène-salle particulier, avec ce qu’il faut de distance et ce qu’il faut de proximité. Les salles pour le bel canto romantique, à part quelques notables exceptions, n’étaient pas si grandes, et les voix à Zurich sonnent parfaitement…Ce n’est pas un hasard si Cecilia Bartoli en a fait sa salle d’opéra quasi exclusive.
Une voix plus petite peut donc parfaitement convenir, et celle de Zuzana Markóvá passe sans mal, grâce à une très belle technique, un vrai contrôle sur la voix, une grande homogénéité dans les passages, et un aigu qui est d’abord contenu mais qui se propage et s’affirme pour se déployer de belle manière. Pas de problème particulier d’agilités (elle chantera bientôt Traviata à Palerme). La scène de la folie est parfaitement dominée, avec un pouvoir d’émotion réel et une vraie prise sur le public. La scène du dernier acte avec Arturo, qui ménage des moments très élégiaques mais aussi une vraie tension, est magnifiquement réussie. Le résultat : un triomphe auprès du public présent, très mérité. Voilà une chanteuse qui utilise ses ressources d’actrice pour affirmer de réelles ressources de chanteuse, pour une artiste aussi jeune, c’est vraiment très prometteur : la voix s’accorde parfaitement à celle de Camarena, et on passe donc avec eux deux une soirée exceptionnelle.

Le reste de la distribution soutient bien le niveau d’ensemble, même si les rôles sont vraiment épisodiques, Diana Haller, jeune chanteuse encore, en Enrichetta di Francia a un beau mezzo, la voix d’une vraie rondeur sans aspérités porte, et elle se distingue dans les ensembles. Les autres, Stanislas Vorobyov (Lord Gualtiero Valton) et Otar Jorjikia (membre de l’Opéra Studio, qui chante Sir Bruno Robertson) sont aussi de bon niveau et donnent à l’ensemble de la distribution une réelle homogénéité.
Le chœur dirigé par Ernst Raffelsberger est particulièrement juste, malgré des exigences scéniques qui le font se déplacer souvent, autour du décor ou dedans : il se prête aux besoins de la mise en scène, et sonne magnifiquement, après avoir la veille chanté le Requiem de Verdi : très belle performance dans un opéra qui exige des masses chorales impeccables.
C’est Enrique Mazzola qui prend la succession de Fabio Luisi dans la fosse, et l’on connaît à la fois l’affinité, mais aussi la technique impeccable de ce chef dans ce répertoire : pas une faute de rythme, une pulsion permanente, un souci de ne jamais couvrir les chanteurs même là où on lui pardonnerait (Suoni la tromba), et un orchestre très clair et très lisible. J’aurais peut-être apprécié moins d’aspérités quelquefois, qui rendent cette approche un peu froide : la mélodie bellinienne réussit néanmoins à se déployer dans les passages plus lyriques.
Un peu à distance au premier acte, je me suis laissé séduire par cette nervosité et cette tension, qui n’oublie jamais l’opéra, le livret et les capacités réelles des chanteurs. Le chef obtient un grand succès, dans l’ensemble mérité.
Entre deux représentations assez exceptionnelles par leur nouveauté s’est glissée une soirée dite de répertoire. Si le répertoire était aussi bien traité partout, le niveau des salles serait totalement hors normes. I Puritani est l’une des œuvres de la période les plus difficiles à produire, car c’est un opéra très difficile pour les voix. L’Opernhaus Zürich a relevé le gant, et confirme d’être l’une des toutes premières scènes d’Europe.[wpsr_facebook]