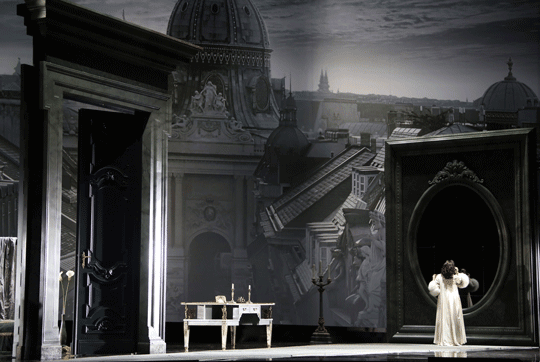
On connaît ce beau spectacle d’Harry Kupfer présenté à Salzbourg en 2014 et repris la saison dernière. Il arrive cette saison à la Scala, par la vertu des opérations Salzbourg-Milan tant reprochées à Alexander Pereira, mais qui valent d’avoir là sans doute l’un des meilleurs spectacles de la saison.
Et pourtant, et c’est stupéfiant à constater, la salle était à moitié vide (au moins la Platea) et bien des loges inoccupées. Certes, l’augmentation massive des prix des billets (jusqu’à 300 €, le prix le plus élevé d’Europe) y est sans doute pour quelque chose, mais on n’a jamais vu la Scala aussi désertée. Tous le constatent, il y a un problème de public à Milan, dû sans doute à la structure de ce public, composé essentiellement de population locale (dans un rayon de 2 km disait Stéphane Lissner) et non comme on le croit trop souvent, de touristes qui se précipiteraient.
L’augmentation du nombre de représentations n’a pas ouvert à d’autres spectateurs, dans la mesure où l’augmentation des prix décourage les éventuels candidats et où la politique culturelle de l’état italien, depuis Berlusconi, a démobilisé pas mal les publics potentiels.
Il est plus difficile de reconquérir le public que de vider les salles. Certes, l’opéra reste le genre roi en Italie, mais tous les habitués de la Scala constatent, malgré des spectacles de bon niveau, que la salle n’est pratiquement plus jamais pleine, et que l’on brade les billets les deux ou trois derniers jours avant les représentations. Ce n’est pas seulement la Scala qui est en cause, d’autres institutions dans d’autres pays vivent les mêmes problèmes, mais c’est particulièrement sensible dans une salle qui il y a quelques années encore affichait régulièrement complet. L’opéra serait-il en danger?
Il reste que le spectacle présenté, dirigé par Zubin Mehta, l’un des mythes de la direction d’orchestre, constitue une des grandes réussites de la saison. Der Rosenkavalier ya été assez souvent représenté à la Scala depuis 1952 (Herbert von Karajan avec Elisabeth Schwartzkopf), en 1961 (avec Karl Böhm et toujours Schwartzkopf – et Ludwig), en 1976 (avec Carlos Kleiber et le trio Lear, Popp, Fassbaender), en 2003 (avec Jeffrey Tate et Adrianne Pieczonka), et enfin en 2010 (avec Philippe Jordan et Anne Schwanewilms et Joyce Di Donato dans la production de Salzbourg d’Herbert Wernicke). Trois productions en 13 ans, le rythme s’accélère et montre la popularité du titre.
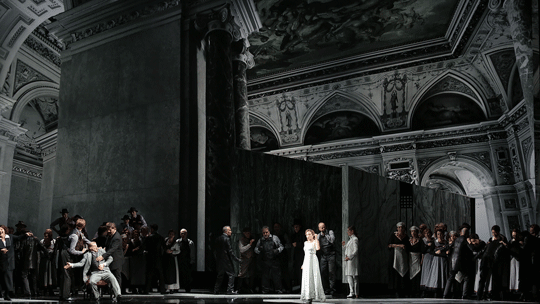
Harry Kupfer, ultra-octogénaire, vient de l’école de l’Allemagne de l’Est où il a travaillé dans de nombreux théâtres de la DDR, pour devenir entre 1981 « Chefregisseur » de la Komische Oper, dont il restera le directeur artistique jusqu’en 2002. Alexander Pereira, homme de fidélités artistiques, a fait appel à lui pour plusieurs mises en scène à Zürich, dont Die Meistersinger von Nürnberg (qu’on verra la saison prochaine à la Scala), et une fois à Salzbourg, l’a appelé de nouveau pour ce Rosenkavalier qui a fait les beaux soirs du Festival, dont l’œuvre est un pilier. La mise en scène installe l’intrigue à l’époque de la création (1911), dans une Vienne « fin de siècle » monumentale, la Vienne de François-Joseph, c’est à dire aussi la Vienne « fin d’Empire ». Discrètement, et sans insister, avec une certaine finesse, Kupfer raconte un peu la même histoire que celle de « Il Gattopardo », à savoir la fin de la domination de la noblesse au profit de la bourgeoisie, et l’obligation aux mésalliances pour survivre. L’image de Faninal, très bien interprété par Adrian Eröd, très juste en personnage dépassé et encore soumis aux caprices d’un Ochs pour une fois élégamment vêtu, rajeuni, plus sûr de son statut que mal éduqué, et finalement lui aussi un peu anachronique dans son sens des rapports humains qui ne considère pas l’évolution des relations sociales. C’est cette élégance dans la manière de dire les choses, accompagnée par une précision particulière dans le travail sur les personnages, Ochs bien sûr et Faninal, mais aussi la Maréchale, très retenue, réservée, déjà presque maternelle, dont Kupfer saisit « l’attimo fuggente », l’instant fugace qui la fait basculer dans la maturité. J’ai évoqué ce travail dans deux articles sur le Festival de Salzbourg, en 2014 et en 2015 , où la dominante est la nostalgie : nostalgie d’une Autriche dominante en Europe et dont l’architecture viennoise monumentale affirmait la puissance, nostalgie d’un monde où tout semblait facile et souriant, nostalgie aussi au second degré de la Vienne du XVIIIème, celle de l’impératrice Marie-Thérèse, dont la Maréchale porte justement le prénom et qui fait aussi rêver Milan qui lui doit bien des palais. De ce monde souriant et apaisé, que resterait-il quelques années après ? Que resterait-il de ce monde qui allait à la guerre comme un somnambule (pour reprendre le titre d’un fameux livre de Christopher Clark).
Mais c’est aussi musicalement que cette production désormais scaligère frappe ce soir. Habilement, Alexander Pereira a repris pour les rôles principaux la même distribution qu’à Salzbourg, excepté Sophie incarnée ici par Christiane Karg, vue à Dresde il y a deux ans sous la direction de Thielemann avec Anja Harteros, qui est un choix particulièrement bien ciblé pour composer une des meilleures distributions de l’œuvre aujourd’hui.
Krassimira Stoyanova est désormais une Maréchale qui compte dans le paysage lyrique. Elle était un peu hésitante, pas trop à l’aise avec le répertoire allemand il y a deux ans. Elle, que Bayreuth avait appelé pour Eva l’an prochain dans Meistersinger, – invitation déclinée- se refuse à abandonner les rôles italiens qui ont fait sa réputation. Néanmoins, le rôle de la Maréchale lui va parfaitement, et elle le domine pleinement désormais. On la sent beaucoup plus à l’aise, complètement maîtresse d’un texte qui exige inflexions, nuances, couleurs. La voix colle parfaitement au rôle, une voix magnifique, modulée, expressive, et qui donne au personnage à la fois une distance aristocratique, mais aussi une bonhomie particulière. J’évoquais plus haut une couleur un peu maternelle, c’est à dire un basculement vers la maturité. Krassimira Stoyanova dit tout cela, et sa réserve naturelle en scène convient parfaitement au personnage que Kupfer dessine, marqué par la discrétion et une relative distance aristocratique. Rien de démonstratif, mais de petites touches, une allure, un port qui finissent par en imposer. Vraiment la Stoyanova est désormais une grande Maréchale.
Effet de l’acoustique, rapport orchestre-plateau différent, volume de l’orchestre, on ne sait qu’imputer à une prestation de Sophie Koch moins froide et convenue qu’à Salzbourg. La voix qui est grande semble plus retenue, le personnage plus naturel, plus fluide : de toutes les soirées où je l’ai vue en Octavian, celle-ci est sans aucun doute la meilleure : c’est Octavian, sans aucune réserve, avec ses réactions brusques, son côté à la fois jeune et farouche, sa tendresse aussi. La voix est toujours là, bien sûr, mais le volume est plus contrôlé, plus maîtrisé. Il est vrai qu’à Salzbourg, Welser-Möst imposait un rythme et un volume tels qu’elle se sentait contrainte de pousser en permanence. Rien de tel ici. Elle est vraiment un Octavian de premier plan.
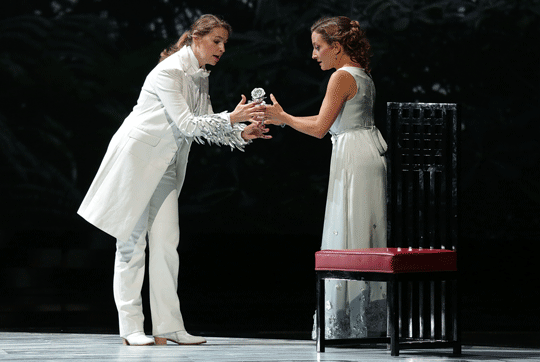
Christiane Karg était Sophie, cette chanteuse attachante a été ici la meilleure Sophie des trois (avec Mojka Erdmann en 2014 et Golda Schultz en 2015) vues dans cette production. Il y a dans ce chant la légèreté, le contrôle, la poésie, la fraîcheur : c’est elle qui se rapproche le plus de ma regrettée et préférée Lucia Popp, inégalée dans le duo de l’acte II. J’aime surtout sa spontanéité et son naturel, qui se lit aussi bien dans le chant que dans l’attitude scénique. Une Sophie de référence.
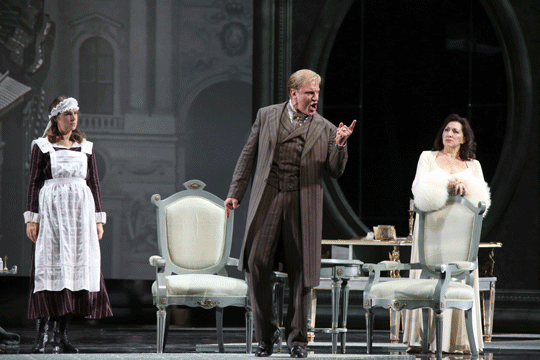
©Brescia/Amisano
Revenir sur Günther Groissböck en Ochs, c’est souligner la nouveauté de cette interprétation et de la vision du personnage. Habituellement – et l’Ochs le plus fréquent des années précédentes, Peter Rose (excellent au demeurant), en était la preuve – Ochs est un hobereau ignorant des règles policées de la vie aristocratique citadine. L’Ochs de Groissböck est vocalement remarquable, comme toujours dans les rôles qu’il aborde, beau timbre, voix puissante, volume, contrôle, intelligence du texte. Mais c’est surtout le personnage qui évolue, plus jeune, moins brutal, mieux habillé, mais en décalage par rapport aux usages et à la situation sociale du moment. Un Ochs hobereau vulgaire convenait au XVIIIème, l’Ochs de Groissböck refuse de voir les évolutions du XXème siècle et de la situation de l’Empire, refuse de voir que l’aristocratie ne peut plus faire « comme si », et Kupfer a bien cerné le personnage, plus obtus que vulgaire : voulant épouser Sophie par besoin financier, il représente cette relation typiquement aristocratique à l’argent dans l’ancien régime, qui se dépense sans se gagner, au contraire de ce que représente Faninal, la réussite et l’argent gagnés par le travail, la bourgeoisie besogneuse qui explose au XIXème siècle.
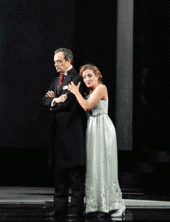
On croirait justement Faninal conçu directement en fonction d’Adrian Eröd, l’interprète du jour. Physiquement par son physique plutôt malingre il s’oppose à Groissböck, grand gaillard musclé. A cette opposition physique correspond aussi une opposition vocale, de volume et de couleur. Eröd n’a pas une voix volumineuse et on le lui a reproché dans cette production, même si Welser Möst dirigeait très fort. Mais il a un contrôle et une élégance du chant qui tranche avec un Ochs qui porte bien son nom vocalement ( le bœuf). Et donc l’opposition entre les deux personnages est bien construite, juste scéniquement et vocalement. Eröd est un artiste intelligent qui sait ce que texte veut dire et la direction de Mehta n’étouffe pas sa voix. Comme d’habitude, la prestation est très satisfaisante. J’apprécie ce chanteur qui incarnait à Bayreuth un Beckmesser très intéressant il y a quelques années.

Der Sänger, le chanteur italien, est évidemment un petit rôle, mais confié dans tous les enregistrements à des ténors très célèbres, qui aident à faire vendre. De fait, le bref épisode du chanteur italien est quasiment un “pezzo chiuso” puis pezzo “interotto” qui dérange, comme pour empêcher l’artiste de monter à l’aigu. Et l’air n’est pas si facile : je me souviens de Marcelo Alvarez distribué à la Scala dans la production Wernicke s’écrabouillant de belle manière, sans élégance, sans style, sans ligne.
Benjamin Bernheim donne ici une preuve supplémentaire de la qualité de son chant. On l’a noté dans Cassio de l’Otello de Salzbourg à Pâques avec Thielemann où il a remporté un vrai succès personnel (et justifié car il était le meilleur du plateau). Il est ici un chanteur italien vraiment impeccable : élégance, ligne, contrôle du souffle, style, mais aussi puissance et phrasé. Il serait temps de l’entendre dans des rôles plus importants. C’est vraiment un chanteur digne de la plus grande attention.
Et tous les rôles secondaires sont tenus remarquablement, parce qu’ils donnent vraiment l’impression d’une troupe , ce qui est singulier à la Scala, et qu’ils se sentent à l’aise. À commencer par Annina ( Janina Baechle) et Valzacchi (Kresimir Spicer) dans une belle composition et avec une vraie présence. Les interventions de Janina Baechle à l’acte III sont vraiment claires marquées d’un aigu puissant et d’un bel allant. Même chose, en un peu plus pâle de la Marianne Leitmetzerin de Silvana Dussmann . Le Polizeikommissar de Thomas Bauer s’en tire bien, même si il n’a pas la présence de Tobias Kehrer à Salzbourg. Seule ombre au tableau, les interventions des trois orphelines, issues de l’accademia di perfezionamento del Teatro alla Scala, sont décalées, mal coordonnées, pas en mesure et les voix fusionnent mal : cela gêne vraiment beaucoup.

Mais l’ensemble de la distribution répond quand même à l’exigence d’un Rosenkavalier de grand niveau, à quelques détails près, parce qu’il y a un maître d’œuvre qui s’appelle Zubin Mehta. Il aborde l’œuvre avec un tempo plus lent que Welser Möst, mais tellement moins agressif, tellement plus rond, laissant tellement respirer les chanteurs que la couleur change complètement. Il y a dans cette manière de lire la partition quelque chose d’indulgent, de souriant qui frappe. Je dirais presque qu’il y a correspondance entre la couleur de l’interprétation de Krassimira Stoyanova et la couleur de cette direction, précise, mais chaleureuse et charnue.
La deuxième observation est l’extraordinaire clarté de cette lecture et le relief donné à certains pupitres, notamment les bois, favorisés par l’acoustique de la Scala, avec une fosse assez haute, mais au rendu sonore irrégulier, notamment en platea. Pour en juger encore mieux il eût fallu être en hauteur où le son est très différent et plus “fondu”. Il reste que la performance de Mehta, avec une respiration peu commune, laissant au chanteur un confort inédit, est singulière et séduisante, avec une vraie personnalité. On sent un plateau à l’aise et détendu, et une direction maîtrisée et intelligente qui construit la cohésion de l’ensemble.
On aura compris que cette soirée fut une très belle soirée, qui permet de redécouvrir la qualité d’un chef protéiforme quelquefois discuté, voire méprisé par certains, et de confirmer celle d’une production qui mériterait d’entrer au répertoire pour quelque temps, car dans son apparent classicisme et sa précision, elle raconte beaucoup de l’œuvre. Kupfer est décidément un metteur en scène encore surprenant. Mehta a 80 ans, Kupfer un peu plus. Et leur travail a une vraie jeunesse et une vraie fraîcheur. C’est dans les vieux pots…[wpsr_facebook]
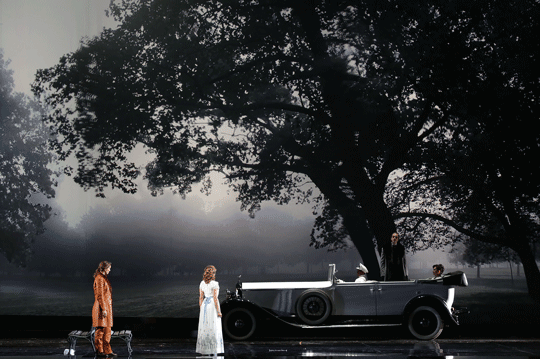



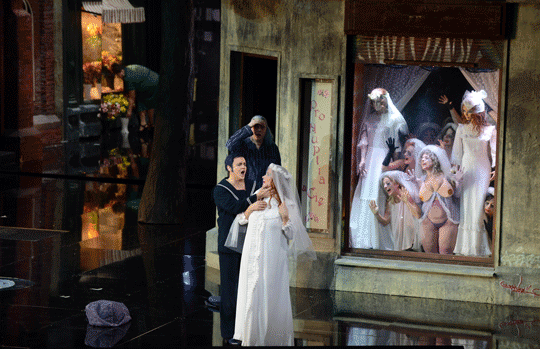
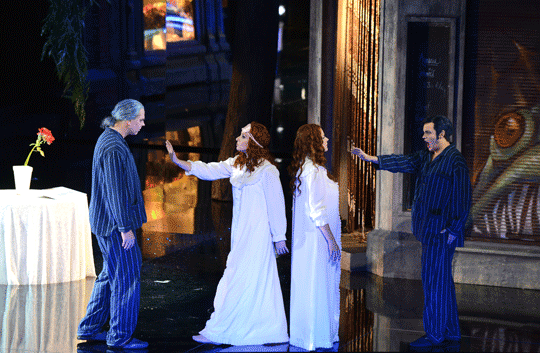
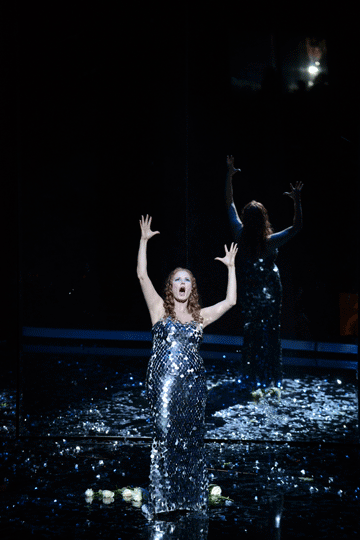
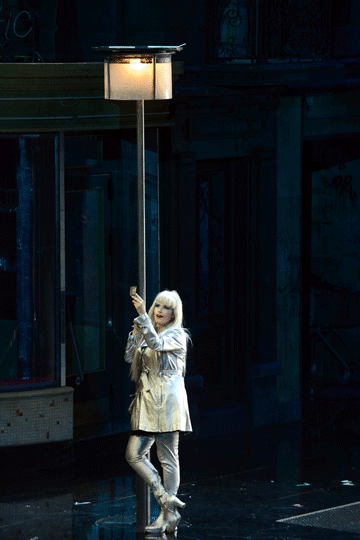


 Il y a dans l’oeuvre des scènes fortes musicalement à commencer par la scène du train très bien réalisée, où Lydia lit des extraits d’Alice au pays des merveilles qu’Anna reprend en corrigeant la traduction, mais aussi la scène des universitaires anglais où Anna Akhmatova récite le bréviaire stalinien pour éviter de créer des ennuis à son fils arrêté, qui passe bien théâtralement, ainsi que le duo final avec Lev. Si j’ai trouvé la musique répétitive et un peu lassante, la production dans son ensemble reste très attentive, Pascal Rophé a fait un très beau travail avec l’orchestre, important, mais qui sonne tantôt de manière proche de la musique de chambre, tantôt envahit tout en éruption sonore, Mantovani le précise d’ailleurs dans le programme “même si l’orchestre reste fourni, j’ai privilégié un traitement de chambre, qui va bien sûr dans le sens de l’intimité”. Il dit aussi essayer de donner une couleur russe, dans le traitement des choeurs, inspirés de Rachmaninov, ou l’utilisation de l’accordéon. Il dit enfin privilégier les registres graves. Il reste que le spectateur a souvent l’impression d’entendre toujours la même musique, c’est peut-être voulu (comme une sorte de litanie), mais cela n’aide pas à capter l’attention.
Il y a dans l’oeuvre des scènes fortes musicalement à commencer par la scène du train très bien réalisée, où Lydia lit des extraits d’Alice au pays des merveilles qu’Anna reprend en corrigeant la traduction, mais aussi la scène des universitaires anglais où Anna Akhmatova récite le bréviaire stalinien pour éviter de créer des ennuis à son fils arrêté, qui passe bien théâtralement, ainsi que le duo final avec Lev. Si j’ai trouvé la musique répétitive et un peu lassante, la production dans son ensemble reste très attentive, Pascal Rophé a fait un très beau travail avec l’orchestre, important, mais qui sonne tantôt de manière proche de la musique de chambre, tantôt envahit tout en éruption sonore, Mantovani le précise d’ailleurs dans le programme “même si l’orchestre reste fourni, j’ai privilégié un traitement de chambre, qui va bien sûr dans le sens de l’intimité”. Il dit aussi essayer de donner une couleur russe, dans le traitement des choeurs, inspirés de Rachmaninov, ou l’utilisation de l’accordéon. Il dit enfin privilégier les registres graves. Il reste que le spectateur a souvent l’impression d’entendre toujours la même musique, c’est peut-être voulu (comme une sorte de litanie), mais cela n’aide pas à capter l’attention. Photo Elisa Haberer/Opéra National de Paris
Photo Elisa Haberer/Opéra National de Paris Photo Elisa Haberer/Opéra National de Paris
Photo Elisa Haberer/Opéra National de Paris Photo Elisa Haberer/Opéra National de Paris
Photo Elisa Haberer/Opéra National de Paris