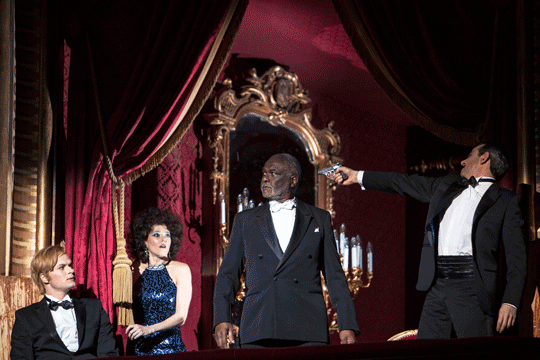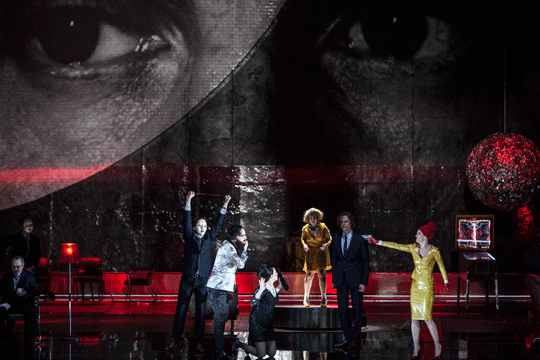Depuis le développement des recherches éditoriales sur Offenbach, depuis la publication des Contes d’Hoffmann revus par Jean-Christophe Keck, la curiosité se focalise sur certaines productions du Mozart des Champs Elysées. Et voilà que l’Opéra de Lyon pour les Fêtes de fin d’année exhibe des cartons une œuvre d’Offenbach totalement inconnue, Le Roi Carotte, jamais repris depuis les premières séries de représentations qui remonte à 1872, une fable légumineuse sur le pouvoir, sur un livret de Victorien Sardou, accueillie triomphalement à Paris, puis à Londres, à New York, à Vienne, et qui a disparu des scènes en 1877 parce que trop coûteuse à monter. Pensez donc, à peu près 6h de spectacle, 40 rôles différents, des centaines de figurants, des décors monstrueux, une sorte de féérie jamais vue, d’autant plus féérique qu’un an après la défaite de la guerre de 1870, la France a besoin de rire, et en particulier Paris, moins d’un an après la Commune.
143 ans après la première, l’Opéra de Lyon a décidé de proposer Le Roi Carotte, profitant d’une nouvelle édition, de Jean-Christophe Keck, dans une version revue par Agathe Mélinand pour la mise en scène de son complice de toujours Laurent Pelly.
Bien sûr, une renaissance après tant de temps eût justifié de monter la version originale, ou à défaut celle allégée revue par Offenbach, d’environ 3h. La version d’Agathe Mélinand est plus réduite encore (2h15 avec entracte). Il faudrait attendre un Festival pour remonter le oser spectacle dans la version originale, qu’un opéra en saison peut difficilement assumer vu les dimensions. Je pense que les polémiques éventuelles sur les coupures sont inutiles, cette série de représentations ne manquera pas de mettre la focale sur l’œuvre et gageons (ou espérons) que Lyon ne soit que la première d’une série de propositions.
En effet, comment gérer, à l’heure de Star Wars, l’opéra féérique ? Il est clair qu’en 1872, les moyens de théâtre étaient différents et que le public avait d’autres habitudes et d’autres attentes. Il est difficilement pensable de proposer les six heures, à moins de réécrire complètement le livret en l’actualisant (car l’essentiel des six heures est du texte parlé). Déjà, les allusions mythologiques et les jeux de mots de La belle Hélène ou d’Orphée aux Enfers échappent à un public qui a bien moins de références classiques qu’alors, imaginons le cas du roi Carotte avec ses allusions politiques, c’est un travail d’orfèvre à confier à un chansonnier.

Enfin, 3 heures de spectacle correspondent presque à certains opéras de Wagner, c’est dire que c’est déjà un ensemble très lourd. Gageons que le choix d’Agathe Mélinand et de Laurent Pelly se justifie par l’économie de la pièce et par la réception d’une telle production pour le public d’aujourd’hui.

Ces deux heures quinze suffisent quand même à donner une très bonne idée d’ensemble et de vérifier que ce Roi Carotte est du grand Offenbach, mené d’une main sûre par le jeune chef Victor Aviat, un jeune hautboïste remarqué, qui entame une carrière de chef en remportant en 2014 le Nestlé and Salzburg Festival conductors award. Avec un sens théâtral marqué, un sens du rythme et de la pulsation très affirmé, il imprime une dynamique communicative à l’orchestre avec un son clair, une lecture particulièrement entrainante et l’orchestre de l’opéra le suit, sans scorie aucune, ainsi que le chœur bien préparé de Philip White, alerte, vif, très en verve. Il y a une tradition bien installée d’Offenbach à l’Opéra de Lyon, et cela se sent, tant l’ensemble des forces a cohérence et énergie.
Car la machine fonctionne au service d’une musique qui touche tous les claviers, avec un sens de l’ironie marquée, comme souvent chez Offenbach, c’est à la fois très symphonique, c’est aussi lyrique, en pastichant les duos d’amour de l’opéra traditionnel notamment bel cantiste, mais c’est aussi un joli exercice acrobatique où chaque son peut figurer un légume ou un insecte : nous sommes dans une fantasmagorie visuelle et sonore, très spectaculaire, qui reste un peu superficielle mais techniquement très au point.
La difficulté consiste à faire du spectaculaire de 2015 et non de 1872, c’est à dire employer les moyens du théâtre d’aujourd’hui pour rendre les tableaux d’hier recevables ou présentables.

Bien sûr, à la fois par l’inspiration, due au conte d’Hoffmann Petit Zacharie, appelé Cinabre qu’on retrouve dans la Chanson de Kleinzach des Contes d’Hoffmann, et par certaines scènes comme celle des étudiants qui renvoie à celle du prologue des mêmes Contes d’Hoffmann, on reconnaît la manière d’Offenbach d’utiliser des motifs qui se répètent ou simplement évocatoires qui construisent un système d’écho entre ses œuvres. Il faut toujours tenir compte chez Offenbach de l’imitation du premier XIXème siècle (Rossini, Auber), de l’interprétation, et de la folie déglinguée qui peut résulter de l’ensemble. L’histoire du Roi Légume est une histoire linéaire assez claire, mais qui donne aussi prétexte à des parodies, à des scènes presque fermées (comme celle de Pompéi, ou celle des insectes) qui ne sont qu’une partie de ce que le spectateur de 1872 avait pu voir et applaudir. Mais l’œuvre est à la fois loufoque, comique, ironique, amère, voire tragique. La monumentalité du propos permet une pluralité de styles et de situations au total assez inhabituelles chez Offenbach, dans cet opéra potager, c’est bien à une macédoine de styles comme de légumes à laquelle nous sommes conviés.
Agathe Mélinand a adapté le texte en travaillant comme à l’accoutumé à la transformation des allusions d’Offenbach aux « actualités » du temps en jeux sur nos habitudes ou nos actualités, allusions, jeu de mots, gestes, paroles à double sens, et travaille ainsi à l’implication du public qui lit quelque part son propre monde ; le descriptif de la situation financière de Krokodyne et la manière dont Fridolin XXIV a ruiné son royaume est à ce titre désopilant tellement cela parle au spectateur, qui évidemment pense à la France d’aujourd’hui voire à la situation économique du monde (crise des subprimes comprise) et rit. C’est pourquoi je parlais de chansonniers plus haut. En tous cas, tout est fait pour que le public entre de plain pied dans l’œuvre et qu’un échange scène-salle puisse naître dans une sorte de bonne humeur communicative.
Laurent Pelly a eu l’intelligence de ne pas afficher de style pompeux ou m’as-tu-vu, et de construire la fantasmagorie sur des éléments apparemment simples mais parlants, plutôt que sur du tape-à-l’œil.
Comme souvent chez Pelly, peut être plus que chez d’autres metteurs en scène, on ne peut séparer les costumes, qu’il a réalisés et qui sont vraiment splendides, notamment la carotte, bien sûr, mais surtout les radis, d’un réalisme troublant ou les céleris-rave (ce sont parmi les costumes les plus réussis vus sur une scène ces derniers temps) qui apparaissent dans un brouillard inquiétant, ni les décors (de Chantal Thomas) très réussis du propos d’ensemble. Il y a d’abord une volonté de ne pas surcharger, mais en même temps de donner le plus de fluidité possible à la succession des tableaux, le risque de ce type d’œuvre étant de ralentir le propos par de trop fréquents changements. Ici, des éléments glissent, se mettent en place, qui un livre gigantesque, qui une passoire, qui un presse purée, qui une galerie de tableaux, qui Pompéi, qui le Vésuve, qui une planche d’entomologie.

Ces éléments n’envahissent jamais le plateau et n’écrasent pas le propos, mais dessinent des ambiances qui laissent les personnages évoluer. C’est qu’à la manière du grand opéra romantique, on voyage beaucoup dans ce Roi Carotte, de Krokodyne à Pompéi, sur le Vésuve, dans des livres, au sein du potager, composant à chaque fois une ambiance ou un tableau, qui rappelle quelque peu les cabinets de curiosités. C’est que Pelly réussit à afficher avec un vrai réalisme poétique une intrigue qui voit une Carotte devenir Roi et tout un potager devenir Cour avec un effet carotène garanti (serviteurs – ou bâtards ?- tous roux).
L’histoire du Roi Carotte est assez simple : Fridolin XXIV règne sur Krokodyne, mais dilapide le trésor et envisage pour se refaire d’épouser Cunégonde (et sa dot), une princesse délurée et pleine d’envies et de désirs. Pendant ce temps, la sorcière Coloquinte qui a été privée de ses pouvoirs pendant 10 ans par le père de Fridolin les retrouve et veut se venger sur le fils; suite à un accord avec Robin-Luron le bon génie de Fridolin, celle-ci le détrône, et Robin-Luron l’accepte pour son bien, pour que Fridolin devienne plus sérieux, il en profite pour libérer Rosée du Soir amoureuse de Fridolin en secret.

Coloquinte met sur le trône une horrible Carotte aimée de tous et notamment de Cunégonde, que rien n’arrête grâce à l’effet d’un philtre: Le Roi Carotte va s’installer et faire régner la tyrannie. Fridolin va de son côté partir faire une sorte de voyage initiatique à la recherche de l’anneau de Salomon qui seul peut faire cesser l’enchantement de Coloquinte, la petite troupe se rend jusqu’à la Pompéi d’avant l’éruption, elle récupère l’anneau, revient à Krokodyne grâce à la complicité des abeilles, le Roi Carotte, détesté, est détrôné et Fridolin revient au pouvoir à la satisfaction de tous.
L’ histoire tient du conte de fées, du voyage initiatique au royaume du délire, et de la satire politique (des pouvoirs abusifs, des courtisans qui tournent casaque, des cours corrompues, n’oublions pas que le public sortait à peine ses ruines du second Empire). Laurent Pelly joue sur tous ces tableaux, à la fois travaillant sur le conte (la vision de la sorcière Coloquinte), sur la fantasmagorie (très beau tableau des insectes en planche d’entomologie), sur la bande dessinée (Pompéi), sur les effets de théâtre (l’éruption du Vésuve), sur le dessin animé (le personnage de Robin-Luron, un génie qui ressemble bien un peu à Jiminy Cricket) et décline la thématique potagère : la prison est un panier-égouttoir à légumes, et Le Roi Carotte finit en purée dans un gigantesque presse-purée. Mais il est surtout très attentif au jeu des chanteurs : il a en main une troupe remarquable, très équilibrée, très homogène, très engagée, qui s’amuse et qui donne à l’ensemble une très grande légèreté.

Bien sûr, Yann Beuron (Fridolin XXIV) domine la distribution, c’est le rôle le plus important, et il joue un vilain enfant-pas-si-sage, un fêtard qui s’adonne au vice avec grand naturel et simplicité, mais terriblement sympathique. Face à lui saluons la Cunégonde d’Antoinette Dennefeld, dont on connaît à Lyon la belle voix de mezzo, entendue dans L’enfant et les sortilèges et Isolier (excellent) du Comte Ory, et qui fait preuve d’un dynamisme et d’un allant irrésistibles qui lui procurent l’un des triomphes de la soirée. Christophe Mortagne en Carotte avec un encombrant costume aux jolis fanes est un ténor d’horrible caractère à souhait, qui réussit une très grande variations de couleurs et qui pose vraiment le personnage. Avec ses sons désagréables, son émission nasale à souhait, ça couine à tous les étages . Jean Sébastien Bou dans un rôle de complément de ministre vendu (Pipertrunck) fait évidemment remarquer une belle voix de baryton marquante, d’une grande élégance tout comme Boris Grappe dans Truck (l’autre ministre) montre son efficacité dans la veulerie..

La jeunesse craquante de Rosée-du-soir (la soprano Chloé Briot) et la fraîcheur de Robin-Luron (la mezzo Julie Boulianne) donnent aux deux rôles une présence marquée, sympathique, celle de personnages positifs de dessin animé ou de bande dessinée,
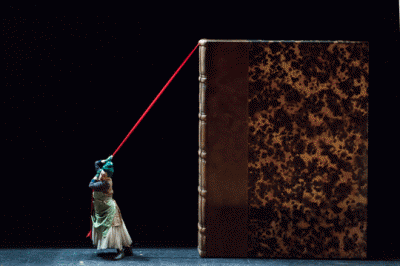
par opposition à tout le groupe des horribles dont une Lydie Pruvot (Coloquinte) désopilante dans ce rôle exclusivement parlé de sorcière.
Le chœur de Philip White est très engagé, et très agile dans le jeu, on l’a dit plus haut, et une bonne partie joue les petits rôles, très nombreux, y compris dans cette version bistourisée.
L’impression de troupe est telle qu’il est presque difficile de distinguer les uns et les autres, mais ce qui est certain, c’est que c’est une production de fin d’année réussie, alliée au célèbre Mesdames de la Halle représenté au théâtre de la Croix Rousse.
Ce Roi Carotte repris à la TV, puis enregistré pour un DVD, va compléter la tradition de l’Opéra de Lyon, marquée par des interprétations désormais historiques de Jacques Offenbach. Il faut découvrir cette musique, parodique quelquefois, romantique à d’autres moments, spectaculaire et pleine de vie, très variée et étonnante. Il faut découvrir cette satire du Grand Opéra romantique, qui est à la fois comédie, vaudeville, mais aussi opéra à machines et opérette. Ce Roi Carotte a quelque chose de très classique dans sa facture et dans sa construction, et se paie le luxe d’annoncer d’une certaine manière ce que va dénoncer le Festival « Pour l’humanité » en mars: l’excès, l’intolérance, la méchanceté, la deshumanisation, qui est au centre d’une histoire qui donne le pouvoir à de méchants légumes, qui n’ont rien d’humain (et donc à l’inhumanité) . Victorien Sardou n’y est pas étranger : il reste qu’Offenbach réussit à surprendre, et nous laisse dans la douce (même en décembre) nuit lyonnaise plein de bonne humeur et plein d’images grâce à l’excellent travail de Pelly, ce n’est pas la moindre de ses qualités en ces derniers mois plutôt gris.[wpsr_facebook]