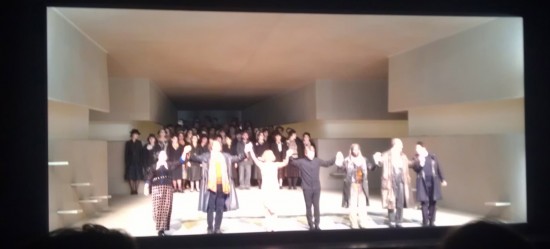Je vais vous soumettre un grave problème: le Hollandais volant est-il un fantôme? un fantasme? un personnage de chair et d’os à qui il est arrivé une désagréable aventure? Probablement, si le Vaisseau est fantôme, il y a de bonnes chances que son capitaine le soit, sinon, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark (enfin…d’Écosse en l’occurrence). C’est une question qui a semblé tarauder certains lors du spectacle présenté dans le cadre du Geneva Wagner Festival, organisé par le Cercle Romand Richard Wagner, financé par la Fondation Hans Wildorf et dirigé par Jean-Marie Blanchard, ex-directeur du Grand Théâtre de Genève. Au vu du succès remporté par la représentation, de l’enthousiasme du public, de la qualité globale du spectacle, la question du fantôme ne perturbe pas notre plaisir.
De fait dans la mise en scène d’Alexander Schulin, Le Hollandais apparaît comme un fantôme, ou plutôt au départ comme un monstre marin émergeant des flots bruns dans le lointain, puis comme une sorte de Belphégor un peu sauvageon, enfin, lorsqu’il rencontre sa promise, il est (presque) présentable dans son vieil habit XVIIIème un peu passé (et froissé).
La mise en scène de Schulin n’apporte rien de neuf dans la lecture de l’œuvre, on peut même dire une fois de plus, merci Harry Kupfer, tant est présent le souvenir de la mise en scène “princeps” des trente dernières années , à Bayreuth en 1978. Il travaille comme tant et tant de metteurs en scène depuis (dont récemment Andreas Homoki à Zürich et à la Scala, ou Philipp Stölzl à Berlin ou enfin Claus Guth à Bayreuth) sur l’idée que le Hollandais est un fantasme d’une Senta un peu trop adolescente ou un peu trop romantique ou un peu possédée (Senta/Satan?).

Au lieu du portrait, elle tient dans ses bras comme son Doudou, une poupée à l’effigie du Hollandais, qui va aussi quelquefois se substituer au réel, s’y superposer ou s’y ajouter: le duo Senta/Hollandais est de ce fait un trio. Rien de neuf sous le soleil wagnérien, au final, elle se précipite sur le devant de la fosse et esquisse le geste (coupé par le noir total) de s’y jeter. La fosse comme l’Océan, on a aussi déjà vu. Auparavant, Senta cherche à suivre le Hollandais et se heurte à un mur: là il faut remercier Claus Guth à Bayreuth dont c’est l’image finale. Comme on le voit, Alexander Schulin a de (bonnes) références.

Là où Schulin a vraiment fait du bon travail, ce n’est pas sur le concept qui commence à être sérieusement éculé, mais sur la manière qu’il a eue grâce au décor de Bettina Meyer essentiel, mais très efficace, d’occuper l’espace, très réduit et surtout très bas de plafond. Il a su aussi jouer à la fois avec la vidéo, avec la perspective qui est si marquée que les personnages en fond de scène apparaissent géants (un peu comme ce qu’avaient fait les Hermann avec Wozzeck à la Monnaie il y a si longtemps – la production fut reprise par Lissner -et Blanchard- au Châtelet quand le Châtelet était théâtre musical et non théâtre du musical) et il a créé une ambiance grise et noire, peu situable, abstraite, et sans vraie tache de couleur sinon le costume de Georg (Erik pour les habitués à version habituelle), d’un marron décalé qui isole le chasseur au milieu des marins (Homoki avait fait la même chose à la Scala, mais avec le vert): cirés noirs, tabliers gris un peu bariolés (blanc, gris, noir), redingotes grises, un univers presque monocolore où la petite chemise de nuit rose et sexy d’ado que porte Senta tout au long de la soirée tranche: l’univers des rêves ou des fantasmes est rarement coloré. Un univers non pas épique, mais intime où la tempête est sous les crânes et non sur les océans. Autre bonne idée: là où Kupfer montrait clairement les moments fantasmés et les moments réels par des changements de décor aussi acrobatiques que brutaux, Schulin ne donne pas toujours de clefs suivant en cela la lettre du texte: Versank ich jetzt in wunderbares Träumen?/Was ich erblicke ist es Wahn? – ai-je sombré dans un rêve merveilleux? ce que j’aperçois est-ce illusion? dit Senta au début du duo avec le Hollandais. De fait la mise en scène joue de cette ambigüité, d’autant que le duo est construit comme un rêve de Georg qui dort côté jardin. Un rêve dans le rêve qui par la construction en abîme sert bien un travail centré autour d’un univers mental. Dans un espace aussi réduit, les chœurs sont particulièrement bien réglés (et comme toujours vraiment remarquables quand c’est le chœur du Grand Théâtre dirigé par Ching-Lien Wu) notamment pour le choeur des fileuses, particulièrement réussi (les fileuses cousent en réalité les fanions- noirs- qui décoreront les guirlandes de la fête de retour du vaisseau de Daland) et bien sûr au moment de la tempête du troisième acte où l’équipage du Hollandais chante dans la fosse, idée cohérente d’un océan qui est la fosse d’orchestre, mais aussi pendant que la fête des vivants sur le plateau est bien chorégraphiée : le chœur de Genève est très engagé dans le jeu, mouvements souples, corps dansants, vraie présence théâtrale, un travail excellent, scénique et musical. Au total donc un spectacle qui ne révolutionne pas la mise en scène, mais qui compte tenu des contraintes est habile et en tous cas fonctionne très bien, avec de jolis effets (effets vidéos du navire en tempête assez saisissants) et une bonne direction d’acteurs.

Musicalement, tout le monde s’est trouvé un peu bluffé par la tension qui préside à ce spectacle, le halètement permanent des rythmes, la dynamique imposée par le chef Kirill Karabits qui a fait là avec un orchestre de jeunes (Haute école de musique de Genève, Haute école de musique du Vaud-Valais-Fribourg, Conservatoire national supérieur de musique et de danse, Paris) un remarquable travail de préparation musicale, un travail de précision qui fait qu’en cette 4ème représentation, il y a peu de problèmes de décalage ou d’attaques. Certes, il faut passer sur des cuivres un peu trop problématiques – dans une œuvre qui en regorge c’est gênant -, mais, signe de la qualité de la prestation d’ensemble, on n’en est pas (trop) perturbé. Du point de vue de la dynamique, si importante dans cette version parisienne de 1841, du tempo, de la tension dramatique, c’est vraiment remarquable, tellement plus intéressant et plus habité que ce que faisait Minkowski avec la même œuvre il y a quelques mois (voir le compte rendu), avec pour (petite) partie les mêmes artistes.
Là où Blanchard a toujours fait merveille c’est par l’attention aux équilibres de distribution: il n’a pas failli à sa réputation. La suédoise Ingela Brimberg était déjà magnifique avec Minkowski, elle est ici fantastique de présence, de jeu, de gestuelle et sa voix est totalement exceptionnelle, intense, large (même si la salle du bâtiment des forces motrices-BFM- a des dimensions qui permettent aux voix volumineuses de facilement s’imposer) avec des aigus d’une force, d’une intensité et d’une sûreté extraordinaires: derrière cette Senta là, il y a une Sieglinde (et une Chrysothemis…). La voix que je trouvais froide à Grenoble, est ici complètement incarnée (la scène fait toute la différence); grande voix à la fois lyrique et dramatique, c’est une chanteuse à suivre qu’on devrait revoir très vite.
Le Hollandais d’Alfred Walker a fait belle impression: la voix est certes bien posée, la diction et l’articulation impeccables (école américaine oblige), je me demande s’il n’est pas servi par le personnage et son costume de monstre nocturne car il impressionne notamment au départ. J’ai cependant trouvé que la voix dont le timbre est vraiment de grande qualité, suave et très pur, manquait quelquefois (juste un peu) de projection et qu’elle apparaissait un peu mate à certains moments. C’est incontestablement un beau Hollandais, je ne suis pas sûr que le volume passe une très grande salle; il faudra en tous cas le réentendre pour se faire une opinion définitive.
Le timbre de Dimitry Ivashchenko est moins joli (cela va avec le personnage: il a un timbre de maquignon), son Donald cependant gagne en présence et s’affirme de plus en plus: la fin du duo initial avec le Hollandais est très réussie, et ses interventions du deuxième acte (au troisième, il a très peu à chanter) sont plutôt mieux scandées, plus colorées. Le personnage est très réussi.
Le Georg d’Eric Cutler, qui a remplacé sur toute la série José Ferrero, est sans doute avec Ingela Brimberg le grand succès de la soirée: son Georg est naturellement très bien chanté, avec là aussi une diction exemplaire, et une technique de souffle impeccable. La voix est assez large et claire, toujours maîtrisée, avec un style et un contrôle qui sont des modèles du genre, mais au-delà de toutes les qualités musicales éminentes, c’est son intensité, son engagement, sa manière de colorer le rôle qui en font vraiment un personnage tragique (et rien du faible qu’on voit quelquefois sur les scènes). J’ai très rarement vu un Erik (je n’ai pas vu souvent de Georg!) aussi intense et aussi présent et j’ai très rarement autant vibré aux scènes avec Senta. Magnifique.
Maximilian Schmitt dans le Steuermann (en ciré et pyjama en dessous, on a ses élégances) est comme toujours (je l’ai entendu à Lucerne avec Abbado en concert) correct, bien contrôlé, mais sans véritable caractère ni charisme. Une prestation honnête mais qui n’a rien à voir avec celle de Bernard Richter, qui avait une autre élégance, dans le même rôle avec Minkowski.
Enfin, la Mary de la brésilienne Kismara Pessati se défend mieux que d’autres dans le rôle ingrat (et pas si facile) de Mary.
Au total, je le répète, un très beau moment, doué de cette magie qui prend le spectateur, qui fait oublier les quelques scories et qui montre que sans forces de référence, ni vedettes, mais avec un ensemble homogène, engagé, et un plateau sans faiblesses, on peut faire du très beau travail. Et puis le Bâtiment des Forces Motrices, planté sur son île au milieu du Rhône avait bien l’air d’un Vaisseau Fantôme, dans la nuit pluvieuse de ce mois de Novembre; ce lieu, superbe, était l’écrin idéal pour cette opération qui va se prolonger à Luxembourg et Caen. Merci Genève, et merci Blanchard, dont le retour à Genève s’est soldé par un vrai succès. Ediles lyonnais, vous cherchez un directeur pour l’Opéra? Vous l’avez trouvé.
[wpsr_facebook]