
Dans l’économie d’une entreprise aussi complexe qu’un Ring, chaque moment est une étape, et cette longue histoire nécessite une construction claire et qui réponde en continu au concept exprimé par la mise en scène. Dans le choix de Frank Castorf, deux éléments clés :
– d’une part le théâtre épique au sens brechtien du terme,
– d’autre la claire séparation du prologue et de l’histoire, dont Die Walküre constitue le premier jour, ou premier moment.
Nous avons vu que le prologue avait mis en place les conditions du récit : un enjeu médiocre d’une humanité médiocre, mais dépendante du consumérisme, sexe, jeux, et pétrole : c’est dans une station Texaco que l’histoire du Rheingold se passe. Mais l’espace est presque un espace mental, issu des bandes dessinées ou des comics, inscrit dans un lieu qui tient sa richesse du pétrole, mais en dehors de toute référence historique marquée.

Avec Die Walküre, l’histoire commence, et elle est au contraire inscrite dans le temps : le récit va être historié, et surtout situé dans l’espace : il prend naissance en Azerbaïdjan, à Bakou, avec les premiers puits de pétrole. Dans un monde qui s’apprête à accueillir le Dieu pétrole, le décor va prendre peu à peu forme et s’élaborer en fonction de l’importance grandissante de l’Or noir : puits et ferme (bottes de foin, cage à dindons) à l’acte I, puits de pétrole primitif à l’acte II, et puits de pétrole-Walhalla et Cathédrale au III. Une histoire à la fois éclatée, dilatée en espace et en temps, d’acte en acte. On avance dans le temps et l’espace se structure. Le troisième acte est déjà celui de l’extraction industrielle du pétrole, et la malheureuse histoire de la Walkyrie se déroule dans un Walhalla qui ressemble bien par certains côtés au Nibelheim de l’Or du Rhin. Un lieu d’exploitation et d’esclavage.
Il faut aussi sans cesse garder en tête les intentions de mise en scène, en s’appuyant sur l’histoire de Frank Castorf, venu de l’ex DDR, profondément lié à Berlin, à son histoire faite de déchirures et d’enjeux idéologiques. Ces questions irriguent son théâtre et donc ce Ring. Si le fil conducteur est l’Or noir, dont Castorf affirme qu’il s’est substitué à l’Or jaune comme source de toute la ruine du monde, de son absence de morale et de l’évacuation progressive de tout sentiment, il souligne que les idéologies quelles qu’elles soient s’y sont subordonnées : au bout du compte, il n’y a plus de béquille pour porter le monde, il n’y plus qu’un immense néant. Crépuscule des Dieux ? non, Crépuscule de l’humanité.
Ce vaste propos, propose un sens délétère au Ring, où derrière la belle histoire mythologique, derrière les rédemptions par l’amour, se cache la ruine universelle.
Dans le parcours proposé, cette Walküre semble plus traditionnelle et donc mieux acceptée par le public que Siegfried, par exemple, auquel je viens d’assister. Walküre est encore d’une certaine manière le temps des illusions et des possibles, le temps où l’ivresse musicale wagnérienne enveloppe l’espoir né des deux jumeaux Siegmund et Sieglinde. Nul n’est besoin de distance, il faut au contraire épouser l’histoire pour mieux ensuite s’en éloigner. Il faut commencer par raconter simplement une histoire avant d’en décortiquer les données où d’en indiquer les dangers. Le couple Siegmund/Sieglinde est immédiat, dans sa rencontre, dans ses décisions, dans son amour explosif, et il a été programmé ainsi par Wotan. Le couple Siegfried/Brünnhilde est un couple encore plus programmé, éduqué pour se rencontrer et manipulé, mais cet amour est déjà perverti, traversé par les aventures du monde pétrolo-dépendant.
La ferme où vit Sieglinde est à peine touchée par le pétrole, le décor monumental et génial (on ne le dira jamais assez: le décor est toujours fascinant) d’Alexander Denić, représente une ferme, avec une tour (le derrick, reproduisant des photos de l’époque), une terrasse, et au pied de cet ensemble, des bottes de foin et deux dindons, auxquels Sieglinde donne à manger, deux dindons en cage prémonitoires, sorte de couple déjà prisonnier, des victimes en attente de solution finale : dans cette cage bientôt débarrassée de ses deux bêtes, viendront se réfugier un anarchiste (au troisième acte), mais on y jettera aussi tous les oripeaux idéologiques ou mythologiques : Wotan y dépose sa lance, Siegmund Notung etc.. Réceptacle de toutes les illusions du monde, réceptacle des dindons, oui, mais des dindons de la farce.
Comme dans l’Or du Rhin, extérieur et intérieur se mêlent à travers l’habile utilisation de la vidéo, Hunding endormi dort mal et semble avoir un sommeil agité de rêves. Sieglinde cachée derrière un drap prépare le philtre somnifère avec un air entendu digne d’un film du muet, tout le combat entre Hunding et Siegmund au deuxième acte se déroule en ombre ou dans l’intérieur de la ferme-derrick, on voit en final alternativement, en phase avec la musique les deux visages de Hunding et Siegmund, les yeux fixes, résultat de leur combat.
Siegmund d’ailleurs meurt lentement, et ne cesse de tendre les bras vers ce père qu’il vient de reconnaître et d’apercevoir, mais c’est Brünnhilde qui le prend dans ses bras, contrairement à la tradition initiée par Chéreau. Dans le monde voulu par Carstorf, même fugitivement, Wotan n’a aucun sentiment.
L’univers dans lequel l’histoire est insérée se colore progressivement de notations géographiques et idéologiques. L’Univers de Castorf est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part.
L’histoire de la Walkyrie traverse les époques, du premier derrick à son exploitation plus mécanisée, voire plus industrielle et sa conséquence sur les masses, exploitées, puis révolutionnaires. Comme dans Rheingold où l’histoire était inscrite dans le Texas profond, champ pétrolifère bien identifié, nous sommes en Azerbaïdjan, russifié, avec ses inscriptions en russe, en azeri (une langue voisine du turc) qui nous envahissent progressivement. Au spectateur de se sentir à la fois concerné, mais aussi étranger, dans un monde qu’il ne déchiffre pas, dans une langue qu’il ne comprend pas (du moins les non russophones…). Au deuxième acte, le monde des graffitis idéologiques est né le monde n’a plus la « pureté » ou l’ignorance primitive du premier acte. À la paille et aux dindons laissent la place le monde d’un Lumpenproletariat exploité par Wotan, de la manière dont habituellement on voit Alberich exploiter ses Nibelungen dans Rheingold. Castorf propose cette image non dans Rheingold, mais dans Walküre, sussurant que derrière le mot Walhalla se cache pouvoir et donc exploitation (et productivisme stalinien) et que Wotan et Alberich sont deux faces d’un même Janus bifrons.
Mais déjà, à l’orée même de l’exploitation du pétrole, naissent dans le même temps ses dérivés les plus destructrices. Pendant le récit de Wotan au deuxième acte, Brünnhilde distraite prépare les produits de mort, les produits explosifs, elle écoute d’une oreille légère le monologue de son père, et va recueillir dans de petites bouteilles qu’on insère ensuite dans une caisse, un suc issu d’une sorte d’alambic, le TNT…
Quant aux Dieux, ils n’ont pas de racine, ils sont partout et ils sont nulle part, et donc ils empruntent les usages là où ils sont: Fricka arrive en scène au deuxième acte vêtue en princesse russe, comme on pourrait en voir dans un opéra de Glinka ou de Borodine. Elle arrive non en char tiré par des béliers, mais portée par un esclave qu’elle fouette, autre manière de montrer que Nibelheim est au Walhalla et que les Dieux sont comme les autres et comme ceux qu’ils combattent. Et Castorf, jamais avare de sarcasme et d’ironie, fait se retirer l’esclave un peu titubant et se frottant le dos maladroitement, pour marquer la souffrance d’avoir porté la déesse. Rires dans la salle.
Ainsi donc alternent une vision traditionnelle de Die Walküre, on y trouve Notung (même si dédoublée au premier acte, plantée sur la terrasse et plantée sur un tronc dans le hangar où Siegmund vient l’arracher), on trouve les amants affolés et traqués, une Sieglinde apeurée (extraordinaire Anja Kampe), et en même temps Brünnhilde préparant des caisses de TNT, et une explosion prémonitoire à l’écran, pour l’utiliser : le temps est bien marqué, il s’agit de 1942, le sabordage des champs pétrolifères de Bakou pour empêcher les allemands de les occuper et les exploiter lors de l’offensive allemande appelée Opération Edelweiss.
Le combat de Hunding et Siegmund a lieu dans ces circonstances, sans doute métaphoriques d’un combat plus planétaire, au total sans vainqueurs ni vaincus, écartelé entre l’extérieur et l’intérieur, écran et théâtre, réel projeté et réel figuré/représenté. Et le combat se voit sur l’écran, comme par regard interposé. Sieglinde, dehors, lance un hurlement animal, d’un volume phénoménal et déchirant, comme le hurlement des éternelles victimes. C’est ce qu’on retient de ce combat, hors les corps qu’on voit étendus et les visages figés, hors le geste de Siegmund, tentative vers Wotan le père qu’il rencontre pour la première fois, hors l’explosion des puits de pétrole.
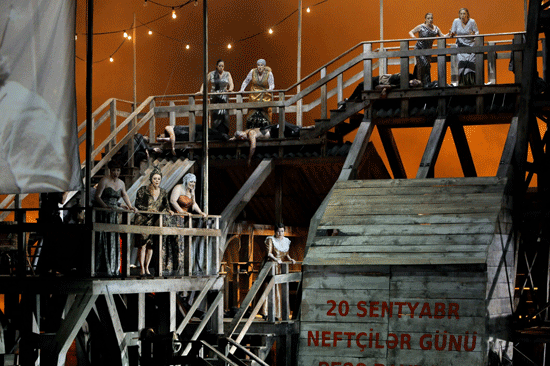
Le troisième acte commence par une Chevauchée marquée idéologiquement : le drapeau anarchiste risque de flotter sur ces puits, on se souvient aussi que les Tchétchènes et autres populations locales excédées par le totalitarisme stalinien ont profiter de l’arrivée allemande pour chercher à se libérer, fortement soutenus par les allemands : bref, les Walkyries ont pour mission là où elles sont, et elles sont partout, de pourchasser ceux qui nuisent à la belle organisation pétrolifère et wotanienne, et tous ces révoltés s’écroulent près du but et meurent. Piétinant ces corps les Walkyries arrivent, vêtues des costumes de toute la société soviétique, dans le temps et dans l’espace, belles dames bourgeoises ou aristocratiques de la fin de l’ère tsariste, babouchkas, femmes de la Russie profonde (on dirait Marfa de la Khovantchina), musulmanes des états d’Asie centrale, princesses traditionnelles. Venues de tout le territoire et de toutes les époques, elles sont toutes vêtues comme des représentantes de la haute société et elles arrivent pour se réunir, quitter leurs oripeaux nécessaires pour tomber dans le monde, pour prendre des habits de Walkyries dignes de dames de revues de Music hall, casques argentés un peu punky, tenues de « maîtresses » de boite SM : le sérieux et la mort côtoient les paillettes, rien n’a de valeur, il n’y a plus d’échelle. Brünnhilde arrive avec Sieglinde en épais manteau de fourrure et en casque argenté punky, seule Sieglinde garde sa vague tenue de paysanne azeri.
Il faut noter aussi au passage les beaux costumes de Adriana Braga Peretski, costumes voyageurs eux aussi, variés, très inspirés pour certains de costumes de music hall, avec paillettes, lamé, des costumes d’apparence, mais jamais de substance, nous sommes à l’évidence au spectacle du monde, the show is going on.
Un autre élément à la fois intéressant et dérangeant, les mêmes personnages apparaissent comme des figures différentes y compris d’un acte à l’autre. Il y a par exemple une plasticité de Wotan qui se présente sous des apparences diverses, dans l’Or du Rhin mauvais garçon, et le voilà dans le deuxième acte de Die Walküre, affublé d’une barbe de patriarche, à la russe.

Il est dans ce deuxième acte celui qui est la mémoire et qui rappelle les épisodes précédents, il est le chroniqueur, un peu le Pimen (de Boris Godunov) de la situation, il ressemble même avec sa grosse barbe à un Léon Tolstoï qui raconterait Guerre sans Paix chez les Dieux. Pendant que Brünnhilde à qui il devrait s’adresser prépare ses fioles de TNT, son discours devient un monologue intérieur, une méditation totalement fascinante, telle qu’elle est dite par Wolfgang Koch, avec un sens de la parole, un sens de la couleur hallucinants, et accompagnée à l’orchestre comme probablement jamais depuis Boulez je n’ai entendu dans ce deuxième acte un orchestre. Une méditation intérieure, fusionnelle entre parole et orchestre, l’orchestre dit ce que le chanteur dit, dans une osmose qui fait rentrer le spectateur en soi, qui crée y compris en lui la posture méditative. Un sommet.

Il est frappant de voir quel statut patriarcal Castorf lui donne ici, d’autant que dans l’acte suivant Wotan perd sa barbe (mais garde ses deux yeux et en perdra un, on verra pourquoi, dans Siegfried) et redevient une figure non de la mémoire, mais du futur immédiat, le jeune chef exigeant. Ces variations sont évidemment la conséquence de ce travail où temps et espace se mélangent et s’épousent, se contredisent et en tous cas voyagent sans cesse : Wotan est un Wanderer du temps et de l’espace et prend, tout comme les dieux de la mythologie, les apparences nécessaires exigées par les situations : tout est mouvant dans cet univers en fusion.
Le dialogue Brünnhilde Wotan du 3ème acte, est complètement différent par l’ambiance et par le propos de celui du second acte. Les attitudes changent : Wotan plus jeune, plus vif, plus projeté vers le futur, Brünnhilde qui n’a pas ici l’attitude vaguement soumise et tendre qu’on connaît souvent dans ce duo. Cela bouge, cela discute ferme, cela s’oppose, et cela vit, d’une manière incroyable grâce à une diction de conversation qu’on a déjà entendue dans Rheingold.
Quant au final, il garde quelque chose d’une vision traditionnelle, c’est le tonneau cuve du premier plan qui s’enflamme (Il y a beaucoup de pétrole par ici…), tandis que Brünnhilde, vue à travers la vidéo s’endort à l’intérieur du décor, qui tient du puits de pétrole, du château fort et surtout de la cathédrale merveilleusement éclairée (il faudrait de longues descriptions des sublimes éclairages de Rainer Casper) avec son immense clocher dominé par une étoile rouge (nous sommes en plein stalinisme).Elle s’endort les yeux ouverts, fixés dans l’attente, comme pour l’éternité, dernière image sublime qui montre aussi que Castorf sait provoquer les émotions.
La réussite de cette Walkyrie qui a triomphé de manière indescriptible auprès du public, doit rendre grâce à une distribution très équilibrée, voire quelquefois d’un niveau exceptionnel.
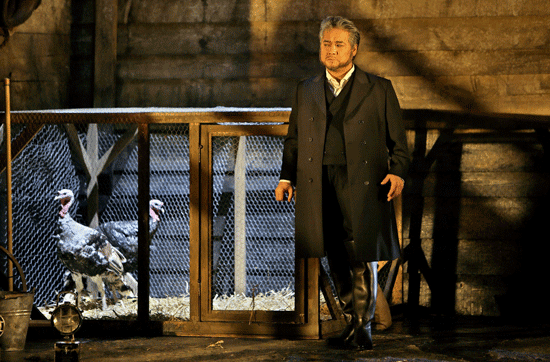
Kwanchoul Youn en Hunding est comme d’habitude remarquable de diction, et d’équilibre, il campe un personnage glacial, violent avec son épouse, distancié, avec une voix bien posée, magnifiquement projetée.

Johan Botha est tout simplement merveilleux, merveilleux de style, de tendresse, de velouté vocal, une voix qu’il sait rendre puissante avec des sons incroyablement tenus (les Wälse du premier acte et surtout le Wälsungen Blut de la conclusion). On sait qu’il n’est pas un acteur de référence, mais Castorf tient compte dans ses mouvements et son jeu des capacités du chanteur, et il fait un Siegmund à la fois passionné, mais en même temps plutôt introverti, qui correspond bien à la couleur sombre et retenue imposée par Petrenko. Passion rentrée plus qu’exprimée, vagues intérieures et réprimées, une passion traversée (déjà) par l’angoisse.
Anja Kampe est vibrante. En petite difficulté dans le premier acte où la voix semble retenue et sortir sans éclat, elle explose au deuxième et au troisième acte. J’ai rappelé son cri final du deuxième acte déchirant, violent, mais en même temps performance inouïe, il faut aussi saluer l’extrarodinaire personnage campé et chanté au troisième acte, avec de merveilleux O hehrste Wunder ! Herrlichste Maid ! bouleversants.
Catherine Forster en Brünnhilde en revanche est un personnage intéressant, mais la voix a de sérieuses difficultés avec les hojotoho initiaux du deuxième acte, qui se résument à des cris stridents, pas toujours en mesure, si bien qu’elle en fait sauter un. Cette voix est étrange, fragile dans les graves peu soutenus et dans le medium où elle s’aide d’un vibrato peu agréable, mais dès qu’elle atteint le haut medium, l’aigu devient large, expansé, solide, charnu, comme si elle n’avait travaillé que l’homogénéité de l’aigu sans s’occuper du reste ; il en résulte des moments très inférieurs au niveau à mon avis requis, et d’autres d’une grande beauté…
La Fricka de Claudia Mahnke est un joli personnage de princesse russe un peu exigeante, la voix et correcte, mais ce n’est pas une Fricka de référence, on est loin d’une Elisabeth Kulman, entendue à Lucerne et qui cassait la baraque.
Les Walkyries sont plutôt bien distribuées, l’ensemble vocal (à part quelques stridences) bien homogènes, surtout chez les mezzo (Alexandra Petersamer, Okka von der Dammerau) et saluons aussi la mise en scène (complexe) sur plusieurs niveaux qui rend le son magnifiquement distribué dans l’espace.
Reste Wolfgang Koch, Wotan étonnant.
Étonnant parce que jamais en représentation vocale : il a choisi de travailler un discours au ton plutôt égal, très travaillé dans le détail. Les aigus y sont, mais attaqués avec subtilité, presque noyés dans le discours, c’est souvent comme du Sprechgesang, avec une incroyable variété de couleurs. C’est un Wotan qui impressionne par l’intelligence et la subtilité, un Wotan au chant presque mozartien (comme je l’ai rappelé dans Rheingold), avec une technique et un contrôle supérieurs, et un timbre chaleureux. Sans s’imposer par le volume (on est à l’opposé d’un Terfel), il s’impose par le discours, par le texte, par le dire. C’est tout à fait exceptionnel.
Exceptionnel, c’est un qualificatif encore inférieur à l’effet produit par la direction de Kirill Petrenko. Je le répète, depuis Boulez, et malgré les Barenboim, les Levine et autre Thielemann, qui furent (ou sont) les chéris du lieu, on n’a pas entendu depuis plusieurs dizaine d’années une lecture de cette hauteur, de cette intelligence, de cette parfaite adéquation au discours scénique. Un orchestre sans effets, sinon l’appui permanent au texte, comme un discours textuel qu’il porterait lui même (le deuxième acte, anthologique d’intelligence et de grandeur), une direction qui est tout sauf démonstrative, qui ne cherche pas à démontrer, qui ne cherche aucun effet de manche ou de baguette, et qui ne cesse de démontrer, qui ne cesse de montrer le discours wagnérien, avec un sens du détail, avec une lisibilité, une clarté uniques. Petrenko, c’est la chance de cette édition du festival, car c’est la profondeur, c’est l’invention, c’est la méditation, c’est aussi la passion, mais jamais explosive, toujours rentrée, toujours avec cette petite réserve qui nous prépare à la noirceur du futur. C’est un Wagner différent de tout ce qu’on entend actuellement, en ce sens, nous avons entendu dans la fosse une Walküre unique. Cristal et métal, fleuve, air, braise, sonore et mate. Le miracle.
On l’aura compris, il serait imbécile de vouer aux gémonies une telle entreprise. C’est la grandeur de Bayreuth d’oser Castorf, mais sans Petrenko, tout ce qui fait la singularité de ces moments disparaîtrait sans doute. Après ces Ring, il va rejoindre Munich son port d’attache. Compréhensible. Il faudra donc s’armer d’une probable longue, très longue patience pour le voir revenir dans cette fosse. C’est pourquoi il ne faudra à aucun prix rater le Ring 2015, son dernier. Mais avant de parler du futur, restons dans le miracle quotidien que constitue la musique de ce Ring, et dans la stimulation quotidienne que constitue le travail fascinant et intriguant de Castorf.
__________________________________
WALKÜRE II LE 11 AOÛT 2014 :
Beaucoup d’émotion, et une admiration de plus en plus forte si c’est possible pour le travail à l’orchestre de Kyrill Petrenko.
Juste quelques remarques sur cette seconde Walkyrie, qui a fonctionné sur le public comme la première. On ne peut que confirmer l’habileté de Wolfgang Koch à incarner Wotan au deuxième acte, son monologue face à Brünnhilde, devenu monologue intérieur dans la mise en scène (il reste souvent seul en scène pendant que Brünnhilde va préparer ses bombes), accompagné par un orchestre époustouflant, reste pour moi le sommet de la soirée.
L’orchestre me paraît plus libéré que lors de la première audition, presque plus lyrique. Toujours aussi fluide, toujours aussi présent dans sa modestie même, toujours aussi précis : on entend le moindre des sons, Petrenko accompagne plus qu’il ne dirige et le sentiment de globalité du spectacle n’en est que plus fort. Cette fois-ci, et plusieurs fois, le cœur a battu très fort et les yeux se sont mouillés.

Une réserve cependant, et de taille : Anja Kampe en Sieglinde a eu un énorme succès, un triomphe indescriptible comparable seulement à celui de Petrenko qui fait hurler et taper des pieds toute la salle en délire, comme la veille dans Rheingold.
Pourtant, je suis très réservé sur sa Sieglinde. Le personnage est formidable en scène, elle vibre et fait vibrer, mais la voix reste quand même notoirement insuffisante pour le rôle. Cela a provoqué des discussions d’entracte, car beaucoup ont adoré sans réserves. Son premier acte pourtant est truffé, je dis bien truffé de problèmes à l’aigu. La voix manque de largeur pour le rôle, le souffle qui accompagne les aigus dans les passages est court, elle doit systématiquement s’y reprendre à deux fois, pousser d’abord, ouvrir après, avec un fort vibrato et certains aigus sont savonnés ou ne sortent pas, d’autant que le tempo installé par le chef en accord avec la mise en scène est plutôt lent et la met en difficulté. Cela va mieux aux deuxième et troisième acte, qui sont plus dramatiques et donc passent mieux en scène, mais la largeur des aigus reste problématique. Nous sommes quelques uns à l’avoir ressenti, et certains mêmes plus violemment que moi : comme dans sa Senta à la Scala, comme dans sa Leonore (Fidelio) avec Abbado, on entend les problèmes d’homogénéité vocale d’une voix forcée. Si cela continuait ainsi, je ne sens pas une longue carrière encore, malgré les évidentes qualités d’engagement de l’artiste.
[wpsr_facebook]











 Edith Haller est une Sieglinde honnête sans plus, dont les aigus du premier acte sont souvent criés, mais qui réussit son troisième acte, Hunding est Kwanchoul Youn, la basse abonnée au Festival depuis plusieurs années, un peu froid, un peu indifférent, sans rien de « terrible », où êtes vous les Salminen ou les Ridderbusch ? La Fricka de Mihoko Fujimura confirme la déception de l’Or du Rhin, la voix est présente, mais l’expression plate, le Wotan d’ Albert Dohmen affronte difficilement les aigus du rôle, ils sont péniblement négociés, au prix de trucages de respiration, et la voix est le plus souvent opaque, même si les qualités de diction du texte sont réelles.
Edith Haller est une Sieglinde honnête sans plus, dont les aigus du premier acte sont souvent criés, mais qui réussit son troisième acte, Hunding est Kwanchoul Youn, la basse abonnée au Festival depuis plusieurs années, un peu froid, un peu indifférent, sans rien de « terrible », où êtes vous les Salminen ou les Ridderbusch ? La Fricka de Mihoko Fujimura confirme la déception de l’Or du Rhin, la voix est présente, mais l’expression plate, le Wotan d’ Albert Dohmen affronte difficilement les aigus du rôle, ils sont péniblement négociés, au prix de trucages de respiration, et la voix est le plus souvent opaque, même si les qualités de diction du texte sont réelles. Linda Watson (Brünnhilde) n’a jamais été une de mes chanteuses de prédilection : une grosse voix, mais pas de réel engagement. Cette fois-ci la grosse voix est moins grosse, bouge dangereusement au prix de sons peu convaincants et la prestation est médiocre. Quant aux Walkyries, elles n’ont pas l’homogénéité voulue pour chanter ensemble, et certaines hurlent en produisant de vilains sons en chevauchée solitaire. Désagréable.
Linda Watson (Brünnhilde) n’a jamais été une de mes chanteuses de prédilection : une grosse voix, mais pas de réel engagement. Cette fois-ci la grosse voix est moins grosse, bouge dangereusement au prix de sons peu convaincants et la prestation est médiocre. Quant aux Walkyries, elles n’ont pas l’homogénéité voulue pour chanter ensemble, et certaines hurlent en produisant de vilains sons en chevauchée solitaire. Désagréable.
 L’Or du Rhin qui ouvre le cycle est d’une totale platitude : les trois filles du Rhin (correctes) complètement habillées sont fixes au fond du Rhin pendant que des corps nus nagent (en vidéo) ou que des jambes apparaissent çà et là entre les galets. On se demande comment Alberich peut être saisi de fièvre érotique dans ces conditions. Alberich apparaît plus comme un animal malheureux qu’on plaint que comme le parangon du mal qui renonce à l’amour pour l’amour de l’Or.
L’Or du Rhin qui ouvre le cycle est d’une totale platitude : les trois filles du Rhin (correctes) complètement habillées sont fixes au fond du Rhin pendant que des corps nus nagent (en vidéo) ou que des jambes apparaissent çà et là entre les galets. On se demande comment Alberich peut être saisi de fièvre érotique dans ces conditions. Alberich apparaît plus comme un animal malheureux qu’on plaint que comme le parangon du mal qui renonce à l’amour pour l’amour de l’Or.