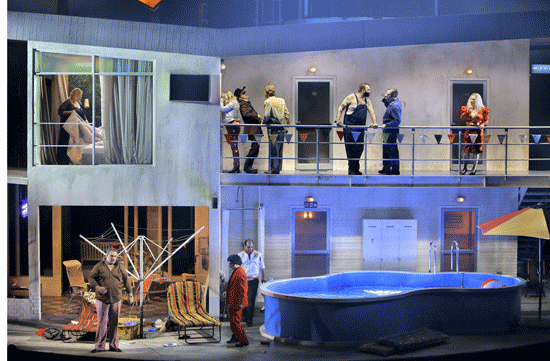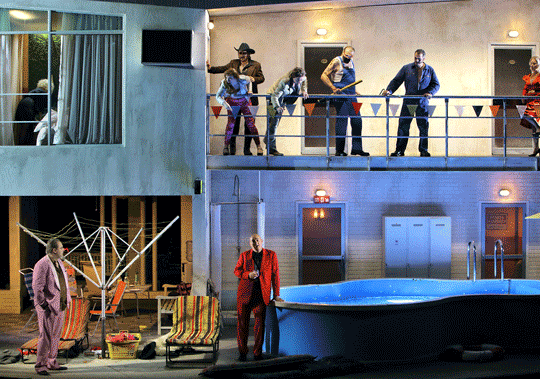
Je relisais pour éviter de me répéter mon compte rendu de l’an dernier , et je crains de ne devoir tout de même me permettre quelques redites. Je recommande au lecteur nouveau venu sur ce blog de s’y reporter pour une lecture scénique plus détaillée.
Ce Ring qui a horrifié certains et que la presse a accueilli avec fraîcheur, avec scepticisme, avec fatalisme et quelquefois avec enthousiasme est un travail d’une intelligence et d’une profondeur rares, qui cumule les talents, à commencer par celui du décorateur Aleksandar Denić qui a construit les décors les plus impressionnants à voir aujourd’hui sur une scène.
De Frank Castorf à quoi s’attendre d’autre qu’une lecture idéologique d’un récit qui raconte la naissance du monde (contemporain) et sa soif de pouvoir et d’or. Il le voit en l’adaptant à la réalité historique, et notamment à l’histoire du pétrole (l’Or noir) avec son cortège de conséquences sur la fin des blocs et notamment du bloc soviétique, sur le pouvoir définitif du Walhalla/Wall Street, et sur ses effets sur le fonctionnement de la société, faite de petits arrangements médiocres, de mafias minables, de vendus et d’achetables, le tout dans une perspective historique avançant d’acte en acte dès Walküre .
La particularité de sa manière de raconter Rheingold, le prologue de cette longue histoire, c’est qu’il en fait une vision de l’après dans une version de type comics ou film de série B. Le prologue est donc un épilogue.
La question initiale de ce Ring à laquelle Castorf essaie de répondre est simple:
vous allez voir un monde pourri rempli de minables, comment en est on arrivé là ?
Ce prologue est non plus le regard sur les racines du mal, le récit de la première tromperie, mais l’état du monde après inventaire.
Que reste-t-il du monde? Il reste ce petit monde en miniature, concentré autour de ses trafics du fin fond du Texas où Wotan est un maquereau minable et Alberich un tenancier de boite interlope. Tous pareils, tous pourris, tous à jeter.
De même qu’à la fin du Crépuscule, rien ne bouge, dans la montée au Walhalla de Rheingold, il n’y a pas de Walhalla, sinon cette station-service sur le toit de laquelle tous les Dieux réunis marchent, regardent, un peu hébétés et que Loge préfère fuir après avoir tenté de la faire exploser. Il s’est passé tant de choses en 2h30 et en fait il ne s’est rien passé puisque rien ne change, sinon quelques morts en plus, quelques bagarres en plus et tout ce qui fait la joie des films de série B, avec leur filles pulpeuses, leurs petits souteneurs et leurs affaires louches.

L’apparition d’Erda est à ce titre fulminante. Nadine Weissmann est prodigieuse dans ce personnage improbable de maquerelle qui a réussi : c’est l’un des grands moments d’un Rheingold qui reste pour moi un chef d’œuvre de virtuosité scénique, jouant habilement du théâtre et de la vidéo, chacun dans son rôle, et obligeant le spectateur à une attention démultipliée.
Il est en effet impossible de se concentrer sur la seule musique, parce qu’il faut se concentrer sur le tout. Puisque nous sommes au temple de la Gesamtkunstwerk : il faut à la fois tout voir, tout comprendre, et se démultiplier tout en prenant chaque élément comme un élément du tout, qui n’a jamais de sens singulier mais un sens au service d’une entreprise globale.
Ainsi un chef d’orchestre persuadé de la primauté de la musique ne supporterait pas ce foisonnement, cette profusion, ces débordements et tous les excès et redondances, qui laissent beaucoup de spectateurs désarçonnés : derrière moi on soupirait , on éructait (discrètement) en exprimant l’étonnement, l’agacement, la surprise, la perplexité : quoi ? les filles du Rhin devant une piscine ? faisant sécher leurs petites culottes, mangeant des saucisses au ketchup grillées au barbecue ?

Et quoi ? Les Dieux rassemblés dans une petite chambre d’hôtel livrés à mille activités licites ou non, dicibles ou non, qu’on essaie de démêler par la vidéo car il est impossible de tout embrasser par le seul regard théâtral? la vision globale est d’une incroyable drôlerie : impossible de croire à ces dieux là, impossible de croire à cette histoire-là née pour faire pschitttt !
Certes, pour qui aime le théâtre, le théâtre intelligent, techniquement impeccable, pour qui aime la virtuosité scénique et surtout l’implacable rigueur, c’est un enchantement, que l’on ne peut voir qu’à Bayreuth, parce que c’est le seul lieu qui puisse donner toutes les possibilités techniques au service d’un spectacle (même si Castorf a souvent rouspété et même plus), parce que c’est aussi un laboratoire, selon la volonté de Wolfgang Wagner. Wolfgang a théorisé la philosophie du Neubayreuth lorsqu’il a appelé à partir de 1972 d’autres metteurs en scène (le premier fut Götz Friedrich pour Tannhäuser): tout spectacle est une proposition, et ne peut être considéré ni comme une vision définitive, ni comme un travail achevé, c’est un perpétuel work in progress.
Bayreuth est de fait ainsi le seul vrai « Festival »: dans la plupart des autres, les productions sont des co-productions qu’on va voir ailleurs, dans des théâtres d’opéra ordinaires. À Bayreuth, une production est uniquement faite pour cette salle, uniquement présentée dans cette salle (il y a quelques exceptions quand le Festival allait au Japon dans les années 60) et pour un public qu’on suppose averti : d’ailleurs, ne comptez pas sur les surtitres, il n’y en a pas.
Ainsi le travail de Castorf est-il d’abord un travail intellectuel avant d’être scénique, qui interpelle l’histoire, la philosophie, la culture cinématographique et qui prend son sens non seulement par ce qu’on voit, mais par le cheminement qui aboutit à ce que l’on voit. Qui se lance dans le travail d’analyse de ce cheminement en découvre alors toute la richesse, toute la finesse, toute la rigueur.
Ce spectacle n’est pas fait pour le consommateur, il est fait pour le promeneur amoureux, il est fait pour aimer et chercher, pour lire et fouiller, pour explorer mais aussi pour discuter, passionnément. Il est fait en réalité pour tout ce que ne produisent pas les sociétés d’aujourd’hui, plutôt du genre Kleenex: ce spectacle a besoin de temps, il a besoin de réflexion, il a besoin de culture et d’acculturation, il a besoin de disponibilité, il a besoin qu’on y revienne. Rien n’est jetable ici, ce qui pose problème dans un monde du jetable en permanence et du touche à tout consumériste.

Alors, il faut pour un tel spectacle un chef et une compagnie de chanteurs qui puissent partager cette conviction. Les remplacements de la troupe initiale montrent certaines limites de l’entreprise. Albert Dohmen est Alberich, vu que le malheureux Oleg Bryjak (qui remplaçait déjà en 2014 Martin Winkler, l’Alberich de 2013) a trouvé la mort dans l’accident de la Germanwings dans les Alpes. Dolmen est un grand artiste, même si la voix est fatiguée, il sait tenir la scène, avec une vraie présence mais Bryjak avait l’an dernier ce côté vulgaire et négligé, ce côté déglingué, là où Dohmen est plus contrôlé voire un tantinet plus distingué. Il reste que certains moments (la malédiction) sont vraiment impressionnants.
Plus encore John Daszak en Loge, au chant très maîtrisé, à la voix claire, bien projetée : un Loge qui a Siegfried à son répertoire est plutôt rare. On préfère en général des ténors de caractère pour Loge, comme le furent Graham Clark ou Heinz Zednik, bien qu’à Bayreuth on ait eu pour Loge tantôt des ténors de caractère, tantôt des ténors à la voix plus large comme Siegfried Jerusalem ou Manfred Jung. L’an dernier, Norbert Ernst était plutôt un caractériste, habillé en levantin roublard (perruque brune frisée, teint mat).

Avec Daszak, à l’allure si différente , grand, chauve, plutôt un physique de héros, on est dans un tout autre genre que le petit levantin. La diction même est plus neutre, moins colorée. Il faut pour Loge quelqu’un qui sache parfaitement la langue allemande pour bien nuancer chaque parole. Daszak a le timbre et la voix, mais il n’a pas beaucoup le caractère. Ainsi son Loge est il plus impersonnel, plus mal à l’aise aussi dans ce monde de malfrats traficoteurs. Alors il distancie par une attitude plus froide, moins concernée, un peu plus raide. C’est un aristocrate dans un monde de petites frappes : on comprend alors mieux qu’il soit tenté de tout faire exploser avec son briquet (ce dieu du feu a son briquet comme grigri…). Ce monde n’est pas pour lui, et il en disparaît donc en tant que personnage.
Çà et là aussi quelques changements pour les autres: Okka von der Damerau hélas a quitté la distribution (c’est Anna Lapkovskaja qui lui succède),

Allison Oakes devient une jolie Freia (elle n’était l’an dernier que Gutrune) à la place d’Elisabet Strid , Donner est Daniel Schmutzhard que les parisiens ont vu dans Papageno de la Flûte enchantée (production Carsen) et il s’en sort très bien en petit malfrat de province à la gâchette facile et dans les Heda Hedo, tandis que Fafner n’est plus Sorin Coliban mais Andreas Hörl, alors que Fasolt reste un Wilhelm Schwinghammer plus en place que dans l’Heinrich de Lohengrin.
Avec pareil travail scénique, il faut des chanteurs qui sachent plier leur voix au rythme, à la vivacité, à la conversation et ne se laissent pas aller à l’histrionisme vocal (encore que Rheingold ne soit pas fait pour), et les voix seules ne suffisent pas, il faut vraiment des personnages. C’est le cas aussi bien de la Fricka de Claudia Mahnke, bien meilleure dans le dialogue de Rheingold que dans Walküre à la vocalité plus spectaculaire, que d’Allison Oakes, magnifique de vérité dans son rôle de poupée ballotée de bande (des Dieux) en bande (des Géants).

J’ai dit combien Nadine Weissmann, très correcte vocalement, mais pas exceptionnelle, était en revanche impressionnante dans le personnage d’Erda, avec une vraie gueule.
Du côté des hommes, Lothar Odinius en Froh/Michael Douglas est très efficace et très juste, il connaît bien la mise en scène et cela se voit.

Le Mime d’Andreas Conrad est comme toujours remarquable, dans une production où il est peut-être sacrifié comme personnage : la scène de Nibelheim est traitée par Castorf de manière moins spectaculaire que la tradition ne le veut. Nibelheim n’est qu’une version encore plus cheap du monde de Wotan, dans le style bar gay. Castorf fait de la scène une sorte de conversation entre petits truands où, une fois que Wotan a affirmé sa supériorité, et non son pouvoir, les choses se neutralisent. Plus conversation que conquête, plus tractations de basses œuvres que piège : ce n’est pas pour moi le moment le plus clair ni le plus réussi de la mise en scène, mais y apparaît la roulotte de Mime qu’on reverra durant Siegfried et on en retient surtout l’image singulière très souvent reprise par la presse de tous ces messieurs sur des chaises longues, face au public pour la photo de cette sorte de Yalta des p’tits voleurs.
Quant à Wolfgang Koch, il n’a rien du Wotan dominateur du monde, c’est le tenancier du Motel/station service Texaco. Un tenancier un peu violent, jouisseur en veux-tu en voilà, un gentil sale type, un mac de quartier. Sa manière de dire le texte, sa science de la modulation, la couleur vocale en font un Wotan modèle pour la mise en scène de Castorf, il n’a rien de la grandeur torturée d’un McIntyre, ou de la noblesse d’un Theo Adam. Voilà un chanteur d’une grande intelligence, d’une très grande plasticité et qui est entré dans la logique de la production avec gourmandise. On lui demande d’être ce Wotan version Rapetou et de ne pas prétendre être le personnage principal du drame comme on le voit souvent, il joue parfaitement le jeu, avec justesse, naturel, et surtout avec une grande intelligence, une grande disponibilité, ainsi qu’une superbe intuition, malheureusement pour la dernière fois puisque l’an prochain c’est Iain Paterson qui reprend le rôle dans Rheingold (trois Wotan sont prévus: dans Walküre John Lundgren et dans Siegfried le Wanderer sera Thomas J.Mayer)
Dans une telle conception, l’orchestre ne peut être le protagoniste. Il n’y pas de protagoniste dans cette version 2013/2015 de la Gesamtkunstwerk. Ce que j’avais écrit sur Petrenko l’an dernier est encore vérifiable cette année, j’y renvoie donc le lecteur pour une analyse de son approche, sur laquelle je vais tout de même revenir.
Y-a-t-il un impératif catégorique pour faire entendre Wagner ? Un style, qui par delà les personnalités différentes, resterait en quelque sorte immuable, un style fondamental avec variations, comme Barenboim ou Solti seraient une variation sur Furtwängler, comme Thielemann une variation sur Karajan, mais tous recherchant la plénitude sonore d’un discours lyrique, l’énergie de l’héroïsme, des cuivres rutilants et des cordes en état d’ivresse pour faire fondre de plaisir le spectateur drogué à la cocaïne wagnérienne.
À entendre le travail de Kirill Petrenko, on en est loin . Et je comprends que ceux qui pensent qu’il y a des fondamentaux chez Wagner, des immuables, des passages obligés, un son “Wagner” puissent rejeter pareille interprétation. Si ce Rheingold est globalement assez voisin de celui de l’an dernier, il est différent de celui de Munich que Petrenko a dirigé au printemps même si visiblement le choix est celui d’un Rheingold plutôt allégé et lyrique. Mais le lyrisme était ce qui dominait à Munich ; ici c’est le choix de faire ressortir le texte avec un soin jaloux et de gérer l’orchestre comme la continuation de la conversation scénique ou comme une conversation parallèle avec une étonnante symphonie de couleurs instrumentales comme on pourrait distinguer différentes couleurs vocales, avec des nuances infinies notamment aux cordes (les altos ! les contrebasses !) ou aux bois. Cette clarté est d’autant plus fascinante que le volume de l’orchestre est volontairement retenu, voire très retenu. Certes, ce que nous voyons sur scène ne nous fait ni rêver d’héroïsme, ni d’épopée, et alors, Petrenko adapte l’orchestre à ce qu’il voit. C’est la force de ces chefs d’exception de ne pas « suivre leur idée » et la mettre en démonstration indépendamment de ce qui se passe sur scène, mais d’accompagner le plateau et la mise en scène en réorientant le travail orchestral en fonction du travail commun avec le metteur en scène.

Un exemple, la montée au Walhalla, qui est ahurissante de lyrisme, de clarté, de somptuosité sonore, est d’autant plus juste dans cette mise en scène qu’elle devient mordante ironie, vu…qu’il n’y a pas de Walhalla, et que la musique tourne somptueusement…à vide : voilà comment Petrenko sert le dessein de Castorf.
J’avais remarqué dans Lulu qu’il a dirigé à Munich en mai/juin le choix qu’il faisait face à la Lulu intimiste et singulière de Tcherniakov, de retenir le volume de l’orchestre pour en faire l’accompagnateur de scènes de théâtre qui sont autant de saynètes dans un espace réduit et glacé: il a approché Lulu dans une version chambriste et glaciale.
Ici, c’est en quelque sorte la même option, mais sans rien de glacé. Tout est fluide, tout suit un discours continu, rythmé, à un rythme presque mozartien. Je ne sais si je vais réussir à rendre l’idée de ce travail, mais la manière de faire fonctionner la musique m’a rappelé le Mozart du deuxième acte des Nozze, un continuum quelquefois tendu, quelquefois haletant, jamais démonstratif, seulement au service non des voix, mais des personnages et de l’action. Il en résulte une musicalité nouvelle, une version cinéma-vérité de Rheingold qui colle avec la scène d’une manière inouïe : la musique de Wagner vécue par beaucoup, pensée par beaucoup, sentie par beaucoup comme protagoniste, devenant, dans cette salle où elle est masquée, le véritable accompagnement musical de la scène, musique de film, scandant le drame, colorant l’action, éclairant les dialogues et jamais, sauf si nécessaire, au premier plan, une musique fonctionnelle en quelque sorte. Fascinant.
Au terme de ce Rheingold, une troisième vision aussi stimulante, passionnante, riche, que les deux précédentes, un seul regret, que ceux qui vendent des places en surplus, une vingtaine de personnes, ne trouvent pas d’acheteurs, tellement la production fait peur. Que cette production fasse office d’épouvantail est pour moi un indice de la stupidité des temps et de ce désir de conformisme à tout crin. Si même à Bayreuth on ne veut plus voir les produits d’une réflexion sur les possibles, tous les possibles du texte wagnérien, et malgré une réalisation musicale d’exception, alors nous sommes devenus les rats du Lohengrin de Neuenfels.[wpsr_facebook]