
Fidelio est un opéra qui d’un point de vue dramaturgique est relativement faible, ou plutôt très conforme à la mode de la fin du XVIIIème des pièces à sauvetage.
Mettez un prisonnier (en général c’est une prisonnière) dans un cachot terrible, enfermé injustement par un méchant. Un gentil passe par là (c’est souvent le ténor), la sauve et c’est l’amour.
La variation c’est que le gentil peut être l’amoureux, et le méchant le rival, ou que comme dans Fidelio, c’est la femme qui est libre et l’homme prisonnier.
La pièce à sauvetage est un genre en soi: il n’y a point derrière d’histoire de droits de l’homme ou de totalitarisme, mais du romanesque à revendre, hérité des grandes épopées italiennes du XVIème, pleines de magiciennes qui retiennent prisonniers des Orlando ou des Rinaldo.
La question de l’arbitraire (on dira aujourd’hui du totalitarisme) est posée chez Beethoven, que la révolution française fit palpiter, et qui s’intéressa surtout à Napoléon (il en revint assez vite) et ainsi que la question de l’humanisme des Lumières qui nous illumine encore, même si aujourd’hui une partie de la France sombre dans un anti-humanisme ou des contre-lumières, un soleil noir qui dresse son front (Front ?) délétère.
C’est que Fidelio est le résultat croisé de l’illuminisme du XVIIIème, d’épopées de la renaissance, de grands romans picaresques et manichéens, et de la mode des pièces à sauvetage. Je me répète souvent et mes lecteurs le savent : à part Die Zauberflöte, autre exemple de pièce à sauvetage, l’exemple même de la pièce à sauvetage, que toute la société musicale et les compositeurs d’opéras connaissaient est Lodoïska de Cherubini (Paris, 1791, même année que Zauberflöte), le plus grand succès de la révolution française – 200 représentations- l’exemple même de pièce populaire, dont l’histoire va être reprise par Mayr, puis par Rossini, mais aussi par Beethoven, (y compris quelques menues phrases musicales, mais à l’époque ce n’était pas pêché) .
On trouve donc une dramaturgie assez conformiste, et un dénouement plein de joie et de bons sentiments, comme dans les opéras comiques les plus courus.
Mais ici, il ne s’agit pas de Cherubini, Mayr ou Rossini, mais Beethoven, et de plus dans son unique opéra, qu’il va travailler et retravailler des années durant jusqu’à sa forme définitive, en 1814 après 10 ans d’hésitations et de remords.
Ainsi donc, la valeur ajoutée de Fidelio n’est pas l’histoire, d’une banalité et d’un conformisme habituels pour l’époque, dont le seul moment d’efficacité dramatique (théâtrale),est le moment de la libération de Florestan et celui où Leonore, une femme, petit être faible et sans défense, brandit une arme en menaçant Pizzaro, la valeur ajoutée de Fidelio, c’est la musique.
Le premier acte commence comme un opéra bouffe de Mozart ou de Paisiello, puis une série d’expositions : Jaquino aime Marzellina qui aime Fidelio qui ne l’aime pas. Rocco estime Fidelio et le destine à sa fille. Fidelio-Leonore n’aime que Florestan et ne jure que par sa mission libératrice à accomplir. Et tout ce badinage se passe en prison, je n’irai pas jusqu’à trouver à l’intrigue l’air un peu stendhalien du bonheur en prison, mais on n’en est pas loin. Car les respirations et les souffrances des prisonniers, il n’en est question que lorsque Rocco les fait sortir de leur soupiraux, sur l’insistance « humaniste » de Fidelio-Leonore qui ne veut qu’avoir l’occasion de reconnaître dans le groupe son chéri. Et du prisonnier singulier qui est l’objet de toutes les attentions, il n’est question qu’à travers l’arrivée du méchant Pizzaro, dont les raffinements psychologiques se limitent à sa haine de Florestan. Il ne se passe donc pas grand-chose dans ce premier acte, sinon cette succession d’expositions.
La seule action qui soit décidée, c’est que Fidelio , en quelque sorte l’employé modèle, et le gendre idéal, va accompagner Rocco voir le prisonnier caché.
Enfin, à l’acte II, après la reconnaissance, après l’action d’éclat de Léonore, et la libération de Florestan, dès l’arrivée du ministre deux ex machina qui en profite pour libérer tout le monde, il ne se passe plus grand chose, sinon un chant de reconnaissance et de remerciements .
De cette situation Harry Kupfer, pour sa mise en scène de Fidelio qui est loin d’être la première (ce doit être la quatrième ou la cinquième), a pris une décision radicale : là où il ne se passe rien, il est inutile de faire du théâtre ou d’inventer une situation ou un contexte.
Il ne va proprement « mettre en scène » au sens habituel que la scène initiale du 2ème acte, la reconnaissance et la libération, et le reste va sembler laisser courir la musique avec le minimum d’initiative.
Il serait erroné de penser que Kupfer, 81 ans, 220 mises en scène, Kupfer l’intellectuel, le brechtien, ait subitement décidé de ne rien faire, de se moquer du public et de l’équipe artistique en présentant une version oratorio de l’opéra de Beethoven. Kupfer retrouve Barenboim après une quinzaine d’années, et la production est très clairement une production vespérale, une production d’adieux : Kupfer a 81 ans, Barenboim 73, et Matti Salminen, qui a 71 ans, a clairement dit que ce serait sa dernière « première ». Même Falk Struckmann (59 ans) le Pizzaro des théâtres depuis des années et Roman Trekel (53 ans), Don Fernando, donnent des signes de fatigue vocale. Production des adieux, certes, mais aussi production des fidélités, où deux vieux maîtres se retrouvent, autour d’une musique qui est celle de l’humanisme pour lequel ils ont toujours combattu et combattent encore. Respect.
Voir dans ce travail l’idée que c’est la musique qui sauve et qu’importe l’habillage pourvu qu’on ait Beethoven serait à mon avis une courte vue. Il y a dans ce travail quelque chose qui va au-delà des signes initiaux les plus visibles : le buste de Beethoven, le piano, les partitions, la leçon de chant qu’on a l’air d’entamer tranquillement au lever de rideau, tous assis autour du piano avec pour fond le très digne et très monumental Musikverein, comme si Fidelio était une musique consacrée pour lieux consacrés, tout cela est le visible. La chute de l’image du Musikverein, laisse se dresser derrière le mur de béton couvert de graffitis authentiques de la 2ème guerre mondiale que Hans Schavernoch a repris d’une prison de Cologne : nous sommes bien dans le monde des prisonniers politiques, un monde idéologique que Beethoven pose, et non le monde fleuri du Neujahrkonzert du Musikverein, de la leçon de chant et du piano où trône l’auguste buste. Tout s’efface et disparaît quand ce mur apparaît.
Que ce Musikverein qui s’est écroulé peu après le début réapparaisse à la fin est donc inquiétant: aujourd’hui, où les menaces de totalitarisme pèsent partout, dans une société de la peur prétotalitaire, cette musique ne sonne plus pour ce qu’elle est, un chant d’aspiration à la liberté (Freiheit, écrit et gravé sur le mur), mais pour être écoutée, simplement, par les spectateurs passifs endimanchés que nous sommes : elle perd immédiatement sa valence révolutionnaire et humaniste. Elle devient musique du dimanche.
C’est pour moi le sens très fort de ce travail : qui nous dit que cette musique est plâtrée par son statut : au fond, même les SS écoutaient avec délices le Fidelio de Beethoven…
La mise en scène de Harry Kupfer, relayée par l’interprétation assez solennelle de Daniel Barenboim n’est ni gratuite, ni paresseuse. Elle est état, état des lieux d’une musique composée pour vibrer, et mise dans la boite du rituel de la musique classique, du rituel de la masterclass, du rituel du chœur final qui forcément amène à la catharsis. Puisque dans ce monde il n’y plus ni justice ni liberté, chantons-la, pour faire comme si.

Il y a dans le travail de Kupfer l’habituelle précision des gestes, et l’habituelle gestion bienvenue des personnages et de leurs mouvements. Le quatuor, où chacun chante son espoir secret, en contradiction ouverte avec celui des autres personnages, s’unit autour de la partition. Là où il y a impossibilité de résolution, l’unicité se fait autour d’une musique non résolutive, mais au fond, consolatrice : car dans le Fidelio de Beethoven, Marzellina est bien la perdante, si perdante même qu’elle se fond dans le chœur final en fusionnant son amertume et sa tristesse dans la joie commune pour mieux la dissimuler. Autre geste magnifiquement réglé par la mise en scène, le jeu de regards de cette même Marzellina de Fidelio à Jaquino, de Jaquino a Fidelio, puis à son père, très discret, mais qui en dit long sur le nœud de la situation.
Il y a aussi le Rocco si humain et si maladroit de Matti Salminen, aux graves encore bien marqués, mais qui m’a frappé encore plus par le mode avec lequel il gère le dialogue, avec une expression et une variation de ton singulières, avec une ductilité qu’il sait bien enchainer avec le chant. Le personnage de Rocco a cette ambiguïté de l’exécutant incapable de se dresser contre l’arbitraire : dans la géométrie des personnages, il est l’anti Leonore, qui elle sait dire non. Rocco ne dit non qu’au moment où il sait qu’il ne risque plus rien. Il y a l’héroïne, qui fait tout bien et va au-delà d’elle-même et il y a l’antihéros, qui gère le quotidien pour ce qu’il peut donner, et qui ne tire que de petits profits. Cette figure, Salminen, immense et débonnaire, la revêt avec une aisance suprême, tant par le dire que par le chant. Son chant, qui ne peut plus valoriser le bronze d’une voix désormais à son crépuscule, en valorise l’humanité, en valorise la ductilité, en chantant quelquefois une sorte de parlar-cantando très efficace : de l’art de s’adapter aux réalités du jour, tout à fait à l’unisson avec son personnage.

Le Pizzaro de Falk Stuckmann fait désormais partie de la galerie des grands portraits de l’opéra. Il l’a chanté partout, y compris dans la production précédente de la Staatsoper de Berlin, on l’a aussi entendu avec Abbado à Lucerne, où il venait de la salle pour éructer sa haine. La voix a perdu de son métal, a perdu en force, mais garde son énergie et sa noirceur par une expressivité et un sens de la diction qui restent un caractère notoire de ce chanteur. Le personnage voulu par Kupfer est clairement dessiné : il a le costume gris des fonctionnaires sinistres de la Gestapo ou de la Stasi. Il est une sorte de Scarpia, celui-là même auquel s’adresse le mur de cris silencieux qui nous est donné à voir. Un mur qui ne laisse voir du jour que quelques filets, quelques rais de lumière blanche : pour mettre en valeur le concret des gestes et des gens, le décor s’abstrait. Il suffit de ce mur de lamentations pour fixer le contexte. D’ailleurs, le chœur géométrique des prisonniers, chœur, contraint par la forme avec laquelle il se présente au public et au monde, va peu à peu se déliter timidement dans sa forme, dans sa couleur (les prisonniers enlèvent leur frusques) par la seule force de la musique, la seule force du chant choral, le chant d’ensemble qui donne énergie, chant d’appel qui, comme un chœur de Bach, va essayer d’atteindre un ciel qui ici se dérobe.
Une musique sublime dans un monde sinistre, des personnages prisonniers de la prison ou d’eux-mêmes, une absence de théâtre qui est impuissance voulue du théâtre : seule « la geste » de Leonore au début du 2ème acte est « mise en scène ». Au fond le mur des graffitis, à jardin la tombe dont on extrait des blocs de ciment (avec une relative facilité, il faut le dire) et à cour le prisonnier. L’espace évolue donc à peine, c’est un espace abstrait et distancié dans lequel chacun va pouvoir s’installer, avec ses rêves et ses désirs.
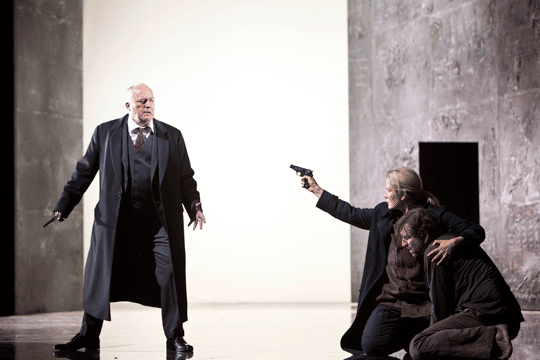
D’ailleurs, ce prisonnier (Andreas Schager) est debout et libre au lever du rideau du 2ème acte. Il n’est pas entravé et commence à chanter le célèbre appel « Gott ». Ce n’est que dans un deuxième moment, comme se ravisant, qu’il va s’entraver le bras et mettre lui-même ses liens, comme s’il se devait de correspondre à ce qu’on attend de lui, comme si aussi il était prisonnier de son personnage de prisonnier. Chacun doit jouer le rôle qui lui est assigné : même dans le monde de Beethoven où tout le monde en appelle à la liberté, on n’est pas libre d’être ce que l’on veut. Kupfer par ce seul geste montre que nous sommes dans un monde de l’attendu, du préfabriqué, où nous sommes prédéterminés, y compris dans notre rôle de symbole du totalitarisme. Evidemment, il y a la « Verfremdung », la distanciation brechtienne derrière tout cela, la volonté de montrer que ce n’est que théâtre.
Dès lors, il va y avoir théâtre, seul moment où il y a une mise en scène qui semble réglée, avec d’un côté Pizzaro et Rocco, toujours un peu à l’écart entre chien et loup, de l’autre Leonore et Florestan (nom sans doute tiré de Floretski, le héros chérubinien de Lodoïska) où enfin une action est mise en place, très traditionnelle, où par la seule force de son chant et son énergie Fidelio-Leonore à califourchon sur le corps de Florestan arrête Pizzaro, avant même de braquer son pistolet.
Cette scène achevée, la scène finale revient au statu quo ante, le chœur s’installe pour une sorte de festwiese beethovenienne (Wagner s’en souviendra en effet dans la scène finale de Meistersinger, qui arrive quand les décisions vitales pour les personnages sont prises) ou devant la photo du Musikverein qui couvre à nouveau le mur, tout le monde chante, les héros avec la partition en main, avec Pizzaro qui quitte la scène au bout de quelque minutes, sans autre forme de procès, pour laisser tout le monde chanter sa joie. Roman Trekel, Don Fernando, le ministre, est habillé en smoking, comme si au moment où le chœur va chanter se présentait le chef de chœur. Roman Trekel, qui est un chanteur de Lied apprécié, a d’ailleurs un peu déçu: la voix n’a plus la projection d’antan, elle manque de stabilité, on a entendu des Don Fernando autrement plus imposants (Mattei!).
Mais cette joie est si médiatisée par la tradition, disposition du chœur, disposition des personnages, que le théâtre s’est envolé, il ne reste plus que la musique, comme mise en boite dans un Musikverein qui est en quelque sorte une nouvelle prison, la prison pour une musique incapable d’agir sur le monde.
Kupfer ne laisse pas éclater sa joie, ne montre pas qu’enfin la liberté est arrivée, mais qu’en réalité un totalitarisme en cache toujours un autre, que le monde ne change pas et que la musique n’y fait rien à l’affaire. Au fond, ce chœur ne chante pas si joyeusement, mais comme presque par devoir: devoir que de se mettre en rang, devoir que de faire face au chef, devoir que de tous chanter ensemble, solistes et choristes.
J’ai évoqué Pizzaro et Rocco, vieux compères de la scène d’opéra, il faut aussi saluer la jolie performance d’une Marzellina jeune, à la voix très lyrique, qui s’impose et sculpte bien chaque parole, Evelin Novak, membre de la troupe de la Staatsoper de Berlin. Elle campe une Marzellina ferme, pleine de relief, au contrôle vocal accompli et à la voix très présente. Florian Hoffmann, lui aussi un membre de la troupe prête sa jolie voix de ténor lyrique à Jaquino.
 Andreas Schager est Florestan. La voix est claire, le timbre vraiment magnifique, le chant sans failles. Son Florestan est lumineux. Il n’a rien du Florestan tourmenté et intérieur d’un Jonas Kaufmann, son Florestan est jeune, il refuse la fatalité, il est visiblement ouvert sur tous les possibles de l’avenir.
Andreas Schager est Florestan. La voix est claire, le timbre vraiment magnifique, le chant sans failles. Son Florestan est lumineux. Il n’a rien du Florestan tourmenté et intérieur d’un Jonas Kaufmann, son Florestan est jeune, il refuse la fatalité, il est visiblement ouvert sur tous les possibles de l’avenir.
Toutefois, cette voix qui se libère progressivement pourrait quelquefois être mieux contrôlée. Barenboim le serre de près et cherche toujours à lui faire atténuer son volume, car Schager a toujours tendance à un peu trop en faire, un peu trop surchanter. Il a d’éminentes qualités, et un organe vocal exceptionnel, et s’économiser un peu ne nuira pas à cet organe délicat et fragile qu’est la voix humaine. Cette tendance au forte finit par nuire à la silhouette psychologique qu’on veut dessiner. Et si l’on veut rester simplement dans le réalisme, peut-on imaginer un prisonnier réduit à tant de faiblesse se mettre à chanter avec une telle santé ? Bien sûr, il pourrait s’agir aussi de cette distanciation brechtienne à laquelle nous faisions allusion, le chanteur chantant à pleine voix indépendamment de la situation, pour distancier la situation et donner ce que l’auditeur mélomane attend : la performance. Il reste que le fougueux Schager ne s’économise pas et qu’il prend des risques .

Camilla Nylund était Leonore. J’aime cette chanteuse qui ne fait jamais partie des premiers noms auxquels on pense pour pareils rôles. Et pourtant, elle est une Elisabeth de Tannhäuser exemplaire, elle est la Rusalka du moment, depuis de longues années, elle est en outre une Elsa émouvante.
Et elle est ici une Leonore exceptionnelle. Exceptionnelle dans ce contexte d’ailleurs, d’une voix jamais en surchauffe, jamais trop démonstrative, qui chante juste, au sens expressif musical et interprétatif du terme, sans jamais rien de trop, mais toujours avec ce qu’il faut d’intensité et de technique. Elle sait distiller l’émotion, et dans le contexte de la mise en scène, elle joue juste aussi, sans trop en faire, dans un équilibre miraculeux qui lui donne cette aura d’évidence. Elle est pour moi la grande réussite vocale de la soirée, dans une sorte de modestie, de naturel, d’équilibre. Elle est presque héroïque sans le savoir, avec un sens de la diction là aussi exemplaire, et en même temps une joie de chanter visible. Certains moments de son 2ème acte sont déchirants, et son « abscheulicher », qui en a fait chuter plus d’une, et des très grandes, est sans reproche très vécu et très vibrant.
Magnifique chœur de la Staatsoper de Berlin dirigé par Martin Wright, qui scande merveilleusement le chœur des prisonniers, avec un sens particulier de l’intériorité et de la noblesse, et bien entendu dans la scène finale, qui appelle le chœur de la future 9ème , avec un éclat tout particulier dans l’espace bien adapté du Schiller Theater .
Daniel Barenboim n’est jamais aussi à l’aise qu’avec sa Staatskapelle Berlin, qu’il dirige depuis 25 ans et avec qui il y a le dialogue habituel des vieux couples (y compris dans les conflits d’ailleurs). En vieux routier gentiment cabot il sait évidemment y faire, avec le rituel des saluts, avec l’importance particulière du salut de l’orchestre sur scène, systématique et conclusif, qui montre où est l’âme de ce théâtre.
Tout commence par une exécution de l’ouverture Leonore 2 (déjà dans la production précédente) bien plus longue, plus tragique, moins dynamique que la Leonore 3, et moins passepartout que l’ouverture habituelle. Et cette longueur, ces ruptures, ce début très noir, tout cela pose l’ambiance de la soirée, d’autant que c’est dirigé de manière magistrale – sans doute un des moments les plus forts musicalement.
Sa direction solennelle, plutôt lente, très claire, notamment dans le premier acte, plus revigorante et vigoureuse au deuxième acte, n’a pas la couleur de l’épique (l’inverse d’un Solti) ni du lyrique (Abbado), ni même leur dynamique: elle est en accord avec cette cérémonie des adieux dont le parlais plus haut. C’est d’autant plus ressenti pour moi qui ai entendu mon premier Fidelio à Paris avec un jeune Barenboim plus fougueux et clairement fils spirituel de Furtwängler avec un jeune Jerusalem aux aigus en jachère vers la fin des années 70, à l’époque où la salle de la porte Maillot était auditorium si j’ai bonne mémoire.
Quelquefois le ton de ce Fidelio m’a rappelé le Furtwängler de l’allegretto de la 7ème, à d’autres moments, il m’évoquait Bruckner, ailleurs Gluck, ailleurs enfin pour remonter dans le temps, Bach. Une direction « noble », jamais ennuyeuse parce que toujours fouillée, mais très « sérieuse » plus que théâtrale. C’est tout un univers choral (au sens Bach) du terme qui s’expose ici, un univers où le théâtre va passer au second plan, en cela en accord avec la prise de position assez radicale de Kupfer, qui se distancie du théâtre au point de le vouloir disparu. Il fallait oser et ainsi provoquer les sarcasmes stupides de ceux dont le sport préféré est la descente en flammes, comme je l’ai lu quelquefois sur les réseaux sociaux. Je n’y vois ni un Fidelio définitif, ni un absolu beethovénien, mais un travail prodigieusement intéressant et profilé, passionnant et profond : c’est un Fidelio rituel et plutôt grave, peut-être aussi désespéré ou tragique qui nous est donné ici, un Fidelio qui ne nous libère pas, qui nous laisse prisonniers parce qu’il va dans le mur.
[wpsr_facebook]






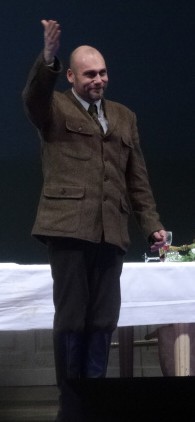

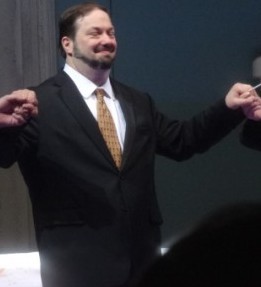







 devenue lieu du couple, puis de la Liebestod, dans un décor très réaliste d’intérieur XIXème, et l’utilisation de cette même table pour en faire une sorte de Tribunal des deux amants. Intérieur impeccable au 1er acte,
devenue lieu du couple, puis de la Liebestod, dans un décor très réaliste d’intérieur XIXème, et l’utilisation de cette même table pour en faire une sorte de Tribunal des deux amants. Intérieur impeccable au 1er acte,  murs décrépis au dernier, où l’on passe tour à tour des des espaces “réels” ou “fantasmés”, l’excellente idée de remimer les soins apportés à Tristan, allongé sur le lit au milieu de bandages sanguinolents, tout cela montre un travail attentif et très rigoureux, non dénué de poésie (acte II) et dont les partis pris radicaux, parce qu’ils sont bien traduits sur scène, ne choquent absolument pas. Il en résulte une fluidité de l’action qui enlève tout statisme à l’ensemble. On voit quelquefois des Tristan statiques, voire ennuyeux: on a ici à la fois une direction musicale très dynamique, incroyablement jeune et vigoureuse, et une traduction scénique là aussi tout en mouvement et prodigieusement stimulante. Tout ennui est banni, et on n’a qu’une envie après cinq heures de spectacle que de recommencer l’expérience a plus vite. Pour Haitink d’abord et avant tout, pour le reste du spectacle ensuite, à ne manquer sous aucun prétexte dès que ce sera repris.
murs décrépis au dernier, où l’on passe tour à tour des des espaces “réels” ou “fantasmés”, l’excellente idée de remimer les soins apportés à Tristan, allongé sur le lit au milieu de bandages sanguinolents, tout cela montre un travail attentif et très rigoureux, non dénué de poésie (acte II) et dont les partis pris radicaux, parce qu’ils sont bien traduits sur scène, ne choquent absolument pas. Il en résulte une fluidité de l’action qui enlève tout statisme à l’ensemble. On voit quelquefois des Tristan statiques, voire ennuyeux: on a ici à la fois une direction musicale très dynamique, incroyablement jeune et vigoureuse, et une traduction scénique là aussi tout en mouvement et prodigieusement stimulante. Tout ennui est banni, et on n’a qu’une envie après cinq heures de spectacle que de recommencer l’expérience a plus vite. Pour Haitink d’abord et avant tout, pour le reste du spectacle ensuite, à ne manquer sous aucun prétexte dès que ce sera repris.