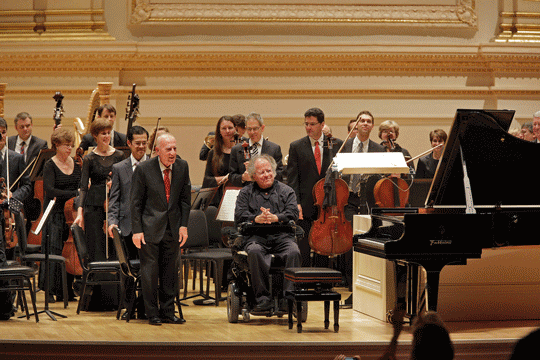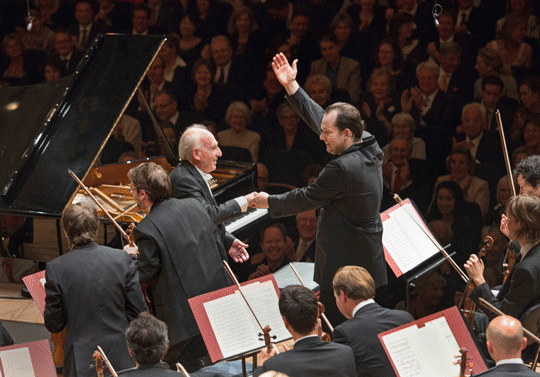On le savait fatigué, il avait annulé plusieurs concerts ces dernières années, mais on ne veut jamais envisager que tout a une fin ; et c’est hélas ce qui a été annoncé ce matin. La disparition de Maurizio Pollini, sans doute le pianiste que j’ai entendu le plus souvent dans ma vie de mélomane. La perte de l’artiste pour le monde musical est immense, c’était l’un des mythes du piano, et les nécros des magazines et des journaux se chargeront de le rappeler. Pour moi c’est une perte plus personnelle liée à mes années Abbado, à mes années Milan, à un quotidien qui m’a bercé pendant des années.
Maurizio Pollini est effectivement étroitement lié à mes années milanaises, à mes années abbadiennes, et à des moments singuliers où quelque chose dans votre univers s’ouvre et que vous gardez en vous comme un bijou précieux, dont vous porterez à tout jamais le souvenir.
Maurizio Pollini donnait pendant les grandes années au moins un concert par an à la Scala, c’était un vrai rituel joyeux que d’aller l’entendre, de le voir apparaître toujours un peu timide aller directement au piano, saluer fugacement et se mettre au clavier pour des programmes très diversifiés, Mon premier concert à la Scala est une sorte de symbole : le jour de mon arrivée à Milan pour y vivre et travailler, le lundi 11 février 1985, je filai à la Scala le soir pour fêter ma nouvelle vie et entendre Maurizio Pollini dans Le livre I du Clavier Bien tempéré de Bach, c’était un concert pour étudiants jeunes et travailleurs (la série fut supprimée quelques années plus tard) à des prix défiant toute concurrence et j’y accédai en place debout à 2500 Lire (environ 1 Euro)… Ce cycle créé par Claudio Abbado et Paolo Grassi avait contribué à ouvrir la Scala, et tout le monde sait qu’Abbado et Pollini allaient aussi jouer dans les usines au début des années 1970 . Autres temps…
En mars 1986 cela continua avec des sonates de Beethoven et Schubert, ou cet autre en décembre 1987 (un lundi, jour de concert à la Scala) dans un programme Beethoven Liszt totalement hallucinant, et cette incroyable combinatoire que fut un soir ce programme introuvable en janvier 1990: les 24 préludes de Chopin, la sonate n°1 de Berg, les Sechs kleine Klavierstücke de Schönberg et trois mouvements de Petrouchka de Stravinski…

La même année, en 1985 quelques semaines après mon arivée, ce fut mon premier concert où j’entendais Abbado et Pollini ensemble, dans le concerto en la mineur de Schumann, qui fut un enchantement, l’un des moments où je compris ce qu’était leur complicité, mais aussi le public de la Scala d’alors, un public familier, enthousiaste, assez jeune, un public de la cité, dans son théâtre, dans sa maison commune. Maurizio Pollini était milanais comme Abbado, et cela comptait énormément… Je feuillette les programmes et tout remonte à la surface…
Bien sûr par la suite, j’ai pu en tant qu’abbadien assister à des répétitions, et voir nombre de concerts aussi bien à Berlin qu’ailleurs et évidemment à Lucerne. Mais je reste attaché à ces années milanaises, qui enracinèrent ma passion et en firent ma vie.
Mais ce n’est pas à la Scala que j’ai été comme frappé par la foudre un soir de concert, c’était toujours à Milan, mais dans la grande salle Verdi du Conservatoire Giuseppe Verdi, où Pollini joua la deuxième sonate de Boulez. Une pièce d’une difficulté extrême, qui me secoua fortement, qui m’ouvrit à un répertoire encore inconnu, mais qui surtout me révéla cet art de Pollini fait d’exigence, de rigueur et aussi d’une certaine forme de simplicité. J’ai rarement entendu une salle aussi concentrée, et une explosion pareille à la fin de l’exécution. Et je me souviens de son regard un peu dubitatif et souriant. Ce fut pour moi fondateur. Par cette exécution, je lus tous les concerts de Pollini différemment. Il était devenu pour moi « autre ».
Pollini était une star, mais qui jamais ne se comporta comme une star, il avait aussi un côté lunaire, et était fortement soutenu, entouré, géré et protégé par son épouse Marilisa attentive à tout, il y avait chez lui un côté artisanal, modeste, qui se fondait dans la foule lors de manifestations à Milan ou ailleurs. Tout sauf mondain, tout sauf circuit médiatique.
Je me souviens lors d’un concert à Salzbourg, un concert ? Non, ce fut pour moi l’un des concerts d’une vie, le 15 avril 2001 où dans un programme Beethoven avec Claudio, il avait exécuté le concerto l’Empereur en première partie et où en deuxième partie Claudio avec les Berlinois éleva la Septième de Beethoven au niveau du miracle, qu’on entend seulement une fois dans une vie et qui avait provoqué larmes et enthousiasme du public de Salzbourg Pâques.
Nous croisâmes avec deux amis Pollini dans le couloir de la loge d’Abbado et nous le félicitâmes d’une exécution qui nous avait tous éblouis, et lui de répondre avec cette voix toujours légèrement bourrue. « Moi ? mais vous l’avez entendu LUI ? »
Une fois encore, un pan qui a construit, éclairé, balisé ma vie de mélomane s’en va. Dix ans après Claudio, il va le rejoindre au paradis des anges musiciens. Il nous laisse avec nos souvenirs, avec sa musique, avec des images émues, mais surtout avec la gratitude de nous avoir ouvert des chemins, fait entrevoir des interprétations autres, neuves, fait vivre la musique pour elle-même et d’avoir tant donné.
La grandeur simple de ce qu’est la musique avant toute chose.
Apostille (Dim.24 mars)
Je suis assez stupéfait voire écœuré de la manière dont certains grands médias dits main-stream ont ignoré le décès de Maurizio Pollini ou l’ont relégué. France Inter qui dans ses journaux cite de manière sans doute justifiée la disparition de Daniel Beretta, acteur qui doublait Schwarzenegger, mais ignore Maurizio Pollini, l’un des plus grands pianistes de notre temps et ce matin même, dimanche 24 mars dans Classique’n co, Anna Sigalevitch qui avait sans doute enregistré son intervention avant l’annonce, n’a même pas cru bon de faire ajouter au moins un petit mot préliminaire.
Le Monde, un journal qui se croit de référence titre : « Maurizio Pollini, pianiste italien, est mort », avec un sens aigu de l’à-propos concernant un artiste de cette trempe. Mais il y a longtemps que Le Monde se fiche comme d’une guigne de la musique classique. Quant à Libération, la nouvelle est passée sous les radars… au moins dans les éditions en ligne qui titrent sur Laurent de Brunhoff (en une) et Daniel Beretta (en pages culture). Il faut attendre le lundi 25 au matin pour lire un article sur cette disparition…. Seuls ont sauvé l’honneur par leur réactivité Les Échos (article de Philippe Venturini qui titre « le pianiste absolu ») et Le Figaro, qui tient en Christian Merlin une des dernières plumes compétentes en musique classique de notre presse écrite nationale font une place digne à cette disparition.