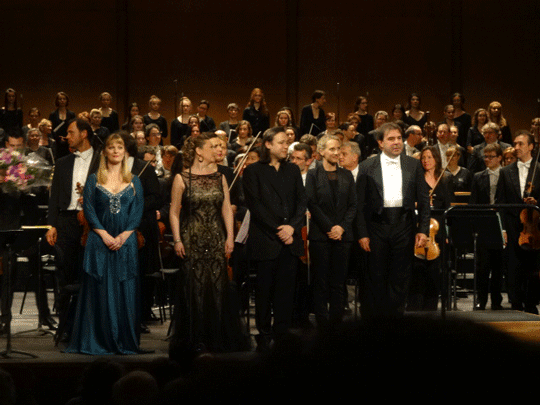On considère en général Tristan und Isolde comme un long chant lyrique « sublime » dédié à la passion amoureuse. Sublime est l’adjectif dont on qualifie la musique de Tristan, une sorte de longue mélopée tragique et lumineuse presque sans aspérités, qui va donner son sens à ce que nous voudrions voir être l’amour, ou la musique (forcément sublime) de l’amour, qui serait platonicien sans être platonique.
Et de ce point de vue, le Tristan und Isolde que nous avons vu au Théâtre des Champs Elysées s’inscrit en faux, et certains auditeurs l’ont fait bruyamment remarquer : il est dérangeant parce qu’il casse cette image séraphique inscrite dans l’éternité du marbre wagnérien. Il y a dans Tristan du désir et de la passion physiques, mais qui sont presque immédiatement transformés en éléments métaphysiques auxquels le « terrestre » ne peut accéder. Et la musique oscille en permanence entre physique (terrestre) et métaphysique : Wieland Wagner et avant lui Adolphe Appia avaient bien identifié tous les aspects métaphysiques par une mise en scène exclusivement évocatoire, aérienne, essentielle. La structuration des personnages est elle aussi tributaire de cette double postulation. Dès qu’ils se sont rencontrés, Tristan et Isolde ont été projetés ailleurs, tandis que Brangäne et Kurwenal sont ceux qui les ramènent (ou essaient) de les ramener aux contingences terrestres. Et Wagner écrit deux musiques, l’une terrestre voire quelquefois un peu lourde, l’autre « céleste » et métaphysique, la musique de la bulle face à celle du terreau.
Daniele Gatti dans sa lecture très fouillée de la partition a osé faire de cette diversité fondamentale un principe de lecture et de rendu musical de l’opéra, par une analyse précise des mouvements dramatiques, des moments dramatiques et de la manière dont le texte est dit et projeté, le signifiant, et ce qu’il dit, le signifié. Car la première remarque sur cette production, au-delà même du jugement, est un constat, banal en soi quand on parle de Wagner, mais oublié par nombre de spectateurs et d’auditeurs, c’est que le texte wagnérien n’est pas un livret au sens verdien ou puccinien du texte, il est un élément de l’œuvre globale, qui a son autonomie « musicale »( c’est particulièrement le cas dans Meistersinger), alors que dans Tristan, les auditeurs se moquent éperdument de ce qui est dit, au profit de pâmoisons sur la musique, et seulement la musique, d’autant qu’il y a un lieu commun consistant à dire que le texte wagnérien est plutôt médiocre. Or Daniele Gatti est très attentif à la mise en valeur du texte : un seul exemple, dans la scène I de l’acte 2, la manière dont il freine l’orchestre pour n’en laisser échapper qu’un fil sonore, lorsque Brangäne souligne à Isolde le rôle trouble de Melot. Gatti colle à dramaturgie, montrant que le couple musique-parole est indissociable et que la dramaturgie de la parole détermine la dramaturgie de la musique, voire de l’ensemble. Il en résulte un Tristan profondément divers, profondément varié, profondément non tant coloré musicalement, mais coloré d’un point de vue dramaturgique : chaque décision musicale est dictée par une lecture dramaturgique serrée, interrogeant les situations, interrogeant les motivations, interrogeant la nature de chaque personnage. Un des axes privilégiés est la manière d’indiquer très clairement les couleurs voulues de la musique dans un sens concret ou abstrait, physique et métaphysique. Un exemple là encore, à l’acte I lorsque Kurwenal évoque la bannière d’allégresse hissée sur le navire, la musique fait clairement entendre une citation de Meistersinger, alors en gestation, il y a d’ailleurs un système de citations croisées entre Tristan et Meistersinger (Hans Sachs cite Tristan « nommément »). Comme si Meistersinger était la déclinaison comique (ou mélancolique) de la thématique de Tristan traitée sur le mode tragique. Cette attention au texte et cette musique deviennent alors accompagnement dramaturgique, comme elle l’est clairement dans Meistersinger.

Tout chef pour Tristan devrait avoir dirigé aussi Meistersinger, l’opéra le plus complexe du Maître voire le centre de gravité de l’œuvre wagnérienne. Et du point de vue du texte, la distribution dans son ensemble ne mérite que des louanges, tant le texte est dit clairement, tout comme la direction de Gatti, si soucieuse de ne jamais couvrir le plateau et de choisir des rythmes et des tempi qui correspondent aux capacités des chanteurs et à la situation qu’ils expriment.
L’intelligence musicale du propos de Gatti consiste à épouser les pleins et les déliés non d’une partition, mais du texte que la partition accompagne et du sens de ce qui est dit. Voilà pourquoi Schopenhauer, base théorique de l’œuvre de Wagner, doit être central dans la compréhension du travail de Gatti, qui est un travail d’abord intellectuel avant d’être sensible ou musical. Et là-dessus, Gatti est sans concession, à la manière d’un Sinopoli ou d’un Abbado (un autre exemple : avant de diriger Parsifal, Abbado avait lu Gustave Thibon).
Est-ce à dire que pour comprendre l’opéra wagnérien, il faut lire Platon, Feuerbach et Schopenhauer ? Evidemment pas : si les salles wagnériennes étaient des cénacles philosophiques, cela se saurait. Mais à se référer à la philosophie (y compris Nietzsche), on comprendra évidemment mieux, notamment les intentions d’un chef ou d’un metteur en scène.
Et il y a donc aussi deux voies, grosso modo, pour mettre en scène Tristan und Isolde, ou bien l’on en fait une abstraction, un travail schopenhauerien construit autour du duo d’amour du 2ème acte, nuit, mort, amour et toute la trame n’est plus que fils tissés autour de ce moment: peu de décor, des lumières, des ombres, une sorte d’espace mental : c’est le choix de Wieland Wagner, et avant lui d’Adolphe Appia : c’est un choix inscrit dans les gênes du théâtre, depuis la naissance de la mise en scène moderne. C’est aussi malgré un décor marqué, le choix de Klaus Michael Grüber, Jean-Pierre Ponnelle, Heiner Müller, Patrice Chéreau, ou même d’Alex Ollé à Lyon, et bien sûr de Sellars/Viola, dans un style de « théâtre-performance ». C’est à dire un choix partagé par la plupart des metteurs en scène, dont Pierre Audi dans cette production.
L’autre voie, c’est de raconter une histoire « historiée », avec un décor très fonctionnel, un espace qui semble faire sens, des personnages qui existent hic et nunc : c’est par exemple le choix récent de Mariusz Trelinski, qui construit un cadre nocturne, sombre, aqueux, glauque pour son histoire, très circonstanciée, ou Claus Guth, qui en fait une sorte de métaphore musicale des amours de Wagner et de Mathilde Wesendonck , et un rêve de Mathilde Wesendonck agonisante.
Il est clair que Wieland Wagner a beaucoup marqué dans son approche de Tristan, seule (ou à peu près) mise en scène bayreuthienne de lui dont on possède des images animées (à Osaka avec Boulez), et il est tout aussi clair que les mises en scène des années 70 et 80 en sont largement tributaires (voir August Everding à Bayreuth). Enfin, un mot du concret/abstrait de Christoph Marthaler, avec son décor à strates temporelles : du premier au dernier acte, on avançait dans les temps, comme si cette histoire était inscrite dans notre mental de toujours, et dans un décor à la fois très concret, mais abstrait à cause du travail sur l’espace vide. Ce fut pour moi sans doute dans les quinze dernières années la mise en scène la plus musicale et la plus convaincante, y compris dans ses aspects décalés, voire cocasses.

Pierre Audi choisit l’option « Appia » à cause d’éclairages changeants, de jeux d’ombres, de lumières aux découpes précises, mais comme Marthaler il projette l’acte III dans un moment temporellement séparé, projeté vers le contemporain, hors du temps des deux autres en tous cas, puisqu’il propose des costumes plus contemporains, les coiffures réelles des chanteurs et non des perruques, et donc les protagonistes qui semblent non plus des rôles, mais eux-mêmes. Au troisième acte, semble nous dire Audi, on ne joue plus. Raum und Zeit se mélangent dans une vision parsifalienne (et le prélude de l’acte III de Gatti, stupéfiant, tire vers cette idée), où Tristan agonisant ne cesse de jouer sous un sarcophage, celui de son père, mais ce pourrait être aussi le sien propre, comme si on jouait le drame sacré de Tristan à l’occasion de ses funérailles. D’où les jeux de reflets dans le « cube » central où apparaissent les personnages jouant devant le trou noir de la salle, où apparaît selon la place qu’on occupe le chef, comme si le troisième acte était non histoire mais représentation : d’ailleurs le cube central du décor est comme une chambre noire où l’on voit les reflets presque comme en négatif.

Mais ce travail m’est apparu sans véritable clarté, même s’il n’est pas dépourvu d’idées et qu’il pose des questions sur l’œuvre, et même avec des moments bien réalisés – le deuxième acte par exemple, malgré un singulier décor. Dès le prélude, Audi évoque le passé, par une pantomime parlante autour de l’épée (qu’on retrouvera en écho dans la scène entre Isolde et Tristan avant le philtre) et le premier acte, le plus théâtral, le plus « concret », le plus explicatif, se déroule dans des ambiances diverses et multiples, avec d’incessants changements de décors, des cloisons qui bougent figurant cales et carénage du navire, et qui bougent tellement et trop qu’elles finissent par gêner la concentration et l’audition. Certes, elles contribuent à isoler les personnages dans leurs drame et à multiplier les points de vue pendant qu’en arrière plan des ombres montrent une sorte de « chœur muet » séparé des protagonistes, certes, l’instabilité du décor figure les hésitations ou l’instabilité de la situation, mais c’est mal fichu et ça fait trop de bruit, avec quelques idées dont celle de faire de Brangäne une sorte de mage qui contrebalance par un geste presque rituel (regard au travers d’un cristal blanc et lumineux) l’effet du philtre (qui est une pierre noire maléfique).

Si tout bouge au premier acte, tout est figé au deuxième, dans une sorte de forêt primaire et pétrifiée faites d’os de baleine disposées savamment (un sanctuaire ?) autour d’une pierre noire, une sorte de Lapis niger qui devient transparente au coeur de la nuit d’amour, figée qui d’une certaine manière fige aussi les protagonistes, dont le jeu est réduit au minimum, volontairement : le duo de l’abstraction amoureuse ne peut être perturbé par des attouchements ou des choses de « vivants », on est ailleurs, dans les limbes de l’amour, dans l’espace où tout n’est plus que représentation « Le monde comme volonté et représentation » dirait Schopenhauer : donc les amants ne se touchent quasiment pas, ils chantent chacun dans son espace – souvenir de Wieland, souvenir des mises en scène des années 70, mais dès que l’amour est évoqué, les deux êtres se positionnent en des points opposés du plateau, ou chantent face à la salle, sans se toucher.
Pendant les deux premiers actes, les vêtements, les coiffures nous renvoient à une sorte d’origine comme un Urwelt primitif lointain, fantasmé, irréel, vaguement sauvage un monde d’ombres, de quelques rais de lumière, sans vraie consistance. L’idée d’un Melot vieillard physiquement déchu, (très bon Andrew Rees) étayé, d’un corps tordu, est une des bonnes idées de la mise en scène, qui explique à la fois la jalousie éprouvée envers Tristan, et la scène du « duel », au demeurant assez mal réalisée, même si l’idée d’Isolde s’interposant n’est pas mauvaise en soi. Quant à Marke, il est au contraire dans la force de l’âge, de l’âge de Tristan ou peu s’en faut, – et d’ailleurs à ce titre, le timbre clair de Steven Humes est plutôt bienvenu – et cela donne au drame une couleur encore plus humaine : se détourner d’un Marke vieillard à qui Isolde serait vendue pour embrasser une histoire de couple « banal » et de trahison d’amitié plus que de vassalité.
Le troisième acte barré par un cube (une chambre) aux reflets multiples et où se reflète même le chef d’orchestre, et bien entendu le monde et le son se mélangent : et la musique (le chef) devient elle-même drame. Plus de « Urwelt », plus de perruques ; les personnages sont dans leur naturel d’individus, Isolde avec ses cheveux courts (elle avait une longue perruque) Brangäne de même ainsi que tous les protagonistes masculins : Melot méconnaissable ne se reconnaît que par sa canne-béquille. Ce basculement du temps interdit tout effet de suivi des 1/2ème actes et du 3ème. Le troisième est « révélateur », au sens photographique du terme (la chambre est noire…) d’une situation et le sarcophage révèle le destin de cette histoire. Mais il n’y plus ni histoire ni suite, mais simplement un espace commun où ce que nous venons de vivre aux actes I et II devient une sorte de rêve commun des protagonistes et de Tristan qui revit l’histoire dans un mouvement semblable à ce que faisait Sautet dans «Les choses de la vie», mais qui est aussi déjà mort et embaumé, comme si on entrait déjà dans le mythe ou qui va compléter la lignée des morts – si le sarcophage est celui du père de Tristan. Et les scènes finales, après le déchirant monologue de Tristan et l’ailleurs auquel il renvoie, c’est l’intrusion du monde (Kurwenal, Marke, Brangäne) en un authentique jeu de massacre qui va contraster avec la Liebestod, inscrire dans la chambre noire devenue chambre de lumière où Isolde apparaît en contrejour puis s’éloigne, en une image non d’apaisement, mais d’abstraction où l’espace s’élargit et respire (d’où le crescendo final inattendu) dans un contre jour sublime. C’est du moins ce que j’ai pu ressentir en voyant le spectacle. Audi a beaucoup travaillé la lumière, avec des ambiances très subtilement variées : Jean Kalman a fait un magnifique travail, car la lumière, le jour et la nuit sont des protagonistes de cette histoire : dans Tristan (c’est dit au 2ème acte) la lumière, c’est la mort et la nuit c’est la vie. Chaque rai de lumière est une intrusion mortelle. Tout cela est cohérent, mais ne va pas assez loin, n’est pas toujours clairement affiché, dans un décor de Christoph Hetzer au total pour mon goût relativement laid, malgré de très beaux éclairages.

La direction de Daniele Gatti, pour son premier Tristan s’appuie sur les qualités spécifiques de l’orchestre français, un National de France à des sommets qu’on croyait inaccessibles, un National de France complètement engagé, dans la main de son chef, lui répondant au doigt et à l’œil dans une relation de confiance visible : un peu tendu à la première, il donne le 15 mai une prestation inoubliable, prodigieusement raffinée, d’une énergie et d’une tension peu communes, le projeantant au niveau des plus grandes phalanges actuelles. Ces qualités de l’orchestre français , on les reconnaît à la fois pour un travail très approfondi sur les bois, qu’il tire résolument vers Debussy, et aussi pour faire ressortir un côté aérien de la partition, transparent, clair, que peut-être Gatti n’eût pu faire émerger avec une autre phalange. En même temps, c’est bien le caractère des chefs italiens dans Tristan que de travailler sur cette transparence et Gatti est « conforme » à cette tradition – l’une des plus riches de l’histoire de l’interprétation wagnérienne commençant à Guarnieri et passant par Toscanini, De Sabata et Abbado. Le prélude est particulièrement emblématique de cette approche : j’ai rarement entendu un prélude au son aussi aéré, d’une insondable mélancolie, mais gardant toujours une certaine tension qui se développe au premier acte, aux couleurs très variées, de la mélancolie initiale à la joyeuse allégresse typique des maîtres chanteurs quand Kurwenal évoque la bannière de la joie hissée sur le navire, ou l’ironie mordante et désespérée d’Isolde face à Tristan, Gatti donne une multiplicité de couleurs au texte, marquant aussi le drame, voire la tragédie : on sent qu’il dirige Mahler, car il sait rendre la musique ou grinçante, ou ineffablement lyrique : l’adéquation texte/musique est lumineuse, et les variations de couleurs sont nombreuses, qui déterminent ensuite des choix de tempos quelquefois inhabituels, mais jamais erronés : Il sait d’ailleurs nous dessiner une ambiance, qui évoque tantôt certains moments du Ring – citations musicales exhumées et entendues comprises-, à d’autres le Tannhäuser, ce double de Tristan que Wagner voulait revoir à la veille de sa mort.
La présence des bois et notamment du cor anglais magnifique, donne à certains passages une puissance inouïe, comme ce prélude du 3ème acte qui par sa lenteur, et son épaisseur rejoint par certains aspects celui du 3ème acte de Parsifal et même le presque contemporain prélude du 3ème acte des Meistersinger, lui aussi prélude à un long monologue existentiel du héros. Gatti y dessine un univers poétique, hors sol, qui va colorer tout le dernier acte.
Il travaille aussi la signification des tempi : à la mélodie de la Liebestod qui clôt le duo d’amour, il applique un tempo rapide, urgent, haletant même, alors que la même mélodie à la fin de l’acte III devient une sorte de mélopée lente, absente, presque majestueuse, également grâce à la voix de Rachel Nicholls, qui réussit à proposer une Liebestod pleine, présente et en même temps évanescente : c’est l’une des plus belles Liebestod entendues ces dernières années, supérieure par sa sensibilité et l’émotion qu’elle dispense à bien d’autres considérées comme des références. Rachel Nicholls, ou la sensibilité de l’émergence. L’orée d’une carrière, sans doute.
Et Daniele Gatti va rechercher tous les détails de la partition qui montrent les différents niveaux d’écriture, et fait émerger le labyrinthe des subtilités wagnériennes : il souligne les moments où la musique de Wagner est volontairement terrienne, comme lorsque Kurwenal parle, mais aussi à certains moments des interventions de Marke, ou de Brangäne, et il s’attarde sur le caractère céleste d’autres moments comme le duo du 2ème acte (c’est plus attendu) , bouleversant de poésie . Mais il sait aussi démêler moments « terriens » et « célestes » dans un même mouvement, grâce au jeu sur les pupitres (clarinette magnifique). L’évidente concentration de l’orchestre se lit aussi à la manière dont ils répondent, à la subtilité des appuis, de telle phrase plus longue, plus étirée, plus dilatée, suivie d’une concentration rarement directe, mais toujours modulée. Il y a là un travail d’une très grande profondeur, très varié, d’une très grande richesse que d’autres lectures ne nous ont pas fait toucher du doigt. Ce Tristan est toujours dramatique, mais jamais massif, jamais lourd, jamais surligné. Jamais par exemple les moments les plus connus ne sont soulignés de stabilo dans le style « écoutez comme je rends bien la musique : jouissez bonnes gens ! ». Un seul exemple, l’utilisation de la harpe, qu’on entend toujours clairement et systématiquement dans le duo du 2ème acte, beaucoup plus clairement que dans d’autres lectures et lorsque s’éteint la musique de la Liebestod, la harpe intervient nettement alors que très souvent on ne l’entend pas (Thielemann à Bayreuth par exemple): elle est pourtant déterminante pour la couleur de cette fin. Seul, de toutes mes expériences de Tristan, Claudio Abbado les faisait entendre, très fortement, très nettement ; ici Gatti fait de même, moins nettement que chez Abbado, mais bien de manière présente quand même, comme des sons à la fois sourds et fluides, comme un discret adieu ou un discret avertissement.
À ce travail d’artisan du son correspond une distribution complètement convaincue parce que Gatti, grand chef d’opéra, sait aider les chanteurs et surtout les écouter, écouter ce qu’ils peuvent faire ou non. Et donc on sent une distribution très réussie, dans son ensemble à l’aise avec l’œuvre. Peut-être le berger (qui est aussi le jeune marin) de Marc Larcher est-il le moins à l’aise de tous, il est vrai qu’il doit ouvrir l’œuvre pratiquement a capella, c’est à dire à découvert : la voix bouge légèrement, à la limite de la justesse. Il faut un ténor familier d’un chant presque bel cantiste ou mozartien pour cela (actuellement, un Tansel Akzeybek, magnifique Nemorino, est la voix la plus juste pour cela) et on se souvient à Paris du merveilleux Toby Spence avec Salonen. Andrew Rees est très expressif, et un Melot plutôt efficace au niveau du chant (ce qui n’est pas le cas de tous les Melot…).
Steven Humes, comme d’habitude, se montre un excellent chanteur pour son premier roi Marke. Chaque parole est sculptée, la voix est puissante, bien posée, bien projetée. On sent l’école de la Bayerische Staatsoper où il est resté 8 ans, mais aussi la formation anglo-saxonne, si soucieuse du texte et sa prestation le 15 mai a été miraculeuse d’émotion, rentrée, de justesse de ton, de présence. La surprise, c’est qu’on attend dans Marke des voix de basse profonde à la Pape ou Salminen, et on a ici une basse au timbre clair, lumineux, qui ne contraste pas avec celle de Tristan et qui par certains côtés, s’en rapprocherait même. C’est surprenant, mais dans le contexte de la mise en scène, où le vieillard est Melot, c’est plutôt cohérent. Magistral.
Michele Breedt promène sa Brangäne un peu partout, elle a chanté dans la production Marthaler à Bayreuth : elle m’a semblé ici plus engagée, plus « personnelle » avec une voix puissante et tendue, et qui contraste timbriquement avec Isolde, au timbre plus clair et plus métallique. Une belle présence et une prestation vocale remarquable, très supérieure à ce qu’on a pu entendre d’elle ailleurs, très incarnée, notamment dans la scène finale où elle donne l’idée d’un chant agonisant (dans cette mise en scène, Kurwenal la poignarde pour faire bonne mesure…).

Brett Polegato est magnifique en Kurwenal, voix sonore, merveilleuse diction, grande expressivité : il fait partie de ces Kurwenal très présents vocalement, vigoureux et solides. On a quelquefois des figures paternelles comme Jukka Rasilainen ou Hartmut Welker ou des figures juvéniles ou poétiques comme Michael Nagy (qui à certains moments semblait chanter un Lied au troisième acte) dernièrement à Baden-Baden. Ici, on a une figure plutôt mâle, plutôt énergique et chevaleresque : c’est très réussi.

Torsten Kerl est un Tristan au timbre velouté, très lyrique, qui donne une image plus tendre et plus fragile. J’avoue qu’autant son Siegfried ne réussissait pas à me convaincre. Ici son Tristan m’a complètement convaincu. Le 12 mai il a donné quelques signes de fatigue au troisième acte, mais l’ensemble possède une ligne cohérente, bien tenue, avec des notes puissamment tenues, sans jamais de ruptures, y compris dans un troisième acte qui les favorise, le 15 mai, il affichait une forme insolente et a été somptueux, magnifique, émouvant de bout en bout. Tendresse, finesse, intelligence du chant caractérisent cette prestation. Certes, Kerl est plus ténor qu’acteur, mais c’est vraiment un Tristan convaincant.
Rachel Nicholls est évidemment une découverte : elle a remplacé au milieu des répétitions Emily Magee initialement prévue. Ce n’est pas un timbre séduisant au sens où la voix serait charnue et ronde, d’une puissance à la Stemme. Mais elle tient la comparaison, avec d’autres moyens. D’abord, c’est une chanteuse résistante : pas de traces de fatigue, une Liebestod tenue sur un tempo lent que peu de chanteuses peuvent tenir de cette manière. Ensuite, elle a un timbre un peu métallique et aujourd’hui les Isolde de ce type sont rares : nos temps préfèrent les timbres plus chauds et moins coupants aussi bien pour Isolde que Brünnhilde d’ailleurs. Les aigus sont tenus, sont vaillants, même si le suraigu au premier acte est un peu acide, un peu rude. Mais c’est une chanteuse très sensible, à la présence rayonnante et un sens du mot étonnant pour une non germanophone, le mot est dit clairement, l’expression est d’une incroyable richesse, expressivité musicale et expressivité du discours (exemple, la manière dont elle dit « Knecht » d’une rare vérité) elle sait dire l’amour, l’ironie, le sarcasme avec une variété de ton stupéfiante. Je pense que cette prestation parisienne va lui ouvrir de grands théâtres (elle sera aussi Isolde à Rome avec Gatti en décembre). Magnifique Isolde qui n’est pas une enchanteresse éthérée à la Stemme, dont la voix est incomparable mais elle est sans doute plus vraie, plus dramatique : elle plie sa voix au sens et en utilise aussi avec intelligence les défauts, ce qui la rend particulièrement convaincante. Magnifique découverte.
On remarque que l’essentiel de la distribution est anglo-saxonne, témoignage de la vitalité du chant anglo-saxon et des formations dispensées aussi bien aux USA qu’en Grande Bretagne, témoignage aussi du travail des agents artistiques, mais c’est aussi une distribution inhabituelle, notamment pour moi qui laboure l’Allemagne. C’est une distribution « disponible » qui a su se plier au travail du chef, et cette réussite est le résultat d’interactions qu’on lit dans la représentation. Un travail solidaire où il n’y a pas d’histrionisme ou de vedettariat.
Au total, avec les réserves sur une mise en scène non dépourvue d’idées, mais qui reste pour moi au seuil d’une vérité scénique qu’il n’est pas facile de trouver dans Tristan, œuvre qui laisse plus d’espace immense à la théorie et à l’arrêt, qu’au théâtre, c’est surtout une très grande, une immense réussite musicale ; Gatti confirme qu’il est un grand chef pour Wagner, parce qu’il ose aller ailleurs, directement, sans détour et qu’il ose aller contre toute la doxa, et l’on sait que la doxa wagnérienne est une chape de plomb avec ses interprétations convenues ou gravées dans le marbre dont il est difficile de se libérer. Il sait tenter, il sait affronter parce que sa démarche est d’abord pesée, réfléchie, et donc intelligente: c’est un work in progress car un premier Tristan renferme le germe du futur passionnant, avec d’autres orchestres, d’autres couleurs, d’autres cast. Mais comme coup premier, c’est un coup de maître. En ce sens, si je peux comprendre que la démarche de Gatti ne convienne pas à tous, je reste interdit devant l’imbécillité structurelle des hueurs du 12 mai (le 15 ce fut un triomphe indescriptible – comment pourrait-il en être autrement ?) : devant un tel travail, devant un tel orchestre (car le National de France fut prodigieux, et si engagé, et si coloré, et si virtuose !) au pire, on se tait, mais on n’affiche pas publiquement sa bêtise et son ignorance crasses. [wpsr_facebook]