« Le principe de précaution n’a de sens qu’associé à un principe de risque indispensable à l’action et à l’innovation »
Edgar Morin
Merci Monsieur de Villiers, vous avez montré qu’on peut être entendu avec un peu de relations haut-placées, et de la volonté, et notamment celle, farouche de faire que votre bébé le Puy du Fou puisse ouvrir et offrir au public ses prestations spectaculaires. Vous avez sauvé votre bébé et pu proposer une fois à 12000, une autre fois à 9000 personnes, votre spectacle.
Et c’est dit (presque) sans ironie.
Tout le monde a été choqué de voir qu’alors que le gouvernement s’égosille à nous inciter à porter le masque, à respecter les mesures barrières, à ne pas se réunir (ah la chasse aux rave-parties) resserre les boulons et continue d’interdire les spectacles à plus de 5000 personnes, le Puy du Fou organise sa rave-party historique avec 9000 personnes, et la bénédiction du préfet (un as des protocoles sanitaires), de la ministre de la culture, qui souligne qu’il n’y a pas eu de passe-droit, et d’autres autorités, dont une malheureuse députée LREM de la Vendée qui aurait mieux fait de se taire.
Qui parle de passe-droit ? On sait que tout s’est joué entre de Villiers et le Président de la République, dont la parole vaut sésame et sans doute dit le droit. Dans un État aussi pyramidal où la Présidence dit oui ou non au gré de ses intérêts bien compris, nomme les directeurs d’opéra, et s’affiche copain-copain en bras de chemise avec le monde de la culture – c’est comme ça qu’on montre sa proximité-, qu’attendre de plus ? S’il y a passe-droit, c’est un passe-droit divin.
J’ai beaucoup aimé la députée de Vendée LREM (j’ai oublié son nom qui tombera sans doute dans les oubliettes de l’histoire) qui défendait son bifteck médiéval (ou historique) en affirmant que le Puy du Fou prenait toutes les mesures sanitaires pour protéger les populations. Comme si c’était le problème.
Le problème, c’est qu’il existe plusieurs vérités. Il y a la vérité du Puy du Fou, une manifestation en soi suffisamment respectable et de qualité pour attirer des foules depuis des années (même si l’on peut ne pas partager ces visions de l’histoire et du roman national) et il y a la vérité des festivals d’été de musique classique et moderne, rock, jazz, opéra, de théâtre, interdits sans rémission ou sans dérogation.
Pour ma part je m’intéresse aux Festivals de théâtre et de musique classique, et depuis plus d’un mois, je sillonne Italie, Suisse et Autriche pour écouter de la musique et voir des spectacles: oui, c’est possible ailleurs, sans que j’aie la conviction que ces pays soient remplis d’inconscients et de risque-tout.
Ce que je vois au contraire, c’est une étonnante unité, les masques, le (ou la) Covid, les avertissements, les mesures-barrières, avec plus ou moins d’élasticité, mais une présence affirmée partout de la pandémie.
Cette uniformité de l’adversité ne s’accompagne pas d’unité des pays devant l’adversité. Chacun agit de son côté, hélas, et la France, vous savez cette France de la culture, mère des arts etc…etc… a choisi de ne pas rouvrir ses salles et de ne pas offrir au public ses grands festivals d’été, même revus à la baisse. Un choix venu de l’État qui fait tout, et ni les Collectivités locales, ni les Régions n’ont moufté, de peur qu’en cas de reprise de la pandémie, on les accuse de laxisme.
Et pourtant, et malgré tout, la pandémie est en train de reprendre…
En Italie, partout où je suis passé, les Régions ou les villes sont en première ligne pour soutenir les manifestations, qui se sont tenues en format adapté ou réduit, mais qui ont toutes marqué le coup. Le Maire de Pesaro affirmait « il faut repartir par la culture ». En France on est reparti du Puy du Fou d’un côté et de La Roque d’Anthéron de l’autre, et c’est tout à leur honneur, et on s’est arrêté là .
L’État français, il faut le reconnaître, a consenti au monde artistique d’être sauvé par le prolongement du statut d’intermittent, qui permet aux professionnels de vivre au moins a minima, mais pas d’exercer leur métier. Cette aide essentielle (conquête de Franck Riester qui l’a obtenue, il faut rendre à César… ) semble avoir été l’alpha et l’oméga pour faire taire : l’argent fait tout.
Si le système unique en Europe de l’intermittence permet de répondre à cette urgence-là, et sauve les individus de la misère, il n’en sauve pas l’institution culturelle dans son ensemble qui attend de l’État d’autres gestes pour cette fois-ci sauver les institutions, mais aussi assurer la présence effective de la Culture dans la vie de la cité. En ayant un Ministère de la Culture, l’État affirme du même coup ses prérogatives en la manière, mais aussi ses devoirs, pourvoir au cadre qui garantit l’activité culturelle, pas l’empêcher, surtout lorsqu’il y a une vérité en Vendée et une autre vérité ailleurs.
On a nommé une Ministre de la Culture éminemment sympathique, et populaire, dans le but de faire de la présence et communiquer, ce qui manquait cruellement. Va-t-elle, en plus, agir?
Au-delà de la guerre des vaccins, des communications tonitruantes (Poutine il y a peu), on sait bien que la question du vaccin est encore en haute mer. Les vigies annoncent « terre » à tout va, mais ce sont encore des mirages. Les institutions culturelles, théâtres, opéras, savent bien en dépit des programmes affichés que les conditions de représentation « normales » ne reprendront ni cet automne, ni cet hiver. Car à supposer qu’un improbable vaccin voie le jour, il faudra des mois avant qu’il arrive dans les seringues du tout-venant, ce qui nous mène allègrement à l’été 2021. Le président de l’académie des sciences d’Allemagne Gerald Haug l’avait dit et avait horrifié: nous y voilà ou presque. (https://www.francemusique.fr/musique-classique/en-allemagne-les-salles-de-spectacles-pourraient-rester-fermees-18-mois-83100).
Bien entendu, personne ne le souhaite, et dans la société du « tout, tout de suite » qui est la nôtre, c’est une perspective qu’on met sous le tapis. Il reste que la question de la reprise de l’activité culturelle se pose, car si elle reprend, elle ne reprendra pas comme avant et en France, on n’a pas utilisé la courte période de répit pour tenter quelque chose.
L’État a été très silencieux en la matière, et en France où tout procède de lui, ce silence trahit une gêne. Car comment édicter des règles communes pour des théâtres ou des opéras, et des salles de musiques actuelles sans sièges, aux formats et configurations si différents ? Comment peut-on comparer la fosse d’orchestre de Bastille et celle de Lyon, le Théâtre des Célestins de Lyon et le TNP de Villeurbanne ou la Comédie Française. Comment édicter des règles pour des programmations diversifiées, pour des opéras avec un chœur d’une centaine de personnes et pas de chœur, entre Erwartung et Aida ? Il y a des difficultés à édicter un protocole général et universellement applicable.
On attend de l’État qu’il dise la règle. On attend de l’État qu’il paie. C’est de bonne guerre, mais du côté des institutions, qu’attendent d’elles-mêmes les grandes institutions culturelles, qu’attendent d’eux-mêmes les grands managers des Festivals qui communiquent à tout venant quand il n’y pas de problème et qui depuis les annulations en chaine, au moins pour le théâtre et la musique classique, n’ont pas dit grand-chose.
Alors regardons ailleurs, et méditons.
En Italie, en Suisse, en Autriche, et même en Espagne (au teatro Real) , on a tenté la reprise: les Festivals ont proposé une programmation, même réduite, même redimensionnée, certains Opéras ont proposé des saisons d’été, c’est le cas de Rome, une saison complète au Circo Massimo, ou des moments exceptionnels comme à Naples. Et partout, la reprise a été négociée avec l’appui des pouvoirs publics.
En Autriche, le poids du Festival de Salzbourg, le poids des Wiener Philharmoniker ou même de l’Opéra de Vienne est énorme, parce que ces institutions sont emblématiques de l’Autriche, de son histoire et de ses traditions, alors on les écoute et la programmation spéciale du Festival de Salzbourg a été décidée au plus haut niveau de l’État. C’était le centenaire du Festival musical le plus important du monde, et en deux mois, une proposition révisée a vu le jour, pas d’orchestres invités, présence des Wiener, deux productions d’Opéras, et quelques récitals, dont un cycle de huit concerts d’Igor Levit avec une assistance divisée par deux.
En Suisse, le festival de Lucerne a fait une proposition minimale, mais a quand même proposé une dizaine de concerts que Wanderer suit et dont il rend compte. Les financements sont différents, le poids de l’Etat fédéral est moindre qu’en Autriche, et l’autofinancement est fort. Il fallait jouer entre les possibles imposés par une assistance divisée par 2 et une programmation coûteuse. Il a fallu renoncer par exemple à la traditionnelle présence à Lucerne des Berlinois fin août début septembre.
Même situation en Italie, le pays le plus touché en Europe et qui avait besoin d’afficher ce retour à une certaine normalité, et partout, les Institutions culturelles ont été soutenues par les structures politiques, essentiellement régions et villes.
Dans ces trois pays, c’est l’initiative des structures culturelles, alliées et soutenues par les cadres politiques qui a abouti à une programmation. Sans les politiques, pas de soutien, pas d’argent, et pas d’autorisation sanitaire non plus. (A Naples, par exemple, c’est la région Campanie qui a financé toute la programmation du San Carlo, les deux opéras en version de concert aux distributions stratosphériques et la IXe de Beethoven). En France, le politique n’a pas bougé.
On sait que chaque pays gère les protocoles sanitaires et qu’il y a d’un pays à l’autre des différences, mais dans l’ensemble, les recommandations pour le public se ressemblent, port du masque, distanciation avec en Italie prise de température, en Suisse port du masque pendant le concert, en Autriche et en Italie on peut l’enlever, mais dans l’ensemble ce sont des mesures assez voisines.
Là où ils diffèrent c’est pour la protection des professionnels. Chacun veille évidemment à la sécurité sanitaire des artistes : en Italie on invente des mises en scènes distanciées ou l’on propose des versions concertantes avec orchestre et chœurs distanciés, en Suisse (à Lucerne) c’est sensiblement la même chose : 35 musiciens pour l’Eroica occupaient toute la largeur de la scène du KKL les 14 et 15 août. En Autriche, on ne renonce pas à une mise en scène « normale » (Le Cosi fan tutte de Loy est très rapproché, on se touche, on se frotte on s’embrasse) mais les artistes sont très régulièrement testés, il y a un dispositif sanitaire spécifique pour que tous les participants – solistes, orchestres, chœurs, techniciens- soient testés régulièrement. Plus généralement, on est presque plus attentif aux personnels qu’aux spectateurs ou aux visiteurs qui en dehors des règles communes, sont des êtres responsables.
Mais le Covid est dans les têtes partout, et les spectateurs se comportent de manière très concentrée ; car la situation invite à la concentration ; peu de tousseurs entre les mouvements, un silence tendu pendant la représentation et les toilettes à Salzbourg sont plutôt sobres: pas d’entracte pour en faire l’exposition.
Nos voisins ont réussi à produire là où la France-mère-des-arts n’a même pas essayé.
Ou plutôt seul René Martin a réussi à préserver la Roque d’Anthéron avec les conditions particulières du lieu, et Philippe de Villiers s’est débrouillé pour défendre le Puy du Fou et assurer la saison.
Et les autres ?
Il est bien sûr de bon ton d’accuser l’État et ce gouvernement. Je l’ai fait plus haut et à juste titre parce que l’État en France à la différence d’autres pays, n’a pas encouragé les institutions culturelles à faire des propositions alternatives, même en mode mineur, pour assurer symboliquement une présence culturelle durant l’été. Il a sans doute estimé cela superfétatoire et à la limite dangereux.
Pourtant, du côté des institutions plus petites et des initiatives locales, il y a eu beaucoup d’efforts et d’initiatives pour susciter des manifestations un peu partout, ce qu’à une époque on a appelé des « petits » festivals, expression cryptique qu’on voudra bien expliciter. Il faut saluer par exemple les efforts d’un Thomas Jolly à Angers ou les surgissements bienvenus, comme ce Festival du Château Rosa Bonheur, dédié aux compositrices, avec une jauge limitée à 100 personnes, (https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/festival/), et il y a bien d’autres initiatives heureuses, disséminées dans le pays.
Le 19 août je crois, la ministre a rencontré les institutions culturelles qui une fois encore appellent l’État à l’aide pour obtenir des moyens ou libérer le secteur du protocole sanitaire et va sans doute laisser espérer une évolution dans un futur proche, tout au moins elle va référer les demandes au plus haut…comme tout ministre, la ministre de la Culture est un intermédiaire entre la terre et Dieu. Mais d’après ce qu’on sait, elle va demander la fin de la distanciation, puisque dans d’autres cadres (la SNCF, l’école même…), celle-ci est n’est plus une obligation. Ainsi, les institutions culturelles au nom de leur survie ne s’imposeront plus grand chose, sinon de belles paroles rassurantes. Je ne sais si c’est une solution, je sais seulement que cet été, toutes les manifestations se sont déroulées avec la distanciation et elles n’ont pas perdu leur âme.
On se trouve donc au cœur d’un paradoxe absurde. Au contraire d’autres pays, aucune grande institution culturelle n’a produit la moindre minute de spectacle vivant, mais l’État a assuré aux travailleurs du secteur une vraie protection. Ils ne travaillent pas, mais ils sont protégés. Il faudra bien que les artistes se remettent à produire, d’une manière ou d’une autre pour honorer leur fonction sociale…France-mère-des-arts…
On voit le danger d’un tel système. Une fois encore, la solution tombe d’en haut, les sous, les moyens, évidemment jamais suffisants et surtout, personne n’a abordé depuis cet été le problème central des conditions de la production de spectacles, des protocoles à mettre en place à la rentrée (on croit comprendre pourquoi, les institutions ne veulent pas de protocole contraignant…) . Seule (saine) réaction, celle de Jeremy Ferrari dans sa lettre ouverte il y a quelques jours.
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/covid-19-lettre-d-un-humoriste-au-gouvernement-16-08-2020-8368551.php
Si cet été quelques institutions en vue avaient programmé même a minima comme ailleurs, on aurait peut-être eu grandeur nature diverses expériences et configurations, comme en Italie, en Autriche, en Espagne et en Suisse, qui auraient permis de faire ensuite des choix, d’avoir plusieurs plans, plusieurs réponses à un problème qui, je le répète, ne va pas s’éteindre cet automne, ni même cet hiver et qui ne peut se traiter qu’au plus près du terrain et presque au cas par cas.
Le problème logistique d’ailleurs est beaucoup plus complexe pour les grands festivals rock avec leur assistance pléthorique que pour les festivals de théâtre et de musique classique, qui attirent un nombre de spectateurs moindre. Mais pour tous, la question est économique, celle de trouver un autre rapport entre l’offre et le nombre de spectateurs. Au lieu de cela, on a fait pleurer Margot sur un secteur sacrifié, mais les sacrifiés se sont laissé faire, refusant souvent implicitement de changer ou d’adapter leur format.
Ce qui frappe en Italie ou à Salzbourg, c’est la volonté d’arriver quoiqu’il en coûte à offrir une programmation, et par la diversité des réponses, voire par les risques qui ont été pris, on a vu l’imagination au pouvoir, mais aussi l’enthousiasme de reprendre l’activité, quoiqu’il en coûte, tout en essayant de préserver la santé des spectateurs et des professionnels. Une institution aussi importante que l’Opéra de Rome a bouleversé sa programmation et Daniele Gatti ne dirigera pas cet automne Rake’s Progress comme prévu, mais Zaide de Mozart, plus économe en moyens et plus conforme aux exigences sanitaires.
Pour chaque institution, la programmation est un vaste point d’interrogation et certaines ont pris ou prennent des décisions en essayant de s’adapter presque au jour le jour, tant le terrain est accidenté et le brouillard épais.
L’État a-culturel (pour reprendre en l’adaptant une expression du regretté Marc Fumaroli) a fait le choix de faire taire le secteur en donnant de l’argent et en assurant la pérennité de l’intermittence. Et le secteur a ouvert les vannes des vallées de larmes sur le monde culturel arrêté. Pour le reste, il n’a pas un seul instant encouragé les grandes institutions culturelles qui illuminent l’été comme Avignon ou Aix à proposer quelque chose de minimal au public. Manque d’imagination ? Peur panique -partagée par tous, État, collectivités territoriales et locales, institutions elles-mêmes-, d’être accusé(s) de laxisme si l’épidémie reprenait : elle est en train de reprendre de toute manière et on n’a même pas essayé de lutter.
Sauf au Puy du Fou, qui devient l’emblème du combat pour le maintien de l’activité…Il y a de quoi s’inquiéter pour ce pays de peurs et d’hésitations, où l’imagination et le courage s’effacent au profit de la pusillanimité.
A-t-on entendu, après les valses hésitations qui ont précédé l’annulation, les responsables de grandes institutions comme Avignon ou Aix, proposer, demander une dérogation, suggérer une programmation de substitution redimensionnée aux exigences de la pandémie ? On croit rêver en lisant qu’une “institution” aussi solidement arrimée à son os que Jean-Michel Ribes « ignorait » qu’il y eût des possibilités de dérogations. Voilà quelqu’un qui dirige un théâtre et ne se tient donc pas au courant des textes ?
Et si les grandes institutions s’étaient un peu agitées, elles l’auraient fait savoir, rien que pour montrer au bon peuple qu’elles avaient envie de reprendre , qu’elles avaient des propositions alternatives mais que l’État-castrateur leur a brûlé les ailes et étouffé leur enthousiasme renaissant.
Mais non, elles ne l’ont pas fait, parce qu’elles n’ont pas voulu, ni osé jouer leur rôle de défenseur de leur institution et de serviteurs d’un public qui serait venu, même divisé par deux ou trois. Surtout, elles n’ont pas répondu à leur mission. On dit en italien Onore onere (à l’honneur correspond la charge…) : on veut bien de l’honneur, mais pas de ce qui va avec.
D’autres pays l’ont fait, dont l’Italie, bien plus atteinte par le virus que nous qui a voulu faire de cette reprise des spectacles un symbole fort. La France n’a rien fait, non seulement à cause d’un État qui s’est lavé les mains de la reprise de l’activité culturelle et qui s’est contenté de servir à la profession un abondant plat de lentilles (ce qui était important voire indispensable) et de l’autre des managers culturels habiles par temps calme et muets dans la tempête, qui au fond, se sont lavés les mains eux aussi d’une programmation de secours ou redimensionnée, et ils n’ont ni proposé, ni lutté pour assurer une présence estivale de leur institution : quand on compare ce qu’a proposé Salzbourg et ce que propose le Salzbourg français, Aix en Provence, même si une alternative numérique a été pensée, et c’est méritoire, on reste perplexe par ce qui a été produit et sur l’effet médiatique ou culturel, et surtout sur l’objectif poursuivi. Les artistes étaient présents, ils répétaient, une production pouvait être montée, à la salzbourgeoise, à la romaine, à la napolitaine, à la madrilène, d’autant que le Théâtre de l’Archevêché est en plein air, ça aurait eu un plus grand effet, voire un effet d’entrainement.
Et Avignon ? Il y a là aussi des lieux à ciel ouvert, dont la Cour d’honneur. Une seule production, comme « aux origines », dans la cour d‘honneur, avec moitié moins de spectateurs mais avec les artistes qui de toute manière étaient inoccupés, ça n’était vraiment pas possible ? En deux mois Salzbourg a monté une programmation, en un mois Rome comme Naples ont monté une programmation et construit ex nihilo une scène, des gradins, des coulisses. Pas Avignon ? Pas Aix ?
L’Allemagne est un cas un peu différent : il y a peu de Festivals d’été (Baden-Baden mais c’est à Pâques son grand moment et le festival de Schleswig Holstein annulé aussi organise quelques manifestations fin août en appelant cet été “l’été des possibles” – Sommer der Möglichkeiten), mais le territoire est maillé de théâtres publics avec leur personnel technique et artistique salarié : ouvrir même avec un public plus espacé ou réduit coûtera moins que laisser fermer parce que la présence d’un public même réduit atténuera les charges. Avantages en l’occurrence du système de répertoire.
Il reste la question du Festival de Bayreuth, le plus important du pays, dont la situation est particulièrement délicate. Si la pandémie dure jusqu’à l’été 21 et au-delà, l’adaptation du Festival de Bayreuth à la situation posera de vrais problèmes dans la mesure où à la différence de Salzbourg, il ne possède pas trois salles, mais une salle, qui est l’objet-sujet du Festival.
Et la question n’est pas celle du public, on mettra un siège occupé sur trois et on aura un protocole strict – avec le problème des entractes d’une heure et de la restauration, mais on y arrivera sans doute. Ce n’est pas non plus la question de la scène et des chanteurs, ni des techniciens, on peut tout résoudre en termes de mise en scène et d’organisation technique. Salzbourg l’a montré et va sans doute servir de modèle.
La question est celle de la fosse, le lieu vedette de ce théâtre, qui est une étuve, avec des musiciens très serrés et enfermés pendant des heures. Un vrai bouillon de culture. On ne peut reprendre en plein air ou dans un autre lieu, sinon le Festival perd son âme, sa nature, son objet, sa singularité.
Alors si l’on veut reprendre à Bayreuth il faudra une politique sanitaire drastique pour protéger les musiciens, une politique de tests permanents, à moins que d’ici là d’autres tests aient été trouvés, plus faciles et plus rapides, et qu’on ait pu convaincre les musiciens de venir y jouer ou des versions de concert avec orchestre sur scène, ce qui se profile un peu avec la Walkyrie prévue en 2021. D’ailleurs le Festival vient de communiquer qu’il donnera le programme 2021 en fin d’année, signe que les choses ne sont pas encore stabilisées et mettra en vente les billets en janvier 2021, avec une probable réduction de l’offre. Voir le communiqué: https://www.bayreuther-festspiele.de/festspiele/news/2020/ticketing-2021/
Seul un vrai pilote dans l’avion peut prendre des décisions, – et actuellement c’est difficile -, mais je gage que si Bayreuth reprend, ce sera avec un nombre de places réduit et moins de productions jouées peut-être plus souvent, pour permettre des alternances plus lâches et moins de personnel pour abaisser les coûts. Mais c’est très loin d’être gagné.
En Allemagne cependant, on vient de voir que Charité (le grand Hôpital de Berlin, qui inspire la politique sanitaire allemande) a déclaré qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que les salles d’opéra et de théâtre soient pleines sans distanciation :
Attendons donc, tout est ouvert là encore et les évolutions sont rapides: peut-être notre ministre portera-t-elle cette information en appui de ses demandes.
Je suis conscient qu’on pourra m’objecter mon ignorance des vrais problèmes, de la logistique, de la technique etc… et me renvoyer au comptoir du café du Commerce d’où j’édicte mes y’avait qu’à ou mes y’a qu’à…J’assume d’être un observateur naïf, mais je voyage en Union Européenne, à nos portes, et je vois simplement qu’ailleurs on a abattu des montagnes pour produire, et que la France des Festivals est une morne plaine, comme Waterloo et ça me désole et provoque ma colère.
Ce n’est pas seulement l’État, lamentable en l’occurrence, qui est responsable de la situation : ceux qui ont voulu ont produit, Le Puy du Fou, La Roque d’Anthéron. Et si de Villiers a obtenu le feu vert de l’Élysée, au moins il est allé au bout de sa logique. L’Élysée aurait-elle donné le feu vert à Avignon ou Aix ? Moindre valence politique : au poids, les autres ne valent pas un de Villiers sans doute aux yeux du Prince. Mais ont-ils seulement essayé ? Ils sont co-responsables de ce désastre en termes d’image, de ce désastre en termes de valeurs et je dirai, d’éthique. Cette incapacité à défendre l’activité de leur institution, à inventer, à s’adapter à la situation, cette absence de volonté de lutter me laisse quelques doutes. Durch Schäden wird man klug dit-on en Allemagne, c’est par les problèmes qu’on devient intelligent, il y a encore du chemin à faire.
Enfin, cet automne, ou cet hiver, dans ce pays qui a connu des mouvements sociaux et les gilets jaunes, le syndicalisme présent et actif dans le spectacle aura beau jeu d’ajouter aux revendications habituelles, les considérations sanitaires pour freiner l’activité, à l’Opéra de Paris ou ailleurs, et là ce sera la boite de Pandore, car s’il y a une leçon à retenir de la crise de l’Opéra de Paris, c’est que bien peu ont pleuré son absence – sinon les passionnés. ou les abonnés qui avaient investi de l’argent. Veillons tous à ce que l’absence de spectacle vivant ne finisse pas dans l’indifférence. Certains pensent même déjà que le Covid en a signé ou au moins en annonce la fin.














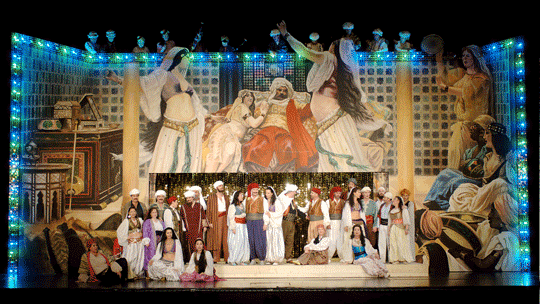


 Quel souvenir! la Horne sur son cheval, avec son casque à plume et sa cape rouge! Et quel souvenir musical!
Quel souvenir! la Horne sur son cheval, avec son casque à plume et sa cape rouge! Et quel souvenir musical!