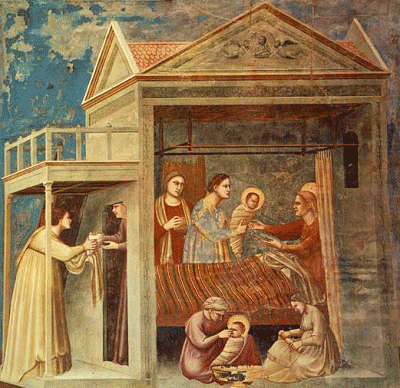Avant d’aborder le spectacle en lui-même, il convient de saluer le très grand effort de la Bayerische Staatsoper pour promouvoir cette création, dont on nous parle à travers mails, tweets, blog, pages Facebook depuis plus d’un an et dont nous avons suivi l’élaboration à travers une campagne de communication intelligente et sympathique. Bien peu de théâtres de cette importance investissent autant dans une création contemporaine. Un effort qui s’est traduit par une production de très haut niveau, une distribution sans failles, une direction musicale extraordinaire et un succès public étonnant : toutes les représentations sont complètes pour cette première série.
Étonnant , oui, j’emploie à dessein le terme. Car le public d’opéra n’a pas la réputation d’être ouvert à la modernité, à la musique d’aujourd’hui, à la création. C’est un débat déjà ancien, cher à Gérard Mortier qui annonçait la mort de l’opéra si l’on ne l’ouvrait pas à la création, car un art ne peut vivre en ne se nourrissant que du passé, même si de manière substitutive ce sont les mises en scène qui se renouvellent et pas les œuvres, – en soulevant maints scandales – et même si les programmateurs remettent au goût du jour un répertoire disparu, comme le répertoire baroque depuis une trentaine d’années et aujourd’hui le grand opéra à la Meyerbeer. On fêtera bientôt le retour de Auber ou Mercadante, et pourquoi pas d’ailleurs ? Mais on avance alors à reculons.
Et d’ailleurs ce n’est pas la création le problème non plus, car bon an mal an, on crée de nouveaux opéras. Le problème ce sont les reprises de ces œuvres. Soucieux de respecter leur cahier des charges qui fait place à la création, les théâtres d’opéra mettent des créations dans leur saison, mais une fois créées, les œuvres sont vite rangées dans les tiroirs aux souvenirs ou les placards de l’oubli. Qui se souvient au Teatro alla Scala, un des théâtres les plus riches en créations tout au long de son histoire, y compris récente, d’Atem, de Franco Donatoni (1985) de Blimunda (1990) ou du Dissoluto assolto (2005), d’Azio Corghi, ou du Doktor Faustus (1985) de Giacomo Manzoni, dont Claudio Abbado a créé Atomtod en 1964 ? Et quand sera repris CO2, de Giorgio Battistelli, créé en 2015 ?
Que South Pole soit créé avec succès, c’est évidemment très positif, d’autant plus que l’opération soutient un compositeur encore peu connu, Miroslav Srnka, né en 1975, formé à Prague, à Berlin, en Italie (auprès de Ivan Fedele) à Paris (auprès de Philippe Manoury et à l’IRCAM) qui a déjà travaillé en 2011 avec le théâtre munichois, comme d’ailleurs pour “Junge Szene” du Semperoper de Dresde.
Il est vrai que le Bayerische Staatsoper a mis beaucoup d’atouts dans l’opération : une distribution de référence avec deux vedettes, Thomas Hampson et Rolando Villazon, une mise en scène confiée à l’un des plus prestigieux metteurs en scène allemands, Hans Neuenfels, et l’orchestre dirigé par le GMD en personne, Kirill Petrenko.
C’est ce dispositif d’ensemble qui me paraît marquant dans l’opération, aussi bien dans l’artistique que le marketing. Il faudra maintenant bien surveiller les programmes des saisons futures pour voir combien de reprises de cette production.
Il est toujours émouvant d’assister à une « Uraufführung », notamment dans le théâtre qui a créé Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Das Rheingold et Die Walküre bien sûr, mais aussi Idomeneo (au Residenztheater), I quattro rusteghi (Wolf-Ferrari), Palestrina (Pfitzner), Capriccio de R.Strauss et plus récemment Lear de Aribert Reimann qu’on va revoir à Paris prochainement.
Et une semaine après cette triomphale Première (dont le succès ne se dément pas à chaque représentation), des images et des fragments de cette musique me restent en mémoire, c’est sans doute bon signe.
Il est évidemment difficile d’édicter une opinion sur une musique jamais entendue : la critique se nourrit de comparaisons et de systèmes d’échos, d’expériences diverses, et le jugement se construit évidemment par l’histoire et l’expérience. Miroslav Srnka ayant surgi brutalement dans mon univers musical, presque ex-nihilo, comme pour la plupart des spectateurs, ce que je pourrai écrire à propos de cette œuvre tiendra sans doute plus de l’opinion que du jugement, et on me pardonnera.
Le sujet du livret anglais de Tom Holloway, est la « course » au pôle que se livrèrent entre 1910 et 1912 Roald Amundsen et Robert Falcon Scott, un sujet à la fois original et austère, que le livret traite en « Doppelopera », en opéra double, l’un ayant pour centre Scott, et l’autre Amundsen, soulignant ressemblances et différences, jouant sur un texte semblable et décalé, organisé autour d’une première partie qui est la conquête du pôle, et une seconde partie qui est le retour, fatal pour Scott.
Ainsi donc, l’opéra est une série de moments, d’espoir, de crise (la mort des animaux), de méditation, mais aussi de souvenirs : l’intervention des épouses, Kathleen Scott (Tara Erraugh, mezzo) et la « Landlady » (Mojka Erdmann, soprano colorature) organise une sorte de Recherche du temps perdu très proustienne. Deux parcours parallèles dans un univers uniformément blanc, deux parcours très semblables et très différents, l’un moderne et mécanisé, mais hasardeux (Scott), l’autre artisanal et préparé avec précision et rigueur (Amundsen). Deux visions du monde et deux personnalités, qui se construisent en première partie, et dont le destin se scelle en seconde partie. C’est linéaire et plat comme les étendues de glace, et c’est néanmoins varié comme la diversité des hommes.
Les deux opéras se déroulent en même temps et parallèlement, mais dans deux espaces différents, que Hans Neuenfels a matérialisé par une séparation, au sol. À Jardin, l’espace Scott, à Cour, l’espace Amundsen.
Musicalement, la séparation est aussi sensible : l’équipe de Scott est faite de ténors, et menée par le ténor Rolando Villazon, et celle d’Amundsen (baryton) par des barytons. Peut-être pour marquer dans les voix d’un côté la légèreté (de la préparation ?) et de l’autre son épaisseur et son sérieux. Parallèlement, les voix féminines font contraste puisque Kathleen Scott est mezzosoprano dans un monde de ténors, et la Landlady est soprano colorature dans un monde de barytons. Cette modulation des voix donne couleur à l’ensemble, et aux ensembles. Les animaux sont des instruments, les cors pour les poneys de Scott et les clarinettes pour les chiens d’Amundsen.
Le texte construit un système d’écho, notamment au début, de phrases identiques. Il est dit successivement avec des couleurs différentes : même phrases, mais couleurs variées.
L’orchestre est immense, très riche en bois, particulièrement fournis, et en percussions très variées (crotales, marimba, vibraphone, mais aussi Glockenspiel et cloches à vaches) ; on trouve aussi l’accordéon, le piano à quatre mains, des harpes. L’impression est qu’on a réuni là volontairement tous les instruments possibles en une richesse prodigieuse, jusqu’au son qui émerge des Gramophones, fixé par la partition, Caruso et Carmen (“La fleur que tu m’avais jetée”) d’un côté et de l’autre la chanson de Solveig de Peer Gynt. Tout va faire contrepoint à une situation apparemment linéaire du point de vue dramaturgique, dans un décor uniformément blanc qui va contraster avec la richesse incroyable de l’instrumentation.
Les parfums les couleurs et les sons se répondent (Baudelaire)
C’est bien le contraste qui est le principe de l’œuvre, deux personnalités, deux parcours, deux préparations, l’une sérieuse et secrète, l’autre sérieuse aussi mais m’as-tu vu, deux univers dans un espace uniforme, et tout un jeu d’oppositions apparentes et plus secrètes, de contrepoints qui vont conduire le principe de l’œuvre et dont Hans Neuenfels va s’emparer.
Le problème c’est que toute cette construction assez élaborée et complexe manque de ce qui a fait l’opéra tout au long de son histoire, des moments vraiment dramatiques, où des personnalités se confrontent, où les éléments se déchaînent, où les émotions affleurent et s’épanchent. C’est bien la désespérante linéarité du paysage qui domine, et d’une « course » vue non comme défi mais plus comme retour sur soi : course contre soi et contre l’autre, et moment où l’héroïsme est aussi bien externe qu’interne. Un seul exemple : souvent et Scott et Amundsen font référence aux éléments, au mauvais temps possible. Et pas un moment de tempête ou de violence des éléments, à laquelle tout compositeur du premier XIXème siècle aurait sacrifié. Il est vrai que nous sommes au début du XXIème et que les lois du théâtre musical ont changé. Espace extérieur et échos intérieurs (auxquels contribuent très largement la présence évocatoire des femmes), course des corps contre les éléments et course des âmes fortifiées ou moins, la musique accompagne plus que décrit. Elle accompagne dans la profondeur, préférant travailler la complexité de la composition qu’une pure musique descriptive « à programme ». Une musique quelquefois « prise dans les glaces » d’une mélodie presque minimale (pour ne pas dire minimaliste) et en même temps très diffractée par la multiplicité des reprises instrumentales. Ce qui frappe, c’est vraiment cette variété des instruments et des timbres, exaltée par la direction redoutable de précision, très pointue et très pointilliste de Kirill Petrenko, qui rend chaque détail de la partition audible, et qui en travaille tous les recoins. Non seulement comme à son habitude il suit pas à pas les chanteurs (et sans doute avec plus d’attention encore pour une Uraufführung) mais il est attentif à tous les moments, tous les instruments, dosant les volumes, les couleurs, les interventions de chaque instrument avec une volonté de cohérence qui stupéfie. Il fait penser à son approche de Die Soldaten, et d’ailleurs la partition m’a souvent renvoyé à certains univers de Zimmermann. C’est vraiment pour moi l’artisan de la réussite de l’ensemble, car Petrenko dirige cette œuvre nouvelle et conduit cette partition avec le souci d’en rendre les qualités, d’en rendre les ombres et lumières, d’en transmettre la couleur, avec le même souci et la même probité que n’importe quelle œuvre classique du répertoire. On pourrait dire : « c’est la moindre des choses », mais ce n’est pas si évident en réalité. L’attention qu’il porte à la construction et au rendu, la plongée dans un univers si différent de ce dont il est familier, le respect de l’œuvre dans son intensité sont des éléments visibles, qui emportent en même temps l’orchestre dans cette perfection formelle. Et la plongée résolue dans cette musique est si visible au spectateur qu’on finit par se demander avec inquiétude comment la musique de Srnka sonnera dans d’autres mains et si Petrenko n’est pas l’architecte de cette incontestable réussite.
À cette musique très « composée » correspond une écriture pour les voix qui m’est apparue à la fois réussie et assez classique, ce qui n’est pas un reproche, loin de là. Les ensembles sont tous magnifiques, à commencer par le quatuor Scott/Kathleen/Landlady/Amundsen à la fin de la deuxième partie qui a frappé tous les spectateurs, et par l’ensemble qui accompagne la mort (le meurtre) des animaux, vraiment exceptionnel par l’émotion qu’il diffuse. Le monologue initial de la 2ème partie, la lettre de Hjalmar Johansen chantée par Tim Kuypers est aussi un moment de théâtre vraiment sensible.
Ce qui frappe dans la distribution c’est d’ailleurs un véritable équilibre. Certes il y a les héros (le quatuor Scott/Kathleen/Landlady/Amundsen) et les deux équipes, les ténors Dean Power, Kevin Conners, Matthew Grills et Joshua Owen Mills (équipe Scott) et les barytons Tim Kuypers, John Carpenter, Christian Rieger et Sean Michael Plumb (équipe Amundsen) sont pour l’essentiel membres de la troupe ou des ex-membres de l’opéra studio. Ils témoignent ici de l’excellent niveau d’ensemble et de leur ductilité, mais aussi témoignent d’un esprit de troupe visible et d’une cohérence dans l’engagement, et même dans la différence sensible de jeu entre les deux équipes (travail magnifique de Hans Neuenfels sur les personnages).

Tara Erraught est pour moi l’un des mezzos les plus intéressants de la nouvelle génération, elle appartient à la troupe, mais a de nombreux engagements ailleurs. La voix est riche, charnue, puissante, avec un beau volume et une science des crescendos qui courent sur toute l’étendue du spectre, ce qui lui permet d’aborder aussi des rôles plutôt attribués à des sopranos, elle a la ligne de chant, le contrôle et aussi les agilités. Épouse bourgeoise (qui tranche avec la Landlady en combinaison qui porte sans cesse le seau rempli de produits de nettoyage) tenue digne, port noble, artiste qui entretient des liens avec le monde artistique de l’époque, élève de Rodin, son allure correspond à une voix pleine d’autorité qui marque aussi un rapport moins direct et plus complexe à son mari. Magnifique et imposante prestation.

Au contraire, la Landlady de Mojka Erdmann apparaît physiquement plus fragile, comme un corps frêle et presque faible, et la partition lui réserve moins de couleur dans la voix, et plus de notes suraiguës tenues à l’extrême des possibilités. La musique d’aujourd’hui use souvent de ces voix à la fois légères et aiguës, mais qui savent tenir la distance. Moins passionnante pour la variété, mais impressionnante pour la performance technique, la prestation de Mojka Erdmann répond à ce qu’on attend d’elle, avec cette fausse fragilité qu’elle affiche en scène, mais aussi son sens de la réponse directe et franche, qui fait là aussi contraste avec le « côté Scott », qui affiche une Kathleen brune, et habillée d’une stricte robe noire, là où la Landlady est blonde, en combinaison légère et claire. Ombre et lumière.

Contraste aussi entre Rolando Villazon et Thomas Hampson.
Le trou noir qu’a traversé Rolando Villazon, promis à l’Empyrée des ténors, a des échos dans sa prestation : il a eu de tels problèmes de santé qu’il a interrompu sa carrière, pour la reprendre à plus petite vitesse et sur des rôles moins tendus que ceux auxquels il nous avait habitués. Villazon est un ténor qui s’engage, toujours sur le fil du rasoir, et donc toujours fragile car toujours au bord de la tragédie. C’est ce qui fait aussi son prix par rapport à d’autres artistes plus solides et peut-être plus lisses. Bien que la voix ait quelques accidents (qui n’ont pas manqué durant le représentation), que la projection ne soit pas toujours au rendez-vous, l’artiste reste passionnant dans une tessiture qui reste tendue. Il fait partie de ces gens qui respirent une humanité profonde, une sensibilité à fleur de peau, une spontanéité démonstrative et même quelquefois excessive, une sorte de fou chantant qui attire irrésistiblement la (et ma) sympathie.
Il chante Robert Falcon Scott, l’officier britannique qui va mener au Pôle Sud ses hommes, mais va périr avec eux de froid et de faim sur la route du retour. Personnalité controversée, sur qui on a fait tomber une certaine responsabilité dans l’impréparation de l’expédition tant pour le choix des vêtements que des transports : encore aujourd’hui, certains norvégiens ironisent sur le choix de poneys ou de chevaux pour effectuer la traversée sur la glace, par rapport aux chiens choisis par Amundsen. Villazon rend parfaitement une certaine instabilité, une certaine « dégaine » méditerranéenne avec des gestes larges, des mouvements brusques, Scott-Villazon est suffisamment fragile et excessif pour qu’on ait de visu, moins confiance dans son projet. Vocalement, Villazon, sans être exceptionnel, « fait le job » comme on dit, avec quelques menus scories, mais reste un profil scénique particulièrement intéressant et un profil vocal honorable parce qu’il marque un grand contraste avec Hampson-Amundsen,.
Thomas Hampson est le triomphateur de la soirée, pour un rôle de héros qui triomphe. La prestation vocale est supérieure à ce qu’on a entendu récemment de lui par exemple son Mandryka dans Arabella à Salzbourg. Il est possible que le rôle ait été (bien) écrit pour lui et en rapport à ses possibilités actuelles, il reste qu’en matière de tenue de notes, de projection, de chaleur de timbre, la prestation est exceptionnelle.
C’est bien l’impression de solidité qui domine, par la voix, par la nature du personnage, exigeant, ne laissant rien passer, très préparé et l’esprit rivé vers le but à atteindre, avec une voix à la fois bien plantée et chaleureuse, et aussi par la taille : il domine physiquement les autres personnages et en face, Villazon « ne fait pas le poids » physique, plus frêle, plus petit à la voix plus claire et plus fragile ; l’opposition entre les deux et l’avenir tragique se lit dans les images scéniques et vocales elles-mêmes. En ce sens, le spectacle est parfaitement calibré.
Il est aussi calibré par la qualité du travail de Hans Neuenfels, qui a été vivement applaudi par la salle (ce qui n’a pas été si fréquent dans sa longue carrière). Il travaille résolument dans le sens de la distanciation, construisant des images essentielles qui font sens, et ne se perdant jamais dans l’anecdotique, l’espace est une vraie construction théâtrale. Le décor, conçu avec Katrin Connan, est un espace blanc (rappelons que celui de sa Manon Lescaut dans le même théâtre était un espace noir) avec un fond de scène frappé d’une croix qui fait cible, une sorte de Croix du Sud qui figure le Pôle à atteindre, la cible commune des deux explorateurs, qui occupent chacun un espace séparé de l’autre par un séparateur au sol figurant les deux parcours.
Un décor donc essentiel où vont jouer les éclairages assez violents (figurant l’éclat du blanc) de Stefan Bolliger, et changeant lorsque les femmes apparaissent (devenant moins aveuglants, pour figurer une lumière non polaire). Le décor est lisse, simplement évocatoire, sans figuration de la glace, sans neige artificielle, sans aucun réalisme.

Car le principe de ce travail (qu’on peut naturellement discuter) est de rendre les contrastes humains évidents, sans se perdre dans un réalisme qui en l’état ne rajouterait rien. Alors, Neuenfels travaille sur les ressemblance et les contrastes, et d’abord sur les mouvements : essentiels et souvent parallèles dans la première partie, alors que les contrastes sont de plus en plus marqués dans la seconde partie, quand Amundsen regagne ses bases pendant que Scott périt de faim et de froid, le plus marqué étant un Amundsen en frac d’un côté (avec un éclairage normal) pendant qu’un à un (belle prestation de Dean Power) disparaissent les membres de l’équipe de Scott (avec un éclairage glacial), et que Scott finit comme pris dans les glaces figurées paradoxalement par d’épais sacs de couchage, allusion au sommeil précédant la mort par le froid et le gel.

Ressemblances dans les mouvements symétriques, alimentés par des paroles parallèles, dans l’entrée des femmes, parallèlement, mais distinguées comme on l’a vu par l’allure et le vêtement. Les différences entre les deux équipes se marquent d’abord par les couleurs, noir du côté de Scott, gris du côté d’Amundsen, par les costumes, épaisses peaux de bête chez Amundsen, cuirs doublé laine du côté de Scott, qui semble bien plus léger. Et de fait, Amundsen, de culture scandinave, avait prévu les choses en fonction de traditions locales : c’est aussi la question du choix des chiens et non de chevaux ou de poneys, figurés par des mimes munis de masques apparaissant dans une niche en fond de scène : Hans Neuenfels aime figurer ainsi les animaux par des hommes (voir les fameux rats de Lohengrin à Bayreuth).

Ainsi la scène où les animaux sont tués devient-elle l’une des plus fortes de l’œuvre, car elle vise à la fois à marquer notre relation très anthropomorphique aux animaux et en même temps, les chiens sont tués au pistolet, comme on tue des hommes dans un massacre: le spectateur voit donc des hommes s’écrouler, et non des chiens. Il y a là un jeu mimétique particulièrement fort qui rend très sensible la situation, déjà terrible s’il s’agit d’animaux, et encore plus forte puisque la relation devient « humaine ». Ce n’est pas un hasard si la scène est l’une des plus dramatiques de la soirée, et objet des souvenirs les plus forts.
Dans ce jeu des parallèles et contrastes, la deuxième partie, à la différence de la première, casse le jeu de la géométrie. Lorsque les uns reviennent du pôle, les autres s’y dirigent encore (je crois qu’ils l’atteindront plus d’un mois plus tard). Enfin lorsque les norvégiens sont sortis d’affaire au moment de la magnifique scène des oiseaux marquant la proximité de la mer : « What ? What is this ?! Birds ! », Scott et ses hommes de l’autre côté sont en train de périr « He has an open wound ».

Contraste enfin dans les comportements et les procédures, l’autochenille de Scott qui tombe en panne face à des moyens moins spectaculaires, mais considérés comme plus sûrs, la rigidité d’Amundsen (l’interdiction d’écrire par exemple ou de tenir un journal hors celui qu’il tient) face à la « souplesse » de Scott, la concentration d’Amundsen tout fixé sur son but. Car malgré un jeu d’acteur volontairement peu démonstratif, – on pourrait regretter que les équipes ne soient pas analysées dans leur comportement individuel, à de rares exceptions près – les gestes essentiels sont donnés, raideur et rudesse du côté Amundsen, plus de variété et de mouvement du côté Scott, et cette posture aide aussi à lire le drame qui se noue.
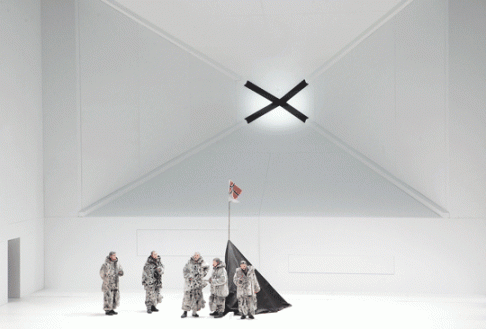
Seule concession à l’anecdote ou à l’Histoire, la figuration du pôle, avec tente et drapeau, reproduction exacte de la fameuse photo de la tente, du drapeau norvégien et de l’équipe.

Il faut remarquer aussi l’important enjeu, très peu marqué dans la mise en scène sinon en creux, que la conquête du Pôle Sud pouvait constituer pour une Norvège toute neuve devenue état indépendant depuis 1905, c’est à dire 6 ans à peine avant l’expédition face à un représentant de l’Empire britannique, à l’époque la plus grande puissance. Ainsi, sans que ce soit si clairement affirmé, c’est bien le mythe de David et Goliath, le pot de terre contre le pot de fer, et le lièvre et la tortue qui est ici reproposé en adaptation polaire.
À travers une histoire documentée, c’est finalement un parcours symbolique qui est ici dessiné fait d’une successions de moments, autant de scènes qui éclairent à la fois les motivations des uns et des autres et les contextes divers, les ambiances, dans un travail abstrait, sans concession et d’une très grande rigueur, sans aucun élément décoratif, presque comme une épure où le paysage indompté et intouché n’est plus un paysage, mais une ambiance où l’homme est seul, face à son destin, dans une sorte de posture héroïque que l’œuvre analyse au delà du récit proposé.
Et ainsi se trouve-t-on devant un spectacle plus théâtral qu’il n’y paraît à première vue, et c’est peut-être là le secret de son succès. Une musique qui se cache et se découvre, une géométrie qui se brise en deuxième partie, des moments d’une grande émotion et de suspension, mais aussi un « ennui » volontaire au départ, comme si les véritables enjeux avaient du mal à s’imposer, comme si la musique se cachait volontairement et si le théâtre se cachait d’abord pour se découvrir peu à peu.
Voilà une réalité historique et historiée qui est en même temps métaphore de la faiblesse et de la force de l’humain et variation sur l’héroïsme. Seul un paysage polaire, sans relief, sans couleur autre que le blanc, sans vie apparente sinon celle du regard qui l’embrasse pouvait peut-être en être le cadre. On comprend du même coup une musique à la fois tendue mais sans relief apparent, à l’image de cette immense étendue blanche du plateau polaire, qui force à rentrer en soi, comme on rentre dans le tissu musical, sans relief apparent non plus, mais en réalité plein d’une foule de détails et de richesses sonores de toute nature. Apparence de désert et être riche et varié, de nouveau l’œuvre nous ouvre vers les contrastes habituels du monde. Et Neuenfels nous les soulève.
Son décor est construit comme une vaste caverne blanche, comme la caverne platonicienne. Et si la caverne était une immense étendue blanche ?
Alors que j’étais un peu dubitatif sur la musique en sortant de ce spectacle, je m’aperçois qu’il reste en moi après une semaine, et certaines images reviennent, certains moments m’accompagnent ainsi que certains sons . C’est qu’il constitue vraiment un spectacle total, fait de vrai théâtre, fait aussi d’une musique qui réussit à chanter et surtout à faire chanter. Mais c’est le chef d’orchestre le véritable démiurge de tout ce travail, sans sa clarté, sans sa précision, sans son approche très pédagogique au total, dévoilant peu à peu les ressorts de l’œuvre, nous n’aurions pu découvrir cet au-delà de la caverne, et respirer cette musique comme nous l’avons fait grâce à Kirill Petrenko, l’artisan fulgurant de ce triomphe.[wpsr_facebook]