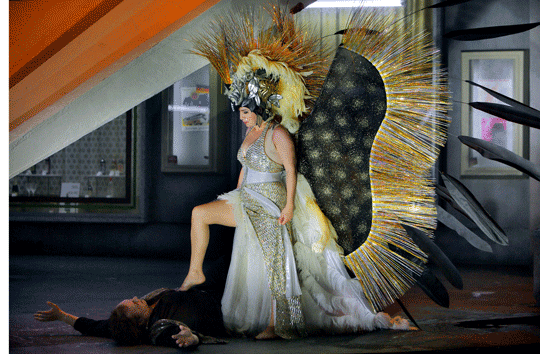
Des quatre opéras du Ring, Siegfried est sans doute le moins populaire, le moins connu et le plus difficile de tous. Plus théâtral au premier acte, plus musical au deuxième, il est plus héroïque au troisième et requiert des qualités très diverses. Pour Siegfried, c’est une partie infernale, très sollicitée à l’aigu, particulièrement héroïque : les Siegfried de Siegfried et de Götterdämmerung sont vocalement suffisamment différents pour que quelquefois, et même à Bayreuth ils aient été chantés par deux chanteurs.
C’est aussi le dernier opéra où Wotan apparaît, en perdant son nom d’ailleurs puisque on l’appelle le Wanderer, le dieu errant sur la terre, attendant patiemment que Siegfried ait grandi. C’est enfin un opéra (presque) sans voix féminines,: Brünnhilde n’apparaît que dans les 45 dernières minutes, et l’oiseau n’intervenant (vocalement) que dans la dernière partie du deuxième acte.
C’est sinon un opéra très équilibré vocalement : deux ténors (Siegfried, ténor héroïque, et Mime, ténor de caractère), deux barytons basses (Wotan et Alberich) une basse (Fafner), deux sopranos (un soprano dramatique et un soprano léger), un mezzosoprano (Erda) : pratiquement toutes les voix sont représentées en huit personnages, et sur les huit personnages quatre vont disparaître définitivement dans Götterdämmerung, dont l’emblématique Wotan qui laisse la place à Siegfried : celui qui a l’universelle connaissance cède devant l’innocent.
Dans l’économie de la mise en scène de Frank Castorf, Siegfried est sans doute celui qui, après une Walküre à la fois pittoresque et historique, plonge directement dans l’idéologie et ses applications : nous sommes à la fin de la deuxième guerre mondiale, le monde est divisé en deux Mount Rushmore, l’un américain, le vrai, et l’autre marxiste, Marx, Lénine Staline, Mao, sous la protection duquel s’est placé Mime et à l’ombre duquel a grandi Siegfried. C’est un décor écrasant tout en hauteur, qui apparaît au lever de rideau : un Mount Rushmore en construction avec des échafaudages. Le décorateur Aleksandar Denić explique d’ailleurs que c’est peut-être un Mount Rushmore en restauration (plusieurs fois les personnages montent soit pour le nettoyer, soit pour lui donner quelques coups de marteau – le nez de Marx en sait quelque chose, l’œil de Staline aussi auquel Siegfried s’attaque (à œil de Staline correspond œil de Wotan…). Mais il précise qu’il peut être en construction, car inachevé, et que les échafaudages sont là pour rajouter un dictateur supplémentaire à la brochette déjà en place…les paris sont ouverts en quelque sorte.
L’autre partie du décor, c’est Berlin, Alexanderplatz. Berlin entre dans l’univers du Ring et ne le quittera plus jusqu’au Götterdämmerung. C’est justement ce qui fait dire à certains que Castorf effectue un travail « narcissique », faisant interférer sa propre histoire et celle du Ring. On sait que Berlin est l’un des éléments centraux de la création de Castorf, mais Castorf est trop rigoureux pour l’insérer gratuitement, au seul motif que Berlin l’intéresse. Bien sûr, Berlin pendant la guerre froide est un enjeu idéologique fort, et le spectateur a beau jeu de l’identifier comme symbole, mais ce qui intéresse Castorf, c’est qu’au centre de l’Alexanderplatz, le centre névralgique de la ville à l’Est, près de tous les monuments

symboles : hôtel de ville, cathédrale, palais impérial, musées, trônait le siège de la Minol, la compagnie pétrolière de l’Est, dès le début des années 50. C’est bien là le focus de ce décor, où le symbole de Minol éclairé au néon orange fait frontière entre le Mount Rushmore et l’Alexanderplatz : il n’y a pas de hasard, là où s’affirme l’idéologie s’affirme en même temps le pétrole, c’est à dire l’Or.
C’est ensuite un raccourci de Berlin Est que veulent nous présenter Castorf et Denić : une sorte de décor de spectacle où tout est dit :
- La poste, dont les employés lisent et contrôlent le courrier (DDR oblige). L’endroit est désert, et y traînent des sacs poubelle anachroniques, mais sis devant la poste, on imagine bien ce qu’ils doivent contenir.
- Le Biergarten, typique de toute l’Allemagne, est comme ouest.
- Le restaurant, triste, typique quant à lui de certains restaurants de la DDR
-

Horloge Universelle L’horloge universelle, reproduite à l’échelle, au pied de la tour de télévision, autre symbole de Berlin Est.
- A l’intérieur du décor, des coulisses de théâtre où Erda achève de se préparer, et des p’tites femmes qui sortent en accompagnant Fafner
Car ce décor, sans aucune concession au hasard, est celui de la grotte de Fafner : sinistre et déserte à l’extérieur, où l’on s’amuse à l’intérieur dans la clandestinité et où Fafner dépense son or en fanfreluches pour gamines faciles, qui ont chacune le même cadeau (une petite culotte), dans une DDR où il n’y a pas beaucoup de choix. Il y a bien aussi un dragon c’est le crocodile unique qui rappelle le Dragon des Nibelungen de Fritz Lang (1924) et qui fait si peur aux gamines.
Comme on le voit, tout est là, les éléments sont en place, réels et symboliques, qui racontent une histoire et une autre, en les reliant dans aucune aberration : Berlin Est, c’est Fafner, c’est le meurtre de Mime, ce sont les crocodiles. C’est un lieu de rupture, et c’est pourtant dans ce cadre que Brünnhilde chante son amour à Siegfried. On sent tout de suite quel avenir leur est réservé…
Nous ne reviendrons pas sur le détail d’une mise en scène qui a peu changé, à part la naissance d’un troisième petit crocodile : la famille s’agrandit, et avec elle les dangers, mais c’est aussi un jeu, qui fait partie intégrante de ce travail. Nous renvoyons donc le lecteur aux revues de 2014, revue 1, et revue 2 et 2015.
La question qui se pose est assez simple : le personnage de Siegfried est l’un des plus ambigus du Ring, mais il ne l’est pas dans cette mise en scène. Incapable d’aimer, incapable de tirer parti d’une éducation idéologique, et plus proche d’un état de nature à la Rousseau, où règne la loi du plus fort, Siegfried apparaît tout au long de ce Ring comme un mauvais garçon, impatient, peu enclin à l’écoute, ne se réalisant que dans l’action violente (meurtre de Fafner et de Mime), un produit dérivé de notre monde, fils de la lutte idéologique. Se pose la question rebattue par ailleurs de « nature et culture », à travers ce personnage qui refuse la culture de Mime pour n’avoir confiance que dans la nature et son spectacle. Il refuse tout autant d’ailleurs les runes enseignées par Brünnhilde : il n’en tient pas compte.
C’est un violent avec Fafner, on l’a vu, l’abattant sans hésitation à la Kalachnikov, c’est un violent avec Mime, qu’il tue avec une rage inouïe, le recouvrant ensuite d’ordures dans une scène difficile à supporter. Signalons d’ailleurs le rôle insistant de ces sacs de plastique ou de ces poubelles dont on sort des ordures, des poubelles et des objets bien anachroniques d’ailleurs, mais tous issus de traitement du pétrole : c’est avec eux qu’il joue pour essayer d’imiter le chant de l’oiseau, laissant le cor à l’orchestre, dans une des scènes les plus désopilantes de la production.

Toute la scène de Berlin est d’ailleurs étonnante par l’alternance d’évocation d’une Berlin qui s’amuse dans sa tradition historique de ville ouverte : les revues, abondamment citées et par le costume extraordinaire de l’Oiseau, et par l’apparition d’Erda, qui semble devoir entrer en scène, avec perruque, maquillage, et surtout descente d’escalier, passage obligé de la revue. Nadine Weissmann est extraordinaire dans le personnage, la démarche, la descente ondoyante d’un escalier où traine le chapeau de Wotan.
A la partie berlinoise correspond toute la partie Rushmore, où se déroulent le premier acte dans son ensemble, les trois quarts du deuxième acte et la moitié du troisième. Le décor du Rushmore marxiste est à la fois le produit d’un imaginaire de Castorf et de Denić qui traduit un imaginaire collectif : cette caravane étrange, qu’on revoit pour la première fois après Rheingold, sorte de fil rouge qui désormais va accompagner l’action et notamment le devenir du couple Brünnhilde-Siegfried, est symbole d’errance, mais aussi de malheur : tous les objets appartenant à Alberich et Mime à l’origine (Rheingold) sont frappés de malédiction. Elle passera de mains en mains jusqu’au final de Götterdämmerung : Alberich, Mime, Brünnhilde-Siegfried, mais aussi Gutrune, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Un objet transactionnel en quelque sorte.
Dans ce paysage désolé en chantier dos à dos avec la Berlin des communistes (on passe de l’un à l’autre par des tunnels…Les vases communicants de l’idéologie en quelque sorte), se déroule un premier acte presque traditionnel, avec un Wanderer tout de noir vêtu, tatouage d’une tête de loup sur la poitrine (Wolf), et lunettes noires (toujours ces problèmes aux yeux…), lunettes noires qu’on reverra sur Siegfried déguisé en Gunther, un Wanderer muni de sa lance et entrant en scène avec des cables semblables à ceux qui rechargent des batteries, munis de pinces-crocodiles (tiens tiens), pour activer la forge ou pour faire tout sauter, selon l’issue de la conversation-examen avec Mime.
Le paysage est singulier : la caravane à tout faire, monceaux de livres sur le sol, suffisamment subversifs pour qu’à l’arrivée de Wotan, Mime cherche à les dissimuler. Du matériel de camping, seul matériel utilisé par les héros, de Wotan à Brünnhilde, matériel léger, transportable, dissimulable, matériel d’errance. Et traînant dans l’ombre au fond à droite, la veste d’Alberich (reconnaissable à sa doublure verte) qui traine au premier acte, trace de sa présence, comme s’il avait comme Wotan, surveillé l’éducation et la croissance de Siegfried : Alberich-Wotan, monde parallèle. D’ailleurs, au début du deuxième acte, il se repose près de la caravane sur un des lits pliants : il est chez lui.

On a déjà souvent disserté sur l’ours, incarné par un homme (l’inévitable Patric Seibert en personnage très beckettien) une sorte de sauvage qui va s’éduquer au contact des livres, un homme-ours à tout faire, qui prépare l’autodafé nécessaire à l’alimentation de la forge : devant l’acier trempé de Notung, inutile d’avoir des livres…la force invincible n’a pas besoin de culture, et l’ours-homme va souffler sur le feu (invisible) des livres qui brûlent pour forger l’épée. Mais Siegfried préfèrera, à choisir, la Kalachnikov trouvée dans deux caisses où est écrit, en russe, НОТУНГ,
Pour en revenir à l’ours, dans tous les Siegfried du monde, l’ours est toujours forcément un homme recouvert d’une peau d’ours. Castorf ici joue la transparence du théâtre, un peu comme le dragon de Chéreau « qui ne faisait pas peur ». Il nous a d’ailleurs montré la peau de l’ours utilisée par Wotan par jeu au troisième acte de Walküre… qui fait le lien comprend que Wotan pilote tout, préparant la journée suivante.
Comme dans les autres épisodes, le jeu est partout, dans toutes les dimensions du plateau, y compris en (grande) hauteur, saluons d’ailleurs la performance des artistes et notamment celle de Siegfried, qui, malgré les efforts notables requis par le chant, ne cesse de grimper et descendre d’échelles ou d’escaliers ; l’effort physique requis est singulier.
Remarquons enfin l’ironie de Frank Castorf, qui place les murmures de la forêt, cet hymne à la nature universellement connu et attendu du public, d’abord au pied d’un Mount Rushmore sans un arbre, puis dans le béton de Berlin Est. Mais ainsi, indépendamment du décor, c’est le monde fantasmatique de Siegfried qui est suggéré, et qui se projette dans cette vision de l’oiseau. Dans la plupart des mises en scène, l’oiseau est un volatile mécanique quand la chanteuse est en coulisse : quelquefois aussi la chanteuse est oiseau (chez Kriegenburg à Munich par exemple). Castorf choisit un oiseau imposant, un oiseau personnage, vision fantasmatique de Siegfried, comme un personnage de ces revues berlinoises de l’Admiral-Palast, mais aussi un oiseau plus oiseau que nature, avec un costume composé de tous les types de plumes possibles, si large qu’il ne passe pas les portes ou les rampes d’escalier étroites (d’où des poursuites désopilantes). Débarrassé de ses plumes à la fin du troisième acte, et revêtu d’une légère robe blanche qui répond alors à celle de Brünnhilde, il se fera d’autant plus facilement avaler par le crocodile de passage. Mais pour Siegfried, pas de doute, l’oiseau est un interlocuteur, le seul avec lequel il va entrer en dialogue et qu’il va écouter, puis honorer…
Deux dernières précisions : deux personnages en vidéo, au sommet du dispositif, l’un Alberich, tend le poing avec une main ouverte : avec le jeu d’ombres, on dirait une tête de crocodile ouverte (comme dans les jeux d’ombres chinoises), l’autre plie le bras et le point fermé, c’est Mime, deux images fascistoïdes qui disent tout à fait leur nom.
Comme on le voit, on ne peut parler d’errances de Castorf, selon le mot d’un de mes lecteurs, car le travail effectué fait système, découvert peu à peu par capillarité, par liens, par écho : rien de gratuit dans ce monde-là du Ring, qui remplace une mythologie par une autre, dans laquelle les personnages trouvent leur place, une place que le texte justifie ou éclaire.
Du point de vue musical, la distribution m’est apparue assez équilibrée, plus en tous cas que dans les épisodes précédents, même si elle n’est pas la plus éclatante.

Le Wanderer est peut-être pour John Lundgren le rôle qui correspond le mieux à sa personnalité. Il apparaît distant et froid, avec une diction qui correspond bien à la nature du texte proféré (le jeu de questions avec Mime, par exemple, est particulièrement acéré), bien projeté. Le sommet étant bien entendu la scène avec Alberich, où deux Wotan en quelque sorte s’affrontent. Le sens du texte est peut-être plus évident chez Albert Dohmen, qui malgré une voix qui fut et qui n’est plus, réussit à camper un personnage encore impressionnant. C’est cet aspect Wotan déchu, déjà perceptible dans Rheingold, qui frappe ici dans la scène où il se confronte au Wanderer, et où une fois encore il se fait manœuvrer pour aller réveiller Fafner. Albert Dohmen est un Alberich inhabituel, presque noble, pétri de frustration, qui s’oppose à un Wanderer qui semble être un ex-lui-même. La scène entre les deux est à ce titre un des sommets de la représentation.
Cet Alberich, qui va rester roder pendant tout l’acte, et observer discrètement le meurtre de Mime, est justement présent partout, il est Wanderer lui-aussi, mais un Wanderer qu’on va retrouver dans Götterdämmerung, quand il partira, après avoir averti son fils, muni, lui aussi d’une valise de grand voyageur, avec une jeune beauté. Par quelques touches , Castorf réussit parfaitement à rendre le parallélisme avec Wotan et le caractère du personnage, bien adapté à Dohmen, qui n’était pas celui de Oleg Bryjak.
Plus difficile est le passage de Koch à Lundgren. On en a analysé précédemment les raisons (voir Walküre), vocalement, Lundgren est moins souple, plus raide, a une voix moins modulée et un chant plus fixe. Il aurait sans doute mieux convenu à la mise en scène précédente de Tankred Dorst. Ce qui frappait chez Koch, c’était la complexité psychologique du personnage, particulièrement bien rendue par le système d’écho scène-fosse établi avec Kirill Petrenko, qui faisait de l’orchestre un assistant du personnage et non un commentateur de l’action. Ici, le rapport scène-fosse étant différent, et d’une certaine manière plus attendu avec un orchestre commentateur, accompagnateur plus qu’acteur ou qu’assistant, le personnage est rendu très différemment. Mais dans le premier acte, cela convient et correspond grosso-modo à l’attendu.
Dans la magnifique scène avec Erda, construite ad-hoc pour un Wolfgang Koch plutôt pas très propre, il construit un personnage différent, plus déchu peut-être que Koch qui se vautrait un peu dans sa déchéance, mais plus rageur aussi. Avec les mêmes gestes et la même construction, il est à la limite moins antipathique et plus pitoyable. En tous cas, sans doute aussi grâce à l’exceptionnelle Erda de Nadine Weissmann, la scène fonctionne encore comme l’un des sommets de la soirée.

En revanche, la scène avec Siegfried qui suit m’est apparue moins « naturelle », ce peut-être aussi un effet du personnage, déchu et déjà perdant, qui teste jusqu’au bout le petit-fils, dans une dernière tentative non d’empêcher l’irrémédiable, mais de constater que la mécanique imaginée par Brünnhilde fonctionne. Elle fonctionne même au-delà du prévisible puisque la lance des Runes est brisée. Voilà qui justifie ensuite la vanité du cadeau de Brünnhilde qui va transmettre à Siegfried une connaissance forclose, qu’il va d’ailleurs ignorer, voire mépriser. Mais dans cette scène, la voix et la présence de John Lundgren me sont apparues moins fortes. Il reste que je trouve son Wanderer de Siegfried jeune et énergique plus convaincant que son Wotan de Walküre. Mais il ne domine pas encore tout à fait le rôle.
J’ai déjà dit le bien que je pensais d’Albert Dohmen. Autant dans Rheingold il semblait un peu mal à l’aise avec le personnage voulu, notamment face aux filles du Rhin, autant ici il me paraît avoir inventé un type de personnage intéressant, qui sait jouer de l’état actuel de sa voix, avec des moments de forte intensité et surtout un travail sur le texte et les inflexions nécessaires acéré et précis. Certes, la projection et la profondeur ne sont plus ce qu’elles ont pu être, mais ce personnage errant, qui fut puissant, cette figure d’ex-Wotan comme je l’ai appelée pour mieux cibler ce qu’il projette sur scène, m’est apparue convaincante. Le début deuxième acte avec le Wanderer est une scène vraiment réussie et intense. Il reste que cet Alberich n’est pas le méchant menaçant habituel, et la prestation de Dohmen le marque comme plus perdu que méchant.
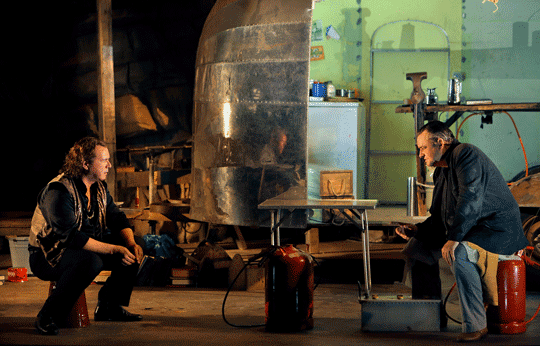
Mime est Andreas Conrad, la voix est bien projetée, l’émission impeccable : il faut une voix qui sache colorer pour un Mime qui est un personnage à la fois pitoyable et comique. Castorf lui donne des faux airs de Bertolt Brecht, mais une silhouette qui doit aussi beaucoup à Beckett, avec son usage du parapluie, citation d’un théâtre de l’absurde qui convient tout particulièrement au personnage. Conrad est parfaitement dans le rôle, même si quelquefois on aimerait encore plus d’exagération, encore plus de tragicomique ; bien sûr, depuis 40 ans nul n’a pu arriver à faire oublier Heinz Zednik, l’inoubliable Mime de Chéreau, qui a donné tant d’idées de mise en scène à d’autres (y compris à Castorf). Après Zednik et Chéreau, Mime ne sera plus jamais le même.
Comme on ne vit pas de regrets éternels, (et l’on peut encore se repaître de Zednik en vidéo, courez-y, c’est unique), Conrad est l’un des Mime du moment, l’un des bons interprètes, qui rentre dans le personnage inquiétant, pitoyable et dérisoire, avec une vraie voix, colorée, claire, et doué d’une belle diction du texte, si importante pour ce rôle, aussi bien au premier qu’au deuxième acte : ses dernières répliques , à la fois désespérantes et désopilantes, sont toujours un des moments de Siegfried, Wagner y joue sur les doubles sens, sur la duplicité, sur le vrai et le faux, l’être et l’apparence, dans une scène où se joue exactement l’inverse de ce qui va se jouer avec Siegfried dans Götterdämmerung : ici le sang est révélateur de vérité, Siegfried voit derrière les mots, il lit au travers. Et Wagner prend ici le parti d’inclure le spectateur dans le jeu. Dans Götterdämmerung, cette clairvoyance disparaît, Siegfried oublie, il efface, et devient mimétique de ses ennemis. Il y devient apparence (un Gibichung de plus) et être à la fois (il est toujours aussi méchant). Seul moment, je l’ai dit, où Siegfried écoute quelqu’un (l’oiseau) et obéit à des suggestions, aux dépens d’un Mime d’autant plus pitoyable que son discours est dévoilé : toute sa vie avec Siegfried, Mime a déguisé son être dans le but de sculpter un Siegfried prêt à s’emparer en son nom du pouvoir (Or et Tarnhelm), et on entend ici son être profond et toute la vérité de sa vie, de manière totalement suicidaire, et en même temps mimant (sans jeu de mot) tout ce qui a été une vie de mensonge et d’espoir. Aussi, la mise en scène de Castorf sort de la jolie histoire d’un Siegfried justicier qui tue le méchant gnome : elle inciterait presque à prendre en pitié ce Mime désespérant de nullité, qui court à sa mort. La manière violente et insistante dont Siegfried le transperce, suivie de la manière dont il soulève le cadavre, l’assoit sur une chaise de plastique et le couvre d’immondices incite le spectateur à rejeter ce Siegfried sauvage. Il reste qu’Andreas Conrad constitue, avec une prestation où chant et déclamation où alternent ou se tressent ensemble avec une redoutable précision, est l’un des pilastres de cette distribution.
La scène qui suit est désormais célèbre : c’est la poursuite de l’oiseau, c’est ce jeu marivaudien entre un oiseau qui suit Siegfried (ou qui essaie de le suivre) jusqu’à ce qu’ils se rencontrent et copulent (vögeln en allemand, « oiseler », comme je l’avais signalé dans mes revues précédentes). Siegfried und der Waldvogel vögeln…c’est l’état de nature…
Un oiseau qui n’a plus la voix si bien posée et si claire de Mirella Hagen, mais celle un peu moins séduisante d’Ana Durlowski, plus nerveuse et plus stridente, et donc pour moi un peu moins intéressante.

Avec une voix moins profonde que d’autres Fafner, Karl-Heinz Lehner, cheveux longs et blanchis par les ans (il reste dans sa caverne à écouter son or dormir), est un homme mur, qui trompe son ennui par le plaisir facile dans sa caverne de Berlin Est bétonnée. Son chant est énergique, assez puissant, plus convaincant peut être dans son quasi unique monologue que dans Rheingold : il est en tout cas un personnage magnifiquement castorfien, tué à la Kalachnikov et secouru par Seibert dissimulé dans la caravane avec sa trousse de premiers secours, inutile. Et sa scène avec Siegfried est pleine de relief
Stefan Vinke est Siegfried pour la deuxième année.
La production a été construite en fonction du personnage époustouflant de Lance Ryan, dont la voix a eu des hauts et des bas. Il faut bien dire que ses Siegfried dans la production de Castorf étaient magnifiques scéniquement mais très pénibles quelquefois vocalement, voix nasale, limite permanente de justesse, et quelques moments extraordinaires ; mais il était tellement le personnage qu’on lui pardonnait (presque) tout. Stefan Vinke l’an dernier était sans conteste plus en voix, plus contrôlé, même si le personnage n’était pas aussi déluré que celui de Ryan : il faut du temps pour entrer dans la mise en scène. Cette année, Vinke montre une joie de jouer et de chanter qui ne fait aucun doute, en particulier dans le Siegfried de Siegfried. La voix accuse cependant une certaine raideur, des sons fixes, dardés, une certaine tendance à pousser sans legato, à s’y reprendre pour assurer les passages et les redoutables aigus : les notes y sont, mais on sent le travail forcé. Autant il est plus naturel en scène, autant il est moins convaincant vocalement que l’an dernier. C’est sensible au troisième acte, où la voix nasale, mal posée, rappelle certains défauts de Lance Ryan. Il ne faudrait pas qu’il chante le rôle trop souvent, même si c’est dans Siegfried que je l’ai trouvé le plus convaincant (notamment le 8 août).
Erda est une voix, la plupart du temps, venue des profondeurs et donc particulièrement grave. Elle est rarement un personnage. Rappelons-nous Chéreau où elle apparaissait comme sortie d’un cocon émergeant du voilage. Rappelons-nous de Kriegenburg où elle sort de la terre pour y rentrer aussitôt après, fixe et hiératique.
Ici, rien de hiératique, tout au contraire : on a dit plus haut combien la descente de l’escalier par Nadine Weissmann émergeant des coulisses avec perruque et fourrure posait le personnage. Le fait même de jouer, et quel jeu, quelle personnalité, quel charme et quelle fascination, oblige à chanter une Erda complètement différente de l’Erda fantôme à laquelle nous sommes accoutumés. Une Erda fantôme n’a qu’à chanter, et à se préoccuper de son chant. Une Erda personnage a ici à chanter, à bouger, monter, descendre, à manger et boire, à s’écrouler et à faire des gâteries à Wotan : le cahier des charges est bien plus écrasant. Elle ne peut chanter comme les Erda habituelles, concentrées sur leur chant. D’où un chant coloré différemment, plus vif, plus amer aussi vu la scène qui se joue (Wotan et Erda jouent la scène de rupture d’un couple qui n’ont plus de commun que leur désir réciproque). C’est une scène exceptionnelle de tension et de vie qui nous est donnée, qui est aussi vérité d’Erda et du Wanderer : ils se déchirent, les parents de cette Brünnhilde qui va s’aventurer au pays des hommes rempli de menaces diverses et ils perdent leur prise sur les événements. De trace d’Erda au Götterdämmerung il ne reste que les Nornes, à qui elle a délégué ses pouvoirs, qui ne réussissent qu’à rompre le fil des destins : dès le prologue, c’est fichu.

Brünnhilde était Catherine Foster, la Brünnhilde de cette production du Ring. On sait que la Brünnhilde de Siegfried a l’un des moments les plus difficiles pour une chanteuse : un duo de quarante minutes à froid, se terminant par un aigu redoutable. Beaucoup s’y cassent les dents. La grande Gwyneth Jones elle-même ne donnait pas toujours à y entendre ses meilleurs moments, même si son réveil était le plus beau des réveils.
Le réveil ici, noyé dans une bâche en plastique, n’a pas forcément la fascination qu’il a pu avoir dans d’autres mises en scène, mais c’est évidemment voulu par un Castorf qui refuse sarcastiquement la magie musicale wagnérienne et les fantasmes du public qui l’accompagnent. Globalement dans cette édition Catherine Foster m’est apparue moins convaincante que l’an dernier, qui au contraire m’est apparu un sommet. Vibrato accusé, notes hautes quelquefois criées, difficultés dans les passages, hésitations même dans les rythmes. Néanmoins, elle a cette force en scène et cet engagement qui émanent du travail effectué avec Castorf, et ce n’est pas dans Siegfried qu’elle est forcément plus discutable, même si on peut discuter çà et là tel accent marqué, telle exagération ou telle subtilité absente. J’avais vraiment été frappé par les défauts d’une voix manquant d’homogénéité lorsque je l’avais entendue la première fois : il y a aujourd’hui une telle différence de qualité dans le chant, une telle amélioration, une telle présence que je trouve la prestation toujours convaincante, même si on entend çà et là quelque problème. Il reste que les aigus sont triomphants, qu’il y a de la fluidité, du legato et qu’au troisième acte elle est indiscutablement plus convaincante que le Siegfried de Vinke.
Il faut reconnaître aussi que si la première partie du duo est plutôt classique, rassurante pour un public en attente de romantisme, avec des éclairages projetés en silhouettes de l’ensemble du décor, la seconde partie est une entreprise de destruction en règle de tout romantisme, avec un Siegfried indifférent, une Brünnhilde ridicule dans sa robe de mariée (elle applique maladroitement les runes qu’elle veut transmettre à Siegfried – voir Fricka au deuxième acte de Walküre) qui refroidit définitivement un Siegfried qui n’a visiblement qu’une seule envie, c’est de la posséder (« Sei mein ! »), et des crocodiles (que les habitués comptent pour bien vérifier qu’il y en a un de plus que l’année précédente) qui provoquent des mouvements divers dans la salle dont des rires nombreux. J’imagine ce qui doit se passer dans la tête de Marek Janowski à ce moment…Et de fait le rideau final est systématiquement suivi d’une bordée de huées. Pour des chanteurs, qui doivent ici fournir leur plus gros effort, c’est très difficile, car c’est un grand écart.
Marek Janowski justement m’est apparu donner musicalement le meilleur possible dans ces conditions.
Je voudrais redire clairement ce que j’ai dit précédemment sur cette direction musicale. Loin de moi l’idée de faire penser que cette direction est de piètre qualité. Janowski est un vrai wagnérien, et ce serait n’être pas honnête que de dire que cette direction n’est pas idiomatique : il y a des moments magnifiques, fortement dramatisés, des sons d’une grande beauté (le réveil de Brünnhilde, moment musicalement si attendu, est vraiment splendide par exemple), même si Janowski poursuit une vision dramatique du récit musical wagnérien, mais il n’y va pas chercher un raffinement dans l’exécution qui collait beaucoup plus l’an dernier à la production chez Petrenko et en a fait la singularité (tout en provoquant des critiques du type, « c’est mou », « ce n’est pas Wagner » etc…), une singularité et une nouveauté, une osmose avec le plateau qui m’avait fasciné.
Ce qui me frappe, c’est une fois de plus que les rythmes de la mise en scène et le rythme de la fosse ne suivent pas les mêmes règles : Janowski suit la partition, avec son rythme, indépendamment de ce qu’il voit (et de ce qu’il ne veut pas voir, à ce qu’il dit lui-même). Ce faisant, je crois qu’il met en difficulté les chanteurs tiraillés entre les mouvements de plateau et le tempo de la fosse. Au vu des mouvements, certains tempos, certaines notes peut-être méritaient d’être plus brèves, plus longues, méritaient de donner ici plus de respiration aux chanteurs, là un rythme plus acéré. J’avais évoqué la manière de placer les chanteurs de face, mais ici c’est plus complexe : on a quelquefois l’impression que les volumes ne sont pas toujours adaptés aux voix, que Janowski suit sa route, imposant une vision musicale très respectable, mais sensiblement autre que ce qu’on voit sur le plateau. On n’y joue pas la Gesamtkunstwerk. Alors effectivement si vous fermez les yeux (ce que certains spectateurs recommandent – l’an dernier certains portaient un masque de sommeil), vous entendrez un Wagner AOC, traditionnel, magnifiquement réalisé : est-il utile alors de faire le voyage artistique à Bayreuth où l’expérience est forcément double, scénique et musicale ? Une fois de plus, je doute. On peut évidemment trouver que dans le dessein général de la production, Janowski est celui qui est le plus convaincant. Certes, mais en soi, et en soi seulement. À y repenser, je crois qu’il n’aide pas forcément les chanteurs, qu’il suit sa conception, honorable et sans aucun doute remplie de qualités, mais de qualités qui ne s’accrochent pas forcément aux autres wagons du train. Ce Ring va avec deux écartements différents, et ça, ça n’est pas très Bayreuth. [wpsr_facebook]


Merci de reconnaître enfin que ce Ring est très, très mal chanté. Wolfgang Koch, sur qui tout reposait l’an dernier, n’a pas été remplacé, et surtout pas par Lundgren, qui, dans Siegfried, est plus Méphistophélès que le Wanderer. Foster et Vinke sont épuisés, maïs pourquoi ne pas souligner plus fortement que la mise en scène ne les aide pas. Vinke n’arrête pas de monter et descendre, cela n’est pas bon pour le souffle. Certes Siegfried Jérusalem s’était vu imposer par Kupfer beaucoup d’escaliers, mais il n’avait pas fondamentalement la voix de Siegfried. L’an dernier Vinke pouvait faire penser à Jean Cox. Cette année c’était Hermin Esser. Et l’an prochain Ticho Parly? Avec un Philippe Jordan dont on se demande, si c’est confirmé , ce que sa direction toute en nuances va venir faire dans cette galère.
Bonjour
Je ne suis pas aussi radical que vous a dire que le Ring est très très mal chanté, on a entendu bien pire quelquefois sur cette même scène. Il n’est pas aussi bien chanté que l’an dernier, c’est vrai. J’ai écrit dans mon article que les artistes ont à monter sur le décor. je suppose qu’il l’ont accepté, et ce n’est pas le motif de la pâleur vocale de Vinke cette année. Jordan fait Meistersinger l’an prochain, et Janowski continue le Ring, c’est du moins ce qui est prévu.
Je viens de reprendre toutes vos recensions de cet été.
Quel courage et bravo.
Permettez moi deux commentaires. Encore une fois
le moment d or des festivals est bien derrière nous…à vous lire deux spectacles impeccables contre une flopée d’ inaboutis, imparfaits ou ratés.
Personnellement je trouve que nous vivons un moment exceptionnel, rarement nous avons eu une série aussi interessante de chefs, de chanteurs et de metteurs en scène, mais à la condition que tous partagent la même compréhension de l’oeuvre interprétée.
Le ring de Munich de ces dernières années reste pour moi la référence,spécialement siegfried.
Je n ai pas grande envie de voir un wagner entre les meistersinger de ce printemps toujours à Munich et le Tannhauser de mars prochain.
Reposez vous un peu la rentrée est chargée.