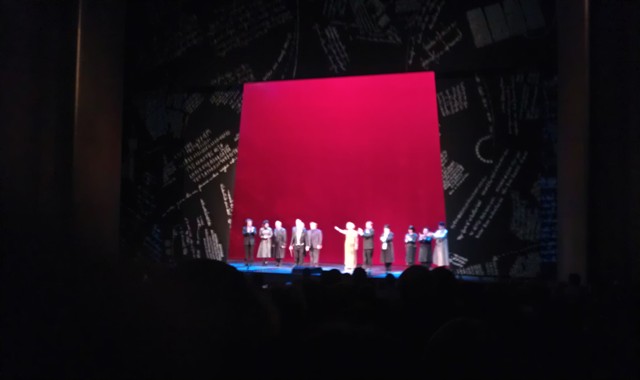Entre deux Wagner, le MET proposait, outre la fameuse Traviata de Willy Decker avec Natalie Dessay, la première de la reprise de Věc Makropoulos, dirigé par Jiři Bělohlávek et avec Karita Mattila. Une telle distribution ne pouvait que m’intéresser, d’autant que je n’ai pas entendu Mattila depuis plusieurs années.
Věc Makropoulos est une étrange histoire, au centre de laquelle une femme, Emilia Marty, une Diva célèbre, a vécu 337 ans: elle est connue au long des âges sous le nom d’Elina Makropoulos, d’Ellian Mac Gregor, ou Eugenia Montez (car on comprend que sur 3 siècles elle ne peut pas garder la même identité) . Ayant bu un élixir de vie éternelle fabriqué par son père, Hieronymus Makropoulos,et qui perd au fil du temps ses pouvoirs; Elina, qui arrive au terme de ses 300 et quelques années, vient à Prague retrouver la formule écrite par son père, qui va lui permettre de repartir encore pour un long bail de vie: elle doit donc récupérer des papiers qui se trouvent dans la famille Prus, qui est en procès avec la famille Gregor, dont Albert Gregor, descendant d’un fils illégitime de Prus et d’Ellian Mac Gregor. Après avoir récupéré le précieux papier, et après avoir provoqué le suicide de Janek Prus, le fils du baron Prus, elle est démasquée, elle est lasse de la vie et donne le papier à la jeune Kristina, fille du clerc Vitek, qui le brûle. Elina/Emilia tombe, morte.
L’Affaire Makropoulos, naît en 1922, quelques années après ce sera la Lulu de Pabst, en 1929, puis celle de Berg commencée en 1929 et inachevée. Ce sera aussi la Turandot de Puccini, en 1926. Autant d’histoires de femmes fatales, fatales aux hommes, et ici fatale aux hommes et fatale au temps.
Il est clair que pour jouer une Diva, il faut une Diva, c’est à dire non seulement quelqu’un qui ait une voix, et quelle voix!, mais aussi qui dès son apparition capte le regard du spectateur. Angela Denoke est de celles là, et Karita Mattila aussi, bien évidemment.
On se souvient du spectacle parisien (et madrilène) de Krzysztof Warlikowski où le metteur en scène avait transposé cette histoire dans le mythe cinématographique, faisant d’Emilia une Marilyn Monroe, avec au fond un gigantesque King Kong, dans une ambiance hollywoodienne des années trente. C’était un spectacle frappant, par sa justesse et la qualité impressionnante de la mise en scène et des interprètes.
La mise en scène du cinéaste et homme de théâtre australien Elijah Moshinsky a été montée en 1997 pour Jessie Norman, dans une version anglaise dirigée par David Robertson. Elle est reprise ici en langue tchèque et pour Karita Mattila, qui a eu un peu de déboires ces dernières années (notamment pour sa Tosca). C’est une mise en scène qui se passe dans les années 40 ou 50, probablement fondée elle aussi sur les Divas de cinéma ou sur le phénomène Diva: au fond, un gigantesque portrait de Emilia Marty, qui ressemble quelque peu à Marilyn Monroe elle aussi, notamment quand elle apparaît en scène en tailleur bleu ciel et coiffure blonde platinée. Les décors d’Anthony Ward sont impressionnants, en premier le cabinet du docteur Kolenaty, avec ses centaines de tiroirs à dossiers qui montent au plafond, comme une sorte de mémoire historique que la pièce, une sorte de thriller, va devoir élucider (Ronconi avec une autre Diva, Raina Kabaïvanska, et en italien, à Turin avait fait avec sa décoratrice Margherita Palli une sorte de lieu bibliothèque qui étourdissait. Certains ont fait remarquer qu’Emilia Marty est à peu près aussi vieille que l’opéra, et voyaient dans l’œuvre un hommage à ce que les italiens appellent le “Divismo” , d’autres notent que c’est la seule œuvre de qui se déroule dans un univers citadin, bien rendu par le décor ici.

Le deuxième acte est la scène vide de l’opéra, on vient de jouer Aida, et un sphinx géant trône au milieu de la scène. Ce peut-être un rappel d’Aida certes, mais pourquoi pas une double référence à Verdi et Mankiewicz (référence à l’entrée triomphale de Cléopâtre/Elizabeth Taylor) pour rester dans l’idée de divismo. La Diva n’a pas d’âge, elle est éternelle, comme la Callas, ou la Malibran.

Le dernier acte est un salon, que la Lulu de Berg ne contredirait pas. Voilà le centre de gravité de l’œuvre, traversée par une Karita Mattila qui nous fascine de bout en bout, au début quand elle entre en scène, à la fin lorsqu’elle raconte sa vie et sa vérité.
Karita Mattila a tout pour ce rôle, le physique, magnifique (lorsque le rideau se lève sur le salon du troisième acte, où elle gît sur un sofa, après une nuit d’amour, elle en est même troublante), la voix est somptueuse de bout en bout: son entrée en scène est magistrale, ses aigus sont larges, triomphants, puissants, ses graves prodigieux, avec un immense volume: une incarnation, presque définitive, qui me restera dans la mémoire.
Elle est entourée de bons chanteurs, à commencer par un revenant, Richard Leech, qui il y a 20 ans était le grand ténor qui laissait espérer une carrière énorme faite de Faust ou de Duc de Mantoue, et qui a disparu des scènes européennes. On le retrouve avec une voix claire, très tendue (il chante beaucoup en force) mais sans erreurs. Belle surprise.
Autre bonne surprise, le Prus de Johan Reuter, un timbre de baryton basse de très bonne facture, comme le Dr Kolenaty de Tom Fox ou surtout le joli Vitek du ténor Alan Oke. Le jeune Matthew Plenk chantait le malheureux Janek, avec vigueur et engagement et surtout, une très jolie Kristina qui faisait ses débuts au MET, Emalie Savoy, délicieuse de fraîcheur.
Bref une distribution équilibrée, qui entourait la Diva de manière avantageuse.
La direction de Jiři Bělohlávek est comme toujours très élégante, très précise, qui fait moins sonner l’orchestre comme on en a l’habitude dans la musique rutilante de Janáček, mais qui lui garde une clarté et une lisibilité qui constitue un modèle du genre. Certains ont mis cette relative discrétion de l’orchestre sur le compte de répétitions insuffisantes à cause du Ring, je n’en suis pas si sûr, mais c’est peut-être un parti-pris, pour cet opéra à texte, sans chœur, sorte de conversation en musique, qui aurait pu d’ailleurs être jouée sans entractes (1h45 de musique environ) et qu’on a divisé avec deux entractes au contraire, au risque de perdre un certain fil dramatique.
Le résultat sur le public a été immédiat, standing ovation, hurlements pour Karita Mattila: la Diva avait encore frappé.