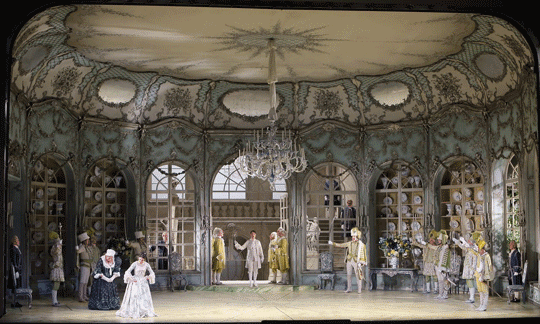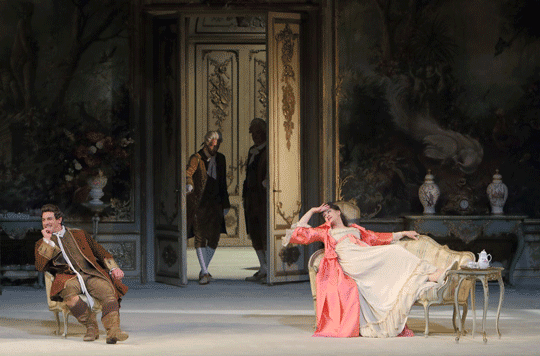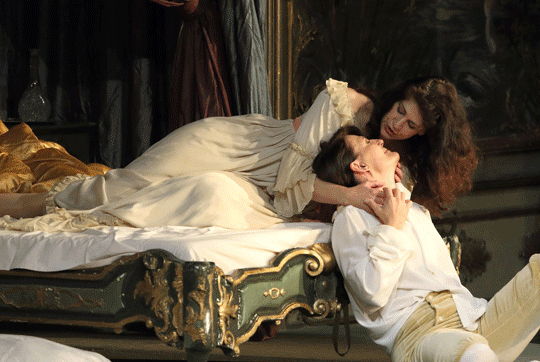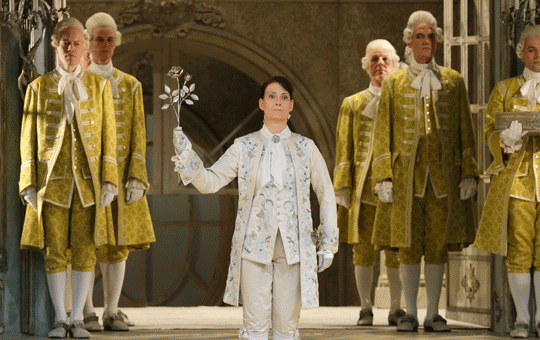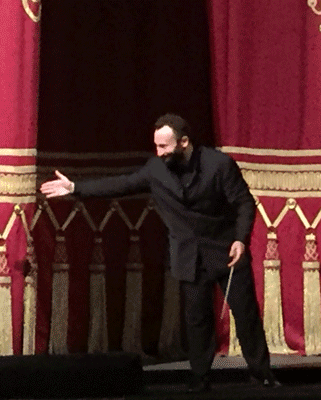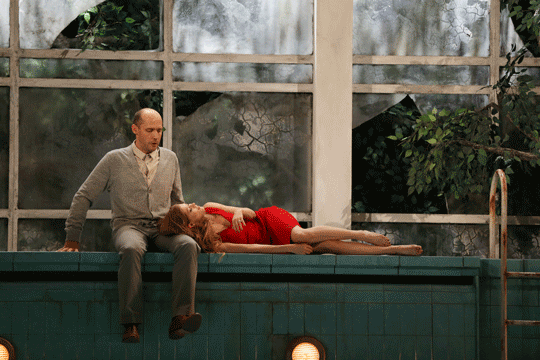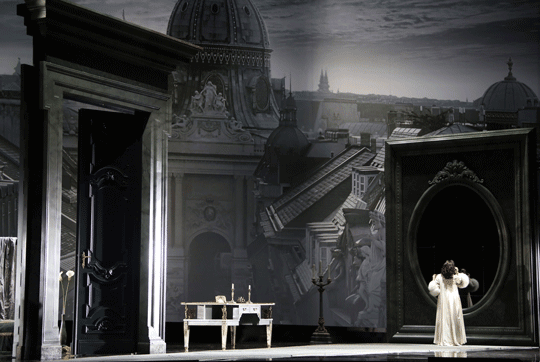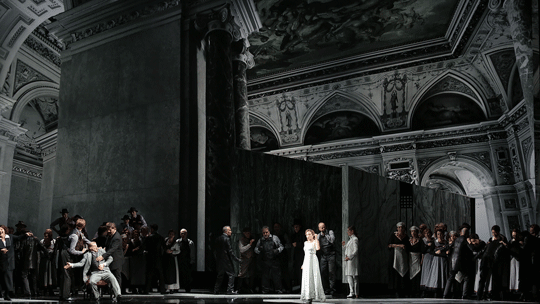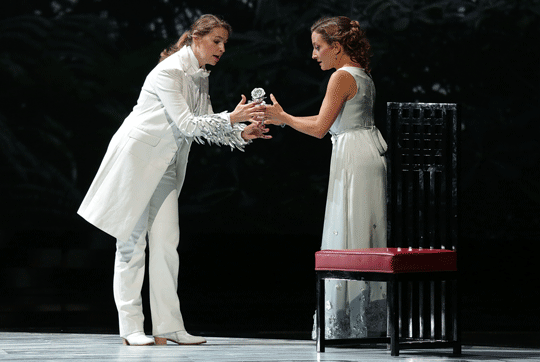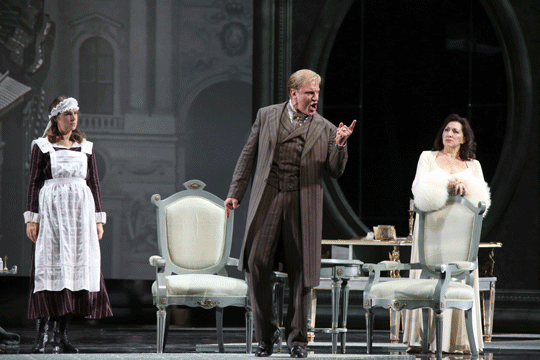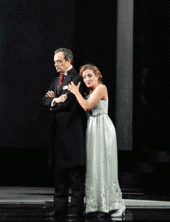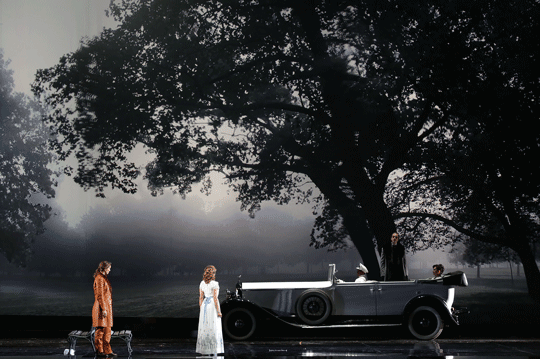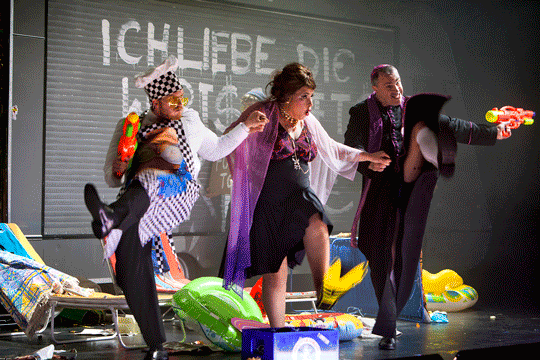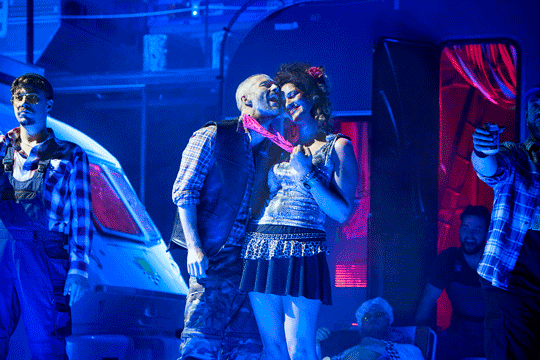Si je me trompai dans mes résultats, rien n’est plus étonnant que la sécurité d’âme avec laquelle je m’y livrai. (J.J Rousseau, Confessions, Livre VIII)
Les opéras de Mozart sont très souvent représentés, mais, et c’est paradoxal, les productions en sont rarement convaincantes, y compris musicalement. Des trois opéras de Da Ponte, seul Le Nozze di Figaro (vertu de Beaumarchais ?) ont connu des représentations exceptionnelles (Strehler, Solti, à Paris par exemple) mais qui peut citer un Don Giovanni qui fasse l’unanimité ? Strehler s’y frotté sans convaincre (Scala 1987), Chéreau n’a pas plus réussi (Salzbourg 1994) pour ne parler que de ceux qui me sont chers, mais combien d‘échecs cuisants! De la trilogie Da Ponte, Cosi fan tutte est l’autre opéra délicat à mettre en scène, avec son intrigue faussement légère, ses dialogues ambigus et ses faux semblants. L’histoire même des représentations, avec le trou d’un siècle (le XIXème) qui range l’œuvre au rang des pochades, met en évidence plus que pour tout autre opéra la question de sa réception. Pochade il y a cent ans et chef d’œuvre aujourd’hui, fragilité des jugements humains pour une œuvre sur la fragilité des sentiments humains.
À certains moments, il me prend le désir d’un Così fan tutte à la Michael Hampe (il en existe une vidéo, production Salzbourg-Scala des années 80), soleil, Naples et perruques, avec de faux albanais qui ne trompent personne, mais auxquels tout le monde fait semblant de croire, sans trop se creuser la cervelle. Il y a dans Così un jeu sur le théâtre qu’avait bien saisi Luca Ronconi en son temps, voire Chéreau aussi sur la scène d’Aix, bien que ce ne soit pas sa mise en scène la plus convaincante, mais aussi d’autres jeux sur la vérité et le mensonge, en des constructions en abyme. Les Hermann à Salzbourg en 2004 présupposaient que les deux sœurs comprenaient immédiatement de qui elles étaient le jeu et que derrière les albanais il y avait leurs fiancés. Double « burla », double farce. Toujours à Salzbourg, mais quelques temps avant, en 2000, Hans Neuenfels en faisait une expérience d’entomologiste, où Alfonso, mettait en éprouvette de petits insectes interchangeables (nos couples), et mélangeait pour voir le résultat. Autant de visions, la plupart justes, mais pas toujours rendues avec la conviction voulue. De toutes les productions vues ces dernières années, celle de Claus Guth (Scala 2014)est sans doute la plus juste, la plus équilibrée, qui fait d’ailleurs des choix bien proches que ce qu’Honoré ressent confusément. Cela reste ma référence récente.

Alors, on imagine avec quelle curiosité je pouvais attendre la vision de Christophe Honoré, dont j’ai tant apprécié les Dialogues des Carmélites et Pelléas et Mélisande à Lyon.
Le Così qui nous été offert à Aix en Provence est dur, cruel : aucun personnage ne s’y rachète. Cette lecture qui privilégie les tensions, les frustrations et les ambiguïtés installe l’action dans un contexte qui surprend, l’Abyssinie italienne des années 30, celle de la colonisation fasciste, celle d’une Italie dominatrice à mille lieues de la Naples solaire souriante et légère de l’original. Ce qui frappe d’abord, c’est l’ambiance nocturne, avec ces feux installés qui ressemblent aux fanaux installés par les prostituées de la via Appia pour signaler leur présence. Alors que Così fan tutte est originellement une affaire de six personnages en quête d’amour( ?), ce Così s’installe dans une société coloniale, avec des dominants et des dominés, une société qui s’ennuie et qui trompe son ennui par l’exploitation notamment sexuelle des autochtones. Il y a donc beaucoup de personnages, des oisifs, des soldats désœuvrés dans un monde étouffant, dans la nuit tropicale moite et infinie. Six personnages en quête de rien.
Qui dit colonisation dit colonisateurs et colonisés, dit violence mentale et physique et en même temps un type de rapports humains pervertis : le désir de l’autre est quelquefois transgressif et le désir de l’altérité absolue est dans cette Abyssinie fasciste le désir de l’autre, de l’africain, de celui qui est à l’opposé de moi, que je méprise et que j’exploite. Mais le désir ignore ces frontières-là. C’est ce que Christophe Honoré se propose d’explorer, et c’est ce qui fait doute chez moi : il y a dans Così, quels que soient les points de vue, un espace typiquement « XVIIIème » qui est celui du jeu. Ce peut être un jeu à la Valmont-Merteuil, qui finit mal, un jeu à la Crébillon, moins définitif, mais peut-être plus excitant. Il y a dans ce Mozart là quelque chose des égarements du cœur et de l’esprit, quelque chose des fragilités, des sentiments vacillants, de la lutte des sentiments contre le désir, ou même de la lutte du désir contre les sentiments, ou du désir qui les révèle, y compris contre la volonté. Le cœur, celui qui a ses raisons que la raison ne connaît pas, est quand même le noyau de l’histoire : Honoré s’intéresse beaucoup plus au désir, Da Ponte aux fragilités du cœur.
Chez Honoré, le jeu grince dès le départ, ce qui pipe un peu les dés : Don Alfonso est un homme mur ravagé par l’alcool, désabusé, misogyne, un tantinet vulgaire qui lui aussi erre dans ce milieu oisif et cherche à se divertir, au sens pascalien du terme, les deux fiancés sont frustes, en terrain conquis : ils trompent leur oisiveté en lutinant l’autochtone. Rien de souriant ni de sympathique. Bien sûr, il y a dans Così fan tutte de quoi faire un film gris, voire noir, et beaucoup s’y sont essayés, mais pas que. Il y a un vaste espace pour toutes les ambiguïtés et tous les doutes : Così fan tutte, comme Don Giovanni est un Dramma giocoso : l’expression aujourd’hui lue de manière presque oxymorique laisse un espace pour le serio, pas forcément pour le serioso (entendu au sens de trop sérieux).
Ce qui me gêne dans le choix de Christophe Honoré, ce n’est pas qu’il pose les questions- il pose d’ailleurs les vraies questions-, c’est qu’il les résolve de manière univoque. Il nous impose dès le départ une réponse indiquant la voie à suivre, comme une sorte de mécanique implacable. Imposant un milieu surprenant (l’Abyssinie italienne à laquelle personne de pensait et personne ne pense plus) et imposant des comportements univoques (de militaires, de corps de garde, de violence exprimée ou rentrée, de colons), il verse des révélateurs pour produire un résultat au fond attendu. Mais dans ce Così plutôt sérieux, dont les personnages inspirent de moins en moins la sympathie, il ne peut échapper à la machine mise en place par Da Ponte, notamment au premier acte, aux lazzi, au jeu, qui devient étrange dans un décor nocturne par ailleurs très suggestif. J’avoue ne pas être du tout convaincu par ce choix de transfert de contexte, destiné à noircir les personnages et à exacerber leurs désirs au contact de l’altérité et du pouvoir local que ces personnages ont sur les gens : la scène du deuxième acte, où les deux femmes se frottent de manière sans équivoque à un serviteur noir est à ce titre emblématique, très bien faite, mais est-elle si justifiée ?

Et c’est bien ce qui me bloque et m’a fait écrire un tweet lapidaire qualifiant cette mise en scène de « ratée » : la lettre aux chanteurs du programme impose un contexte dont je persiste à ne pas voir la pertinence : rien dans le texte de Da Ponte ne dit que les albanais sont refusés parce qu’ils sont albanais ou qu’une intrusion d’étrangers est malvenue. Les deux femmes expriment leur désagréable surprise à ce qu’on leur mette dans les pattes deux hommes qui pénètrent chez elles alors qu’elles sont dans la déploration du départ de leurs amants, ce n’est pas l’autre qu’elles refusent a priori, mais la présence mâle dans leur univers à ce moment-là. Bien sûr, Christophe Honoré a voulu exacerber les tensions, et marquer les possibles du désir (son allusion à Sade dans son texte est en ce sens cohérente), mais je trouve que la lecture de Sade enrichit des œuvres bien plus avant dans le temps, de la première moitié du XXème siècle par exemple, et paradoxalement moins des œuvres contemporaines du divin marquis. La transposition dans un monde aux relations de pouvoir ou de force, destinée à aiguiser le désir, ne répond pas pour moi aux possibles de ce texte-là, ironique toujours, sarcastique quelquefois, pastiche des drames bourgeois ou des tragédies lyriques. Mozart mime le pathétique avec un sourire permanent, même si amer quelquefois.
Du coup, la comédie, intrusive dans un contexte qui ne lui est pas favorable, apparaît être un chien dans un jeu de quilles, même si le clown peut être triste, elle dérange bien sûr, et c’est voulu, et cela ne fonctionne pas.
Je trouve donc que la transposition ne prend pas sens, parce que Così fan tutte n’est pas un opéra noir. C’est une œuvre sans doute amère, sans doute porte-t-elle un double sens, sans doute le rire ou le sourire sont-ils quelquefois forcés. Mais orienter toute l’œuvre vers une vision où tout concourt ici à dévaloriser les personnages, les hommes comme les femmes, est « una forzatura » diraient nos amis italiens une sorte de vente forcée: personne n’en réchappe. Du côté des femmes, il y a de la sensibilité au moins en plus du désir: mais les hommes, aussi bien Alfonso, ivrogne revenu de tout que les deux tourtereaux, que Guglielmo qui embroche dans un coin une prostituée, ou que Ferrando pas bien malin sont peu recommandables…ces femmes n’ont pas un goût très sûr, mais elles ont le goût qui leur correspond et n’ont que ce qu’elles méritent. On a beaucoup glosé sur le déguisement « parfait » en Dubats, ces soldats locaux employés par les italiens (Regio Corpo di Truppe Coloniali), où les blancs deviennent noirs méconnaissables : certes, l’impossibilité de reconnaître leurs amants donne au désir ces femmes un exquis parfum d’exotisme, avec tous les fantasmes que l’homme noir peut éveiller. Mais la possibilité de les reconnaître, dans d’autres mises en scènes, donne aussi au jeu peut-être encore plus de profondeur. Toujours ce côté univoque et presque chimique de réaction en chaîne qui me dérange ici.
Seule la Despina (magnifiquement incarnée par Sandrine Piau) équivoque, plus dame que suivante (un peu dans le sillage de Haneke ou même Guth), revenue de tout, sans illusion sur personne, ni même sur elle-même, réussit à se détacher et à imposer un vrai personnage singulier, le seul peut-être à exister face à des couples sans grand intérêt et un Alfonso à la dérive.
Ce manque de légèreté et ce pessimisme structurel ont été exploités dans d’autres mises en scène, mais le propos ici a généré chez moi un certain ennui, notamment dans la première partie, à cause d’un manque de rythme, voire de vitalité. J’ai trouvé cela mortifère, et je ne sens pas Mozart ainsi, même en 1790…Amer oui, mortifère non.
Il y a sans aucun doute de jolis moments notamment dans la deuxième partie (celui de la douche notamment) parce que Honoré est un sculpteur de caractères, parce qu’il est attentifs aux gestes, aux regards, mais dans un espace ( avec de très beaux décors d’Alban Ho Van) qui n’a pas emporté ma conviction parce que l’œuvre ne semble jamais prendre son envol, dans une atmosphère sombre et lourde que la musique ne contribue pas à éclairer.
En effet, pour conduire un tel travail de mise en scène, il eût fallu à mon avis que la distribution fût sans failles, et que la musique n’allât pas son chemin, et un chemin au total assez fade.
Le ténor Joel Prieto est Ferrando, une voix agréable sans caractère particulier ; peu de lyrisme, peu d’expressivité, peu d’accents : una aura amorosa complètement anonyme. On demande pour Ferrando une certaine présence, une certaine élégance qu’on n’a pas ici, un chant plat qui ne réussit jamais à captiver.
Nahuel di Pierro entendu dans Il Viaggio a Reims n’avait pas vraiment marqué dans Lord Sydney, même si c’est un chanteur valeureux. Il ne marquera pas plus dans Guglielmo. Une certaine brutalité qui va certes avec le rôle que lui dessine Christophe Honoré, maislà aussi un chant assez anonyme : c’est là qu’on s’aperçoit combien Mozart est difficile, il faut le style, la diction, l’expression et la présence. Ce chant est correct, sans scories, mais sans rien de particulier non plus.
Rod Gilfry est Don Alfonso : même si le rôle est toujours à la limite du chant et du récitatif et ne demande pas d’effort particulier, il exige un art aigu du parlando, une vélocité de l’expression particulière et de la couleur vocale : la voix de Gilfry est fatiguée, ou du moins apparaît telle. Même si dans Alfonso ce peut être un atout, cela reste ici décevant du point de vue de l’expression. Autant j’avais bien aimé ce chanteur dans Saint François d’Assise (il est vrai assez loin de Don Alfonso), autant aussi sur cette même scène son Don Giovanni m’avait déçu. J’écrivais : « Don Giovanni vocalement sans relief et scéniquement « forcé ». Il est mal dans le rôle que veut lui faire jouer Tcherniakov. Là où il y a trois ans un Bo Skhovus à la voix vacillante était phénoménal de justesse et d’adéquation à ce Marlon Brando bis voulu par la mise en scène, Rod Gilfry reste un peu extérieur: il joue mais il n’est pas, il chante mais sans éclat ni accent, il n’est pas Don Giovanni, ni dans la vision de Tcherniakov, ni dans toute autre vision ». Si on remplaçait Don Giovanni par Don Alfonso, on aurait exactement la même impression. Don Alfonso (ah ! Gabriel Bacquier ! Ah, Ruggero Raimondi à la voix même usée jusqu’à la garde !) exige non seulement une implication, mais surtout un maniement de la langue impressionnant (un maniement qui rappelle ce qu’exige Falstaff), une aisance dans l’expression. Ici tout est caricatural, exagéré, il joue ou surjoue mais on n’y croit pas. Et puis cet Alfonso vulgaire et usé voulu par la mise en scène correspond-il à ce seigneur libertin ? Je préfèrerais un vieux Valmont, bien plus crédible dans l’imposition du pari, bien plus crédible aussi auprès de Despina.

La distribution féminine correspond mieux au niveau requis pour un festival, et même à ce qu’a voulu Christophe Honoré : on sent que dans cette œuvre la psyché féminine l’intéresse plus en l’occurrence que son pendant masculin, sans doute aussi les qualités théâtrales des dames sont-elles bien plus convaincantes que celles de leurs collègues), même si je n’ai pas été emporté par la Fiordiligi de Lenneke Ruiten, au moins du point de vue du chant. Les qualités théâtrales sont, elles, notables. Elle montre une Fiordiligi d’un extraordinaire naturel, et d’une agilité scénique qui marque le spectateur. Si le ramage s’était rapporté au plumage, c’eût été sans doute un des clous de la soirée, et elle nous eût laissés pantois. Mais son chant reste plat, sans éclat particulier et sans caractère, même si correct. Ce n’est pas une Fiordiligi qui marque vocalement. Kate Lindsey a une voix plus personnelle, avec une belle chaleur et une belle rondeur, plus en phase avec l’œuvre et avec le caractère du personnage, même si Smanie implacabili n’a pas le relief qu’on attendrait. Sandrine Piau, on l’a déjà dit, est la seule vraie incarnation : elle incarne une Despina plus amie que suivante, désopilante dans ses déguisements successifs très couleur locale (très beaux costumes de Thibault Vancraenenbroek), même si la voix accuse certaines âpretés notamment à l’aigu. Il reste que des trois femmes, c’est elle qu’on va retenir, et qui ramasse la mise aux applaudissements.
Au-delà du chœur très épisodique, un Cape Town Opera Chorus dirigé par Marvin Kernelle très « couleur locale » et donc très vrai dans son comportement scénique, et bien en phase vocalement, le Freiburger Barockorchester était en fosse, ce qui garantissait niveau d’excellence et son légèrement rugueux qui convenait bien à l’ambiance voulue. Des cordes charnues, des cuivres impeccables, des bois de rêve qui confirment que nous avons là pour ce répertoire une des phalanges de référence : ils furent excellents. Mais j’ai été très déçu par la direction musicale, très précise, voire syncopée, de Louis Langrée. J’avais apprécié son Don Giovanni, je trouve son Così fan tutte assez anonyme, peu vital et pour tout dire sans prise de risque ni de direction claire. En ce sens, cette direction est à l’opposé de la mise en scène parce qu’elle est sans parti pris : ni marquée par la mise en scène : on aurait pu entendre dans la fosse quelque chose de plus sombre, ni par le « giocoso » : cela ne pétille pas non plus. C’est presque un pilotage automatique, tout ce qui est à faire est fait, mais sans accents ni personnalité. Je pense que le manque d’engagement de la musique est pour beaucoup aussi dans l’impression d’ensemble distillée par la soirée : il eût fallu un Harnoncourt pour ce Così-là .
Une soirée qui laisse en bouche un goût d’inachevé. Un parti pris de mise en scène mené sans vraiment aller jusqu’au bout, comme au milieu du gué, qui commence par être « radical » et qui s’affadit à mesure malgré une direction d’acteurs très soignée, un parti pris de direction musicale justement sans parti pris malgré un orchestre superlatif, et un cast déséquilibré, qui n’est pas à la hauteur des attentes, malgré de fortes individualités. Le gracieux Mozart a encore frappé.[wpsr_facebook]