
On attendait beaucoup de ce spectacle qui affichait complet (2 soirées seulement) avec une distribution enviable, Esa-Pekka Salonen en fosse après son triomphe dans Pelléas, et Peter Sellars qui attire toujours la foule.
Sur le papier, un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.
Peter Sellars depuis quelques années s’intéresse plus particulièrement aux oratorios et à leur mise en espace, on lui doit à Salzbourg et Berlin une Passion selon Saint Mathieu avec les Berliner Philharmoniker et Sir Simon Rattle restée dans les mémoires. L’an dernier, il s’est déjà intéressé à Stravinski, à travers la mise en perspective de deux spectacles, Iolanta de Tchaïkovski, et Perséphone de Stravinski. Je n’avais pas été convaincu ; il est vrai que la musique de Perséphone n’était pas de celles qui vous marquent à vie. J’ai beaucoup d’admiration pour Peter Sellars dont j’ai vu bien des spectacles, depuis son Don Giovanni originel à la MC93, en passant par Cosi fan tutte, Saint François d’Assise, déjà avec Salonen, à Salzbourg en 1992, puis à Paris (sans Salonen) sans aucun doute son chef d’œuvre, qui a popularisé dix ans après ou quasi une œuvre sabotée par une mise en scène sans saveur (Sandro Sequi) à sa création en 1983. J’ai beaucoup aimé Nixon in China de John Adams, mais aussi sa Mort de Klinghoffer (vue à Lyon) et Doctor Atomic plus récemment, à Amsterdam. Comment passer sous silence son partenariat avec Bill Viola pour un Tristan und Isolde de légende vu à Paris et Lucerne, encore et toujours avec Salonen. Bref, Sellars a marqué beaucoup de spectacles et reste pour moi une grande référence.
Je suis d’autant plus perplexe devant cet Œdipus Rex…
Voulant de nouveau lier deux œuvres proches par l’époque (Œdipus Rex remonte à 1927, La Symphonie de Psaumes à 1930) et a priori éloignées par la thématique, Sellars et Salonen ont décidé de les rapprocher et d’en faire un spectacle unifié, faisant de la Symphonie de Psaumes une sorte de transfiguration d’Œdipe. Cette combinaison a déjà été travaillée avec Esa-Pekka Salonen à Los Angeles, et plus en arrière dans le temps, Peter Sellars et Kent Nagano ont présenté une soirée Œdipes Rex/Symphonie de Psaumes au festival de Salzbourg à l’invitation de Gérard Mortier en août 1994, dans d’autres décors -coop Himmelb(l)au- mais comme à Aix avec Dunya Ramicova pour les costumes ainsi que James F.Ingalls pour les lumières , comme me le rappelle un lecteur attentif que je remercie chaleureusement. Il s’agit donc de la reprise d’un projet vieux de 22 ans…
Dans un espace blanc immaculé, seulement scandé par des sculptures africaines de l’artiste Elias Sime, Œdipus Rex reste un oratorio, à cause de l’importance donnée au chœur, qui par sa disposition et sa masse écrase les protagonistes, plus ou moins en rang d’oignon au proscenium. Les sculptures africaines, seul élément de décor et donc évidemment hautement emblématiques, renvoient cette histoire à celle d’une tribu, mais aussi à un originel primitif, celui de la première des tragédies, la seule peut-être. Stravinski ambitionnait (un peu d’ailleurs comme les compositeurs des premiers opéras au XVIIème ) de revenir à une sorte d’épure antique, à l’opéra comme survivance de la tragédie grecque. En ce sens, peut-être Œdipus Rex aurait-il une place de choix à Epidaure. Évidemment, dans ce retour aux sources, le texte de Cocteau original fait un peu désordre. C’est pourquoi il a été réécrit, à partir de Sophocle, mis dans la bouche d’Antigone qui fait office de récitante (Pauline Cheviller) accompagnée de sa sœur Ismène (incarnée par la danseuse Laurel Jenkins) dont la présence esthétisante m’est apparue un maniérisme.

Le choix se défend dans la perspective de l’arc formé par Œdipus Rex et la Symphonie de Psaumes, qui rend le chœur totalement protagoniste comme dans la tragédie grecque et qui veut revenir à Sophocle. Mais dans l’œuvre originale, le texte de Cocteau, qui en matière de mythes grecs s’y connaissait un peu, met un zeste d’ironie, de distance, un zeste de commentaire de conférencier qui évite le « tragico-tragique » et d’ailleurs le choix du latin, pour « faire oratorio » contribue à cette distance:
« Spectateurs, vous allez entendre une version latine d’Œdipe Roi. Afin de vous épargner tout effort d’oreille et de mémoire, et comme l’opéra oratorio ne conserve des scènes qu’un certain aspect monumental, je vous rappellerai, au fur et à mesure, le drame de Sophocle.»
Évidemment ma déception aussi pour origine un souvenir encore brûlant, l’Œdipus Rex donné l’Opéra de Paris en 1979 sous la direction de Seiji Ozawa, dans une mise en scène de Jorge Lavelli, avec Maria Casarès en récitante…L’urgence de la mise en scène, très marquée par l’expressionnisme, noire et rouge, drapée dans le sang, la distance de Maria Casarès qui dit ce texte comme personne, au point que je l’ai encore dans l’oreille, tout cela a donné un relief à mes souvenirs parce que cela donnait un relief inédit à l’œuvre. Ceux qui ont eu la chance de voir ce spectacle se souviendront…
Nous avons ici une tentative, non dénuée de prétention à mon avis, de proposer une version totalement tragique. La jeune Pauline Cheviller en Antigone un peu déclamatoire, n’arrive évidemment pas à remplir la scène de ce texte adapté par Peter Sellars et traduit par Alain Perroux et Vincent Huguet, qui n’a ni le relief, ni la distance, ni l’élégance du texte de Cocteau, bien daté certes, mais en plein dans le sujet. On dit que Stravinski n’était pas trop satisfait…mais le fut-il d’un librettiste… ? Le texte de Gide pour Perséphone est pour moi inaudible aujourd’hui. Ce n’est pas le cas de celui de Cocteau…J’entends encore Casarès dans les dernières paroles du récitant :
« Le roi est pris. Il veut se montrer à tous, montrer la bête immonde, l’inceste, le parricide, le fou. On le chasse avec une extrême douceur. Adieu, adieu, pauvre Oedipe! Adieu Oedipe; on t’aimait. »
Alors pour moi Sellars n’a effacé ni Cocteau, ni Lavelli, et Salonen n’a pas effacé Ozawa. Encore sans doute un souvenir d’ancien combattant diront ceux qui ont été émerveillés par ce spectacle à Aix. Sans doute n’auront-ils pas tort d’un côté, mais dans l’affaire cela permet pour moi de remettre les choses en place. Je ne dis évidemment pas que ce spectacle est médiocre, je dis simplement que dans ma propre histoire il y a eu bien mieux, – je renvoie les lecteurs curieux vers le site de la BNF pour voir les documents relatifs à cette ancienne production- et que Peter Sellars brutalement parlant ne m’a pas semblé trop se fatiguer. Je veux bien qu’il ait refusé les effets de théâtre, le tragique donné en spectacle pour privilégier le tragique dépouillé de ses oripeaux, et qu’il a pour cela limité au minimum les mouvements des personnages, rendant l’oratorio mis en espace plus qu’en scène et en faisant une version semi scénique où les protagonistes arborent des costumes qu’ils pourraient à la limite revêtir en concert, même si berger et messager sont costumés. Cette simplicité que l’on appellera de ses vœux pour célébrer la tragédie des tragédies valorise en fait un chœur qui à peine entré en scène, est pressant-oppressant, disant le texte latin en l’illustrant de gestes qui s’apparentent à la langue des signes, mais aussi à ce qu’on sait des mouvements et des gestes qui accompagnaient les prières dans l’antiquité, c’est à dire une gestuelle à la fois cryptique et symbolique, qui communique et qui célèbre, proche d’un rituel mystérieux et lisible à la fois. C’est bien le chœur qui unifie les deux œuvres, dont il est protagoniste, puisque la plupart des personnages disparaissent, sauf Œdipe, Antigone et Ismène, soulignant la malédiction qui frappe la « tribu » des Labdacides.
De « personnages » dans Œdipus Rex il y en a bien peu. Peu d’engagement scénique, peu de mouvements sinon les plus habituels et surtout peu de personnalités scéniques qui se démarquent.
Le vétéran Sir Willard White assume les rôles de Tirésias, du berger et de Créon. C’est sans doute un choix d’économie de la scène, mais Créon et Tirésias devraient être deux personnages différents. Bien sûr, faire un seul personnage, c’est montrer qu’ils déclinent chacun un élément du destin d’Œdipe et qu’ils finissent par n’en faire qu’un, mais dramaturgiquement, les trois personnages dont bien distincts et je préfère qu’on les distingue. D’ailleurs en dehors d’Œdipe de Jocaste et des deux filles, les autres s’effacent presque en arrière-plan comme pour éviter d’identifier qui est qui.
L’ensemble de la distribution est évidemment de bon niveau, mais Sir Willard White affiche une voix assez fatiguée, même si sa présence scénique est toujours forte, notamment pour Tirésias, qui mériterait une voix moins mate, plus sonore, plus prophétique, et le danger d’un seul chanteur pour trois rôles c’est l’uniformisation, même si je pense que c’est ici intentionnel.
Joseph Kaiser en Œdipe est très correct, mais un peu sage. Il manque de cette urgence, de cette angoisse qui monte, il aurait besoin de mieux caractériser sa voix : c’était à Garnier Kenneth Riegel, un ténor de caractère, sans énorme voix, mais qui soignait la couleur et l’expression. On peut préférer une voix plus forte, mais il faut que cette voix soit expressive, qu’elle sculpte la parole, c’est là l’essentiel : Œdipe doit être d’abord un questionnement, et la voix doit évoluer au fur et à mesure de la découverte de la vérité. Joseph Kaiser est un bon chanteur mais plat et un peu fade et surtout il chante à peu près toujours de la même manière, ce qui pour ce personnage est délétère.
La seule à être dans le personnage et le drame, c’est indiscutablement Violeta Urmana en Jocaste. Comme les autres elle ne fait pas grand-chose en scène, mais à la différence des autres, elle impose une présence vocale forte, pleine de relief, avec une voix pleine : il faut l’entendre lancer ses « cave oracula » prophétiques. Revenue après des errances dans des rôles plus proches de sa tessiture d’origine, mezzo-soprano, elle impose ici un personnage de mezzo dramatique qui sait dire un texte, qui colore, qui est expressif, qui projette. Elle tranche avec les autres : c’est la seule qui pour mon goût soit dans le drame et en pleine harmonie avec la couleur voulue par Stravinski. J’ai suffisamment émis des doutes sur cette chanteuse pour dire quel bonheur elle m’a procuré ce soir.

Les chœurs, c’est le chœur suédois Orphei Drängar, auxquels s’adjoignent le Gustav Sjökvist Chamber Choir et le Sofia Vokalenensemble, dirigés par Folke Alin. J’ai dit plusieurs fois que c’est le protagoniste central du projet, celui qui reste en scène, celui qui va passer des questions angoissées d’Œdipus Rex à la transfiguration d’Œdipe apaisée et émouvante dans un détournement ici bienvenu de la Symphonie de Psaumes, à mon avis plus réussie. Un chœur (d’amateurs je crois) très engagé, plein de relief et de présence qui est vraiment la grande découverte de la soirée, et qui a contribué pleinement au triomphe public final. Un chœur toujours en mouvement, assis ou couché ou debout, avec toujours cette étrange gestuelle qui tient du rituel et du langage des signes à laquelle le spectateur s’habitue et qui rythme la musique. Magnifique.

Reste l’orchestre Philharmonia et son chef Esa-Pekka Salonen. Un orchestre magnifiquement préparé, sans scories, avec une belle précision dans les attaques et un beau son. Mais comme dans Pelléas, j’ai trouvé l’option de Salonen insuffisamment engagée, notamment dans Œdipus Rex, il a manqué pour moi du relief, du drame, quelque chose d’un couteau aiguisé (là où jadis Ozawa était un poignard dardé à la limite du supportable[1]). Pour cette musique paroxystique, le rendu est un tantinet en dessous du paroxysme : peut-être est-ce voulu, mais je n’ai pas entendu cette retenue dans son Elektra par exemple, autre musique paroxystique. En bref quelque chose m’a manqué dans Œdipus Rex de cette urgence, un peu comme ce qui m’a manqué chez Joseph Kaiser, une musique certes au point certes précise, certes quelquefois ciselée, mais qui ne va pas jusqu’au bout de l’histoire et qui s’efface derrière le chœur. Peut-être ce choix est dû à la volonté d’harmoniser un peu les deux œuvres et d’en donner un spectre cohérent, mais le fait est que dans la Symphonie de Psaumes, la musique m’est apparue mieux correspondre à l’attente, plus accomplie, plus apaisée, séraphique comme attendue.
La mise en scène du chœur un peu répétitive mais le rituel convient bien à l’œuvre et la conduite d’Œdipe à son sommeil définitif, au sein de ce carré lumineux censé en faire le mythe que nous connaissons, transfiguré en figure définitive du tragique humain est sans doute une trouvaille relativement facile, mais qui correspond bien à l’œuvre et qui répond aux images qu’elle nous invite à investir. Nous eûmes donc une belle image finale.
Il est possible que le goût du jour soit moins sauvage que ce que j’attends de l’œuvre, mais si je lis bien le texte, Œdipus Rex est un opéra-oratorio. C’est dire qu’il faut de l’opéra, autrement dit de la chair, de la stupeur et du tremblement. Nous avons vu privilégier l’oratorio qui s’est mis d’ailleurs à respirer plus à son aise dans la seconde partie, mieux réussie pour moi dans sa cohérence et même dans le propos. Ainsi, et je le regrette, ni Sellars ni Salonen (que j’aime beaucoup par ailleurs) chacun dans leur sphère et malgré leurs qualités (nous sommes à un très haut niveau) n’ont réussi à me convaincre du bien-fondé de leur option.
[1] J’ai voulu pour vérifier l’adéquation de mes souvenirs et de la réalité sonore, et donc n’être pas injuste, réécouter l’enregistrement d’Ozawa que j’ai encore de la radio d’alors. Quelle différence ! Quelle immensité !
[wpsr_facebook]



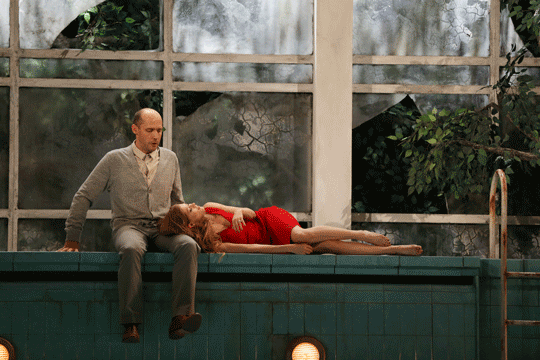








 Souvent, lorsqu’on écoute du Wagner, même si l’interprétation est moyenne, la musique réussit presque toujours à émouvoir. Quand tout est parfait, ce qui fut le cas ce 10 septembre à Lucerne, alors le succès prend des proportions océaniques.
Souvent, lorsqu’on écoute du Wagner, même si l’interprétation est moyenne, la musique réussit presque toujours à émouvoir. Quand tout est parfait, ce qui fut le cas ce 10 septembre à Lucerne, alors le succès prend des proportions océaniques. De plus, le fait de mettre des voix devant l’orchestre fait qu’enfin dans cette salle faite pour les orchestres, on entend, très présentes les voix, quelles que soient leur place dans la salle, puisque Peter Sellars utilise orchestre, galeries, balcons pour distribuer des personnages, spatialisant l’oeuvre (comme il le fit pour la Passion selon saint Mathieu à Salzbourg et à la Philharmonie de Berlin, ou comme le fit Abbado pour Parsifal à la Philharmonie de Berlin, inoubliable) . Peter Sellars, qui commença sa carrière dans l’hyperrréalisme (souvenons nous de sa Trilogie Mozart-Da Ponte), est en train d’évoluer vers un hiératisme tout aussi parlant. C’est un travail d’une rigueur prodigieuse.
De plus, le fait de mettre des voix devant l’orchestre fait qu’enfin dans cette salle faite pour les orchestres, on entend, très présentes les voix, quelles que soient leur place dans la salle, puisque Peter Sellars utilise orchestre, galeries, balcons pour distribuer des personnages, spatialisant l’oeuvre (comme il le fit pour la Passion selon saint Mathieu à Salzbourg et à la Philharmonie de Berlin, ou comme le fit Abbado pour Parsifal à la Philharmonie de Berlin, inoubliable) . Peter Sellars, qui commença sa carrière dans l’hyperrréalisme (souvenons nous de sa Trilogie Mozart-Da Ponte), est en train d’évoluer vers un hiératisme tout aussi parlant. C’est un travail d’une rigueur prodigieuse.