| Rappelons: c’est une longue recherche, musicale, philosophique et humaine qui a mené Claudio Abbado à Parsifal, qui passe par Lohengrin et Tristan. C’est aussi une période qui s’ouvre, puisque Parsifal dominera la saison jusqu’en septembre 2002: on l’entendra à Salzbourg au printemps, puis successivement, avec l’Orchestre des jeunes Gustav Mahler à Bolzano, Edimbourg, Lucerne. C’est dire le prix attaché au projet. Parsifal a aussi été l’objet d’une très longue préparation, à peine interrompue par la maladie. Il est évident que c’est là une pierre miliaire dans le parcours de Claudio Abbado. Comment s’en étonner: Parsifal est une de ces oeuvres par lesquelles il faut un jour passer, une de ces oeuvres qui n’ont jamais fini de dire quelque chose, une de ces oeuvres qui gardent un mystère qui les rend incontournables, pour l’auditeur comme pour l’artiste.Faut-il sacraliser Parsifal ? Il est difficile de répondre. L’appellation “Festival scénique sacré” devrait nous induire à le penser. Dans le parcours wagnérien, nul doute que l’on est au-delà de l’opéra et du spectacle: on est à un point d’aboutissement qui a commencé au Fliegende Holländer, qui est passé par Tristan, par le Ring. Comme Tannhäuser et comme le Vaisseau Fantôme c’est une oeuvre sur la rédemption possible, qui passe obligatoirement par l’amour, la souffrance et la mort. Comme Lohengrin – avec quelle filiation ! – c’est une oeuvre sur l’impossible dialogue entre l’homme et l’ordre du mystique et du divin, et sur l’arrivée du sauveur inconnu; comme Tristan, c’est une oeuvre sur Eros et Thanatos, comme Meistersinger, Parsifal est une oeuvre sur l’initiation; comme Ie Ring, Parsifal est le récit d’une aventure individuelle qui passe par l’amour, la divinité, la société, et qui se clôt sur sur une fin et une renaissance. Les tentatives de lecture de l’oeuvre hésitent entre l’ésotérisme, la religion à laquelle elle emprunte de nombreuses formes et de nombreux thèmes, on a même pu parler de fatras mystique. Certains enfin nous demandent de prendre garde au danger que l’oeuvre peut représenter pour l’individu (Nietzsche)!
Sang, blessure, castration, chasteté, amour, sensualité, connaissance, passion (au sens religieux et christique), initiation, pouvoir et pouvoirs, société, armée, mère, innocence – comme l’innocent de Boris -, mort. Voilà quelques uns des mots et des concepts qu’il faut avoir en mémoire pour suivre l’oeuvre sans vraiment toujours la saisir. Parsifal, un de ces héros sans origine, parti voir le monde comme Siegfried, sans mère et pourtant complètement soumis à l’image maternelle et au manque, comme Siegmund et Siegfried, arrive dans une société de chevaliers régie par un rite unique qui lui garantit survie et pouvoir: le rite du Graal.
Dans cette société, le pouvoir chevaleresque est détenu par un “roi”, Amfortas, déchu par la faute. Le Graal, vase contenant le sang du Christ, qui a coulé sur la croix par la lance du soldat romain est la source du pouvoir vital des chevaliers. La Sainte Lance (qui perça le Christ) est garante de la survie de ce pouvoir. Amfortas, en fautant, se l’est fait dérober . Aux mains de l’ ennemi, le magicien Klingsor, qui a l’en a transpercé , son pouvoir s’exerce désormais seulement pour faire lui faire éprouver l’atroce souffrance, à chaque fois qu’il exécute le rite, la blessure s’ouvre et le sang coule, sans possibilité de rédemption. Détruit par l’horreur de la souffrance, Amfortas refuse de plus en plus d’exécuter le rite. Au premier acte, il l’exécute pourtant, pour permettre à son père Titurel de reprendre force et survivre. C’est à ce récit et à ce rite que nous assistons.
Parsifal, entré en scène après avoir tué un cygne, comme Siegfried entrait accompagné d’un ours (Parsifal ignore toute règle sociale, Siegfried ignore la peur), assiste au rite et à la torture d’Amfortas, qu’il ne comprend pas: il est chassé du domaine du Graal.
Le personnage central de ce premier acte est Gurnemanz, compagnon et ami d’Amfortas, c’est d’une certaine manière la mémoire vivante de cette société particulière: le garant de l’histoire, des rites, et celui qui transmet. C’est une sorte de Pimen.
Il transmet aux nouvelles générations l’histoire du Graal, et c’est pourquoi en ce premier acte, il raconte son récit à de très jeunes chevaliers (ils peuvent avoir entre 10 et 15 ans). Dans cette version, les jeunes chevaliers sont chantés par des enfants et adolescents…Toute l’approche sonore en est bouleversée. Chaque épisode en est accompagné dans la fosse par l’exposé des leitmotive, qui se suivent et s’enchaînent, répondant à la progression de l’histoire.
Si Amfortas choisit de raconter ce récit à ce moment là, c’est que les jeunes se sont attaqués à une femme: la seule femme que nous verrons dans le domaine du Graal, qui, venue de partout et du nulle part parcourt le monde à la recherche de baumes salvateurs pour apaiser les souffrances d’Amfortas…Qui est-elle ? d’où vient-elle? nul ne le sait, et surtout pas Gurnemanz. Elle est seulement là par intermittences, pour servir, et dépositaire d’un étrange savoir: elle sait que la mère de Parsifal est morte, elle le lui lance au visage, mais au moment où Parsifal va assister au rite du Graal, elle tombe dans une étrange léthargie qu’elle refuse, mais à laquelle elle ne peut résister.
Voilà le premier acte de Parsifal, tel qu’on peut en saisir les quelques implications: un jeune innocent tombe au milieu d’une société au bord du gouffre, dont les lois sociales et morales sont menacées par des forces obscures. Seul un sauveur la sortira de la mort lente: “durch Mitleid wissend, der reine Tor, harre sein, denn ich erkor” (“la pitié instruit le pur, l’innocent, attends celui que j’ai choisi”) Parsifal ne sait pas ce qu’il voit. Il est chassé: le royaume du Graal a laissé partir son sauveur sans le reconnaître. En somme au terme de ce premier acte, nous savons que nous ne savons rien: nous avons assisté, pétrifiés par la grandeur, au rite du Graal, mais nous ne connaissons aucune clé de l’oeuvre. Mais si nous ne savons rien, nous avons appris quelque chose: nous pouvons donc poursuivre le chemin.
Jeudi 30 novembre
Inutile aussi de décrire l’attente dans laquelle était le public de Berlin. Et celle du Wanderer, pour lequel Parsifal est l’oeuvre chérie entre toutes, liée à toute son éducation musicale et à toute l’histoire de sa relation à l’opéra et en particulier à Richard Wagner. Première oeuvre entendue à l’opéra, première oeuvre de Wagner entendue intégralement, première oeuvre entendue à Bayreuth, premier disque d’opéra acheté (celui de Solti..). Eh bien, que dire après cette audition: le lecteur sera surpris de ne pas trouver les superlatifs habituels dans ce site et dans ces lignes pour qualifier ce que nous avons entendu hier…Mais qu’il ne se méprenne pas: il n’y a pas de déception. Il y a stupéfaction. Une stupéfaction qui empêche une réflexion rationnelle et une distance de bon aloi lorsqu’il s’agit de rendre compte. Une stupéfaction qui attend la deuxième audition pour s’assurer avoir vraiment compris les intentions et la volonté du chef.
On a l’habitude d’entendre un Parsifal de cathédrale, grandiose comme un Te Deum, recueilli comme un Requiem, une musique charnue, lente et cérémonielle, éclatante et tout à la fois émouvante, un Parsifal “gothique flamboyant”. Nous nous trouvons devant une rigueur franciscaine, une simplicité et un hiératisme à la limite rugueux, comme dans une cérémonie toute de grandeur simple. Rugueux, le son de ces cloches fondues tout exprès pour cette représentation, que Wagner lui-même voulait et n’avait pu obtenir, rugueuses, ces voix blanches là où habituellement on entend des voix féminines. Là où le son est fini, rond, parfaitement délimité, on a un son aux limites, quelquefois hésitant, mais incroyablement puissant, incroyablement parlant, incroyablement juste. Ce Parsifal est pour moi rupestre, comme ces peintures des chapelles des premiers chrétiens, et par là-même originel. En ce sens, le premier acte doit être grandiose, mais d’une grandeur froide, comme cette distance mise entre ce qui se voit et ce qui se sent, comme cette distance qui sépare Parsifal de la compréhension, de cette Mit-leid, de cette souffrance-avec, de cette passion qui doit être physiquement ressentie pour devenir action. D’où un premier acte parfait dans sa réalisation, mais distant et étranger, impressionnant mais lointain. Comme si il y avait quelque chose qui séparait encore de la lumière et du sublime: c’est beau, certes, c’est impressionnant certes, mais les surprises sont telles qu’elles finissent par déranger l’audition. Et quelques hésitations à l’orchestre. Mais critiques de journaux allemands sont toutes sans aucune exception enthousiastes
Lundi 3 décembre
Samedi 1er décembre: Le miracle. Dès les premières mesures du prélude, quelque chose de différent se passe dans la relation du chef et de l’orchestre. Une fluidité et une précision dont nous nous étions rendu compte jeudi, mais qui cette fois-ci est devenue fusionnelle. Tous sont en place: les voix d’enfants n’ont plus aucune hésitation et les chanteurs sont en forme (Alfred Dohmen le jeudi avait eu quelques difficultés dans Amfortas, il domine ce samedi sa partie de manière impressionnante), le vétéran Kurt Moll, qu’on peut sans crainte qualifier de Gurnemanz de ces trente dernières années donne une leçon de phrasé, un véritable cours d’interprétation, tout pétri d’humanité et de rigueur: son récit est dit, compris, mot à mot et entendu, car l’orchestre ne couvre jamais les chanteurs: comment Claudio Abbado a-t-il réussi à obtenir ce son légèrement amorti qu’on entend seulement dans la salle de Bayreuth? Jamais l’orchestre n’est envahissant quand les chanteurs sont en scène, il n’est qu’un personnage parmi d’autres, mais il ne reprend ses droits – avec un éclairage particulier – que lors de l’extraordinaire Verwandlungsmusik, là où “le temps devient espace”: certains spectateurs ont été gênés par le son des cloches, à la fois envahissant et obsédant, et qui donne à ce qui se passe une allure décidement cérémonielle et religieuse: il n’y a plus de théâtre, plus de distance, nous sommes de plain pied avec l’action scénique . Les choeurs alors se mettent à dialoguer: le Tölzer Knabenchor, tout en haut de la salle, près de la voute céleste… tient allègrement le la bémol(!), le Rundfunkchor Berlin sur le podium n’est pas en reste, on se souviendra longtemps du son du “letzten” dans les premières mesures du choeur “Zum letzten Liebesmahle” à la fois adouci et attendri dans un choeur habituellement chanté comme une entrée vaguement martiale, et lorsque la voix du ciel descend vers le spectateur et sonne les dernières mesures après une heure et quarante cinq minutes de musique, le silence est pesant dans la salle frappée d’obscurité, même si de courts applaudissements éclatent lorsque les lumières se rallument.
Ce samedi, nous avons retrouvé cette clarté, cette simplicité franciscaine dont je parlais plus haut, mais cette fois-ci, tout nous a semblé encore plus fluide, encore plus essentiel: loin des grosses machines lourdes que nous avions pu entendre à Bayreuth et ailleurs, loin de ce ton cérémoniel d’une lenteur insupportable que certains chefs prennent pour du recueillement, loin aussi de l’action au sens théâtral du terme: tout l’acte est construit autour de la Verwandlung, de la transformation à vue de la scène, entre le court moment où Parsifal entre en scène et le rite qui va avoir lieu , seul moment de théâtre et d’action construit volontairement au centre de l’acte qui crée un moment de trouble, qui va infléchir notre regard sur le recueillement des chevaliers , mais qui par ce trouble même montre qu’il est l’élément perturbateur cher aux contes, et donc casse un rythme de la représentation auquel nous nous étions habitués dans tout un acte dont l’objet est d’apprendre, et apprendre à sentir: Parsifal est en scène, il faut sentir que quelque chose se passe.
Le deuxième acte est l’acte de la péripétie, cher au schéma narratif traditionnel: nous retournons à l’action et au théâtre: Klingsor le magicien est en réalité un chevalier déchu: incapable de se soumettre au voeu de chasteté, il s’est châtré. Il a été chassé du royaume du Graal et pour se venger a fondé un royaume magique qui en est le symétrique, cet affreux soleil noir dont parle Hugo. Là où le Graal cultive la chasteté et la connaissance mystique, Klingsor organise une société construite autour du plaisir sensuel, une sorte de Venusberg exclusivement dédié à la chasse aux chevaliers pécheurs. Parmi ces chevaliers, Amfortas qu’il a piégé, à qui il dérobé la Sainte Lance, et au moyen de laquelle il l’a castré à son tour, telle est la blessure qui ne se referme jamais. Son arme: des filles fleurs d’un jardin enchanté et une femme, Kundry, qu’il emploie pour les missions délicates en la sortant d’un sommeil léthargique, devenue pour la circonstance un parangon de beauté et de sensualité sauvages, omnisciente (on l’avait constaté au premier acte). Ainsi donc le mystère de Kundry est – quelque peu – dévoilé: lorsque Klingsor ne la rappelle pas, elle court le monde pour expier, et notamment pour soigner Amfortas, qu’elle avait elle-même attiré dans ses filets et séduit, elle est pécheresse suprème (Klingsor l’appelle Höllenrose, Urteufelin – Rose infernale – archidiablesse) et recherche tout à la fois la rédemption . Elle est appelée par Klingsor parce que le cas Parsifal est le plus ardu: c’est un innocent….Après une résistance désespérée, elle cède dans un rire sardonique.
Parsifal passe, amusé au milieu des filles fleurs, scène légère et colorée, mais aussi mystérieuse comme la sensualité, et entend un appel venu du fond des âges: “Parsifal, weile..”.(“Parsifal, reste”) Parsifal, ainsi le nommait sa mère en rêve. Il reste donc et se retrouve devant Kundry, dans un dialogue étrange où Kundry entreprend un jeu de séduction qui est en même temps la première pierre de la construction du savoir de Parsifal. Elle lui raconte l’amour maternel, une vie toute tournée vers le fils chéri. Elle lui raconte la fuite du fils et la mort de la mère. Cet amour perdu parce que tué, quelque part, par le fils, elle va, elle Kundry, le transmuer en amour, tout simplement, par un dernier baiser de mère et un premier baiser d’amour. Parsifal, à qui vient d’etre révélé la première grande vérité de la vie, qui perd, déjà, son innocence, se laisse aller au baiser.
Mais, justement parce que Kundry vient de le faire passer en un instant à l’état d’adulte,qu’ il éprouve la sensualité, et la connaissant, identifie immédiatement la douleur d’Amfortas: il repousse Kundry: il sait désormais, parce qu’il a souffert (“Durch Mitleid wissend” “la pitié instruit le pur…”; cette pitié il faut bien la prendre au sens littéral allemand “souffrance avec”): c’est parce qu’il vit une passion, une souffrance qu’il partage, que Parsifal comprend: lui seul peut donc comprendre le sens du Graal, et du sang versé pour la rédemption du monde. Dès cet instant, Parsifal est ailleurs et Kundry argumente dans le vide. Pire, Kundry comprend le rôle de son baiser (“So war es mein Kuss der welthellsichtig dich machte”/”ainsi c’est mon baiser qui t’a donné la clairvoyance universelle”). La dernière partie de l’acte est vraiment l’effort désespéré de Kundry de récupérer Parsifal, pour elle-même, et elle seule? pour Klingsor? Tout cela reste ambigu: tente-t-elle le tout pour le tout ou bien use t-elle de toutes les stratégies pour piéger et séduire Parsifal ? Est-elle d’abord une femme amoureuse, désire-t-elle Parsifal pour sa propore rédemption ? ou bien n’est-elle qu’une esclave de Klingsor? Est-ce là sa suprème souffrance, à elle, qui vit une recherche tragique d’expiation ou bien est-ce un piège de la stratégie de Klingsor? Elle raconte en tous cas son histoire, son destin face à Klingsor, face à Amfortas, son existence dédiée au mal et à son expiation: sincérité de femme perdue et souffrante ? Nous sommes au coeur même du débat. Parsifal n’entend rien, il sait sa mission, sa vie a une direction, le piège ne peut se refermer sur lui et le royaume de Klingsor est détruit par un signe de croix fait par la Sainte Lance récupérée, reste en scène Kundry: “du weiss, wo du mich wiederfinden kannst” / “tu sais où tu peux me retrouver”: Invitation à la rédemption au sein du royaume du Graal, lorsque – et parce que – la mission aura été accomplie.
Comment rendre la péripétie ? Comment rendre la sauvagerie? comment rendre la souffrance des êtres ? Dans cet acte qui est celui de l’impossible dialogue, mais aussi du théâtre retrouvé et de l’action, Claudio Abbado opte pour la course à l’abîme. Un rythme haletant, qui commence par la peur et le refus, une peur indiscible se lit dans le rythme avec lequel il emmène son orchestre (remarquons au passage les ressemblances dans la situation comme dans la musique avec le début du IIIème acte de Siegfried, mais là la rédemption et la victoire se lisent par l’amour humain, non par la mission mystique…Mais cette Kundry qui surgit du sommeil et qui refuse d’obéir est bien proche d’Erda….Quant à Klingsor et à la lance qu’il va perdre….) Parsifal traverse le monde de Klingsor sans danger car sans savoir. Le savoir commence lorsque Kundry l’appelle, et l’orchestre à ce moment change. Nous avions eu la peur extrème, et le jardin des plaisirs légers, nous retombons dans la souffrance, le mystère, l’obscurité: scène paroxystique s’il en est la scène Parsifal / Kundry est à la fois un récit dans sa première partie, et une seule action dans sa deuxième partie (le baiser) qui fait tout basculer dans le dialogue de la troisième partie: il s’agit désormais de convaincre Parsifal et non plus de le séduire: adieu magie, le discours reprend ses droits, puisque Parsifal est désormais en état de comprendre. Mais puisque la magie a disparu, il faut que le discours soit aussi urgent que le malheur essentiel de Kundry, d’où ces déchirures, ces contrastes saisissants, cette impossible quête qu’Abbado nous fait toucher par un orchestre époustouflant de ductilité, tantôt allégé à l’extrème, tantôt fortissimo, tantôt effleurant les mots des protagonistes, rivalisant bientôt dans l’excès. A cet orchestre il fallait peut-être une autre voix que celle de Linda Watson dans Kundry: elle s’en sort avec les honneurs, mais reste en deçà du nécessaire: face au déchaînement, il fallait une Meyer, ou sans doute une Urmana. Robert Gambill en revanche est assez surprenant, avec une voix qui n’est pas si puissante, il réussit à faire exister le personnage. Tout ici est déchirant, tout est souffrance, lutte, tragédie: nous sommes chez les hommes.
“Du weiss, wo du mich wiederfinden kannst” / “tu sais où tu peux me retrouver”, au roulement de timbale final succède le noir total, puis une explosion du public.
Les personnages sont en place, le troisième acte n’est dès lors que conséquence de ce qui précède: le royaume du Graal s’enfonce dans la déchéance depuis qu’Amfortas refuse de célébrer le rite, Titurel est mort, et le rite funèbre devrait s’accomplir, pour la dernière fois. C’est en même temps le Vendredi Saint, jour de deuil, mais la nature se réveille, c’est aussi la renaissance du Printemps…Comme on le voit, aux thèmes chrétiens s’associent dans le monde wagnérien une vision assez païenne de la nature, mais cette vision est en même temps une anticipation dramaturgique de la renaissance finale, signe du retour de Parsifal. Kundry est en scène, reconnue par un Gurnemanz bien vieilli, elle ne prononce qu’une seule parole “dienen”. Dans ce troisième acte, la parole est en même temps acte, c’est sa seule nécessité, il n’y a plus de récit, les personnages n’ont plus à dialoguer, il faut agir. Gurnemanz rappelle rapidement ce qui se passe, après quelques hésitations reconnaît Parsifal mais ne saisit pas encore ce qu’est l’enjeu de ce retour, signe qu’on reprend l’histoire exactement à la fin du premier acte: rien n’a évolué, tout s’est au contraire dissous. C’est la vision de la Lance indiquée par Parsifal qui lui donne enfin la lumière: tout s’enchaîne alors, mais de nouveau la priorité est donnée au rite: Gurnemanz, gardien des traditions, baptise et indique comment baptiser: Parsifal le sauveur a besoin de ce signe tangible pour faire partie de la communauté, pour y faire entrer à son tour Kundry. La nature participe par sa renaissance à l’événement et anticipe la dernière scène, qui commence par une formidable Verwandlungsmusik.
De ce dernier acte, Abbado fait une cérémonie funèbre: c’est ce rythme funèbre qui marquera l’ensemble de l’acte, avec un climax lors de la Verwandlungsmusik. A cette cérémonie funèbre est attachée une infinie tristesse. Même la scène finale, qui apporte la paix, reste plongée dans cette tristesse existentielle. L’enchantement du Vendredi Saint est plein de cette beauté triste, ce “Beau, ardent et triste”, cher à Baudelaire – cet admirateur de Wagner -, qui rend bouleversant l’atmosphère de l’ensemble de l’acte. Dans ce contexte, comme on l’a dit plus haut, la Verwandlungsmusik prend une allure d’apocalypse, et les cloches déchaînées s’allient aux coups de timbale, très secs, la vie et la mort, la communauté face à son destin, le reste de chaleur contre le froid absolu. Cette vision de l’absolu wagnérien est sans doute unique, réalisée de cette manière, dans les annales de l’oeuvre: Jamais on n’a entendu ça, comme ça. Comment faire désormais un Parsifal sans les cloches!?
L’atmosphère apaisée de la scène finale et sa relative rapidité laissent tout en une sorte de suspens. L’extraordinaire manière dont Abbado révèle le tissu orchestral, l’enchevêtrement des motifs et des instruments et sa paradoxale impression d’harmonie absolue donnent une impression d’ordre céleste. Si l’on se réfèreà la théorie des trois ordres pascaliens, l’ordre des corps (Kundry), l’ordre des esprits (Gurnemanz), c’est la Musique qui assume le troisième ordre du divin, aidée en celà par les voix du Tölzer Knabenchor, ces enfants qui chantent comme des Anges du Paradis: comme les anges musiciens des tableaux de Giovanni Bellini, les enfants donnent ici l’impression définitive, la projection sur un futur possible, l’ouverture, car le reste a été et reste si triste.
Noir absolu, très long silence, trente minutes de délire d’un public bouleversé.
On aura compris que ce Parsifal là ne ressemble à aucun autre, il a l’harmonie de la tristesse et la violence de la souffrance, la rugosité de la simplicité et le grandiose des cathédrales primitives. Aucune facilité, aucun laisser aller à l’esthétisme gratuit: chez Abbado, la forme est toujours au service d’une substance. Alors, les amoureux de la beauté ardente et triste, courez à Salzbourg pour Pâques, à Edimbourg, Bolzano et Lucerne cet été, mais vous, simples amateurs d’opéra, amants du faux grandiose et de la flamboyance gratuite et théâtrale, passez votre chemin, ce Parsifal n’est pas pour vous. |

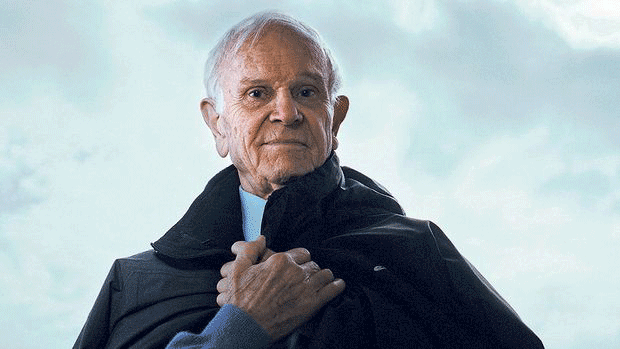


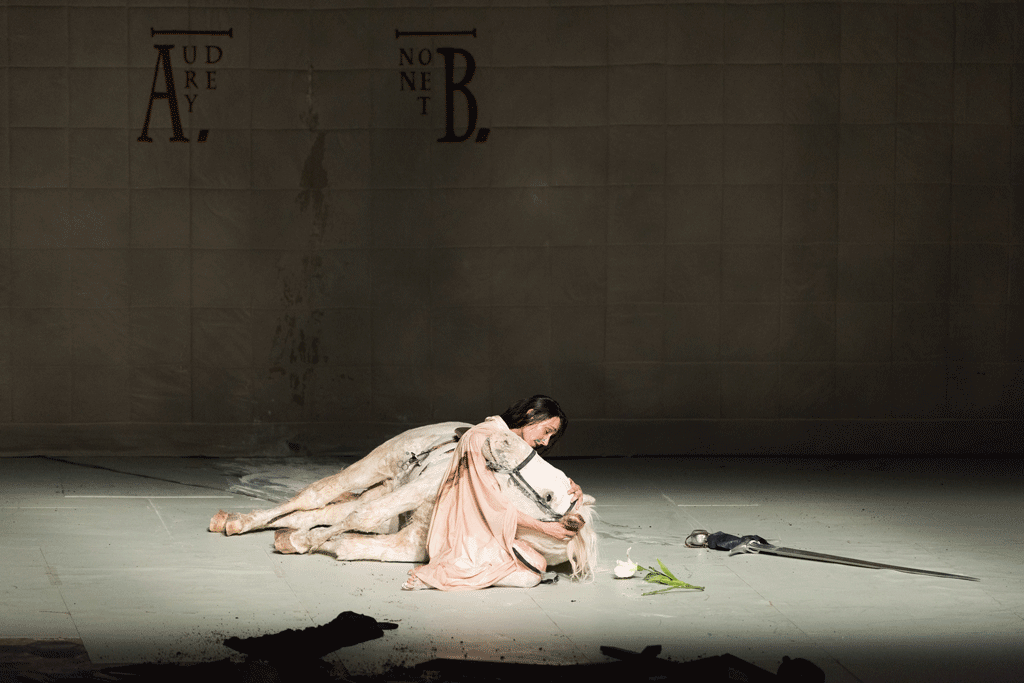



 Georges Prêtre n’est plus. Avec lui s’éteint d’un des derniers très grands chefs internationaux français qui a dû sa renommée internationale d’abord à cause de sa collaboration avec Maria Callas, et qui était aimé dans des pays aussi différents que l’Italie (adoré à la Scala) ou en Autriche (où son passage au Wiener Symphoniker comme premier chef invité qu’il est toujours resté fut marquant et apprécié). Rappelons pour mémoire qu’alors que les Wiener Philharmoniker, les plus connus donnent seulement quelques concerts à Vienne (la plupart des musiciens sont en fosse à l’opéra), la grande saison symphonique locale (au Konzerthaus) est assumée par les Wiener Symphoniker, actuellement dirigés par Philippe Jordan. Il reste tout de même le seul chef français à avoir dirigé deux fois le Concert du Nouvel an à Vienne, en 2008 et 2010.
Georges Prêtre n’est plus. Avec lui s’éteint d’un des derniers très grands chefs internationaux français qui a dû sa renommée internationale d’abord à cause de sa collaboration avec Maria Callas, et qui était aimé dans des pays aussi différents que l’Italie (adoré à la Scala) ou en Autriche (où son passage au Wiener Symphoniker comme premier chef invité qu’il est toujours resté fut marquant et apprécié). Rappelons pour mémoire qu’alors que les Wiener Philharmoniker, les plus connus donnent seulement quelques concerts à Vienne (la plupart des musiciens sont en fosse à l’opéra), la grande saison symphonique locale (au Konzerthaus) est assumée par les Wiener Symphoniker, actuellement dirigés par Philippe Jordan. Il reste tout de même le seul chef français à avoir dirigé deux fois le Concert du Nouvel an à Vienne, en 2008 et 2010.