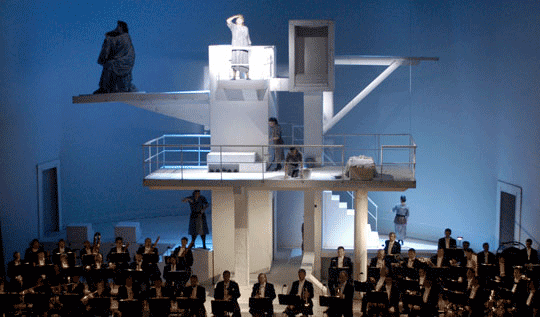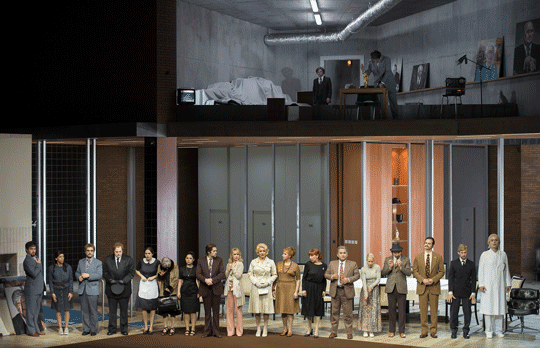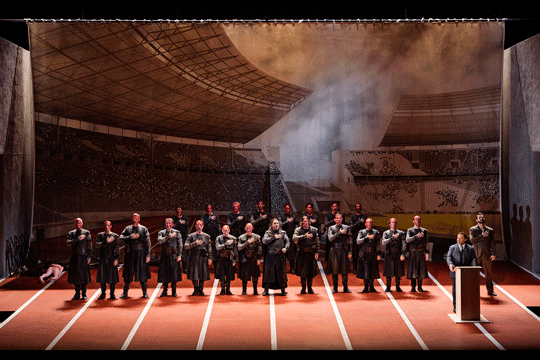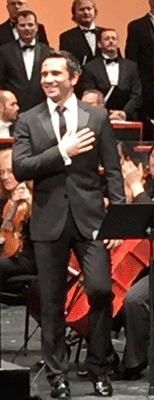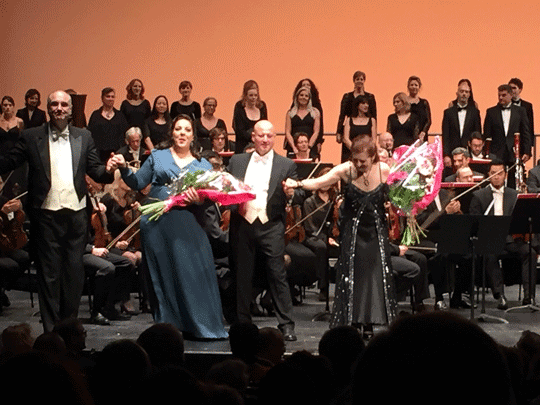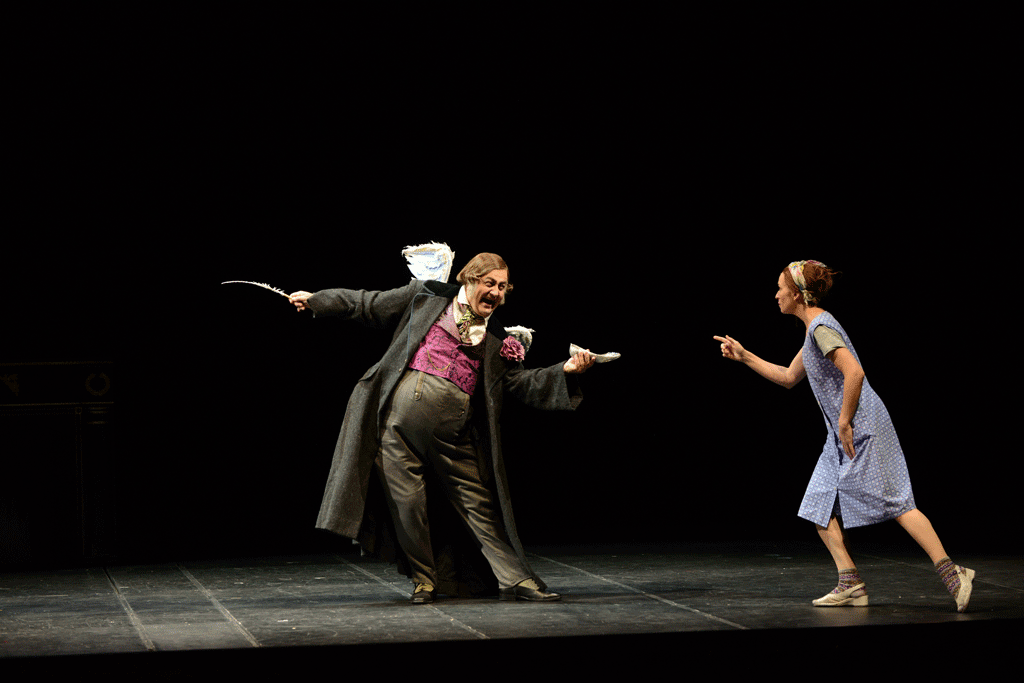
La plume enchantée
La plume et le livre
Le motif central de la magnifique production lyonnaise de La Cenerentola c’est la plume : la plume avec laquelle on écrit ou on compose, cette plume qui crée et suscite les situations, la plume qui manie comme on veut les personnages, comme la flûte ou le Glockenspiel chez Mozart arrêtent le cours des choses et agissent sur les personnages et enfin la plume qui dirige aussi l’orchestre et donc suscite la musique. C’est la plume de tous les enchantements.
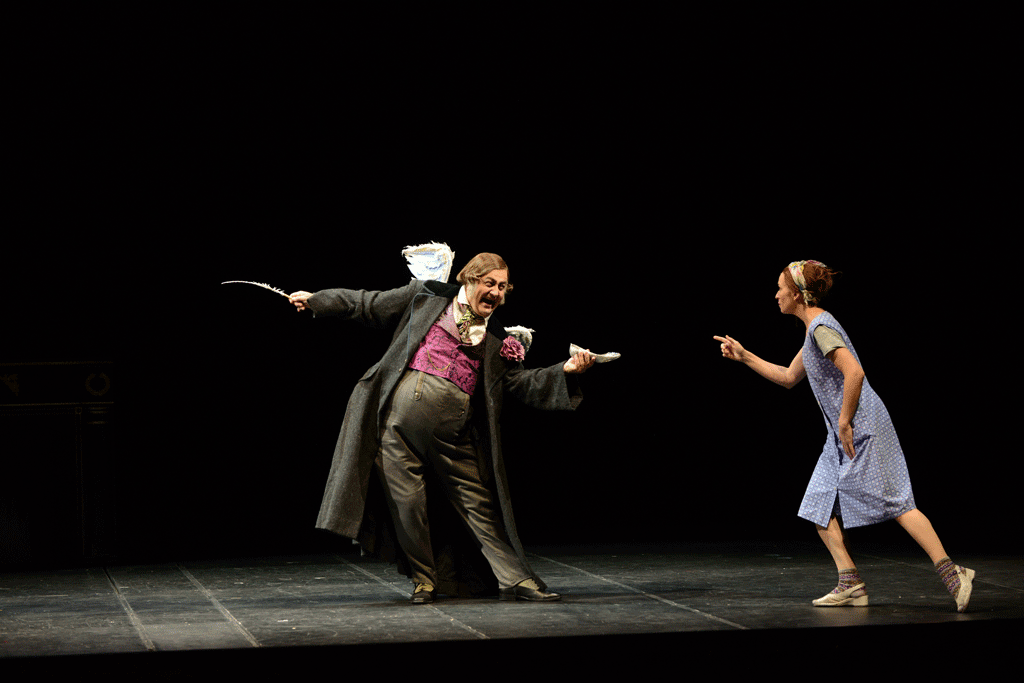
Et cette plume, Stefan Herheim la fait tenir à Rossini, véritable démiurge du spectacle, Dieu le père (il prend la place de Don Magnifico) pendant qu’Alidoro est le fils qui gère les situations sur la terre, habillé en évêque pour les grandes occasions, mais aussi en diablotin avec sa perruque légèrement cornée et son frac rouge, un diablotin qui s’arrange (l’arte di arrangiarsi), qui fait du chariot de nettoyage le carrosse de Cendrillon, qui cout la robe de mariée, bref qui manipule, comme un gentil Mephisto des familles.
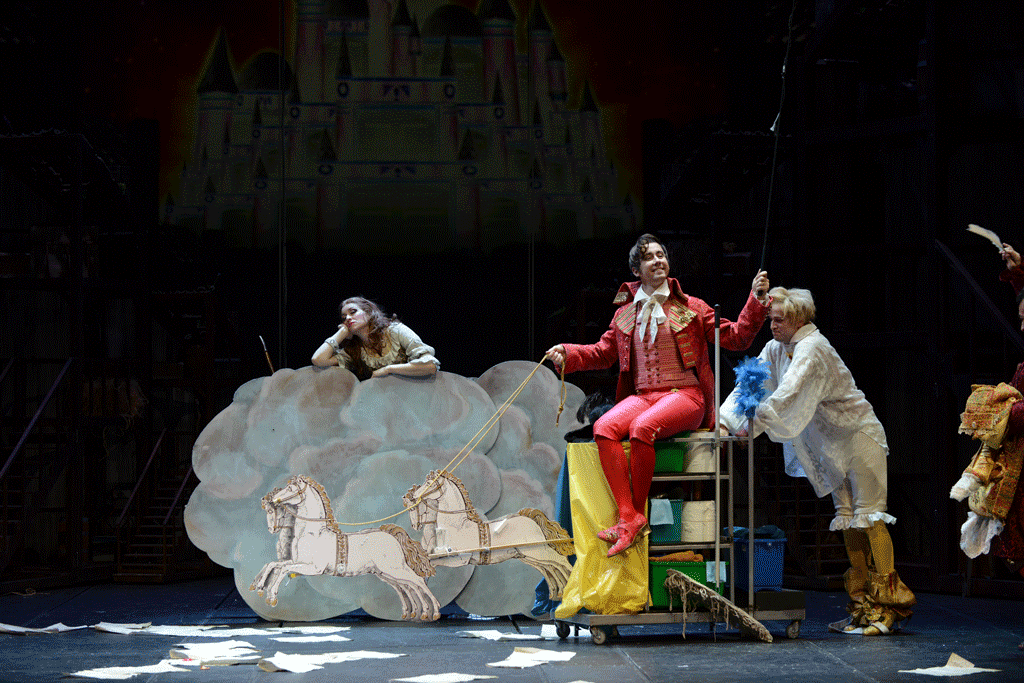
L’autre matière emblématique, c’est le papier, la feuille volante sur laquelle Rossini compose la musique de la tempête, dans une sorte d’immédiateté d’une scène où d’un côté Rossini compose et d’un autre les personnages agitent fumigènes et outils de théâtre pour nous montrer que la tempête musicale que Rossini compose est forcément tempête de théâtre, forcément tempête de représentation, et il compose avec tant de vélocité qu’on comprend pourquoi La Cenerentola a été écrite en 24 jours…
Le papier, c’est aussi le livre, motif récurrent de cette production, le livre du conte de Perrault que la jeune femme de service trouve dès le début, avant même que la musique ne se déclenche, et qu’on va aussi voir se promener de scène en scène ou même dans les décors qui, en tournant, en font voir la tranche. Le conte et la partition, le récit qui fait rêver et son adaptation musicale, voilà les bibles de ce travail.
Thème et variations
Voilà une mise en scène à tiroirs qui fourmille d’idées, et qui pour l’occasion s’est trouvée le chef Stefano Montanari, qui en a embrassé la logique et qui lie la mécanique musicale à la mécanique scénique avec une précision d’horloger, tout en participant au spectacle, en donnant de sa personne, sur scène (début de l’acte II) ou dans la fosse.
Dans la longue liste des productions réussies à Lyon, La Cenerentola sans nul doute marquera fortement les esprits : c’est une réussite de public (100% de fréquentation) et une réussite éclatante tant musicale que scénique, avec des chanteurs qui ne sont pas tous rossiniens AOC mais tous engagés et impeccables dans la mécanique voulue par chef et metteur en scène : pour les deux protagonistes, Ramiro (Cyrille Dubois) et Cenerentola (Michèle Losier), c’est même une prise de rôle.
Même si le livret de Jacopo Ferretti ne suit pas l’original de Perrault notamment dans l’histoire de la pantoufle de vair devenue ici bracelet, et par la disparition de la fée remplacée par Alidoro (Ali d’oro= les ailes d’or, comme celles de l’ange gardien qui va tout mettre en place pour exaucer le rêve de Cenerentola), rôle difficile avec un seul air mais une présence quasiment continue en scène, Herheim travaille sur le conte et la déclinaison de son univers.
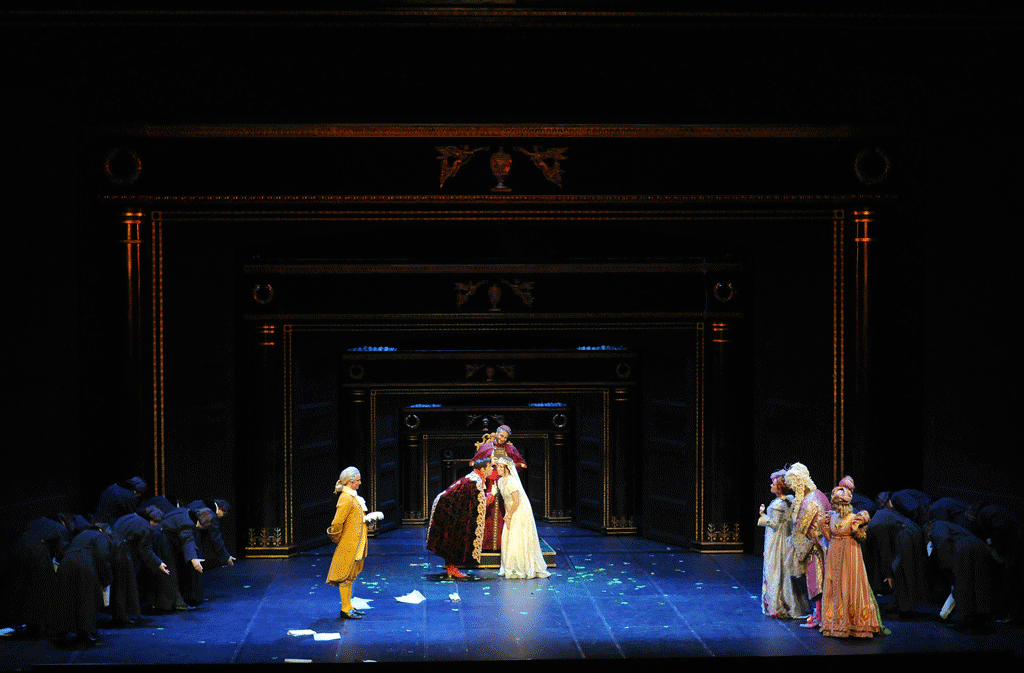
La question du conte et de ses traditions, et des références qu’il suscite est en effet la racine de ce travail. Le décor affiche d’ailleurs des cheminées en abîme, à partir du cadre du scène, ces cheminées autour desquelles on raconte les histoires, et desquelles quelquefois surgissent les génies (ou le père Noël) : voilà le lieu du récit dont Herheim fait le théâtre du conte. Dès le départ les personnages surgissent du feu de l’âtre, mais dès que surgit Cenerentola, le feu de l’âtre se transforme en cendres grises. Joli…
Stefan Herheim aime à mettre en scène le compositeur qui voit son œuvre se réaliser sur la scène comme un démiurge, il l’a fait de manière plus ou moins heureuse dans Lohengrin à la Staatsoper de Berlin, dans La Dame de Pique de Tchaïkovski à Amsterdam, mais aussi dans Die Meistersinger von Nürnberg à Salzbourg et Paris, il importe peu qu’il paraisse répéter une idée exploitée ailleurs car cette fois-ci, c’est totalement réussi et convaincant : l’idée est presque…rossinienne tant le cygne de Pesaro était facétieux et tant il est l’inventeur de d’univers diversifiés à partir des pièces de théâtre du temps, à travers les récits enchanteurs du Tasse et dans toutes ses œuvres comiques , il cambiale di matrimonio – première œuvre représentée (en 1810) – est une « farsa comica »…. Un Rossini comme deux ex machina, comme Dieu le père sur son nuage, démultiplié dans le chœur d’hommes (géré un peu comme chez Jean-Pierre Ponnelle à qui Herheim rend un hommage discret), qui se glisse dans Don Magnifico (le père, justement) et quel joli jeu que de faire que Magnifico soit Rossini, ou que Rossini soit justement magnifico).
La musique créatrice de monde
Mais si la production tournait autour de cette seule idée, ce serait bien pauvre et assez commun : au-delà de Rossini le démiurge, l’idée suggérée est celle de la musique qui crée le rêve et qui l’illustre, qui crée le monde en quelque sorte.
Le propos est très clair, le rideau s’ouvre dans le silence, avec sur scène une femme de service avec son chariot sur qui tombe du ciel (où Rossini veille) le livre de Perrault, qu’elle se met à lire mais Rossini essayant de lui faire enfiler la pantoufle de vair n’y arrive pas, alors il faut trouver autre chose et faire partir un rêve (qui est variation sur le conte, puisque pantoufle oblige, le conte ne marche pas tel que) en même temps que part la musique.
À la fin de l’opéra, la jeune femme qui a rêvé son triomphe, qui se retrouve seule et victorieuse, quand tous les personnages ont disparu, quand les cheminées se sont évaporées, quand la musique s’arrête, retourne au silence, au vide initial, et à son travail. C’est donc la musique qui crée le monde, qui suscite l’enchantement, qui crée le rêve, qui fait bonheur : voilà la leçon de ce travail qui est sur la musique et sur le théâtre, sur le moment théâtral qui est instant plus réel que la réalité.
De cette histoire de rêve qui est rêve de jeune fille, va procéder toute une série de variations sur le personnage et ses relations avec l’entourage qui tranche avec le conte et qui justifie l’appellation dramma giocoso et non opera buffa: nous ne voyons pas Cenerentola en direct, mais à travers le prisme de ce rêve et du caractère, non de Cenerentola, mais d’Angelina, la jeune fille sur qui est tombée le conte. C’est la lectrice qui recrée son monde, et Cenerentola n’est que son avatar.
Une Angelina qui adapte le conte à son caractère
C’est ainsi que le spectateur habitué à l’œuvre de Rossini a-t-il la surprise de découvrir une Angelina décidée, jamais victime ou pleurnicharde, au caractère trempé et assez manipulatrice, qui sait s’imposer, qui sait conquérir, qui sait aussi séduire, en bref un personnage qui se détache du conte pour entrer dans l’histoire d’un être, qui se construit et se projette avec un sacré caractère : au final c’est elle qui s’assoit sur le trône, qui décide, et qui aussi fait disparaître tous les personnages – compris le Prince, qui fut marchepied- pour rester seule en scène, un coup d’Etat en quelque sorte. Et Michèle Losier est intéressante dans cette perspective parce qu’elle n’a jamais chanté Rossini, et que son chant n’en a ni la tradition, ni les clichés. Aussi peut-elle chanter de cette voix décidée, aux aigus dardés et puissants, sans trop de mignardises ni trop de sucre. Elle garde une certaine acidité et c’est tout à fait cohérent avec la mise en scène, mais aussi, on le verra avec le chemin choisi par la direction musicale.
C’est aussi une Cenerentola qui ne pardonne pas, ou qui fait mine de pardonner, le pardon formel qui est dû à l’histoire et à son sous-titre (La Bontà in trionfo) mais comme on dit, elle garde visiblement un chien de sa chienne des humiliations reçues, comme Cenerentola et comme femme de service. Nous sommes donc face à une Cenerentola second degré, qui s’habille du conte mais dans une couleur qui lui est propre : c’est un destin qui n’appartient qu’à elle qu’elle construit : on est bien dans le dramma giocoso.
Du même coup, les autres personnages procèdent aussi du rêve de la jeune femme :
- Alidoro est le bon génie qui la protège, c’est en quelque sorte le fils de Dieu le père (Rossini), mais c’est aussi pour la jeune fille celui qui l’aide à manœuvrer pour vaincre, en ce sens il est un petit diable, et sa coiffure cornée déjà évoquée plus haut et son frac rouge sont ceux d’un Mephisto souriant. Ainsi Alidoro a-t-il deux identités : face à Rossini Dieu le Père et face au prince, il est l’évêque, l’homme de religion, et face à Angelina, il est le bon petit diable.
- Le père, Don Magnifico est aussi lui aussi bi-face : il est ce père ruiné qui rejette Cenerentola, comme la tradition l’exige, mais il est aussi le père ou la figure de « la paternité », en ce sens, Angelina cherche à s’en faire aimer, au moins à s’en faire regarder et cherche à le circonvenir pour qu’il lui permette d’aller au bal, et il est Rossini-le-père dont il revêt les atours, comme si Rossini se glissait dans le personnage pour faire avancer son histoire et en atténuer les effets.
- Rossini justement est partout, il est au ciel, il est ange avec ses petites ailes, il est ce Magnifico (Rossini il magnifico …) ce méchant des contes, il est aussi démultiplié à travers le chœur des servants (lointain souvenir de Ponnelle) qui sont tous des Rossini : c’est lui le démiurge, c’est lui le créateur qui crée ses créatures à son image. C’est…le compositeur et le monde de la scène n’existe que par lui ; hors de lui, hors de sa musique, tout s’écroule.
- Ramiro le Prince même n’a pas le même profil que dans les représentations traditionnelles, où il est un peu en retrait, personnage plus éthéré et moins affairé, entraîné par Dandini ou par Alidoro. Ici, le Ramiro de Herheim est, grâce à Cyrille Dubois dont sa formidable vis comica en fait un personnage plus actif, plus décidé, moins timide (il cherche très vite un baiser d’Angelina), qui remplit vraiment la scène, il chante bien sûr, mais il danse, mais il virevolte, même si à la fin, il disparaît avec les autres quand Cenerentola a atteint son but.
Les autres personnages sont plus conformes, à commencer par Dandini, auquel Nikolay Borchev donne une vraie présence, jamais vulgaire, toujours élégante, mais avec ce presque rien d’excessif qui rend la supercherie lisible, une vraie construction qui fait de Dandini le personnage de toujours, certes, mais avec quelque chose de plus qui le rendrait presque digne d’être prince.
Les deux sœurs sont parfaitement dans la tradition, bien incarnées par Clara Meloni et Katherine Aitken, les pestes habituelles, très délurées.
Ainsi Herheim dose-t-il son regard sur les personnages : ceux qui sont directement nécessaires à Cenerentola, en prise directe avec son destin, procèdent de sa propre construction et de son propre désir, et ceux restent dans la tradition pour que l’histoire se déroule quand même conformément aux désirs de Dieu le Père (Rossini).
Cenerentola et ses références
Mais on lit aussi dans ce travail un regard souriant sur la tradition de la représentation de cette histoire, où bien peu ont lu Perrault mais où tous ont vu Disney : le château au fond est évidemment celui des contes de Disney dont on voit à Disneyland, Disneyworld ou Eurodisney la reproduction, et cela suffirait à marquer l’évocation, mais certains mouvements sont pris au dessin animé ainsi que l’utilisation de la vidéo : la fumée des cheminées qui devient fleurs puis cœur lorsque le Prince et Cenerentola se rencontrent est digne de dessins animés. Mais l’univers onirique des albums pour enfants n’est pas bien loin non plus.
Autres éléments et trouvailles, les allusions à la mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle (créée au Mai Musical Florentin de 1971, puis à la Scala et à Munich en 1973) et encore visible à la Scala et à Munich, devenue la référence désormais historique de l’histoire de l’œuvre au XXe siècle, se lisent on l’a vu à la fois dans la manière de gérer le chœur, et aussi au décor, ces escaliers de bois qui semblent descendre de masures, où Ponnelle référait clairement aux livres d’images du XIXe .

Enfin Herheim installe ce Rossini dans le sillon des univers baroques, le nuage, les transformations,les costumes sont des renvois clairs à un univers que les opéras de Rossini vont clore au début des années 1820.
Les costumes d’ Esther Bialas mélangent habilement XVIIIe et XIXe, ils sont atemporels avec une touche de fantaisie dans le sens où ils renvoient à des histoires lointaines où le rêve mélange les époques pour construire sa « réalité » propre.
Ce qui frappe aussi dans ce travail, c’est une conduite d’acteurs précise, rythmée, avec un vrai tempo qui colle à la musique, et qui rend l’ensemble incroyablement vivant, parce que la distribution fait troupe, avec une vraie cohésion d’ensemble.

Une direction musicale en prise directe avec le plateau
Musicalement nous sommes aussi à la fois de l’esprit Rossinien, mais avec une approche un peu différente : Stefano Montanari impose un tempo qui accompagne la scène et colle au rythme du travail de Herheim de manière quasiment métronomique, il y a là pulsions, vivacité, et un son qui colle à l’acoustique sèche de Lyon. Montanari vient du baroque et use peu du rubato, il est toujours un peu tendu, et ici son tempo n’est pas toujours aussi rapide qu’on pourrait imaginer (par référence à d’autres travaux qu’il a dirigés à Lyon et à d’autres modèles pour Cenerentola). C’est une approche assez originale qui produit un son par moments assez « rustique », d’autre fois très lyrique, souvent très spectaculaire, comme la tempête impressionnante sans trop « casser les oreilles », avec des bois magnifiques (ce moment si cher à Rossini qu’il a pris des tempêtes baroques et qu’on retrouve ailleurs, jusqu’à Guillaume Tell…) mais qui garde toujours beaucoup de raffinements. À ce propos, signalons la manière dont il accompagne le sextuor Che sarà, che sarà/Questo è un nodo avvilupato…qui n’a jamais de lourdeur caricaturale, notamment l’insistance exagérée sur les r roulés de gruppa et raggruppa et qui est un vrai bonheur.
Signalons au passage enfin le continuo élégant de Graham Lilly.
Ce Rossini ne pétille pas forcément comme du Champagne (c’est ce qu’on dit toujours sur Rossini, notamment quand il est dirigé de manière conventionnelle) mais se boit comme un merveilleux vin de dessert, un Vin Santo par exemple. Il y a une couleur quelquefois mélancolique (la couleur des bois excellents au début de l’ouverture par exemple) et pas seulement celle de la bonne humeur, c’est un travail raffiné et très théâtral et l’orchestre de l’opéra de Lyon répond avec bonheur, sans scorie aucune, aux sollicitations du chef qui devient l’un des plus demandés en Italie dans la très riche nouvelle génération. Avec Rustioni et Montanari comme chefs de référence, l’orchestre de l’Opéra de Lyon est bien chanceux. Il est bien chanceux aussi avec un chœur très bien préparé par Barbara Kler : on ne dira jamais assez le saut de qualité de ce chœur en cinq ou six ans.
Une distribution homogène et toute engagée
La mise en scène et la direction dans leur rythme construisent l’homogénéité de la distribution, très engagée dans son ensemble et parfaitement en phase avec le style voulu.
Les deux sœurs Clorinda (Clara Meloni) et Tisbe (Katherina Aitkin) sont des figures parfaites, dans la grande tradition, vocalement, elles montrent une belle projection et une vraie présence, mais avec quelques âpretés dans l’aigu, un peu acide notamment dans les ensembles des scènes finales.
Simone Alberghini (Alidoro) est un chanteur rompu au style rossinien, ce qu’il démontre dans son unique air « Là del ciel nell’arcano profondo » où l’on reconnaît ses qualités de souplesse, d’agilité et sa précision, et de beaux graves même si le timbre semble avoir un tantinet perdu de son bronze et de son éclat. Il reste que nous sommes là dans de la belle ouvrage.
Renato Girolami, le seul qui ait participé aux représentations d’Oslo en février 2017, est un Magnifico lui aussi parfait exemple de style traditionnel de chant rossinien, avec l’expressivité voulue, avec la couleur et la dynamique voulues. La voix n’a pas l’éclat ni les aigus d’autres basses rossiniennes, mais elle en a la présence, elle en a la dynamique et l’agilité, et convient parfaitement à l’espace de l’Opéra de Lyon, d’autant que l’acteur est formidable, étourdissant de variété dans la logique de la mise en scène, changeant sans cesse d’habits et de perruques parce qu’il est aussi Rossini, le Père dans toutes ses acceptions. Une jolie performance très idiomatique.
Nikolay Borchev est Dandini, timbre chaud, présence forte, il chante avec style (dans le duo un segreto d’importanza avec Magnifico, comme il dit Son Dandini il cameriere… en imitant Figaro) , avec beaucoup d’élégance et donne au personnage une allure quelquefois plus noble qu’habituellement, notamment intéressant dans la manière dont il est renvoyé à ses chères études par son maître où discrètement est suggérée une sorte de parenté des destins entre lui et Angelina.
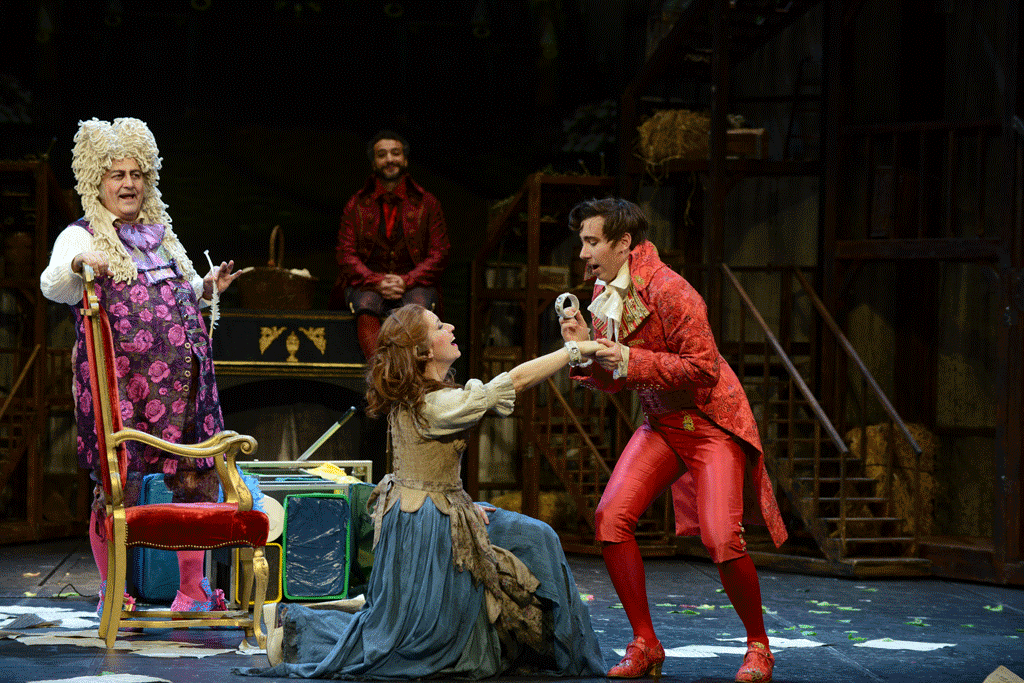
Cyrille Dubois est étonnant dans Ramiro, dont il donne une image très active et très engagée, moins timide et moins pataud que dans certaines productions. J’(avais émis des réserves sur son Belmonte, ici aucune réserve et même beaucoup d’admiration : Sa présence scénique, sa personnalité comique, sa manière d’embrasser tous les aspects de la mise en scène en font déjà un Ramiro de premier rang, un Ramiro qui existe, et ils ne sont pas légion.
Mais c’est aussi vocalement qu’il étonne. Il n’a pas cette émission nasale de certains ténors rossiniens et la voix est directe, franche, bien projetée, le texte est clair, la dynamique est là, l’agilité aussi. Il compose un Ramiro moins conventionnel, hors des schémas habituels, et surtout il est à l’aise avec les redoutables aigus en introduisant même des variations (dans si ritrovarla lo giuro, la cabalette du 2ème acte) qu’il affronte et tient sans difficulté. Un grand répertoire belcantiste s’ouvre à lui, on pense même à certains Meyerbeer pour lesquels manquent les ténors français. Magnifique.
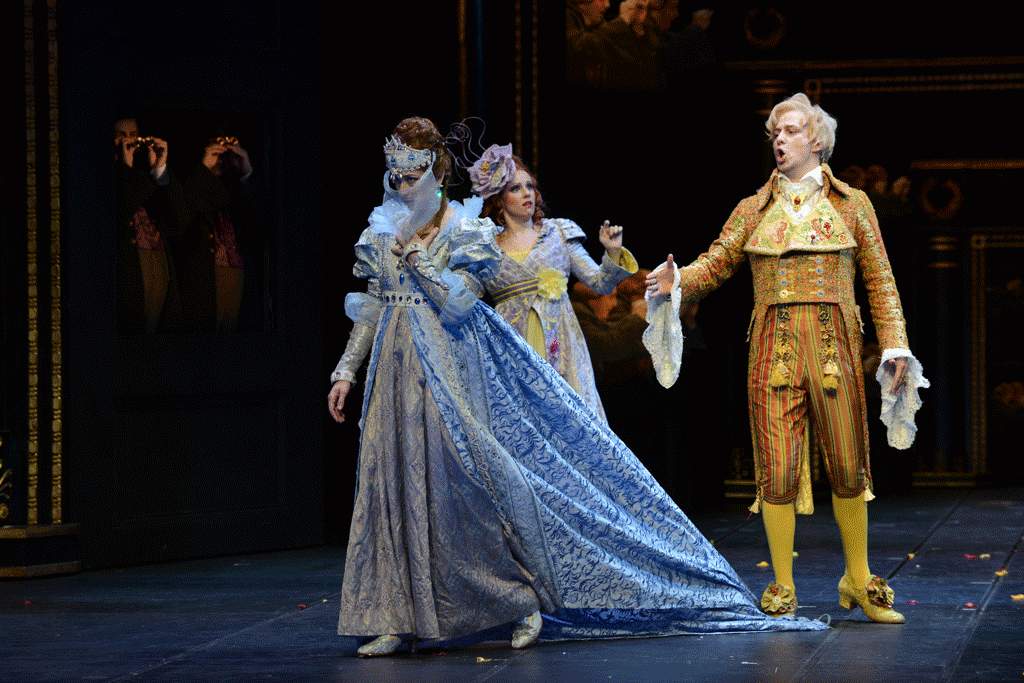
Michèle Losier affrontait aussi Cenerentola pour la première fois. Elle aussi embrasse la mise en scène et le personnage avec beaucoup d’engagement, de finesse, en en rendant les aspects émouvants mais aussi son côté « gentille peste » très original.
Elle n’a pas la poésie que d’autres ont mis dans le personnage (Von Stade ou Berganza) elle n’est pas effrontée et capable de n’importe quelle acrobatie vocale comme la Bartoli, je parle là de mes références, mais elle est une Angelina très personnelle. Le timbre est sombre, la voix est puissante, avec peut-être un petit problème d’homogénéité dans les passages quelquefois, mais elle a la fluidité, la dynamique et les agilités remarquables dans « Non più mesta… » la fameuse cabalette finale, avec-être des aigus trop dardés qui surprennent et des variations pas forcément très heureuses, il reste que sa Cenerentola, elle aussi hors des schémas habituels, passe magnifiquement.
Cependant, au-delà de sa très belle prestation, j’ai tellement aimé jadis son Ascanio de Benvenuto Cellini que je la vois peut-être mieux dans des rôles de travestis, ou de mezzos plus graves du bel canto qu’une Angelina vocalement toujours un peu sur le fil du rasoir, pour des voix plus hybrides. Affaire de goût, mais franchement, mes réserves d’enfant gâté sont menues…
En conclusion…
Au total, seuls les hérons de l’opéra, je veux dire les éternels insatisfaits, voire les pisse-froid, pourraient émettre des réserves sur ce spectacle éblouissant, qui est l’une des Cenerentola les plus réussies de tout mon parcours lyrique, toutes références confondues, même si évidemment, je garde Abbado-Berganza/Von Stade irréductible au fond de mon cœur. Mais au-delà de cette légende, je ne vois pas beaucoup de productions qui aient atteint ce degré d’homogénéité, d’intelligence, de perfection scénique et musicale.
Lyon couronne alla grande son année 2017 qui l’a hissée au sommet des salles d’opéra. mais on regrette qu’un tel spectacle n’ait pas été repris en vidéo ou par Arte pour les fêtes…
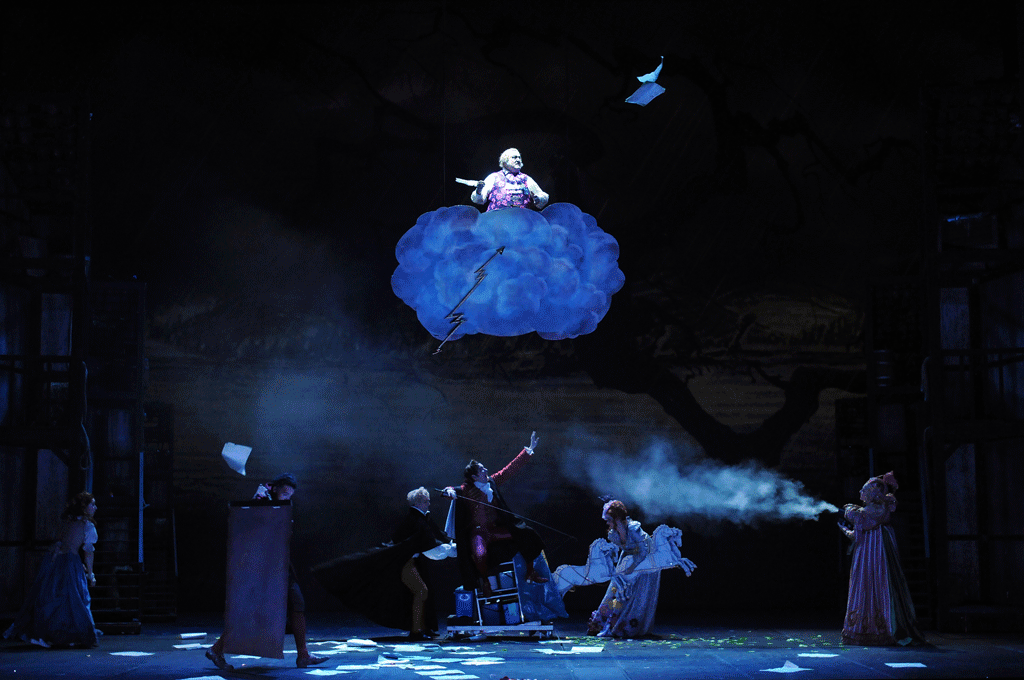







 Georges Prêtre n’est plus. Avec lui s’éteint d’un des derniers très grands chefs internationaux français qui a dû sa renommée internationale d’abord à cause de sa collaboration avec Maria Callas, et qui était aimé dans des pays aussi différents que l’Italie (adoré à la Scala) ou en Autriche (où son passage au Wiener Symphoniker comme premier chef invité qu’il est toujours resté fut marquant et apprécié). Rappelons pour mémoire qu’alors que les Wiener Philharmoniker, les plus connus donnent seulement quelques concerts à Vienne (la plupart des musiciens sont en fosse à l’opéra), la grande saison symphonique locale (au Konzerthaus) est assumée par les Wiener Symphoniker, actuellement dirigés par Philippe Jordan. Il reste tout de même le seul chef français à avoir dirigé deux fois le Concert du Nouvel an à Vienne, en 2008 et 2010.
Georges Prêtre n’est plus. Avec lui s’éteint d’un des derniers très grands chefs internationaux français qui a dû sa renommée internationale d’abord à cause de sa collaboration avec Maria Callas, et qui était aimé dans des pays aussi différents que l’Italie (adoré à la Scala) ou en Autriche (où son passage au Wiener Symphoniker comme premier chef invité qu’il est toujours resté fut marquant et apprécié). Rappelons pour mémoire qu’alors que les Wiener Philharmoniker, les plus connus donnent seulement quelques concerts à Vienne (la plupart des musiciens sont en fosse à l’opéra), la grande saison symphonique locale (au Konzerthaus) est assumée par les Wiener Symphoniker, actuellement dirigés par Philippe Jordan. Il reste tout de même le seul chef français à avoir dirigé deux fois le Concert du Nouvel an à Vienne, en 2008 et 2010.