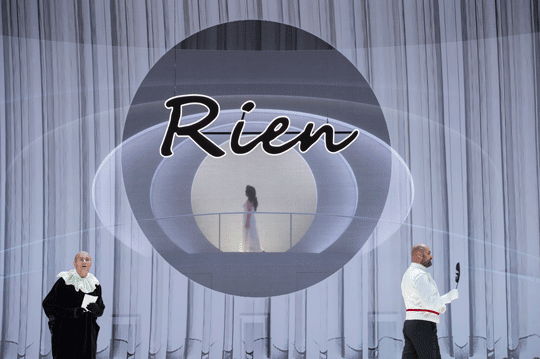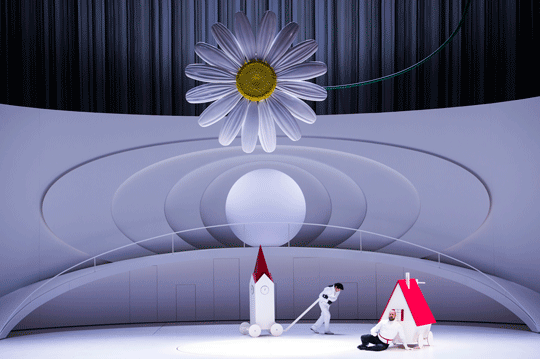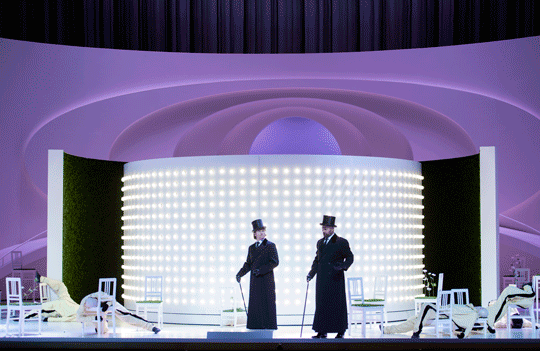(NB Les photos se réfèrent à d’autres éditions de cette production)
Cette représentation appelle de ma part quelques observations liminaires, car j’ai encore lu quelques tweets discutables sur les réseaux sociaux à son propos, et notamment sur la mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle, âgée de 37 ans, dont la Première, sous la direction de Bruno Bartoletti, remonte à décembre 1980, qui n’a cessé d’être reprise depuis.
Cela mérite quelques observations
La première est que cette production est un remake de la production de la Scala d’avril 1973 dirigée par Abbado, qui reproposait alors les opéras de Rossini dans l’édition de la Fondation Rossini de Pesaro signée Alberto Zedda qui continue de faire autorité. La production est donc âgée d’environ 44 ans, et fait partie de la trilogie bouffe Il Barbiere di Siviglia (9 décembre 1969), La Cenerentola (19 avril 1973), L’Italiana in Algeri (7 décembre 1973) signée par Jean-Pierre Ponnelle pour Claudio Abbado à la Scala (et à Salzbourg pour Il Barbiere di Siviglia que la Scala avait repris). Au contraire des deux autres œuvres La Cenerentola à la Scala n’a jamais été chantée par Teresa Berganza, mais par Lucia Valentini-Terrani et par Julia Hamari et Ann Murray pour la dernière édition dirigée par Abbado (et Pietro Wollny qui reprenait toujours les représentations qu’Abbado ne dirigeait pas) au début des années 80. Par ailleurs, cette production a été reprise plusieurs fois au début des années 2000, avec Juan Diego Florez dans Ramiro, Sonia Ganassi et Joyce Di Donato dans Angelina avec Bruno Campanella, rossinien AOC, au pupitre. Signalons aussi que l’Opéra de Paris a proposé La Cenerentola dans la version Ponnelle (celle de Munich) en 2011/2012 avec Bruno Campanella et Karine Deshayes, puis en 2012/2013 dans deux séries, l’une dirigée par Riccardo Frizza et l’autre par Riccardo Frizza et Giacomo Sagripanti avec Serena Malfi, Mariana Pizzolato (et une fois Karine Deshayes). Signalons enfin que Rolf Liebermann avait proposé en juillet 1977 une production de La Cenerentola signée Jacques Rosner, dirigée par Jesus Lopez-Cobos, avec deux distributions A et B, l’une avec Teresa Berganza, l’autre avec Frederica von Stade, rien moins.
Enfin, le DVD de la production Ponnelle signé Claudio Abbado avec la Scala est interprété par Frederica von Stade, qui ne l’a pas chanté en public sur la scène de la Scala.

L’Opéra de Munich a proposé cette production continûment et c’est ma deuxième observation : on peut critiquer le système de répertoire, peu de répétitions, pas de retour du metteur en scène, effilochage des productions originales, je reviendrai ailleurs sur la question, mais c’est lui qui permet la conservation d’une mémoire qui s’oppose aux attitudes consuméristes de certains (de type j’aime, j’aime pas, j’ai fait, je vais faire, vite passons à l’opéra suivant) et d’un fil historique que cet art doit porter : Ponnelle est un metteur en scène (français) qui des années 70 à 88 (année de sa disparition) a été une référence de la scène lyrique, notamment en Italie et dans l’aire germanophone, moins en France, mais nemo propheta in patria. Liebermann lui avait confié un Così fan tutte qui ne fut pas une de ses meilleures productions, Strasbourg en revanche lui doit une Bohème qui en son temps fut une référence.

Enfin, outre la trilogie bouffe de Rossini, on lui doit un inoubliable Tristan und Isolde à Bayreuth, dirigé par Daniel Barenboim. C’est dire que Jean-Pierre Ponnelle n’est pas un metteur en scène banal, même s’il est oublié des jeunes générations, y compris des jeunes critiques qui montrent ici leur ignorance, et le jettent avec l’eau du bain.
Certes, cette mise en scène n’a visiblement pas été retravaillée, certes, l’orchestre n’a pas eu le temps de s’y replonger, pris entre Tannhäuser et la répétition de l’Akademiekonzert des 5 et 6 juin. Mais c’est le lot des orchestres d’opéra de répertoire.
Certes également, on ne vient pas à une exécution de répertoire avec les mêmes attentes que pour une nouvelle production, préparée des années à l’avance et répétée plus d’un mois durant sinon plus.
Sans répétitions d’orchestre (ou avec le minimum…), avec peu de répétitions scéniques (tout au plus une mise en place par les assistants) la représentation ne peut avoir ni la rigueur, ni le résultat d’une production retravaillée, dans le cadre d’un Wiederaufnahme. Alors oui, aux ignorants, ce spectacle peut paraître has been, « kitschissime » et j’en passe.
L’intention de Ponnelle était de reporter cette histoire dans l’univers du conte de fées, du spectacle enfantin dans le cadre d’un de ces livres d’images qu’on a tous feuilletés dans notre jeunesse, ou même de ces livres-maquettes qui s’ouvrent et laissent apparaître une scène en carton, alors les personnages sont tous identifiables, caricatures comme héros.
Mais ce qui était insurpassable dans ces productions de Ponnelle, et qui plaisait tant à Abbado, c’était leur musicalité, c’était le réglage métronomique de chaque mouvement sur la musique, comme si la musique elle-même provoquait les mouvements, dans une sorte de théâtre-boite à musique : cette mécanique de précision n’est possible qu’avec de longues répétitions parce qu’elle exige un rythme qui colle à la volonté du chef, comme si se déclenchait un système d’automates comme dans certaines maisons de poupées (ce que rappelle un peu la structuration du décor de Ponnelle qui concevait décors et costumes dans cet esprit). Un peu comme dans le théâtre de Feydeau qui ne supporte pas les chutes de rythme et exige une diction qui aille avec toute la mécanique scénique qui se déclenche au moindre quiproquo, les opéras bouffe de Rossini, et notamment les trois dont on a parlé, ne tiennent que sur
- Une direction musicale rythmée et dynamique qui anime la scène et fait surgir les effets scéniques
- Une mise en scène calée sur la musique et qui en visualise les intentions, les jeux, les pièges.
- Une diction et un rythme de la parole qui soit en même temps musique : la parole est souvent soignée au niveau sonore, dans le rythme, dans la manière de rouler les r (ex : le sextuor du deuxième acte dans Cenerentola) ou ces cliquetis sonores des mots qui accompagnent le rythme endiablé de la musique. Rossini utilise le livret et les mots comme source d’effets musicaux que seuls des chanteurs vraiment rompus à ce répertoire peuvent se permettre.
Et Ponnelle concevait cette mécanique-là, en travaillant étroitement avec le chef, musique et scène étant étroitement solidaires : rien de plus délétère qu’un effet scénique en décalage avec la musique, ou qu’une musique cassant le rythme et la respiration de la mise en scène.
Or aujourd’hui, ni Ponnelle, ni Abbado ne sont plus de ce monde, il nous faut donc manger les merles qu’on nous présente. Or, dans ce type d’approche, aucune des mises en scènes des trente ou quarante dernières années n’est arrivée à supplanter ce travail qui collait au texte et à la musique, et qui a créé la magie rossinienne que nous connaissons aujourd’hui.
Il faut attendre des travaux comme ceux de Damiano Micchieletto qui détournent l’histoire, en la décontextualisant (La Cenerentola de MIchieletto se passe dans un bar-fast food américain) et travaillent autrement sur le geste pour trouver une nouvelle manière : il reste que l’importance du texte et du rythme dans la mise en scène collant au rythme musical est une exigence de base chez Rossini, quelle que soit l’approche.
Alors évidemment la représentation du 3 juin n’a pas réuni toutes ces exigences, parce qu’elle est une représentation de strict répertoire, sans répétition, appuyée sur la venue de Javier Camarena, ténor de référence dans ce rôle, que tous mes voisins attendaient (à ce que je percevais des discussions), et même le jeune chef Giacomo Sagripanti, une des références de la génération italienne montante, avec un temps de répétition minimal (au plus quelques heures) pouvait difficilement rendre cohérence et brillance à la musique de Rossini. Tout au plus agir sur les tempi ou sur le volume, mais sûrement pas sur la diction, sur les voix, sur la couleur de l’ensemble.
On va me répondre, dans ces conditions, à quoi bon ? je réponds qu’au moins les jeunes munichois peuvent entendre une Cenerentola régulièrement, même a minima, dans une production historique qui a marqué la fin du XXème siècle et ce n’est pas si mal. Les jeunes milanais ne peuvent en dire autant, puisque la production manque à l’appel depuis 2004 et qu’entre 1982 et 2001 elle n’a pas été reprise.
On ne peut que regretter que les grands chefs italiens d’aujourd’hui qui connaissent ce répertoire et qui l’ont exalté, que ce soit Daniele Gatti ou Riccardo Chailly, ne le dirigent plus. La Cenerentola fait partie de ces très grandes œuvres que de très grands chefs doivent continuer de porter. Or il semble qu’aujourd’hui il y ait des œuvres réservées aux jeunes chefs (Rossini, jeune Verdi, Bel canto) et des œuvres réservées aux chefs éprouvés (les « grands » Verdi ou le répertoire germanique post romantique et le XXème siècle). On a vu ce qu’un Rossini inconnu, Semiramide travaillé avec une précision minutieuse a pu produire à l’orchestre il y a quelques mois avec Michele Mariotti.
Or ici, l’orchestre en est réduit à faire ce qu’il a l’habitude de faire, avec ses tics et ses faiblesses (quelques bois pénibles à entendre, dans une partition qui ne cesse de les exalter), malgré un chef qui fait ce qu’il peut avec ce qu’on lui donne.
La critique allemande sait ces choses, et ne vient jamais aux représentations de répertoire, sauf exception (chef prestigieux, distribution d’exception, « wiederaufnahme », c’est à dire production retravaillée) dont la fonction est de faire entendre l’œuvre, dans les conditions minimales les moins médiocres possibles.
Cette longue introduction pour faire entendre une autre musique, pour essayer d’expliquer qu’il ne faut pas chercher dans ce spectacle une production d’exception, mais prendre date pour tel ou tel chanteur, et apprécier simplement ce qui est appréciable, d’une production dont on a vu jadis le prix, et dont on voit aujourd’hui les restes.
La distribution a réservé quelques très belles surprises et des confirmations.
Très belle surprise, l’Alidoro de Luca Tittoto, jeune basse entendue dans l’Ariodante d’Aix, son répertoire est plutôt tourné vers le baroque et le premier XIXème, à part quelques incursions ailleurs. Par son style, et la couleur vocale, il a montré une vraie présence scénique et musicale. Avec Camarena, c’est pour moi le plus convaincant de la soirée.
Sean Michael Plumb était Dandini, jeune chanteur américain, membre de la troupe de la Bayerische Staatsoper, il m’a frappé par son joli timbre, une voix claire et une diction très correcte. Certes, dans les parties plus rapides il éprouve encore quelques difficultés, mais c’est déjà un bon Dandini, très présent scéniquement, avec l’application et l’exactitude des chanteurs américains.
Lorenzo Regazzo était Don Magnifico. À sa décharge, je dois dire que depuis Paolo Montarsolo, je cherche encore un Magnifico qui me fasse hurler de rire et qui me fasse admirer le style inimitable de la basse bouffe. Las, je n’en ai pas encore trouvé. Pas un qui ait l’aisance en scène et l’exactitude stylistique, et la voix, qui doit être forte, au volume important.
Lorenzo Regazzo qui n’est pourtant pas si âgé, et lui qui est un bon rossinien et belcantiste a perdu le volume, les aigus, certes pas le style. Mais on l’entend mal, les notes ne sont pas tenues, le volume inexistant, seuls les gestes et le jeu passent. Dans une mise en scène où tout est plus qu’ailleurs étroitement lié, c’est dommage et c’est problématique.
Javier Camarena était Ramiro, et c’était certes attendu, mais magnifique, un port de voix unique, un volume important, une présence vocale efficace, avec l’avantage d’être une voix forte, sans les nasalités gênantes de certains ténors rossiniens, et assez « mâle », le travail sur les mezzevoci, sur les notes les plus retenues est admirable, l’aigu est facile, le suraigu exemplaire. Que demander de mieux : il est aujourd’hui dans ce répertoire avec Florez la référence et le reste. Grandissime prestation saluée par un très grand succès.
Du côté féminin, saluons la prestation des deux sœurs, très en verve, très présentes scéniquement, et vocalement très en place, Eri Nakamura et Rachael Wilson, toutes deux de la troupe locale.
Tara Erraught était Angelina. J’ai toujours apprécié cette artiste, au répertoire diversifié qui va de Janáček à Mozart, de Sesto à Flora Bervoix, et qui interprète aussi Rosina de Barbiere di Siviglia. Elle appartient toujours à la troupe de la Bayerische Staatsoper, exemple même d’une artiste sérieuse et accomplie. Dans Angelina, elle a la diction, les agilités, mais elle reste peut-être en deçà du style voulu, avec des cadences et variations surprenantes (des aigus quelquefois dardés qui ne cadrent pas avec la fluidité et l’aisance requises). Sa prestation est honnête, mais pas exceptionnelle.
Au pupitre le jeune Giacomo Sagripanti, dont c’est la première apparition dans ce théâtre, et qui dirigera en 2018 La Favorite : c’est l’une des grandes promesses de la baguette italienne. Il dirige une Cenerentola de répertoire, sans avoir répété plus de quelques heures, comme signalé plus haut. Dans ces conditions, il est difficile d’émettre une quelconque opinion. Sans nul doute il a la dynamique, il connaît ce répertoire et cela se sent, il fait ce qu’il peut pour donner de la cohérence, et de la cohésion à l’ensemble. Mais sans préparation approfondie, il est difficile de donner une couleur à l’orchestre ou de le faire travailler dans la finesse et de manière approfondie. Il garantit donc un niveau correct à la représentation, mais l’orchestre n’a pas la transparence voulue, avec son un peu trop compact. Il dirige les chanteurs, mais, c’est un exemple, le sextuor du deuxième acte tombe un peu à plat alors que c’est une des maîtres-moments de la partition. On ne peut incriminer le chef, ce sont bien les conditions de la représentation qui sont en cause. Dans un théâtre de stagione, le spectacle aurait certes été répété, mais repris tous les dix ans…sinon plus…il faut choisir.
Au total une représentation certes en ton mineur, mais qui néanmoins rend encore honneur à Ponnelle, parce que ce qui reste est encore digne, et parce que justement il n’y a rien d’indigne à aucun niveau dans cette représentation, une représentation du quotidien qui affiche néanmoins complet. Mais dans un théâtre comme Munich, on a l’impression qu’elle dépare parce que le mélomane qui se déplace le fait toujours pour des occasions d’exception. C’est une question de point de vue et d’organisation artistique.[wpsr_facebook]