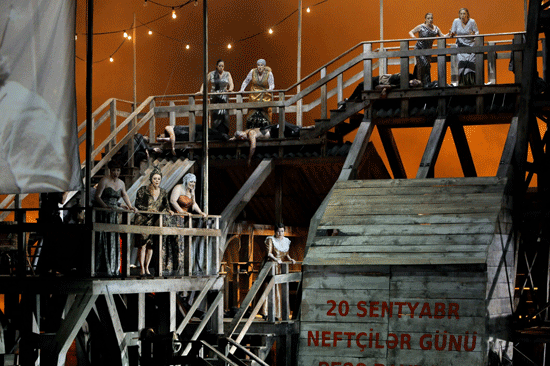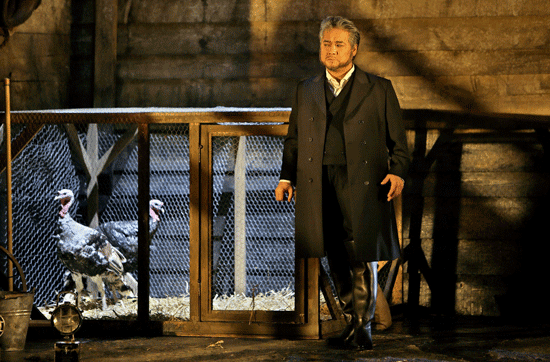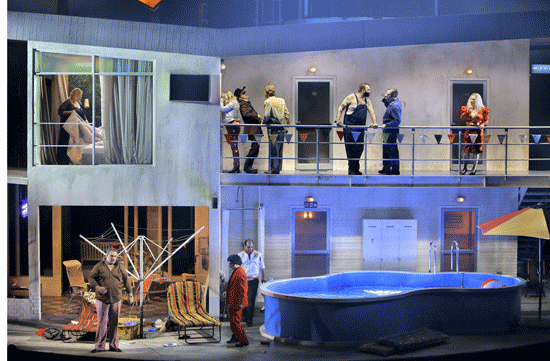Dans le Ring, Siegfried est un moment un peu particulier, peut-être pour le profane le plus difficile des quatre opéras qui composent la Tétralogie, beaucoup de longs dialogues malgré des moments fameux tels le chant de la forge, les murmures de la forêt, et certains moments du duo Siegfried/Brünnhilde, mais une dramaturgie un peu en retrait, laissant libre cours aux expressions individuelles et notamment celle de Mime.
Pour Castorf, c’est le moment le plus idéologique dans un décor des plus monumentaux jamais vus au théâtre : pour faire simple, la reconstitution du Mount Rushmore, enfin d’un Mount Rushmore sauce marxiste, puisqu’à la place des quatre présidents références des USA, sont sculptés Marx, Lénine, Staline et Mao, les références révolutionnaires.
Car c’est bien de révolution qu’il s’agit. Le pétrole continue de faire son effet, même si on quitte l’ambiance de Walküre qui lui est directement liée. Il ne faut pas penser la mise en scène comme un récit linéaire qui substituerait à l’or jaune l’or noir, et qui raconterait plus ou moins la même histoire. Quel en serait l’intérêt ?
Carstorf donne à ce Ring un sens crépusculaire : d’ailleurs, jamais les éclairages ne sont « a giorno » : brumes, aurores, lumières nocturnes alternent en des ambiances stupéfiantes de Rainer Casper, qui se modifient sans cesse et de manière à peine perceptibles. Même le fameux « Heil dir Sonne » de Brünnhilde au réveil est plus une espérance qu’une réalité. D’ailleurs, on le verra, tout est fait pour que ce réveil ne réveille pas grand-chose. C’est un crépuscule du monde, un crépuscule des idéologies, un crépuscule de la révolution, de celles qu’on prépare sans jamais les faire vraiment. Car le fameux mount Rushmore, construit en l’honneur des quatre Dalton des révolutions du XXème siècle, n’est qu’un chantier abandonné. On est loin du triomphant Rushmore américain. Le Rushmore que nous avons sous les yeux est un chantier laissé en friche, avec échafaudages, escaliers de bois et palans, dont les replis servent d’abri à la timide caravane de Mime, qui a quitté son frère dans Rheingold avec la caravane « familiale », qu’on retrouvera au Götterdämmerung, et qui va passer de main en main : Alberich, Mime, Siegfried-Brünnhilde : une ligne apparemment pas vraiment directe et pourtant…pourtant Siegfried sera éduqué beaucoup par Mime (tant de livres dans la roulotte, une éducation probablement intellectuelle et révolutionnaire version Rote Armee Fraktion) un peu par l’Oiseau (enfin, on va le voir, une éducation assez sexualisée…) et pas mal par Hagen…parce que les Runes transmises par Brünnhilde le temps d’une nuit d’amour, il aura tôt fait de les oublier avec le philtre de Hagen…; on a toujours tendance à classer Siegfried dans les héros positifs, et tous les signes de cette mise en scène nous indiquent que c’est plutôt un héros négatif (qu’il soit naïf, berné ou non), tout simplement parce qu’il n’est qu’un outil : outil de Wotan, outil de Mime, outil d’Alberich plus tard au travers de Hagen, il est le bras armé des autres, le Gavrilo Princip du moment.
Ne nous laissons pas non plus berner par les apparences, si d’un côté on a un Mount Rushmore à l’envers, et inachevé, la symphonie inachevée des révolutions perverties l’est par le pétrole, toujours présent, même de manière fugace :

la firme Minol (spécialisée en produits issus du pétrole, voir leur site https://www.minol.de et fondée par l’Allemagne de l’Est en 1949 avec un nom issu de Mineralöl-dont la traduction exacte en français est petr+ol=pétrole- et oleum, l’huile en latin) éclaire de son néon agressif la tranche de ce décor bi-face, une face Rush-mort, et une face Berlin-Minol. Oui, Berlin Est, comme symbole de l’idéologie dévoyée, de la révolution volée, des enjeux planétaires de la puissance : d’ailleurs ce Berlin-là est adossé à un mur gigantesque, qui cache l’autre face du décor…n’oublions pas le mur…
Derrière le mur, une poste : parce que la poste est l’instrument du pouvoir, de la Stasi, qui fouille dans le courrier : sacs de courriers ouverts et jetés en pâture, Siegfried au passage consultant des registres, personnages louches observant des dossiers, des feuilles. On n’envoie pas de lettres de cette poste, on les reçoit, on les rassemble et sans doute on les ouvre et on les perd. Et puis, il y a EXANDERPLATZ (pour Alexanderplatz) station de métro (U-Bahn) au pied de la tour de télévision gigantesque qui domine la partie est de Berlin, avec à ses pieds l’horloge URANIA, l’horloge universelle (qui dans cette mise en scène tourne très vite : toujours l’élasticité du temps…), et dans ce Berlin-là il y aussi des personnages, comme sortis d’une revue de l’Admiral Palast : l’Oiseau est une meneuse de revue, assez gênée d’ailleurs pour se mouvoir (jeu désopilant de poursuite impossible, Siegfried montant et descendant par des escaliers étroits interdits à l’Oiseau emprunté avec son énorme costume et ses ailes de géant). Personnages sortis d’un mythologie urbaine berlinoise, pauvre Biergarten qui va être témoin d’une scène de ménage entre Erda et Wotan, puis d’un triste duo d’amour( ?) Brünnhilde-Siegfried…La bière est triste hélas…

Berlin comme emblème des perversions idéologiques, de la course au pétrole : l’Alexanderplatz était justement jusqu’en 1968 le siège de Minol – voir plus haut-, avec sa Minolhaus…

le pétrole est bien là, installé dans les symboles de la Berlin d’avant…
Ah, j’oubliais, un détail qui fera plaisir aux français : Minol, aujourd’hui appartient à Total.
Ainsi donc, l’intrigue se déroule dans une linéarité troublée. On se souvient que Tankred Dorst dans sa malheureuse production du Ring précédente avait eu la (bonne) idée de montrer des Dieux comme en transparence derrière un monde qui vivait sa vie au quotidien : les Dieux sont parmi nous. Mais c’était assez mal rendu, et peu clair. Ici, c’est le monde qui défile derrière les Dieux et les héros qui gèrent tant bien que mal leur vie agitée. Un monde qui se transforme au fur et à mesure que cette vie agitée génère des catastrophes et des ruines. Un monde qui tourne : la tournette n’est pas seulement un artifice permettant de construire un décor qui est espace, qui est passage (il y a toujours dans le décor un point de passage d’une face à l’autre, ici c’est la Poste…tiens tiens…point de passage…cela ne vous rappelle-t-il rien à Berlin ?), qui est cadre, qui est ambiance, la tournette organise le changement, l’évolution temporelle, spatiale, l’évolution des caractères, la tournette tourne sur elle même, mais en même temps on avance en une sorte de progression spiralaire.
Au premier acte, Castorf pose Mime (Burkhard Ulrich, très beau personnage) et Siegfried, dans leurs relations conflictuelles. Mime, digne frère de celui qui a renoncé à l’amour ne peut générer que haine et mépris. Mais Mime est dans ce travail plus un intellectuel qu’un habile forgeron, il se forge…des idées et se prépare en secret à faire exploser le monde: d’ailleurs quand le Wanderer arrive, inquisiteur en lunettes noires, il cache vite l’intérieur de la roulotte avec des journaux…
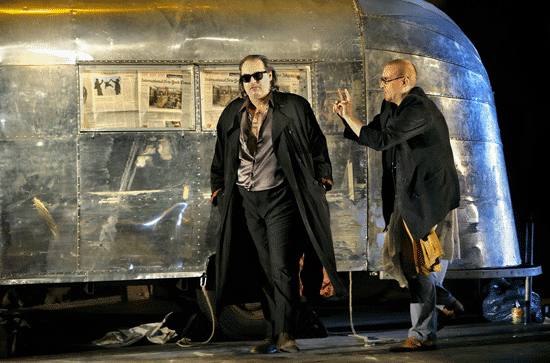
Et on peut supposer que Siegfried en a aussi été imprégné. Mais Siegfried n’est ni obéissant, ni soumis, il entre en scène tenant en laisse non un ours, comme dans tout Ring qui se respecte, mais un homme, l’éternel Patric Seibert, barman-victime dans l’Or du Rhin, victime dans Walküre, et victime dans Siegfried, mais une victime qui serait consentante, le bon chien-chien à Siegfried qui a su au moins se ménager un esclave. Seibert, c’est l’éternelle victime, l’Untermensch nietzschéen (on ne compte plus les coups qu’il prend), la figure de celui qui est programmé pour perdre, le peuple quoi. Mais Siegfried est en opposition à l’idéologue Mime, comme s’il avait confusément compris que l’idéologie ne vaut rien non plus. Même s’il forge Notung (déjà forgée, de menus ajustements suffisent) comme d’habitude, il ouvre surtout des caisses remplies d’armes : on n’est pas chez les bandes des bas quartiers, on est, sous les figures faussement tutélaires gravées dans le granit, chez des terroristes en puissance. Siegfried est un outil préparé pour tuer, un outil qui va monter sur le visage de Staline pour lui enfoncer l’œil à coup de marteau et une projection du visage de Wotan couvrira Staline à l’acte III. Wotan n’est pas Staline.
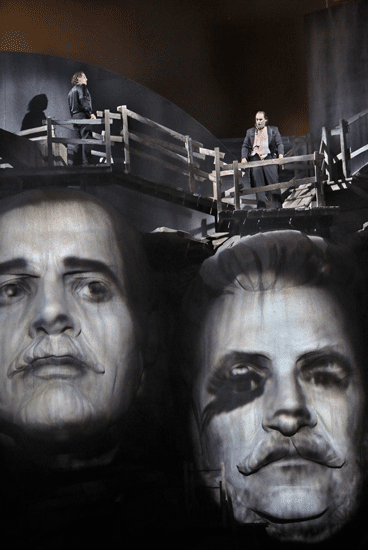
Wotan prend momentanément le visage de Staline parce que la situation le demande. Siegfried au 2ème acte tue Fafner (un Fafner qui veille au grain au fond de la Poste, qui dort au fond du métro, entouré d’enveloppes et de filles faciles) à la Kalachnikov, manière Rote Armee Fraktion, en un bruit à ce point assourdissant qu’il faut un avertissement aux spectateurs à l’entrée de la salle et sur les feuilles de distribution. Siegfried est un violent, un fils de la révolte et de la violence, un marginal dressé contre le monde, élevé par ceux-là même qui en veulent la fin. Il tuera Mime d’une manière incroyablement sauvage, comme il a été dressé.
Le premier acte se termine par l’esclave-ours tenu en laisse qui revêtu d’un voile de mariée violemment ironique se jette avec amour sur Siegfried. Ce dernier devenu héros (il a forgé Notung) et donc objet de l’amour de tous, comme dans les contes, il l’est aussi de l’ours-esclave qui veut sa part de rêve. Mais après cette fin un peu folle et sarcastique, le second acte commence non dans la forêt, mais devant la roulotte désertée autour de laquelle tournent les deux vautours : Alberich et Wotan, et continue devant la poste, où se réveille Fafner, entouré de ses minettes avides (Fafner assis sur son or…) qui va rentrer en disant « laissez moi dormir », mais Castorf, probablement joue sur le double sens en allemand de schlafen qui indique les deux types d’activités possibles dans un lit…la forêt, c’est la forêt de béton et de lumière de Berlin, c’est les tristes vitrines de l’est, c’est la poste, c’est les corbeilles à ordures où Siegfried cherche des bouts de bois pour imiter l’oiseau, c’est la forêt métaphorique et plus inquiétante que la forêt profonde des légendes. Et Siegfried se bat peu contre Fafner déjà homme, et pas Wurm (d’ailleurs, pas de dragon…mais un autre reptilien…) et il l’assassine, simplement, à la Kalachnikov, : devant la poste, un crocodile étendu…tout est dit…avec la lourdeur provocatrice voulue, pas de gants à prendre avec le capital…

Quant à l’Oiseau, je l’ai déjà évoqué, habillé en meneuse de revue berlinoise, plumes envahissantes et paillettes, elle est une femme qui cherche à séduire le jeune Siegfried, peu impressionné, et tout cela se terminera par une étreinte violente au rythme des dernières mesures. Siegfried pas trop pressé de rejoindre Brünnhilde honore d’abord l’Oiseau, et cette activité commune à l’humanité s’appelle en allemand vögeln (de Vogel, oiseau…) qu’on pourrait traduire par oiseler, gentille métonymie…Carstorf, évidemment s’amuse comme un fou à ironiser (il cite abondamment dans le programme le livre de Jankelevitch sur l’ironie) sur l’histoire, à la gauchir sans la trahir dans un monde sans morale et sans amour, oiseler ne serait-elle pas la seule activité qui reste possible?
Le troisième acte est à ce titre assez terrible : l’entrevue avec Erda, (qu’on avait quitté dans Rheingold en superbe maquerelle de luxe), se déroule comme une scène de ménage ou de rupture. Le vieux couple Erda/Wotan n’arrive plus à communiquer.

Erda est d’abord vue en vidéo se préparant à sortir pendant que Wotan l’appelle, elle se maquille, choisit sa perruque du jour pour l’occasion et sa tenue (pendant que son assistante lui pique des produits de maquillage): les Dieux doivent apparaître sur le théâtre du monde en costume choisi, comme un acteur qui intervient à la juste place dans le juste appareil. Très belle femme (Nadine Weissmann), elle sort de son couloir comme on rentre en scène, sur la terrasse, descendant un long escalier comme elle le ferait aux Folies Bergère (toujours cette idée sous jacente de revue) et vient trouver un Wotan un peu fatigué, débraillé, et surtout affamé : ils s’installent à une table de Biergarten, choisissent le menu sur la carte, les vins sont l’occasion d’une scène à la Charlot, orchestrée par le garçon (toujours le barman esclave…), qui verse en veux-tu en voilà toutes sortes de vins, pendant que Wotan mange un énorme saladier rempli de pâtes…(on est chez les dieux, et les repas divins sont olympiques, ou walhallesques), mais le dialogue autour d’une bonne table ne passe pas, Erda finit pas quitter violemment les lieux.
Elle réapparaît très vite, avec une autre perruque d’un blond platiné et putanesque. Et finalement se réconcilie avec Wotan en lui faisant une petite gâterie…Wotan lui avait lancé hinab (descends !), elle descend en effet, mais pas tout à fait dans les profondeurs de la terre…
J’imagine l’inquiétude du lecteur. Et je tiens à le rassurer. Rien de particulièrement insensé : dans toutes les mythologies, les Dieux passent leur temps en querelles et en oiselage ; Castorf ne fait que traduire en version d’aujourd’hui ce que nous acceptons parfaitement dans l’Iliade, l’Odyssée ou les Métamorphoses d’Ovide.
Et de plus la vérité de la relation Erda/Wotan est rendue avec crudité certes, mais justesse, il y a dans toute cette scène entre eux deux à la fois rancœur, familiarité, souvenirs.
Même vérité dans la scène avec Siegfried qui suit. Inutile de chercher des flammes et un rocher, il n’y en a pas. Il y a d’abord une course poursuite sur tout le décor (Mount Rushmore en largeur et en hauteur) entre Siegfried et Wotan, que Siegfried voudrait éviter, parce que Wotan ne l’intéresse pas. L’inverse n’étant pas vrai : Wotan le cherche, comme on dit et finit par le trouver : extraordinaire ballet d’une grande vérité psychologique, cette scène étant pour Wotan une vérification obligée que Siegfried ne peut être arrêté, et qu’il est donc bien programmé : ici c’est Wotan qui provoque et non Siegfried ; belle trouvaille.

Et puis enfin, le réveil et le duo d’amour : un réveil étrange, Brünnhilde étant enfermée sous une bâche de plastique (tiens, un dérivé du pétrole…) dormant sur un tas de reliques de chasse laissées là (bois de cerf), comme sur un tas d’ordures dont elle serait le joyau. Accompagnant ce réveil, une projection vidéo, un homme marche en forêt, trouve un cheval (Grane ?), puis un corps de femme ensanglanté, il plonge sa tête dans le sang, comme Siegfried dans le sang du Dragon…Pas d’ouverture vers le bonheur, mais vers le rite (vaudou ? on le verra au Götterdämmerung). Sur scène, Siegfried n’a pas vraiment peur devant ce corps de femme (il a connu l’Oiseau et sait désormais oiseler), et ce duo va se dérouler dans une ambiance glaciale, sinon glaçante : amateurs de romantisme passez votre chemin. Castorf va détruire pièce à pièce tout ce qui rendrait une émotion vraie. Et Petrenko le suit, rythmes lents, pas de pathos une Verfremdung (distanciation) totale, absolue.
L’essentiel de la scène se déroule autour des restes du repas de Erda/Wotan (tiens, encore une histoire de couple), et chacun d’un côté de la table, raides comme deux passe-lacets, elle méditant sur la perte de son savoir et de sa virginité, et lui pensant carrément à autre chose : il s’ennuie déjà, va voir des dossiers à la poste, en arrière plan : pas étonnant que dès le début du Götterdämmerung, il n’ait qu’une idée, celle de partir…
Comme malgré tout le désir monte (chez elle, pas chez lui : Siegfried dit son désir, mais distraitement, vulgairement) elle se rapproche de lui et ce sont les premiers accords du final…mais arrivent à ce moment là pour troubler la fête une famille de crocodiles. On en avait déjà vu un auprès de Fafner, qui effrayait les jeunes filles. On voit cette fois une famille. Dans le bestiaire de Castorf, il y avait eu les dindons dans Walküre, couple victime prémonitoire métaphore de Siegmund/Sieglinde. La famille de crocodiles contient évidemment le couple, mais aussi le petit rejeton. Image de menace, certes, mais surtout image traditionnelle du capitalisme envahissant, image de bande dessinée ou de vignette journalistique qui montre que la vraie menace est là : Siegfried aurait presque peur, mais d’une part Brünnhilde donne un parasol au crocodile le plus proche, qu’il avale (rires dans la salle), et Siegfried lui lance des pommes…Et notre crocodile croque la pomme…
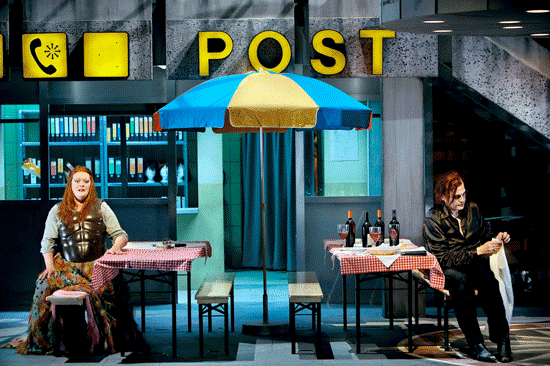
Voilà un duo d’amour bien perturbé, totalement ailleurs, et ce n’est pas fini. En arrière plan, l’Oiseau (débarrassé de ses énormes plumes, et tout de blanc léger vêtu) entre en scène et s’amuse avec l’un des deux crocodiles adultes, du genre Titi et Gros Minet : il lui ouvre la gueule, regarde dedans, et l’autre l’avale, il ne reste plus apparentes que les jambes fort accortes de dame oiseau et Siegfried, tout en chantant l’amour avec Brünnhilde (on est au final de la scène, l’orchestre est lancé à toute volée…), se précipite pour sortir l’Oiseau de la gueule du reptile, tombe dans les bras de l’Oiseau et les deux se mettraient à oiseler sur le champ si Brünnhilde, vêtue en mariée, n’arrivait pour l’arracher des bras plumés et l’emmener manu militari, préfiguration de la scène de mariage Gudrune/Siegfried du Götterdämmerung. Rideau .
On l’aura compris, le rideau à peine tombé que les huées pleuvent, les crocodiles ont eu raison d’une bonne frange de la salle.
Leçon de tout cela : un Siegfried totalement dénué d’humanité, dénué de calcul, dénué même de regard. Un animal sauvageon, pur outil, ou pur produit du monde. Terroriste, certes, mais par occasion plus que conviction. Portant l’anneau, il est l’objet de la convoitise et de la menace (les crocodiles), il vit au jour le jour, au gré de telle ou telle rencontre, insouciant, parfaitement imperméable au sentiment, mais pas au désir : le Siegfried de Castorf, depuis l’Oiseau et jusqu’au filles du Rhin, n’arrêtera pas de lutiner qui passe une sorte de Wanderer du sexe. Elevé par Mime, programmé par Wotan qui ne vaut pas mieux, éduqué par l’Oiseau qui en profite, Siegfried n’est qu’un produit du mal, le neveu (et bientôt fiancé) de celle qui faisait exploser au TNT les champs de pétrole (il en a appris quelque chose…) : dans le monde post idéologique et post pétrolifère, il n’y plus de place que pour l’humain en ruines. On commence à comprendre que le Ring de Carstorf est nihiliste, il ne laisse aucune échappatoire. Le pétrole a fait de nous des bêtes sauvages : on l’entend bien aux cris émergeant de la salle à la chute du rideau…
Cette profusion de détails, d’idées enchâssées les unes aux autres, de propositions surprenantes, apparaissant logiques, ou saugrenues, ou incompréhensibles, mélange de clarté et de brume, est paradoxalement accompagnée dans la fosse par un Petrenko plus clair que jamais. Son premier acte, à la fois tendu, très sombre (c’est vraiment la couleur qu’il va donner à toute l’œuvre), est incroyablement lisible, suit les données du texte : la scène des énigmes avec Mime est totalement fascinante, on est presque contraint de fermer les yeux pour se rendre compte au mépris de la Gesamtkunswerk.
Les murmures de la forêt, en vraie sourdine, avec des cordes à se damner, emportent, même si les appels au cor sont complètement ratés par le cor solo (et pas seulement au deuxième acte) ; il y a dans cette direction une cohérence de musique de film qui colle à l’image d’une manière totale, dérangeante au besoin. Le duo final est pris avec lenteur, avec distance, comme jamais on ne l’a entendu, mais vrai comme jamais, vrai comme la vérité scénique qui nous est donnée. Le spectateur ne peut faire abstraction de l’un pour se concentrer sur l’autre : les deux vont tellement ensemble, de conserve, de complicité, de justesse : la fosse est tantôt distante, tantôt grandiose, tantôt ironique, mais toujours présente, toujours à l’affût, toujours capable de dire à l’oreille ce que nous voyons. Kirill Petrenko est toujours soucieux de l’effet à produire, du sens à donner, il s’est plongé dans les partitions des archives Richard Wagner, comparant les observations des partitions originales du Ring 1876, effectuant un travail approfondi de redécouverte musicale, alors que le Ring est ce qui l’a lancé dans la carrière lorsque tout jeune encore, il était GMD (lointain successeur de Hans von Bülow) dans le théâtre historique de Meiningen, dont la Hofkapelle fut la base de l’orchestre du festival de Bayreuth en 1876.
Chef d’œuvre de dynamique et d’énergie, mais aussi de retenue, d’adaptation à la scène, de construction sonore permettant aux voix de ne jamais être couvertes, le travail de Kirill Petrenko est pour moi la meilleure direction musicale du Ring depuis longtemps, à la fois par sa simplicité apparente, par le rendu systématique de chaque note, de chaque phrase, de chaque moment, par l’absence d’effet de mise en son et par une sorte d’exécution de toute la partition, mais rien que la partition, sans interférences.
Une fois de plus, les problèmes réels viennent des chanteurs et d’une distribution, certes honorable, mais moyenne au regard du lieu…
Même si l’on sait que Bayreuth a toujours préféré les chanteurs jeunes et moins connus que les valeurs consacrées, sauf à de rares exceptions (je rappelle que bien des « gloires de Bayreuth » étaient des débutants qui ont fait leur sillon sur la colline verte), le Festival a eu quelquefois la main plus heureuse, la question du chant se pose, fortement.
Leur performance d’acteur n’est pas en cause, ils sont tous des chanteurs-acteurs immergés dans le jeu, attentifs à la mise en scène, engagés : visiblement, le travail avec Castorf a fonctionné, à la différence de Chéreau au début, qui avait eu des difficultés avec certains (Karl Ridderbusch et René Kollo notamment). Mais vocalement, les choses sont pour le moins contrastées. Mirella Hagen en Oiseau (Waldvogel) a une voix projetée certes, mais avec de désagréables stridences, Alberich a une voix claire, lancée plus que projetée, sans un sens de la parole et de la diction accompli, et sans la profondeur voulue, Oleg Bryjak ne fera pas partie des Alberich de référence. Le Mime de Burkhard Ulrich est plutôt honorable. Certes, Castorf n’en fait pas un clown comme on le voit habituellement, c’est plutôt un intellectuel un peu lâche, mais qui n’en fait point trop. Pas d’effets sonores, point de voix nasillarde, point de jeux sur les aigus, une interprétation assez retenue, mais qui ne fait pas de Burkhard Ulrich un des Mime qui vous emporte une salle.
Wolfgang Koch reste ce Wanderer contenu, un peu introverti, très attentif au texte, très soucieux de la diction (son premier acte est magnifique). Dans la ligne de ce qu’on a entendu dans les épisodes précédents, c’est un Wotan non spectaculaire, mais homogène, mais intelligent, mais accompli.
Catherine Foster n’est pas ma Brünnhilde de prédilection, trop d’incertitudes dans le medium et dans le grave, un vibrato excessif pour mon goût, mais il faut lui reconnaître des aigus larges, sûrs, tenus, un bel appui sur le souffle et un engagement réel dans le jeu. C’est cependant une Brünnhilde sans aura, sans rien d’exceptionnel, sans expression du sublime. Est-ce voulu par Castorf ? Sans doute, rien n’est fait pour accentuer le sens du sublime dans toutes ses actions, mais la personnalité scénique, malgré un jeu bien en place, reste terne. Elle joue : elle n’est pas.
Et Lance Ryan ? On pourrait disserter à l’infini sur le rôle de Siegfried et ses exigences. Siegfried, il l’est en scène, merveilleusement engagé, juste jusque dans les moindres expressions, antipathique jusqu’au bout des ongles. Et dans ce cas la voix le sert bien, car elle n’a rien de séduisant. Il a les aigus, il travaille même les modulations, la couleur. Et disons que le Siegfried de Siegfried lui va, au moins dans les deux premiers actes. Il fatigue au troisième, le plus lyrique, celui qui exigerait une voix plus veloutée. La voix au contraire se raidit, le timbre se nasalise encore plus que de raison, devenant de plus en plus désagréable, sauer (aigre). C’est un Siegfried scéniquement hors pair mais vocalement difficile qui risque de devenir bientôt difficilement audible. J’ai suivi ce chanteur depuis que je l’ai entendu à Karlsruhe dans le Ring intéressant de Denis Krief. Il était jeune, et alors vocalement prodigieux. Il l’était encore à Valence dans le Ring Mehta/Fura dels Baus, avec une Jennifer Wilson rayonnante. A-t-il trop chanté le rôle ? je ne sais, en tous cas l’impression est celle d’une voix au crépuscule. Et l’en suis très triste, car c’est un véritable artiste.
En conclusion, ce travail, certes discutable, mais ouvert et disponible à la discussion, prodigieux d’intelligence et de profondeur à tous niveaux, montre que Bayreuth est toujours l’occasion pour le spectateur de questionner, de discuter passionnément, et de prolonger ensuite le plaisir du spectacle par le plaisir de l’étude.
Il n’y a aucun sens à aller à Bayreuth pour consommer de l’opéra…et puis s’en vont. Impossible de consommer Castorf ou Petrenko car alors la pilule sera bien amère : pareil Ring se prépare, se déguste, se digère (ou pas…), et en tous cas se pense sans cesse. Voilà pourquoi Bayreuth est unique.
[wpsr_facebook]