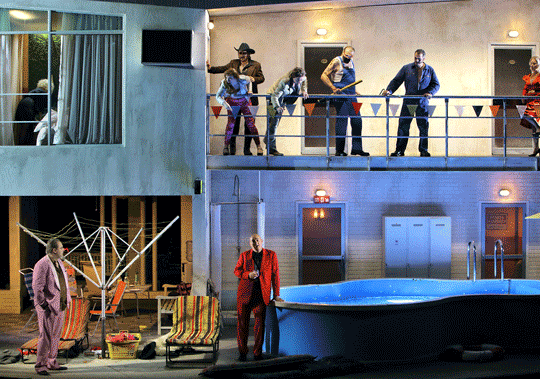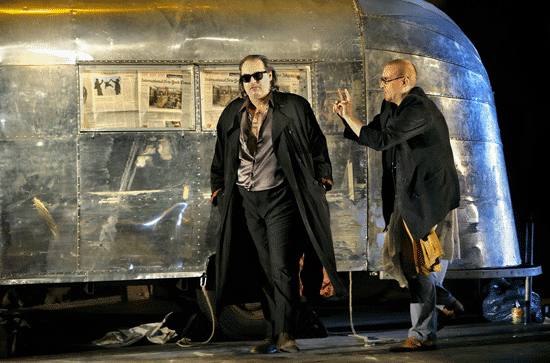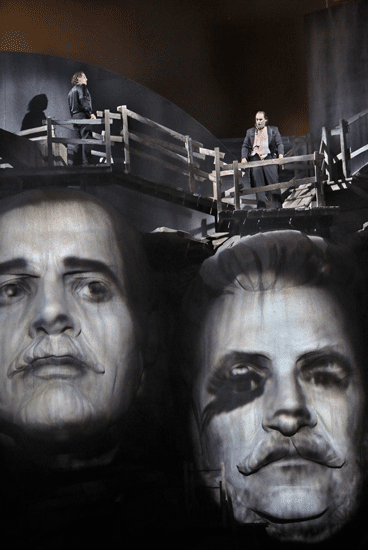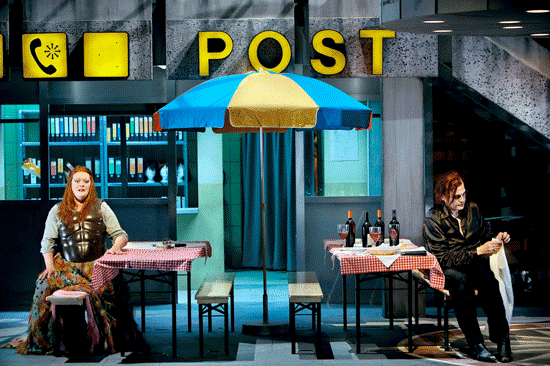En 2013, ils étaient deux.
En 2014, ils étaient trois (deux adultes, un petit)
En 2015, ils sont quatre (deux adultes, deux petits).
L’air de Bayreuth est favorable à la reproduction des crocodiles, et les crocodiles sont les chiffons rouges ad hoc pour stimuler les buhs qui ont accueilli cette représentation de Siegfried, comme l’an dernier. Le final très brechtien ne passe pas. Mais les buhs ont été vite étouffés par l’ovation énorme du public devant ce Siegfried d’une rare intensité musicale.
Si par hasard la notion de distanciation (Verfremdung) n’est pas tout à fait assimilée, il suffit de regarder ce Siegfried et notamment son troisième acte, pour recevoir une leçon de dramaturgie brechtienne. Au moment où l’amour éperdu de Brünnhilde s’exprime et où elle s’est libérée de ses craintes, au moment où la musique devient ivresse, Siegfried semble faire autre chose, boire, lire, autour d’une table improbable de restaurant que Brünnhilde vient de rejoindre vêtue d’une robe de mariée plus vraie que nature. C’est à ce moment musicalement somptueux qu’arrivent les crocodiles, provoquant les rires et donc interrompant forcément l’ivresse lyrique à laquelle le public commençait à s’adonner car toute la scène devient de plus en plus loufoque : Siegfried donne à manger au crocodile comme à son chien, et Brünnhilde s’y met,et si les dernières minutes du duo sont construites comme un duo d’opéra, les deux chanteurs debout face au public (ils ne se touchent jamais dans ce duo dit d’amour), le crocodile veille à un pas…
Las, au moment même des toutes dernières mesures, si éclatantes, l’oiseau fait sa réapparition sous sa forme humaine et joue avec un crocodile qui l’avale : on voit dans la gueule les jambes qui battent et un bras qui appelle à l’aide : Siegfried (qui ignore la peur, évidemment) va sauver la situation et arracher le frêle volatile de la gueule de la bête, l’en retire, le serre dans ses bras d’une manière si peu équivoque que Brünnhilde intervient par un baiser goulu, comme pour dire « Siegfried, il est à moi !». Rideau.
Et évidemment huées immédiates des frustrés de l’ivresse et des spectateurs non brechtiens.
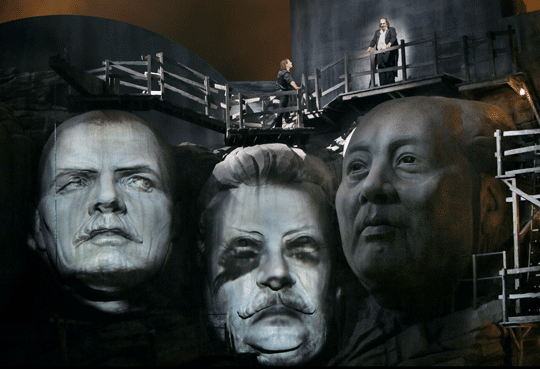
Castorf n’a pas changé grand chose de la mise en scène, sinon l’ajout d’un bébé crocodile, qui fait presque figure d’événement tant tout le monde en a parlé : les fondamentaux y sont, un Siegfried qui se déroule à l’ombre d’un Mount Rushmore version communiste, Marx, Lénine, Staline, Mao : les idéologies triomphantes de la guerre froide, et de l’autre côté du décor une Alexanderplatz à Berlin d’avant la chute du mur, sous une immense publicité au néon pour Minol (le combinat gérant l’énergie de la DDR repris par Total au début des années 1990) dont la fameuse Minolhaus trônait sur Alexanderplatz. Aleksandar Denić est un décorateur de génie.
On a dans cette mise en scène de Siegfried un concentré de la pensée de Castorf, à la fois sur les idéologies du bloc oriental, sur la DDR, d’où il vient, fondement de son travail théâtral : sur le toit de son théâtre la Volksbühne, au moins jusqu’en 2017, trône un fier OST (Est), affirmant les racines de cette maison.
Siegfried commence à indiquer clairement les voies de la perversion : trafics, crimes, absence de sentiment ou d’amour. Le personnage de Siegfried est incapable de tendresse, c’est une graine de terroriste mâtinée de petit truand formé à l’école de Mime, qui est aussi l’école d’Alberich, où l’on a renoncé à l’amour. La mise en scène est sans doute des quatre spectacles la plus agressivement « provocatrice » pour les spectateurs. Cette troisième vision permet de voir que Castorf ne travaille pas dans les longs dialogues, à l’inverse d’un Chéreau par exemple, sur les gestes (je veux dire sur le petit geste vrai) ou sur l’individualisation des personnages, il laisse souvent ses personnages avec de rares mouvements, quelques pas, ou plutôt immobiles : le dialogue Alberich/Wanderer est à ce titre assez emblématique. Castorf joue de l’espace, immense en l’occurrence puisque prenant toute la hauteur du décor, obligeant les chanteurs à monter des escaliers ou des échelles, quelquefois à leurs risques et périls (Albert Dohmen a trébuché), une bonne partie du duo Wanderer/Siegfried du 3ème acte se déroule en haut du décor sur la passerelle de bois où ils trouvent chacun ostensiblement qui Notung et qui la lance. Siegfried brise d’ailleurs la lance en deux alors que le Wanderer a déjà quitté la place, déjà redescendu, déjà vaincu avant même le moment fixé: Castorf n’en manque pas une pour casser l’histoire, et à ce titre la scène la plus impressionnante et la plus réussie (c’est un vrai chef d’œuvre grâce à la Erda supérieure de Nadine Weissman) est la scène initiale du 3ème acte, où une Erda sans doute vedette d’un musical berlinois – tout comme l’Oiseau – se prépare, se maquille, s’habille comme pour rentrer en scène mais en réalité pour rencontrer Le Wanderer/Wotan qui l’appelle, un Wanderer défraichi, débraillé, un Malcolm McDowell à l’abandon (il en a le même œil maquillé que dans Orange mécanique) attablé devant un saladier plein de pâtes qu’il mange à pleines mains. Un repas de vieux amants, qui se finit en dernière gâterie de Erda au Wanderer (sur le fameux « Hinab », « descends ! »), où Nadine Weissmann, dont j’avais déjà évoqué le personnage dans Rheingold est extraordinaire de vérité et de présence, mais aussi très sûre vocalement. Son adresse à Wotan prend plus de relief, plus de sens et affiche une vérité qui va bien au-delà des apparitions habituelles d’Erda émergeant des abysses. C’est un grand moment de théâtre par son côté délirant et sa criante vérité et conformité au sens général de la relation Erda/Wotan.
Qu’Erda et l’Oiseau procèdent dans cette mise en scène du monde du spectacle, ou plutôt des revues est intéressant d’ailleurs, car Castorf renvoie les personnages de l’histoire à une sorte de pacotille chargée de distraire le bon peuple, inscrite dans ce Berlin où l’histoire se déroule pour partie dans cette vision, Berlin comme symbole des idéologies triomphantes et finissantes (Le Wanderer vu comme Wotan décrépi).
Autre motif clairement affiché, les relations de couples Erda/Wotan et Brünnhilde/Siegfried mises en parallèle autour de la table de restaurant en terrasse, deux versions de la vie du couple, chacune désabusée. L’une est une rupture, l’autre est une rencontre déjà installée dans la lassitude et l’impossibilité de communiquer (Götterdämmerung est annoncé…), le parallèle de la situation ne peut être un hasard.
Ainsi en est-il de ce Siegfried, dont nous épargnons les détails au lecteur qui se reportera à 2014 (Compte rendu du 30 juillet, et compte rendu du 13 août 2014)
S’il n’y pas de changements fondamentaux dans la mise en scène, mais la distribution évolue avec rien moins qu’un Siegfried, un Mime, un Fafner et un Alberich nouveaux et forcément avec elle le rythme de la représentation car les personnalités sont différentes. L’Alberich d’Albert Dohmen était plus à l’aise aujourd’hui que dans Rheingold. Sans doute une mise en scène moins ébouriffante l’y a-t-elle aidé : ses mouvements en effet sont moindres, dans un espace scénique encombré d’objets où il est difficile de bouger (une roulotte, des lits pliants, des caisses) aussi monte-t-on sur les hauteurs. La voix, légèrement voilée, reste puissante et le style impeccable. C’est son premier Alberich et c’est globalement très convaincant. La mise en scène (et notamment les costumes d’Adriana Braga-Peretski) en fait dans la scène I de l’acte II un double fraternel du Wanderer (merci Chéreau), chacun rôdant autour de la même proie. La scène est prodigieuse d’intelligence et Dohmen y est remarquable.

Fafner est cette année Andreas Hörl (l’an dernier Soren Coliban). Cette basse moins profonde que d’autres Fafner (qui chante un Titurel très vivant( !) dans le Parsifal pour enfants) a un timbre assez clair, une voix plutôt ouverte, une émission impeccable et une diction parfaite, La prestation en Fafner est très réussie, ce Fafner qui dans la mise en scène profite de la vie et de son or en entretenant une brigade de jeunes femmes : c’est sa manière à lui de dormir « accompagné ». C’est un Fafner assez vif, un genre de hippie à la retraite (qui garde sa barbe noire peinte) vu comme un petit chef de bande qui se bat vraiment avec Siegfried : point de Dragon puisque le serpent est en nous.
Le Mime consommé de Andreas Conrad épouse certes la mise en scène (désopilant avec son parapluie, un vrai personnage de bande dessinée), et chante au départ avec une voix particulièrement bien assise dans les aigus. Les choses se gâtent un peu par la suite, où toutes les notes ne sont pas chantées, et où il semble un peu indifférent à l’action. C’est un ténor de caractère…sans trop de caractère ici est c’est dommage. Il est vrai aussi que Castorf ne s’y intéresse pas trop, sans doute parce que tous les metteurs en scène s’y intéressent en revanche, moins qu’à Siegfried, moins qu’à Alberich, et moins qu’à l’ours, joué par un Patric Seibert, l’assistant de Castorf, qui est ours, mariée, chien de garde, et esclave, mais aussi ailleurs barman, garçon de café ou cadavre. Il est une des figures, une des silhouettes marquantes et marquées de ce Ring, comme un chœur muet, comme le facteur du petit Brecht illustré. Pour Castorf, le reste des personnages ou bien sont interchangeables, ou des caricatures, ou des ombres .
L’intervention finale avec le voile de mariée veut paraît-il montrer que Siegfried ayant forgé Notung devient un héros dont tous ont envie : « tutti lo bramano ! », le voile final du 1er acte annonce celui aussi arboré par Brünnhilde à la fin du 3ème. Siegfried, qui va aussi épouser Gutrune après l’ours et Brünnhilde, au 2ème acte du Crépuscule devient ainsi l’épousé du genre humain, à défaut d’en être l’épouseur.
Le Wanderer de Wolfgang Koch a toujours cette éminente intelligence de l’interprétation, scandant les mots, avec une émission modèle. Il semble plus fatigué néanmoins avec une voix moins colorée et un petit peu plus instable. On l’avait remarqué dans les toutes dernières mesures de Walküre où la voix bougeait fortement. Son Wanderer est toujours impressionnant comme personnage, comme acteur, mais vocalement un peu moins sculpté. L’an prochain, trois Wotan pour trois soirées, c’est presque unique dans les annales : en 1988, dans le Ring de Kupfer, Mazura avait chanté le Wanderer et Tomlinson Wotan de Rheingold et de Walküre. Ce qui ne va pas arranger les affaires de Castorf qui a souvent protesté contre les changements de distribution.

La grande nouveauté, c’est le Siegfried de Stefan Vinke, qui comme Andreas Conrad en Mime, a remporté un gros succès mais inférieur à celui de Lance Ryan l’an dernier (malgré les huées inévitables d’alors, vu la prestation vocale contrastée du ténor canadien). Stefan Vinke est sans aucun doute possible un Siegfried convaincant, qui chante tout de manière égale, avec la même puissance et la même résistance, et avec un notable volume. Vocalement nous y gagnons. Y gagnons-nous pour le reste. Pas pour la couleur et les inflexions : la voix est moins claire ou juvénile que Ryan, plus épaisse et peut-être moins expressive, moins de couleur et plus linéaire, et le jeu est plus approximatif et moins personnel, moins incarné : son marteau semble bien peu convaincu quand il frappe dans l’œil de Staline, sans l’atteindre…comme son geste lorsqu’il jette le sac poubelle sur le cadavre de Mime au lieu de l’en recouvrir ; c’est malgré tout plus réussi scéniquement au deuxième acte. La manière vive dont il mitraille Fafner avec sa Kalashnikov avant d’y penser à deux fois (Siegfried tue d’abord et pense après) est assez convaincante, comme son troisième acte crocodilien. Disons qu’il entre dans le rôle peu à peu, mais qu’il emporte l’adhésion vocalement, même si les dernières mesures, comme souvent dans Siegfried sont vacillantes. Mais l’épreuve est bien dominée.
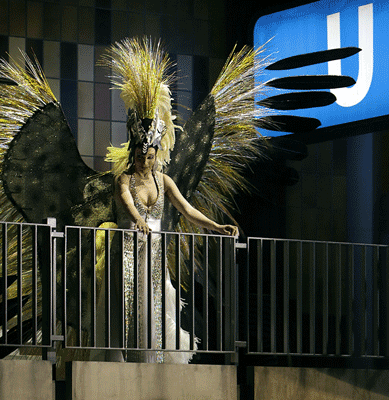
L’oiseau de Mirella Hagen, qui se bat avec ses ailes de géant et ce costume de meneuse de revue de l’Admiral Palast, est un peu moins en place que l’an dernier, mais reste très honorable, et surtout très spectaculaire. Là où l’oiseau est une toute petite chose habituellement, Castorf en fait un monument dédié au kitsch, un objet de spectacle et de désir (Siegfried…).
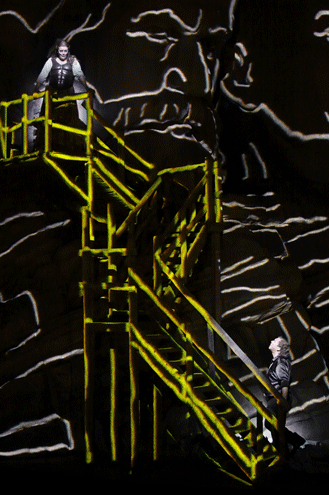
Le duo final de Brünnhilde et Siegfried est vraiment construit en deux parties, la première, sous les effigies des grands emblèmes du marxisme triomphant, est volontairement inscrite dans un récit presque abstrait, presque mythique, notamment quand par un étonnant jeu technique des figures et des éléments du décor il ne reste de ce décor monstrueux que de gigantesques lignes lumineuses (le résultat d’une ingénieuse projection vidéo), comme une ambiance. Le moment est suspendu, et presque poétique au point qu’on pense être revenu à l’expression mythique de l’amour dans un Siegfried traditionnel. Mais Castorf construit ainsi sa première partie pour mieux nous assommer dans la deuxième partie, quand Brünnhilde enfin se débarrasse de ses craintes (la perte de la virginité). Elle se passe de l’autre côté du décor, devant la station de U Bahn Alexanderplatz, dans un restaurant en terrasse, et cette évocation de l’ex-DDR très réaliste semble déjà faite pour la fin des illusions. Comment l’amour absolu peut-il exister là ? Il n’y a plus d’amour, il n’y reste qu’un Siegfried déjà désintéressé de sa conquête et une Brünnhilde déjà délaissée. Catherine Foster qui montre dans la redoutable partie de Brünnhilde de Siegfried, si tendue, la même homogénéité que dans Walküre, avec peut-être un peu moins d’engagement vocal. Elle s’économise, mais c’est surtout un chant un peu moins éclatant, presque moins vivant qui frappe. Les notes de la fin y sont bien présentes (au contraire de la plupart des Brünnhilde du marché) mais Catherine Foster est un peu en-deçà, pas aussi dédiée qu’on la rêverait, elle est déjà presque ailleurs. L’ensemble m’est apparu vocalement un peu moins captivant, à moins que les crocodiles ne m’aient trop distrait.
Car on en veut à ces crocodiles qui captent l’attention quand l’orchestre est à son sommet, lyrique, énergique, dynamique, offrant une fête sonore aux multiples reflets. Kirill Petrenko épouse parfaitement les différents moments de Siegfried, quand dominent théâtre et dialogues, il se fait discret, il se fait non protagoniste mais soutien, mais partenaire, mais écho, mais accompagnateur d’un discours : on a rarement entendu un Wagner ainsi intelligemment plastique et collant de si prêt à la nature de l’action scénique. Il faut entendre les différents éléments qui ouvrent l’œuvre, cette présence sourde, pesante, inquiétante de l’orchestre qui naît du silence et de cet imperceptible moment où le silence devient musique, avec cette alternance de sons très modelés, un peu plus forts ou un peu légers et le crescendo terrible et tendu avant que les coups de marteaux sur l’enclume ne se fassent entendre. Il faut aussi entendre les moments où l’orchestre se fait entendre en protagoniste, un fulgurant prélude du 3ème acte, un acte phénoménal à l’orchestre dans son ensemble. A-t-on entendu un tel descrescendo des flammes dans la transition entre la scène avec le Wanderer et le réveil de Brünnhilde, ou un tel réveil de Brünnhilde où un soleil sonore se lève en soulevant le cœur. Non, dans ce Ring, l’orchestre n’est pas protagoniste, on n’entend pas que lui, mais il est partout et on entend tout de lui, et dès que l’oreille se concentre sur le son de la fosse, c’est un abîme qui s’ouvre, de profondeur, de sensibilité, d’invention. Quelle fête !
Allez-vous étonner de l’ahurissante explosion quand le chef vient saluer, encore peut-être si c’est possible plus impressionnante que dans Walküre.[wpsr_facebook]