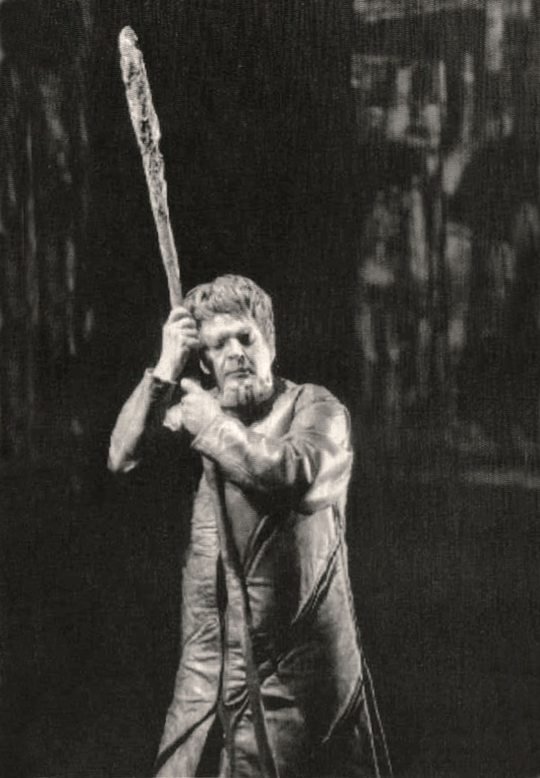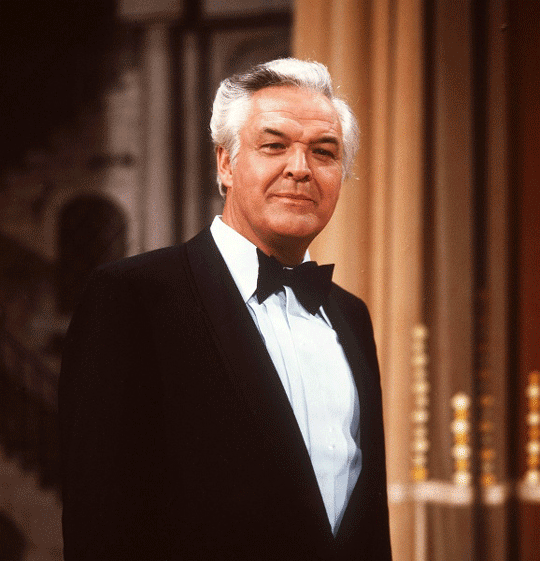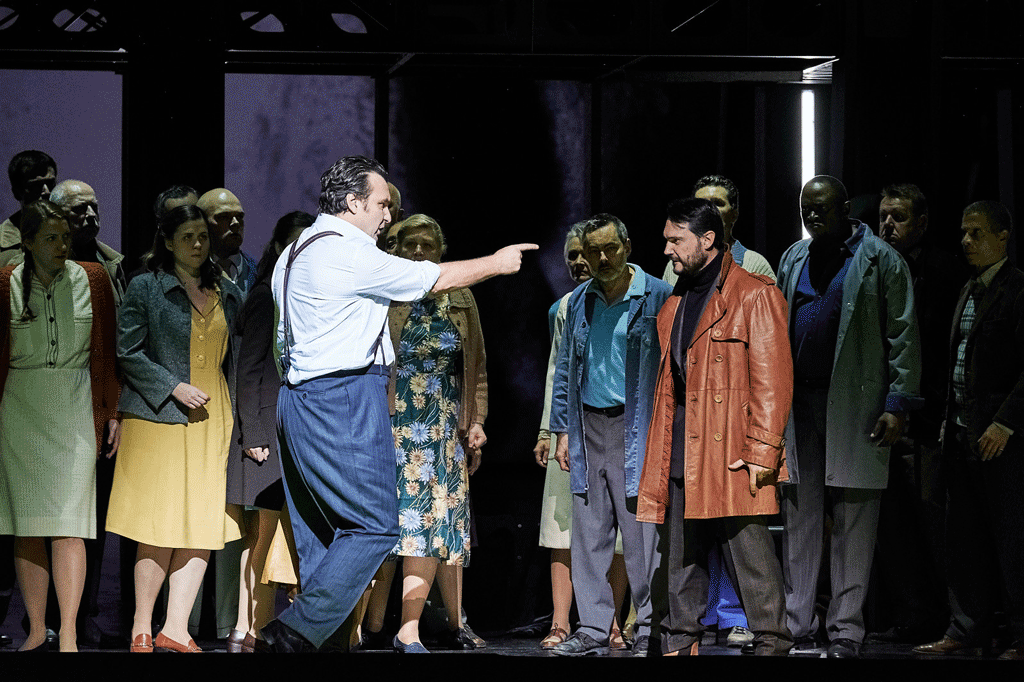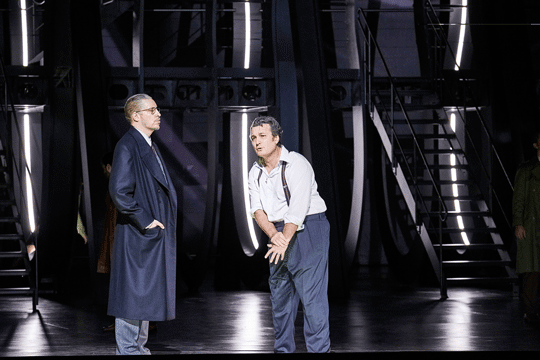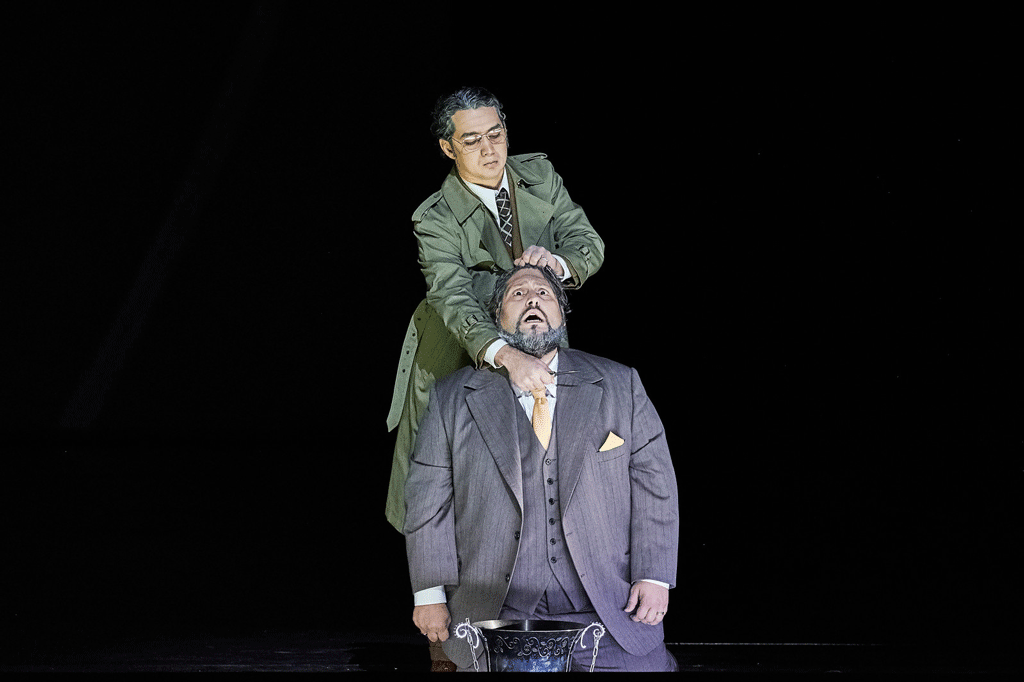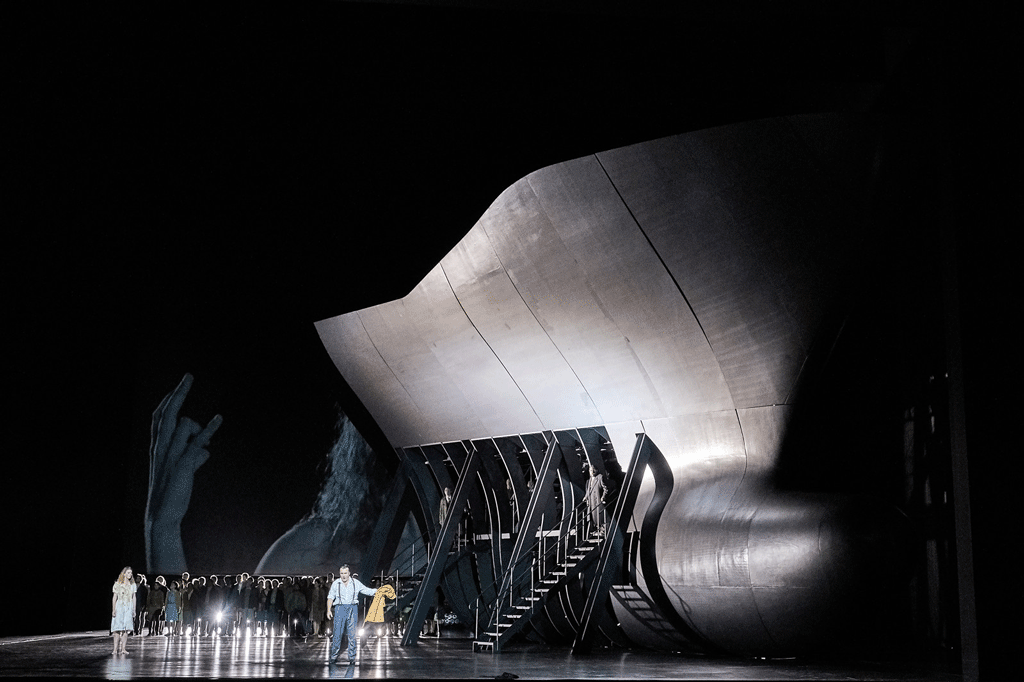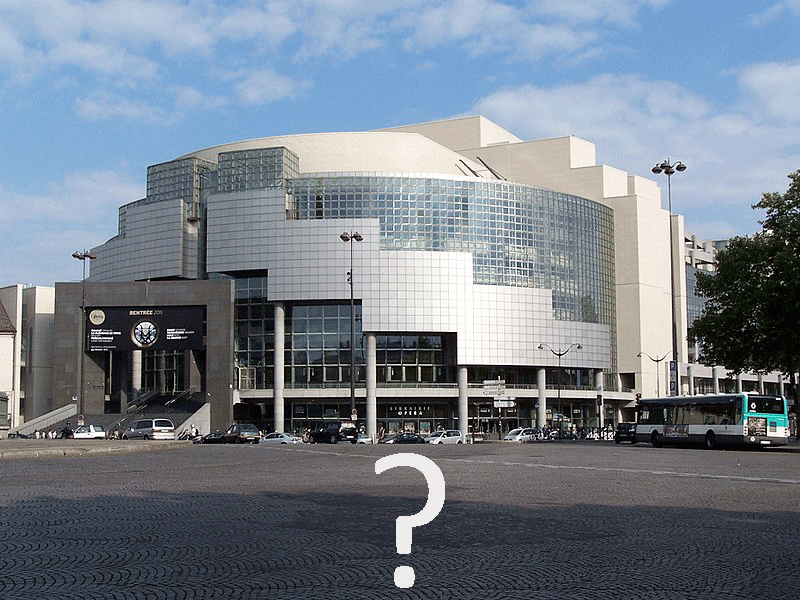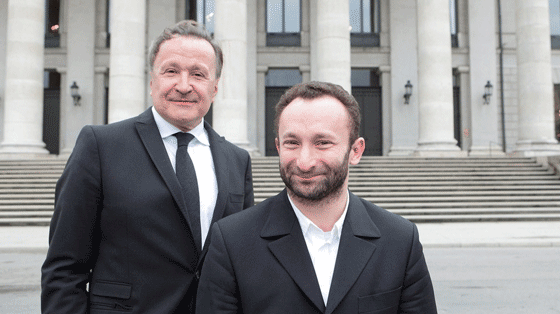Plus on avance dans la lecture des saisons de l’Opéra de Lyon, et plus on mesure l’évolution d’une programmation qui aujourd’hui affirme sa singularité, dans les choix des metteurs en scène et des œuvres, dans les choix culturels, tout en affirmant la présence répétée de compagnons de route; en ce sens, Serge Dorny est bien l’héritier de Gérard Mortier, avec qui il a travaillé au tout début de sa carrière. Plus on considère d’ailleurs les programmes des opéras en Europe, et plus on ressent l’absence de Mortier, de sa vivacité intellectuelle, de son sens dialectique redoutable, de sa soif de culture sous toutes ses formes, de sa manière de considérer le monde, et de voir comment le traduire sur une scène d’opéra.
Dorny quittant Lyon à la fin de la saison 2020-2021, le processus de recrutement de son successeur est lancé, moins médiatisé que celui du successeur de Lissner à Paris, mais peut-être plus difficile. Le travail à Paris est plus ou moins calibré: du répertoire, des nouvelles productions, le ballet et sa crise endémique depuis le départ de Brigitte Lefèvre et deux théâtres à gérer avec les soucis inhérents, sans compter le regard d’une presse toujours à l’affût de la faute de l’abbé Lissner, comme elle le fut de celle de l’abbé Mortier. Il faut un profil artistique certes, mais bien plus en ce moment un gestionnaire capable d’être aussi visionnaire, denrée rare. Mais même avec un médiocre, l’histoire a prouvé que la machine continuait de tourner, car ce type d’institution a une force d’inertie qui la fait survivre même à une direction problématique.
C’est peut-être plus difficile à Lyon parce que la structure est plus fragile et dépend étroitement (au niveau du lyrique) de la programmation appuyée sur huit grosses productions presque toutes nouvelles. Certes, le théâtre est aujourd’hui un théâtre européen prestigieux, ce qu’il n’était plus en 2003 à l’arrivée de Dorny : il traversait une crise de succession depuis la fin de l’ère Erlo-Brossmann, qui, ne l’oublions pas, fut elle aussi brillante et solide et qui a construit l’identité de cette maison. N’oublions surtout pas les directeurs musicaux de leur période, qui ont eu nom John Eliot Gardiner et Kent Nagano et des productions enviables.
Après l’ère Dorny, ne souhaitons pas de crise de succession similaire. Mais il est vrai qu’autant reconstruire un théâtre dure plusieurs années, autant le mettre à terre ne peut durer que quelques mois.
Ce sera difficile pour le successeur qui devra ou bien proposer des saisons radicalement différentes, ou bien suivre le chemin ouvert par Dorny avec des inflexions, d’autres choix et d’autres esthétiques, mais toujours profondément enracinées dans la modernité, dans le style de La Monnaie de Bruxelles qui a toujours gardé quelque chose de la couleur donnée initialement par Mortier.
L’Opéra de Lyon est en France un fer de lance, qui accumule les réussites, il ne faudrait pas que cela s’émousse. Et pour l’instant, je ne vois pas vraiment qui en France pourrait continuer le travail initié à Lyon par Dorny.
La machine lyonnaise est une machine construite pour un rythme de stagione, un titre par mois à peu près, qui a atteint un rythme de croisière . Elle a trouvé aussi un équilibre musical, avec des chefs aussi différents que Kazushi Ono et aujourd’hui Daniele Rustioni, qui ont consolidé la qualité de l’orchestre, et Stefano Montanari, qui a emporté l’adhésion dans le répertoire XVIIIe sans parler du chœur, souvent splendide, investi, et très engagé aussi dans le travail scénique ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs.
Enfin, du point de vue scénique, cette maison a une singularité qui marque la différence avec les autres scènes françaises et bien des scènes européennes : Lyon a fait découvrir à la France des metteurs en scène en vue ailleurs, mais ignorés chez nous, comme David Bösch, ou Axel Ranisch la saison prochaine, des artistes à l’univers très singulier comme David Marton, des cinéastes qui se sont lancés dans l’opéra comme Christophe Honoré, et la saison prochaine Olivier Assayas. Bref, Dorny a affirmé l’opéra comme un art de notre temps (dans la lignée de Mortier) mais il a aussi offert à Lyon une visibilité internationale que cette salle n’avait jamais eue, montrant un taux de remplissage enviable avec un répertoire à mille lieux de la complaisance, sans oublier aussi une ouverture aux jeunes, soutenu en cela par la Région Auvergne Rhône-Alpes et les Ministères de l’Éducation nationale (rectorats de Lyon et de Grenoble) et de la Culture (DRAC Rhône-Alpes) .
Un séminaire fort riche sur Lessons in Love and Violence de George Benjamin (présenté à l’Opéra partir du 14 mai dans la mise en scène de Katie Mitchell) destiné à des formateurs de l’Éducation Nationale et des responsables de structures culturelles vient de s’y dérouler avec un énorme succès, par ailleurs quelques collèges isolés ont des classes à horaire aménagées expérimentales « Opéra » pour ne citer que deux opérations parmi d’autres : l’action de l’Opéra de Lyon ne se limite pas à la ville de Lyon et commence à vraiment rayonner. Tous les spectateurs de Lyon savent que pour n’importe quel spectacle, il y a dans la salle des jeunes, qui d’ailleurs dès les beaux jours, envahissent le péristyle comme terrain d’entraînement de Hip Hop.
La saison 2019-2020 ne déroge pas à la tradition, avec un dosage subtil de titres traditionnels (Rigoletto, Le Nozze di Figaro, Tosca, Guillaume Tell), d’opéra en concert (Ernani) de titres rares (Irrelohe de Schreker), une création (Shirine de Thierry Escaich ) et deux reprises : un titre plus bref (L’Enfant et les sortilèges), et un succès pour les fêtes (Le Roi Carotte, d’Offenbach).
Hors de la salle de l’opéra de Lyon, l’opéra se déplace au Théâtre de la Croix Rousse, ou au théâtre de la Renaissance à Oullins pour des formes diverses, destinées à un public plus jeune, ou plus large, plus divers en tous cas
- The pajama game, comédie musicale de Broadway de 1954 (à Oullins et à la Croix Rousse)
- I was looking at the Ceiling and Then I saw the Sky (de John Adams) (Croix Rousse)
- Gretel et Hänsel (Engelbert Humperdinck & Sergio Menozzi)(Oullins)
Enfin, hors salle, comme troisième œuvre (avec Rigoletto et Irrelohe) du Festival 2020 dont le thème sera « La Nuit sera rouge et noire », au théâtre du point du jour, La Lune de Carl Orff.
On le voit, l’offre est variée, alternant grands standards, création, titres inconnus, et formes diverses pour toucher tous les publics.
Octobre
Guillaume Tell (7 repr. Du 5 au 17 octobre)
Le chef d’œuvre de Rossini, la référence du « Grand Opéra » romantique dans sa version originale en français (créé à l’Opéra de Paris en 1829). Daniele Rustioni au pupitre, évidemment, et dans une mise en scène d’un des jeunes metteurs en scène les plus intelligents et imaginatifs d’Allemagne, Tobias Kratzer (qui mettra en scène cette année Tannhäuser au festival de Bayreuth). Avec évidemment John Osborn inévitable dans le rôle d’Arnold, Nicola Alaimo, le grand baryton italien dans Tell, un rôle un peu hors de l’habitude pour lui, Jane Archibald dans Mathilde et Enlelejda Shkosa dans Hedwige.
Grande œuvre, grande distribution, grand metteur en scène, à ne manquer sous aucun prétexte.
Novembre
Ernani (6 novembre)
En version de concert (qu’on verra aussi au TCE à Paris le 8 novembre), un opéra du jeune Verdi dans le sillon tracé par Attila en 2017 et Nabucco en 2018), peu connu en France inspiré de Victor Hugo, avec l’Ernani du moment sur toutes les scènes du monde : Francesco Meli ; Il sera entouré du Carlo de Amartuvshin Enkhbat, qui a triomphé dans Nabucco en 2018, du Silva de Roberto Tagliavini et de l’Elvira de Carmen Giannatasio (seul élément de la distribution qui suscite dans ce rôle terrible un petit doute de ma part). Orchestre et chœur dirigés par Daniele Rustioni.
L’Enfant et les sortilèges (7 représentations du 14 au 19 novembre)
Reprise de la production très visuelle de Grégoire Pont et James Bonas qui avait eu tant de succès en 2016. Une manière d’ouvrir le théâtre aussi à un autre public qui entre à l’opéra pour un spectacle d’une heure. La production a déjà triomphé et revient précédée d’une flatteuse réputation, avec une qualité musicale garantie, puisque l’orchestre sera dirigé par Titus Engel, un jeune chef suisse vivant à Berlin qui aura ouvert un mois auparavant la très attendue nouvelle saison du Grand Théâtre de Genève. Le chœur sera dirigé par Karine Locatelli cheffe valeureuse de la Maîtrise, et les solistes seront ceux du Studio de l’Opéra de Lyon.
Décembre :
The Pajama Game (11 représentations : du 12 au 14 décembre au Théâtre de la Renaissance à Oullins, du 18 au 29 décembre au Théâtre de la Croix Rousse).
Une comédie musicale de Broadway à Lyon, pour les fêtes, en parallèle avec Le Roi Carotte à l’Opéra. La première en 1954 à Broadway fut triomphale : Le livret, signé Georges Abbott et Richard Bissell, la mise en scène Jérôme Robbins, la chorégraphie Bob Fosse. Rien de moins !
Évidemment, la Croix-Rousse n’est pas Broadway, et l’œuvre présentée le sera avec une orchestration allégée dirigée par Gérard Lecointe et une mise en scène qui convienne à l’espace de la Croix Rousse, signée Jean Lacornerie et Raphaeël Cottin. Et plein de jeunes sur scène.
Le Roi Carotte (9 représentations du 13 décembre au 1er janvier)
Reprise de la production de Laurent Pelly dont le nom est à Lyon indissolublement lié à Offenbach, manière aussi de fêter doublement l’anniversaire de ses deux-cents ans après le Barbe-Bleue qui fermera la saison 2018-2019.
C’est le jeune Adrien Perruchon qui dirigera, un talentueux jeune chef qui commence à émerger, on y retrouvera Yann Beuron, Christophe Mortagne, Chloé Briot, Julie Boulianne. À voir évidemment : on ne rate pas un Offenbach pareil, dont le destin fut si difficile.
Janvier
Tosca (9 représentations du 20 janvier au 5 février)
Présentation à Lyon de la production coproduite avec Aix en Provence 2019, signée Christophe Honoré, qui revient à l’Opéra après son superbe Don Carlos de 2018. Dirigée par Daniele Rustioni, elle sera interprétée par les mêmes chanteurs qu’à Aix, sauf le ténor (ce n’est peut-être pas un mal), soit Angel Blue (Tosca) et Massimo Giordano, une belle voix italienne brillante qui était Ismaele dans le Nabucco de Novembre 2018, dans Mario, ainsi qu’Alexey Markov l’un des meilleurs barytons actuels, pour Scarpia. À noter la présence une des Tosca mythiques des années 90, Catherine Malfitano, une des très grandes de la fin du siècle dernier dans le rôle de la Prima donna, double de Tosca.
Un must comme on dit, parce que Tosca manque à Lyon depuis 1979, parce que la production est excitante, avec Rustioni et Honoré aux manettes, et aussi pour Malfitano, une de ces immenses qui dès qu’elle était en scène, aimantait tous les regards.
Février
I was looking at the Ceiling and Then I saw the Sky de John Adams ( 9 représentations du 13 au 25 février) au Théâtre de la Croix Rousse.
La préparation du Festival (deux grosses productions à répéter dans l’Opéra) nécessite en février que la programmation s’externalise. C’est une excellente initiative que de proposer une forme plus légère, très peu connue en France hors des spécialistes, créée à l’Université de Berkeley en 1995, d’un des grands compositeurs de la fin du XXème siècle, John Adams (l’auteur de Nixon in China, de la Mort de Klinghoffer, de Docteur Atomic, très lié à Peter Sellars). La mise en scène en sera confiée à Macha Makeieff, une garantie, l’ensemble instrumental à Philippe Forget, et le chant aux chanteurs du Studio de l’Opéra de Lyon. Inutile de souligner qu’il faudra aller voir ce spectacle qui permettra de découvrir un John Adams peut-être moins connu.
Mars
Festival 2020 : La Nuit sera rouge et noire
(du 13 mars au 2 avril)
Un titre pastichant le mot laissé par Gérard de Nerval le soir de son suicide “La nuit sera noire et blanche”: sang et mort, inquiétude, drame, amours névrotiques, assassinats. Trois œuvres dont deux inconnues en France (Irrelohe, et La lune) et la troisième un grand standard de l’opéra, Rigoletto. On est donc dans le contraste savamment calculé.
Rigoletto (9 représentations du 13 mars au 2 avril)
Cette nouvelle production en coproduction avec Munich (qui a au répertoire un Rigoletto qu’il est temps de changer) est confiée pour la mise en scène à Axel Ranisch à qui l’on doit récemment une très belle production de Orlando Paladino au Festival de Munich de 2018. Cinéaste, metteur en scène de théâtre, acteur, Axel Ranisch, né en 1983, est l’un des artistes émergents sur la scène de l’opéra, et bien qu’encore jeune, il a derrière lui une longue liste de productions et films.
Rigoletto, ce sera Roberto Frontali, qui a triomphé à Rome en décembre dernier dans le rôle, Gilda sera Nina Minasyan et un Duc de Mantoue à découvrir, Mykhailo Malafii un jeune ukrainien à la voix étonnante.
La direction sera aussi confiée à un jeune chef italien qui concentre l’attention actuellement, Michele Spotti, que les lyonnais auront découvert dans Barbe-Bleue d’Offenbach en juin 2019. Beau retour d’un titre qui manque à Lyon depuis 1976.
Irrelohe (6 représentations du 14 au 28 mars)
Voilà la grande inconnue du Festival, un opéra de Schreker, c’est déjà rare, même si on le connaît mieux désormais et notamment Die Gezeichneten (Les Stigmatisés) déjà vu à Lyon en 2015. Irrelohe, créé à Cologne en 1924 par Otto Klemperer est une partition complexe qui n’a pu se maintenir au répertoire, même s’il en existe deux enregistrements et puis Schreker, devenu un « dégénéré » sous le nazisme a été victime de l’histoire et ses œuvres ont peu survécu à la guerre. Irrelohe néanmoins a été récemment repris à Bonn (2010) et Kaiserslautern (2015). La production lyonnaise est une création française. L’œuvre dont le titre signifie « Les flammes folles » est une histoire qui ressemble au Trouvère de Verdi et qui finit aussi dans les flammes.
C’est David Bösch, désormais l’une des références de la mise en scène d’aujourd’hui en Allemagne, (on lui doit Simon Boccanegra à Lyon et aussi Les stigmatisés ), qui assurera aussi celle d’Irrelohe, créant ainsi un fil d’une œuvre de Schreker à l’autre, et la direction sera assurée par Bernhard Kontarsky, connu à Lyon depuis longtemps, un des très grands spécialiste des œuvres du XXe siècle. Dans la distribution, les lyonnais retrouveront Stephan Rügamer, déjà vu à Lyon dans Le Cercle de craie (Zemlinsky) et Piotr Micinsky, qui a triomphé dans Masetto du dernier Don Giovanni et surtout dans l’Enchanteresse où il jouait le rôle de Mamyrov, le méchant.
Serge Dorny renouvelle autour de Schreker l’opération qui a conduit L’Enchanteresse au succès. Mais David Bösch est un metteur en scène un peu plus sage que Zholdak…
La Lune (7 représentations du 15 au 22 mars) au Théâtre du Point du Jour (Lyon 5ème)
L’œuvre, signée Carl Orff (le compositeur des Carmina Burana) a été créée en 1939, à la veille de la guerre, par Clemens Krauss à Munich. Elle s’inspire d’un conte de Grimm, et raconte d’une certaine manière, la naissance de la Lune, qui éclaire la nuit. Elle a l’avantage d’être exécutable aussi par une petite formation (deux pianos, orgue et percussion) et a été confiée au duo-Grégoire Pont et James Bonas qui ont proposé L’Enfant et les sortilèges en 2018, repris dans la saison 2019 à cause du grand succès. Ce sera sans doute encore un enchantement visuel.
Avril
Gretel et Hansel (6 représentations au Théâtre de la Renaissance à Oullins)
L’œuvre de Engelbert Humperdinck, adaptée par Sergio Menazzi est présentée hors les murs (après le mois de Festival, l’opéra se repose un peu et abrite les répétitions de la création mondiale du mois de mai) .C’est une production où la Maîtrise de l’Opéra de Lyon joue un rôle déterminant et l’orchestre sera donc dirigé par sa responsable artistique Karine Locatelli, avec des solistes du Studio de l’Opéra. La production est confiée à Samuel Achache, Molière 2013 du spectacle musical, membre du collectif artistique de la Comédie de Valence, un metteur en scène qui aime particulièrement le théâtre musical.
Mai
Shirine (6 représentations du 2 au 12 mai)
Opéra de Thierry Escaich, sur un livret de Atiq Rahimi. C’est la deuxième création mondiale à Lyon de Thierry Escaich après Claude (livret de Robert Badinter) en 2013. C’est le poète perse Nizami Ganjavi qui a inspiré le librettiste Atiq Rahimi (Prix Goncourt 2008). Shirine raconte une histoire d’amour impossible entre le Roi de Perse Khosrow et Shirine, une princesse chrétienne d’Arménie. On perçoit immédiatement les échos que pareille histoire peut avoir aujourd’hui.
La direction en est confiée à Martyn Brabbins, grand spécialiste du XXe siècle qu’on a déjà vu dans la fosse de l’Opéra de Lyon (L’Enfant et les sortilèges de Ravel, Der Zwerg de Zemlinsky, Cœur de chien de Raskatov), et la mise en scène sera assurée par Richard Brunel (qui a fait aussi à Lyon en 2012 L’Empereur d’Atlantis ou le Refus de la Mort de Victor Ullmann et en 2018 Le Cercle de Craie de Zemlinsky) . Dans la distribution, des chanteurs francophones très valeureux, Julien Behr, Hélène Guilmette, Jean-Sébastien Bou (qui chantait Claude dans l’opéra précédent d’Escaich) et Laurent Alvaro.
Juin
Le nozze di Figaro (8 représentations du 6 au 20 juin 2019),
L’œuvre de Mozart clôt la saison 2018-19, comme Don Giovanni avait clôt 2017-18, et les deux sont confiées à Stefano Montanari, l’un des chefs les plus réclamés aujourd’hui notamment en Italie dans le répertoire mozartien et rossinien, à qui Dorny a donné une de ses premières chances il y a quelques années. Venu du baroque, Montanari se caractérise par une énergie peu commune, un travail sur la pulsation à l’opéra qui aboutit à des résultats souvent triomphaux, tant l’œuvre retrouve une incroyable vie. Il fait partie comme d’autres des compagnons de route que Dorny a su fidéliser.
Pour ce Mozart, Serge Dorny fait de nouveau appel à un cinéaste pour sa première mise en scène d’opéra, Olivier Assayas qui est aussi scénariste, et dont l’univers pourrait très bien convenir à cette folle journée. Dans la distribution, on trouve les noms de Nikolay Borchev (le Comte), le très bon Dandini de la Cenerentola lyonnaise signée Herheim, Mandy Fredrich (la comtesse), un des sopranos importants en Allemagne aujourd’hui pour les rôles de lyrique (Marguerite de Faust, Agathe de Freischütz), Figaro sera Alexander Miminoshvili, dont Wanderersite écrivait à propos de son Erimante dans l’Erismena d’Aix en Provence en 2017 « belle basse barytonnante aux graves profonds, au chant souple et au timbre chaleureux doué d’une jolie expressivité en colorant bien les paroles » .
À ce riche programme s’ajoutent des concerts dirigés par Daniele Rustioni ou Stefano Montanari, des récitals (Ian Bostridge, Maria Joao Pires), des concerts de musique de chambre dans le cadre lumineux du Grand studio de ballet dont les programmes font écho à celui de la saison.
Enfin l’Opéra de Lyon partira en tournée, à Aix en juillet 2019 pour Tosca, à la Ruhrtirennale de Bochum en août 2019 où sera proposé Didon et Enée Remembered (David Marton, Festival 2019) et en octobre 2019 à l’opéra de Mascate (Oman) pour l’Enfant et les Sortilèges dans la production reprise en novembre 2019 à Lyon de Grégoire Pont et James Bonas.
Vous en conviendrez, tout cela vaut bien quelques allers et retours en TGV, pour découvrir des nouvelles œuvres, des metteurs en scène inconnus et aussi, ne l’oublions pas des chanteurs souvent jeunes mais très valeureux, découverts par le conseiller vocal de l’Opéra de Lyon, Robert Körner.
Il y a plein de raisons de se retrouver à Lyon et pas seulement au Festival. Je suis déjà impatient pour ma part de découvrir le Guillaume Tell signé Rustioni-Kratzer.
Mais je n’ai qu’un seul regret, c’est que certaines productions qui ont marqué le public n’aient pas fait l’objet de captations, faute de financements. Je pense par exemple à l’Elektra de Berghaus et à la Damnation de Faust de David Marton, mais on pourrait en citer d’autres, comme l’Enchanteresse…