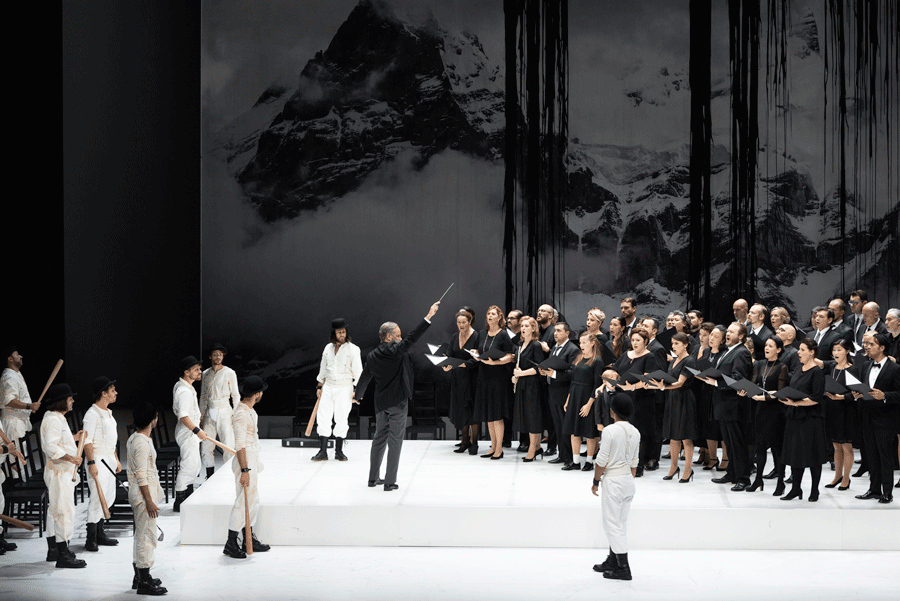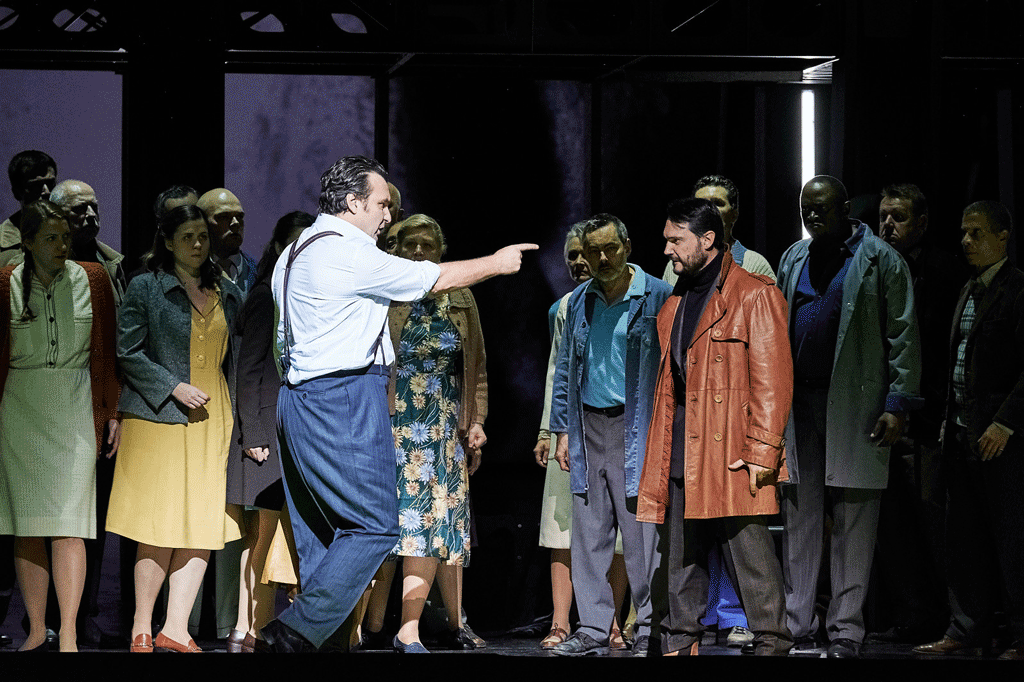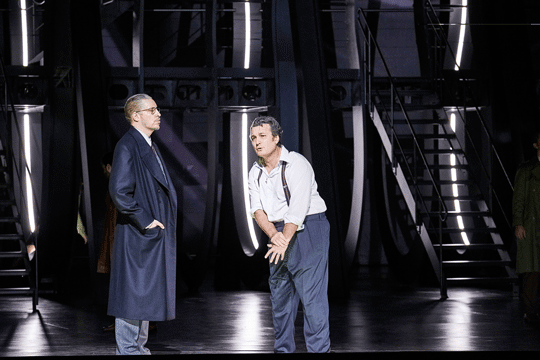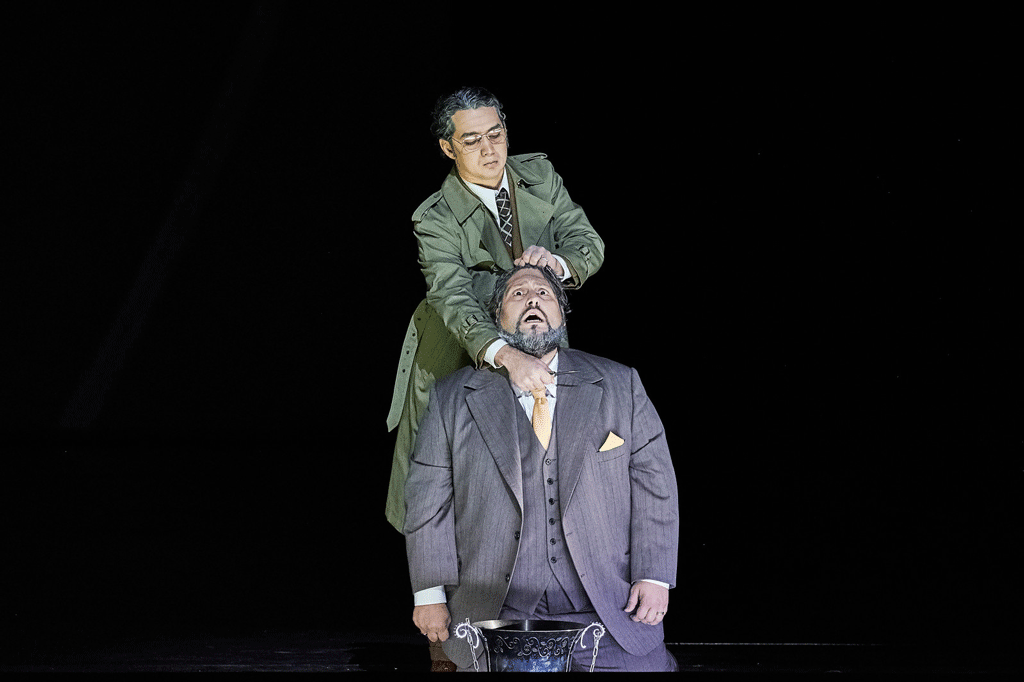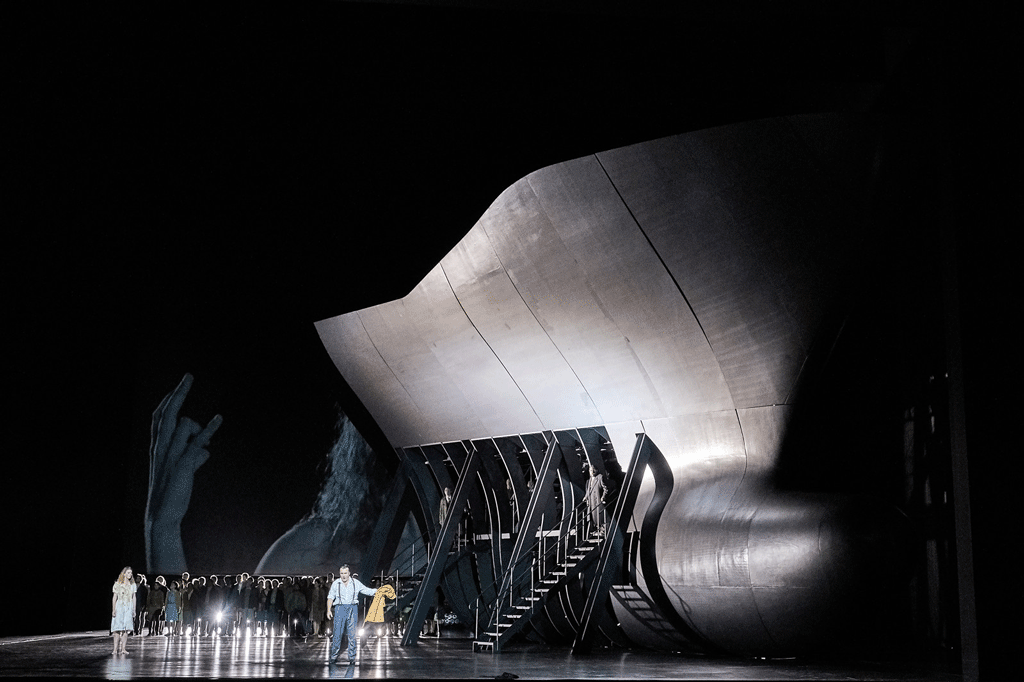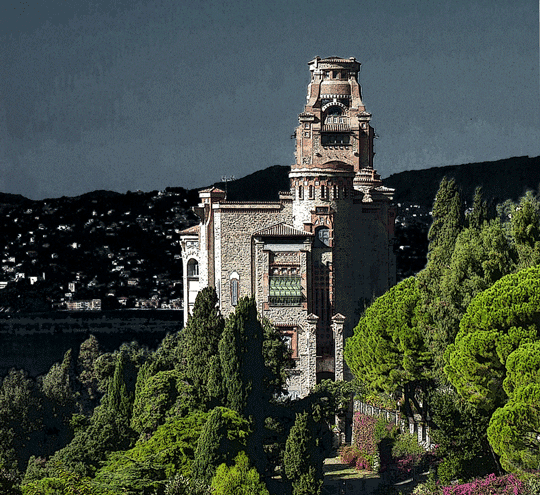Introduction
Un peu comme celle de Bogdan Roščić à Vienne, l’arrivée d’Aviel Cahn à Genève a été bousculée par le Covid et c’est seulement pendant la saison 2021-2022 qui se termine qu’on a pu observer l’articulation de son projet pour Genève, et la saison prochaine confirment ces intuitions.
La construction d’une saison est une alchimie, et on doit donc se garder de conclure hâtivement car si c’est sa quatrième saison effective, ce sera sa deuxième complète.
On doit se garder de conclure, encore plus dans un théâtre de système Stagione au nombre de productions limitées où chaque choix pèse plus lourd. Enfin, même si Aviel Cahn a été appelé un peu pour « casser la baraque », il ne pouvait simplement transposer sur les rives du Léman ce qu’il avait réalisé en Flandres.
Les conséquences de la pandémie sont lourdes pour toutes les salles : tous constatent dans la plupart des opéras la difficulté à retrouver les publics d’avant-pandémie ; d’autres habitudes ont été prises, d’autres peurs sont nées, la reprise est fragile, à Genève comme ailleurs et la couleur des saisons, pour la plupart prudentes, s’en ressent.
Le Grand Théâtre dans le paysage lyrique européen
La place de Genève est un peu singulière, son théâtre a été voulu par ses habitants sur le modèle du Palais Garnier, avec une capacité un peu surdimensionnée aujourd’hui (1500 places) mais avec la garantie aujourd’hui d’un public notamment alimenté par les institutions internationales nombreuses sises sur les bords du Léman et un bassin d’habitants à cheval sur la Suisse et sur la France (la Haute Savoie), même si le public français, certes présent, est moins nombreux qu’on ne le pense.
En tant que théâtre d’une ville internationale, il est comparable à La Monnaie de Bruxelles, avec une jauge en spectateurs supérieure (Bruxelles a une jauge de 1150 spectateurs), mais un bassin d’habitants inférieur. Le nombre de productions lyriques est comparable, même si le nombre de représentations par production est supérieur à Bruxelles (salle plus petite, plus de spectateurs potentiels). Du point de vue de la couleur des productions, Bruxelles cherche à rester depuis le temps de Gerard Mortier (années 1980 quand même…) un fer de lance de l’innovation scénique, ce que n’est pas Genève à l’histoire différente.
En termes de comparaison, il peut être aussi mis sur le même plan qu’un Théâtre comme le Teatro Real de Madrid à la jauge légèrement supérieure, mais au nombre de productions comparables, avec comme Bruxelles, un nombre de représentations supérieur (la population madrilène est nettement plus importante que Genève). En termes productifs, Madrid cherche à rester à l’équilibre entre tradition et innovation, le public espagnol reste assez conservateur et très attaché au répertoire traditionnel notamment italien. Il reste qu’au Teatro Real est passé aussi Gerard Mortier, et que son passage a laissé quelques traces.
Genève est donc un Théâtre en équilibre fragile, qui n‘a pas vraiment de «couleur productive », quelque part entre tradition et modernité depuis
des années, bien avant la pandémie. C’était déjà vrai vers 2008 du temps de Jean-Marie Blanchard qui mena une politique de grande qualité, et assez équilibrée. Le remplissage du Grand Théâtre (1500 places) ne posait guère problème, pas plus que lors des premières années de Tobias Richter qui quant à lui mena une politique peu lisible, plus proche de la tradition des théâtres de répertoire à l’allemande (un comble dans le temple suisse de la stagione !). Pas forcément passionnante. Mais quand la salle est pleine ou à peu près, c’est forcément que ça va bien, et on ne se pose pas de questions…
Les travaux de rénovation qui durèrent quelques années motivèrent un repli dans le théâtre des Nations « éphémère », dont la capacité était de 1000 places. Pas de problème de remplissage non plus, mais perte d’un tiers de spectateurs potentiels…
Lorsque le Grand Théâtre a rouvert, il a rouvert ses 1500 places et déjà le remplissage s’est fragilisé. Les dernières années nous ont appris que le public captif ça n’existe pas. De plus, pendant les périodes d’ouverture en temps de pandémie avec ses contrôles de pass, de masque etc… bien des spectateurs ont été découragés ou simplement craintifs. Et comme le public genevois n’est pas de toute première jeunesse, il est évidemment sensible aux questions sanitaires : toutes ces raisons cumulées expliquent largement des difficultés actuelles de reconquérir un public qui met du temps à revenir Place de Neuve.
1500 places, c’est aussi la jauge la plus importante de tous les théâtres de Suisse : Zurich en a moins de 1200, Bâle autour de 1000, mais aussi plus que de la plupart des théâtres européens. Les théâtres de très grandes capitales ont autour de 2000 places, les théâtres qui servent un bassin comparable à Genève ont autour de 1000 places. Lyon, qui sert un bassin de population plus important, a par exemple 1100 places.
Enfin, la crise du genre lyrique fait son œuvre, et si l’on pouvait remplir 1500 places à Genève, il y a quelques années, ce n’est plus aussi facile aujourd’hui. Même une salle comme Vienne, traditionnellement remplie à 99% a des difficultés. Et ne parlons pas du MET de New York…
À Genève en plus, il y a la question des tarifs, de l’écart entre les places les moins chères et les plus chères, dans une zone frontalière très mixte où tout le public n’est pas payé en Francs suisses, un Franc suisse dont le taux égale ou dépasse l’Euro .
Comme on le voit, ce sont des questions qui ne tiennent pas à la présence de tel titre, de tels chanteurs, de telles ou telles mise en scène, mais qui tiennent au contexte géographique, sociologique, historique et aussi politique : la question du théâtre est toujours plus politique qu’artistique, c’est d’abord le théâtre de la Cité.
On le voit chez la voisine lyonnaise dont l’Opéra a été une référence culturelle internationale avec un public largement plus diversifié que Genève (et à la billetterie plus de 50% moins chère) mais que la municipalité actuelle (écologiste) ne semble pas vraiment porter dans son cœur tandis que la Région de bord politique opposé, retire aussi de l’argent de manière importante pour des questions de petits jeux internes aux politiques locales. L’Opéra est bien loin.
Dans toute cette complexité, la programmation d’Aviel Cahn – au-delà de l’appréciation sur tel ou tel spectacle, fait honneur au mandat qui lui a été confié : il y a des productions qui n’ont pas bien fonctionné, mais la qualité offerte reste très largement défendable. Elle reste toutefois exploratoire pour l’instant. On commence à peine à voir des lignes de force se dessiner.
Cette programmation est plus disruptive que celle de son prédécesseur, et a sans doute suscité la circonspection, au-delà de la qualité des productions qui n’est pas en cause, d’autant que le contexte du territoire genevois n’est pas celui des Flandres, où Cahn a dirigé l’Opera-Ballet Vlaanderen.
La Flandre, depuis des années, a produit des metteurs en scène et des chorégraphes qui ont illuminé la scène flamande et européenne, et donné un prestige international inédit. À cela, il faut le répéter, le passage de Gerard Mortier à Bruxelles dans les années 1980 n’est pas étranger, bien évidemment, qui a su réveiller la créativité locale. Et la Flandre reste encore aujourd’hui pratiquement quatre décennies plus tard, un territoire de création. Une programmation telle que celle d’Aviel Cahn à Gand-Anvers atteignait un public plutôt accoutumé (ou quelquefois résigné) à ce type de productions.
Le contexte genevois n’est pas comparable, avec un public vieillissant d’un côté, où la présence d’institutions internationales donne aussi à un certain public une couleur un peu mondaine que j’appellerai « internationale-locale » rien à voir avec Gand ou Anvers.
D’ailleurs, aussi bien sous Hugues Gall que Renée Auphan, la politique visait à garantir un niveau musical globalement international et des productions disons consensuelles. Jean-Marie Blanchard a essayé de mener une politique plus avancée sur les productions, en équilibrant l’offre, tout en continuant à défendre un niveau musical qui a longtemps été la marque continue de ce théâtre. Tobias Richter n’a pas réussi à marquer fortement la mémoire artistique, malgré ses dix ans de mandat.
Enfin, Le territoire genevois n’est pas un territoire de création théâtrale, chorégraphique ou lyrique comme l’ont été les Flandres depuis les années 1990.
L’atout de Genève, c’est non pas une histoire théâtrale, mais un passé musical fort, un Grand Théâtre construit à l’imitation de Paris (on voit les ambitions), et une vie musicale riche et variée, avec plusieurs orchestres et un conservatoire de grand prestige international. Cette ville a de telles institutions musicales qu’on se demande comment un projet comme « La Cité de la musique » qui reflète une certaine identité culturelle a pu capoter.
Aviel Cahn a été appelé pour casser un train-train, pour insuffler quelque chose de neuf, et il a trouvé le Covid. La saison qui vient recase du même coup des productions prévues, qui ont quelquefois été répétées sans voir le jour. Ce qui bouscule aussi les profils de saison prévus plusieurs années à l’avance.
Il faut aussi réaffirmer qu’une saison n’est jamais une succession de triomphes où l’on affiche complet, chaque saison a des échecs quelquefois cuisants. Mais surtout changer les habitudes du public, c’est long, cela dure plusieurs années, quelquefois plusieurs mandats. Genève doit à la fois modifier la couleur de son public, faire évoluer l’offre et garantir encore et toujours le niveau musical du théâtre qui est son ADN. Au total ça fait beaucoup dans la corbeille, cela veut dire tester, risquer, réussir (comme la récente Jenůfa) ou moins réussir, mais cela signifie aussi ne jamais faire de concessions à la qualité. Ce n’est pas une Tosca nouvelle qui fera venir le public régulièrement et remplir le théâtre, ce sera au mieux, une illusion sur un titre : c’est une qualité régulière, et un équilibre continu entre tous les critères qui doit être l’exigence.
C’est la qualité qui paie, et fait venir durablement le public, pas la multiplication des Puccini et Verdi. Et à Genève, la qualité est au rendez-vous.
La saison 2022-2023
Introduction
La saison dernière la thématique choisie était « Faites l’amour », cette année c’est « Mondes en migrations », on semble passer du rose au gris. Mais l’idée de la migration doit être reprise au sens large, migration des peuples, migration intérieure, migration symbolique etc… mais aussi voyages, errances et tous les récits qui les glorifient : Ulysse, le peuple juif, Parsifal, les migrations récentes en sont des exemples.
La thématique est élargie au ballet, où l’événement de l’année est la venue de Sidi Larbi Cherkaoui comme directeur du ballet de Genève, lui aussi un transplanté, belge d’origine marocaine, installé en Flandres qui arrive à Genève.
Le ballet
N’étant pas spécialiste du ballet, je m’abstiendrai de commenter la programmation du nouveau directeur du ballet Sidi Larbi Cherkaoui, avec qui Aviel Cahn a travaillé en Flandres. Mais je noterai plusieurs éléments :
- En s’installant à Genève, Sidi Larbi Cherkaoui qui est l’un des grands chorégraphes belges et une référence internationale, proche d’Aviel Cahn va contribuer à donner une couleur et une cohérence à l’ensemble de la programmation de la maison
- De plus, Sidi Larbi Cherkaoui est aussi un metteur en scène d’opéra (on lui doit par exemple une production de grand relief des Indes Galantes à Munich, bien supérieure à celle de Clément Cogitore à Paris et de Lydia Steier à Genève. Il devrait faire aussi de l’opéra à Genève, ce qui est aussi un gage d’originalité du Grand Théâtre que d’avoir dans ses murs un chorégraphe qui soit aussi metteur en scène lyrique.
- Enfin il a visiblement voulu la saison prochaine signer une saison de ballet qui ait des liens avec la thématique du voyage, mais résolument contemporaine et personnelle, en travaillant notamment avec son complice le chorégraphe Damien Jalet, pour affirmer d’emblée un style . Il sera toujours temps de modifier et d’infléchir les choses les saisons suivantes
Cette manière de tisser le lyrique et le ballet et de ne pas en faire des mondes simplement parallèles et autonomes, c’est aussi un élément d’enrichissement de la programmation. C’est pour moi un signe fort non seulement de la saison, non seulement pour le ballet, mais pour l’ensemble de cette maison que d’accueillir un des grands chorégraphes européens, qui puisse travailler en pleine « intercompréhension » avec Aviel Cahn. Ainsi Genève ne s’affiche pas seulement une machine à produire, mais d’abord comme une machine à créer.
Les productions lyriques :
Aviel Cahn propose des séries, des lignes de force, ce qui est aussi un moyen de conquérir d’autres publics, et d’enrichir la compétence des spectateurs. Dans des saisons de stagione, où ce qui est produit l’année X ne sera plus repris, ou ne se reverra pas avant au minimum plusieurs années, il faut créer d’autres habitudes. Les lignes de force, les compositeurs, les artistes qu’on retrouve, les équipes réinvitées, c’est un moyen de poser des pierres miliaires, comme des bornes d’orientation, c’est le cas par exemple de la présence répétée au programme de Janáček. De même faire appel pour certaines productions aux mêmes équipes, c’est aussi créer des repères au public, « le rassurer » en quelque sorte, et contribuer aux équilibres de la saison, à condition que les équipes soient évidemment indiscutables…
2021-2022 a affiché Prokofiev, Monteverdi, Donizetti, Bizet, R.Strauss, Eötvös, Janáček, Puccini.
2022-2023 affiche Halévy, Janáček, Monteverdi, Wagner, Donizetti, Jost, Chostakovitch, Verdi.
Il est certain qu’en huit ou neuf productions on ne peut couvrir l’intégralité du répertoire, y compris sur plusieurs saisons : dans les « musts » on passe de Strauss-Puccini la saison dernière à Verdi-Wagner cette saison et cette bande des quatre ne peut mobiliser chaque année la moitié des productions. Donizetti est aussi un pilier du répertoire, mais il y a des manières différentes d’affirmer une couleur : une année séparent La Juive (1835) de Maria Stuarda (1834), et donc le répertoire romantique occupe environ un quart des choix, et si on ajoute Parsifal et Nabucco le XIXe occupe la moitié des titres, le reste se divisant entre baroque (2), XXe siècle (2) et contemporain (1). La ligne de programmation reste donc une ligne de répertoire traditionnel.
On notera enfin une palette de choix assez subtile entre titres inconnus, titres attendus, créations dans une saison assez classique, convenant a priori au public genevois, et une grande prudence en ce qui concerne le nombre de représentations (environ 6 représentations par production) : le bassin genevois n’est pas extensible.
La saison 2022-2023 apparaît donc diversifiée, avec des distributions solides des artistes qui sont très connus mais très peu de stars (cette année Herlitzius, la saison prochaine Aušriné Stundyte), il serait peut-être pertinent d’afficher un peu plus de grandes références vocales, même s’il faut les retenir bien à l’avance et pas seulement dans des récitals. L’opéra, c’est aussi ce plaisir-là, et pas seulement une plongée dans le sérieux du monde…
N’oublions pas les effets de souvenir : on se rappelle les stars passées à Genève, notamment sous Gall, comme si elles passaient chaque soir alors que sous Gall il fallait aussi jouer sur des équilibres. Quant aux chefs, ils sont globalement de bon niveau – que je les apprécie ou non- et la nouvelle génération de chefs est suffisamment riche pour permettre à Genève d’être une sorte de rampe de lancement pour des figures nouvelles, à condition qu’on les repère. Cette fonction exploratoire dont je parlais plus haut s’applique aussi au choix des chefs, ce qui est peut-être le plus délicat.
Septembre 2022
Jacques Fromental Halévy
La Juive
(6 repr. du 15 au 28 sept )(Dir :Marc Minkowski /MeS : David Alden)
Avec Ruzan Mantashyan, John Osborn, Ioan Hotea, Elena Tsallagova, Dmitry Ulyanov
Chœur du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse Romande
Retour de La Juive, pas représentée au Grand Théâtre depuis 1927. Un des musts du XIXe et du début du XXe siècle dans tous les opéras francophones, indirectement célébrée par Proust (Rachel quand du Seigneur). Un retour que Paris a accueilli une fois en 2007, que Lyon a accueilli en 2016. Un Grand-Opéra légendaire, une histoire de tolérance et d’humanité, un énorme succès jusqu’aux années 1920 et une disparition à partir des années 1930, au moment de la montée du nazisme. Hasard ?
John Osborn qui fut un Leopold exceptionnel, chante cette fois Eleazar, et c’est un événement que cette prise de rôle. Ruzan Mantashyan entendue à Genève l’an dernier dans Guerre et Paix sera Rachel et Leopold est confié à Ioan Hotea, un jeune ténor roumain très prometteur, vainqueur du concours Operalia, à l’impeccable phrasé et aux aigus assurés (et nécessaires dans ce rôle). La vibrante Elena Tsallagova sera La princesse Eudoxie, tandis que Dmitry Ulyanov, grande basse devant l’éternel, sera le Cardinal de Brogni. Très belle distribution.
Mise en scène sans doute efficace sinon inventive de David Alden, spécialisé dans ce type de répertoire et surtout pas de risque d’écheveler ni de heurter le public en ce début de saison.
Marc Minkowski dirige ce Grand-Opéra, qui s’en est aussi fait une spécialité (rappelons ses Huguenots), j’aimerais un chef plus raffiné pour une musique qui est plus élégante qu’on ne le croit souvent. Mais on ne peut pas tout avoir. Et Minkowski est un nom qui peut attirer du public.
Ce devrait être de toute manière un beau début de saison et l’occasion de découvrir une œuvre injustement négligée depuis presque un siècle, qui grâce au livret de Scribe, dit des choses fortes sur notre humanité.
L’éclair
(18 septembre 2022 ) Dir : Guillaume Tourniaire.
Avec Éléonore Pancrazi, Claire de Sévigné, Edgardo Rocha, Julien Dran
Orchestre de Chambre de Genève
En prolongement de La Juive, Le GTG propose cet opéra-comique de Halévy, créé la même année (1835) en version de concert. L’idée est séduisante pour faire mieux connaître le compositeur, qui reste pour beaucoup un inconnu, à travers une œuvre qui eut son succès au XIXe.
L’histoire est celle d’un anglais et d’un américain amoureux de deux sœurs, mais l’un des deux hommes devient momentanément aveugle suite à la foudre (« l’éclair »), ce qui complique les choses.
L’Orchestre de Chambre de Genève entame une collaboration avec le Grand Théâtre qu’on espère voir se développer et Guillaume Tourniaire est un chef de très bonne facture.
Octobre-novembre 2022
Leoš Janáček
Katia Kabanova
(6 repr. du 21 oct. au 1er nov. 2022)(Dir : Tomáš Netopil /MeS : Tatjana Gürbaca)
Avec Corinne Winters, Aleš Briscein, Elena Zhidkova, Stephan Rügamer, Tómas Tómasson, Sam Furness
Chœur du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse Romande
Après la Jenůfa triomphale, et à peine six mois plus tard (toujours en 2022), Aviel Cahn repasse le plat Janáček avec de nouveau une mise en scène de Tatjana Gürbaca et Corinne Winters en héroïne. Quand on aime on ne compte pas. Mais on remarque d’autres noms excellents dans la distribution à commencer par la remarquable Elena Zhidkova qui sera Kabanicha, la belle-mère, et une brochette de remarquables chanteurs, Aleš Briscein, Stephan Rügamer, Tómas Tómasson, Sam Furness. Direction de Tomáš Netopil à prévoir correcte parce que c’est un bon chef, mais sans doute pas aussi imaginatif que Tomáš Hanus qui est l’un des artisans essentiels du triomphe de Jenůfa. Espérons que le succès de Jenůfa attire la curiosité du public pour ce troisième Janáček de l’ère Aviel Cahn et que le spectacle ait le même accueil.
Novembre 2022
Claudio Monteverdi et contemporains
Combattimento – Les amours impossibles
( 2 repr. les 6 et 7 nov. 2022.)(Dir : Christina Pluhar/Chorégraphie : Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustinjen)
Avec Rolando Villazon, Céline Scheen, Giuseppina Bridelli, Valer Sabadus, Krystian Adam…
Aviel Cahn propose à l’instar des années précédentes avec les tournées du Budapest Festival Orchestra dirigé par Ivan Fischer (Orfeo et Incoronazione di Poppea) au succès modéré. Cette fois, il appelle Rolando Villazon, le ténor bien connu qui s’est reconverti dans la répertoire baroque, et qui travaille avec la cheffe Christina Pluhar. Un « spectacle musical » et chorégraphique complété par des vidéos avec des chanteurs de très bon niveau, au-delà de Villazon… Mais soyons clairs, c’est un moyen d’afficher un titre supplémentaire à peu de frais, avec en plus une ex-star du firmament lyrique qui excitera la curiosité… Coup de dés sans grand risque.
Gaetano Donizetti
Maria Stuarda
(6 repr. du 17 au 29 déc. 2022 )(Dir : Stefano Montanari/MeS : Mariame Clément)
Avec Stéphanie d’Oustrac, Elsa Dreisig, Edgardo Rocha, Gianluca Buratto, Simone del Savio
Chœur du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse Romande
Aviel Cahn a installé à Genève, nous l’avons dit, des sortes de séries, des rendez-vous avec des artistes qui reviennent, manière éventuelle de fidéliser le public. Après Anna Bolena, Maria Stuarda avec la même équipe. Je n’ai pas aimé le travail de Mariame Clément dans Anna Bolena, j’ai eu quelques doutes sur le cast, et j’ai applaudi à la direction de Stefano Montanari, une véritable chance pour le GTG dans ce répertoire qui vient d’éblouir Munich dans une reprise d’Agrippina de Haendel, et nul doute qu’il animera l’entreprise (c’est à dire en sera l’âme). On retrouve Elsa Dreisig (qui reviendra, auréolée de ses triomphes berlinois dans Fiordiligi et de sa Salomé très attendue d’Aix) qui sera non Maria Stuarda mais Elisabetta (c’est la surprise du chef) tandis que Stéphanie d’Oustrac sera la reine d’Êcosse. Wait and see. Les rôles masculins seront tenus par de solides chanteurs.
C’est à la fois excitant, et en même temps je crains la déception… c’est la glorieuse incertitude de l’opéra.
Janvier-février 2023
Richard Wagner
Parsifal
(6 repr. du 25 janv. au 5 févr. )(Dir : Jonathan Nott/MeS : Michael Thalheimer)
Avec Daniel Johansson, Christopher Maltman, Tareq Nazmi, Tanja Ariane Baumgartner, Martin Gantner
Chœur du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse Romande
On se souvient que ce Parsifal a été victime du Covid, récupéré partiellement en forme de concert. Le voilà de nouveau programmé, pour le plus grand bonheur des nombreux wagnériens de Genève. L’histoire du Grand Théâtre est jalonnée de succès wagnériens notables. Certes, toutes les saisons ne peuvent afficher Wagner, mais c’est la première production wagnérienne d’Aviel Cahn et à ce titre, elle mérite une grande attention.
Si la direction est assurée par Jonathan Nott, le directeur musical de l’OSR, la mise en scène est confiée à un artiste très connu en Allemagne, mais pratiquement inconnu en aire francophone : Michael Thalheimer. Il ne faut pas attendre une lecture qui bousculera le public genevois, mais Thalheimer est un metteur en scène de théâtre solide, où il est plus connu qu’à l’opéra (j’avais vu de lui Les Troyens , une production très épurée à Hambourg). C’est une sorte d’ascète de la scène : Parsifal devrait lui convenir.
Je ne suis pas convaincu par le choix de confier Parsifal à Daniel Johansson, chanteur très honnête, mais qui n’a jamais transfiguré les rôles où je l’ai entendu. Bien plus excitant la prise de rôle en Amfortas de Christopher Maltman, un des barytons les plus intéressants du jour, et un acteur exceptionnel dans les rôles de personnages torturés. Kundry sera Tanja Ariane Baumgartner, qu’on a vue en Clytemnestre cette saison, et qui est une véritable actrice (on va attendre avec avidité son deuxième acte). Intéressant aussi le choix de confier Gurnemanz à Tareq Nazmi, une des basses les plus intéressantes du jour, qu’on a bien connu quand il était en troupe à Munich et qui commence à être invité dans des rôles de plus en plus importants. Enfin, Martin Gantner sera Klingsor, ce très bon baryton (il est un Beckmesser remarquable) devrait trouver une voix intéressante d’interprétation du personnage. Au total, c’est un Parsifal très solide par des choix de distribution originaux, sans être capable sur le papier de faire courir les foules wagnériennes d’Europe. Mais ce n’est sans doute pas le but…
Février-mars 2023
Claudio Monteverdi
Il ritorno di Ulisse in patria
( 6 repr. du 27 févr. au 7 mars )(Dir : Fabio Biondi/MeS : FC Bergman)
Avec Marc Padmore, Sara Mingardo, Jorge Navarro Colorado, Elena Zilio etc…
L’Europa Galante
On s’intéresse beaucoup en ce moment et dans pas mal de maisons à Monteverdi et notamment à Ulisse, le troisième opéra après L’Orfeo et l’Incoronazione di Poppea. Dans la vaste salle du Grand Théâtre, c’est peut-être une gageure, mais on y a vu de grandes réussites baroques.
Pour ma part, j’estime que c’est un des projets les plus convaincants, sinon le plus convaincant de la saison, aussi bien musicalement que scéniquement. Appeler FC Bergman, le groupe flamand anarchiste et poétique, c’est à la fois audacieux et stimulant pour une œuvre difficile, dramaturgiquement moins stimulante que Poppea par exemple. Douce folie poétique sur scène, et en fosse l’un des meilleurs orchestres baroques de la baroquie européenne, et l’un des premiers ensembles italiens à s’imposer à sa fondation au moment même où c’est le Nord de l’Europe et la France qui tenaient le haut du pavé. Le sicilien Fabio Biondi, le fondateur, sera en fosse : c’est un vrai cadeau pour les genevois que cet orchestre et cette équipe de mise en scène. La distribution ne sera pas en reste : avec de grandes vedettes du chant baroque comme Mark Padmore (irremplaçable interprète des Passions de Bach) et Sara Mingardo, qui reste l’une des références de ce répertoire. Et remarquons dans la distribution Elena Zilio (Ericlea, la nourrice de Pénélope) gloire du chant italien des années 1980, qui ne fut jamais dans les grands rôles, mais irremplaçable là où elle était distribuée. Voilà une production où l’on reconnaît une vraie patte, et voilà ce qu’on aimerait voir plus souvent à Genève.
Mars-avril 2023
Christian Jost
Le voyage vers l’espoir
( 5 repr. du 28 mars au 4 avril)(Dir: Gabriel Feltz/MeS : Kornél Mundruczó)
Avec Kartal Karagedik, Rihab Chaieb, Ivan Thirion, Denzil Dehaene
Orchestre de la Suisse Romande
Encore une victime du Covid, cette production était prévue dès la première saison d’Aviel Cahn, et elle a été passée par profits et pertes à cause de la fermeture des théâtres. Bien heureusement, comme Parsifal, cette production réapparaît deux ans après. Elle traite d’un problème hélas d’une tragique actualité, la migration, à travers une famille kurde qui quitte son pays pour gagner la Suisse, un supposé paradis. L’œuvre est fondée sur le film de Xavier Koller, prix au festival de Locarno 1990, et Oscar du meilleur film étranger en 1991.
Le compositeur Christian Jost, compositeur de 9 opéras, dont un Hamlet pour la Komische Oper Berlin et un Egmont pour le Theater an der Wien. Le dixième est donc cet opéra, fondé sur l’histoire du film de Koller.
La mise en scène est confiée à Kornél Mundruczó, lui-même cinéaste, pour sa troisième mise en scène à Genève après ses deux belles productions que sont L’Affaire Makropoulos en 2020 et Sleepless en 2022. Mundruczò commence à essaimer les scènes européennes, comme Hambourg, Munich, Berlin.
C’est l’excellent chef Gabriel Feltz, GMD de Dortmund, qui dirigera, et c’est un nouveau profil pour Genève, un de ces chefs qui dirigent partout en Allemagne, mais peu à l’étranger plutôt attiré à l’opéra par le XXe siècle et le contemporain. Dans la distribution, notons Kartal Karagedic, que j’avais beaucoup apprécié en Chorèbe dans Les Troyens à Hambourg, où il est membre de la troupe.
Ce sont des ingrédients qui devraient garantir une production intéressante.
Mai 2023
Dmitry Chostakovitch
Lady Macbeth de Mzensk
(5 repr. du 30 avril au 9 mai )(Dir : Alejo Pérez/MeS : Calixto Bieito)
Avec Aušriné Stundyte, Dmitry Ulyanov, John Daszak, Ladislav Elgr, Kai Rüütel etc…
Chœur du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse Romande
Une fois de plus Aviel Cahn propose des rendez-vous répétés avec des séries, comme nous l’avons déjà souligné, puisque la série russe est marquée par le couple Alejo Pérez, excellent chef qui a convaincu dans Guerre et Paix, et la production déjà ancienne (2014) de Calixto Bieito, venue du OperaBallet Vlaanderen qui avait saisi le public par son univers apocalyptique fait de violence et de sexe. Accueil triomphal à l’époque.
Dans le rôle-titre, la Katerina du moment, qui l’interprète sur toutes les scènes, Aušriné Stundyte, fabuleuse dans les mains de Calixto Bieito. Aucune hésitation, c’est une production phénoménale qui fit date. La revoir à Genève est une chance.
Juin 2023
Giuseppe Verdi
Nabucco
( 8 repr. du 11 au 29 juin )(Dir: Antonino Fogliani/MeS: Christiane Jatahy)
Avec Simone Alaimo, Saioa Hernandez, Riccardo Zanellato, Davide Giusti, Ena Pangrac
Chœur du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse Romande
Une prise de rôle est un événement et quand il s’agit de Nicola Alaimo, l’un des plus grands barytons italiens, spécialiste de Rossini et de Bel Canto, qui aborde Nabucco, il faut se précipiter. Saioa Hernandez sera sans nul doute une Abigaille solide. Zanellato n’était pas en grande forme ces derniers mois, espérons qu’il se sera repris car c’est une grande basse. Et Antonino Fogliani est l’un des chefs italiens à suivre en ce moment.
Reste la mise en scène.
Elle est confiée – et c’est une excellente idée – à la brésilienne vivant en France Christiane Jatahy, l’une des artistes les plus intéressantes du théâtre aujourd’hui, qui use avec intelligence et finesse de la vidéo, et qui après un Fidelio à Rio de Janeiro, aborde de nouveau un opéra monumental s’il en est, l’un des musts de Verdi. Si la production est réussie, sa carrière sera sans doute lancée à l’opéra.
Alaimo et Jatahy, deux motifs puissants pour faire de ce Nabucco la deuxième nouvelle production totalement stimulante de la saison.
Au total, aucun des titres, aucune des productions n’est dénuée d’intérêt, soit par la rareté, soit par les choix artistiques, chacune se justifie.
Mais pour ma part, trois me rendent impatient : Il ritorno di Ulisse in patria, Lady Macbeth de Mzensk et Nabucco.
Concert du Nouvel An
Marina Viotti, Stanislas de Barbeyrac
Marc Leroy
Orchestre de chambre de Genève
Deuxième concert avec l’Orchestre de chambre de Genève dirigé par Marc Leroy pour le Nouvel An avec deux des voix les plus intéressante du panorama aujourd’hui, Marina Viotti, mezzo de plus en plus réclamée et particulièrement musicale, figlia d’arte puisque fille du chef suisse Marcello Viotti et sœur de Lorenzo Viotti. Mais si elle a un nom effectivement connu, elle s’est fait un très solide prénom.
Et puis le ténor français mozartien (et bientôt beethovénien) Stanislas de Barbeyrac, une des voix françaises les plus en vue, et les plus intéressantes.
Joli cadeau pour le Nouvel An
Récitals
Diana Damrau (24 septembre)
Bryn Terfel (26 novembre)
Nina Stemme (4 février)
Simon Keenlyside (4 mars)
Anne Sofie von Otter (16 juin)
C’est courageux dans la période actuelle de programmer une série de récitals, un art qui peine à survivre hors du monde germanophone, même si tous les chanteurs invités sont des stars. L’art du récital est très spécifique : on a vu certains s’écrouler en récital alors qu’ils dominaient les scènes. Bien sûr, il faudra aller écouter Bryn Terfel, l’un des phares de l’opéra des vingt dernières années, les stars Damrau et Stemme, et d’authentiques spécialistes de la mélodie, Anne Sofie von Otter et Simon Keenlyside (qui se souvient de son Pelléas magique à Genève ?) savent installer un univers et une chaleur dans une salle quand ils abordent la mélodie.
Un choix équilibré, qui justifie qu’on aille à chaque concert, mais on aimerait aussi voir l’une de ces stars dans une production d’opéra… Genève le vaut bien.