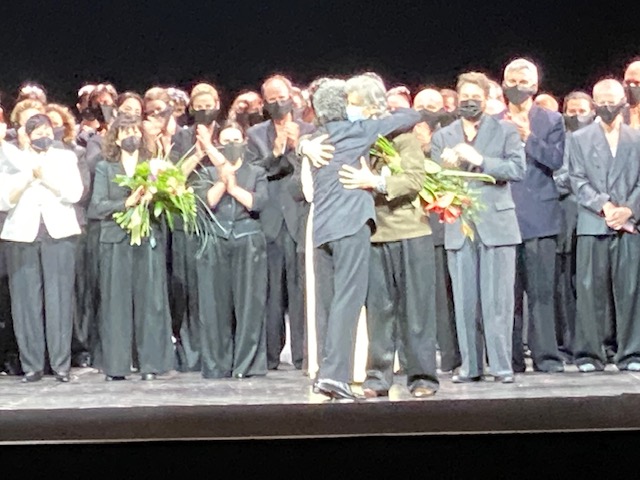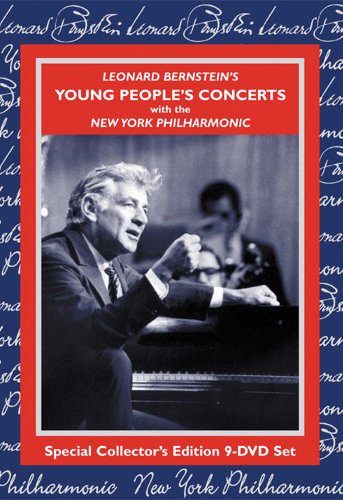C’est la troisième saison d’Alexander Neef à Paris. Cela signifie que désormais un certain nombre de points sont repérables dans sa politique, tant au niveau du répertoire que des distributions.
La maison n’est pas facile, on le sait pour des raisons qui tiennent à son gigantisme, avec ses deux théâtres là où un seul suffirait à n’importe quelle capitale, son corps de ballet pléthorique qui n’a pas vécu des jours si heureux ces dernières années, un public assez peu ouvert et un État qui traine l’institution comme un boulet. À tout cela s’ajoutent les déficits qu’il faut combler depuis le Covid et les grèves.
Visiblement Alexander Neef est un homme discret et résiliant, qui ne s’étale pas dans les médias et qui semble faire régner à l’intérieur de l’institution une ambiance plutôt apaisée, ce qui, compte tenu de l’histoire de la maison, est tout à son avantage.
Les difficultés inhérentes à l’Opéra de Paris ces dernières années n’ont pas vraiment suscité des saisons attirantes, quelques perles sur un tas d’ennui. La Saison 2023-2024 est plus riche de promesses, tant sur le lyrique que sur le ballet, dirigé désormais par José Martinez après l’heureux départ d’Aurélie Dupont.
Le lyrique
20 productions se divisant comme suit :
8 Nouvelles productions :
- Adès : The exterminating Angel
- Bellini: Beatrice di Tenda
- A. Charpentier : Médée
- Massenet : Don Quichotte
- Mozart : Don Giovanni
- Spontini: La Vestale
- Wagner: Lohengrin
- Weill : Street scene (Scène de rue)
12 Reprises :
- Cilea: Adriana Lecouvreur
- Donizetti : Don Pasquale
- Haendel : Giulio Cesare
- Janaček : L’Affaire Makropoulos
- Massenet : Cendrillon
- Mozart : Cosi fan tutte
- Offenbach : Les Contes d’Hoffmann
- Puccini : Turandot
- Ravel : Ma mère L’Oye/L’enfant et les Sortilèges
- Strauss (R) : Salomé
- Verdi : Simon Boccanegra
- Verdi : La Traviata
6 ouvrages en français, 9 en italien, 2 en anglais, 1 en tchèque, 2 en allemand
Parmi eux quatre appartiennent au répertoire des XVIIe et XVIIIe, 9 au XIXe siècle, et quatre au XXe siècle. Prudemment Alexander Neef ne va pas au-delà de 1947 (Street Scene).
Il s’agit de conjuguer goûts du public et une variété suffisante dans la programmation pour défendre une valence culturelle que cette maison doit défendre. Il semble que ce soit assez réussi.
NOUVELLES PRODUCTIONS
Septembre-octobre 2023
W.A.Mozart, Don Giovanni
13 repr. du 13 sept au 12 oct – Dir : Alexander Soddy/MeS : Claus Guth
Avec Peter Mattei (A) / Kyle Ketelsen (B) Adela Zaharia (A) / Julia Kleiter(B), Ben Bliss(A) / Cyrille(B)Dubois, John Relyea, Gaelle Arquez(A) / Tara Erraught(B),,Alex Esposito(A) / Bogdan Talos(B), Guilhem Worms, Ying Fang / Marine Chagnon
Opéra-Bastille
L’Opéra de Paris avait une production de l’époque Mortier tout à fait remarquable qui pouvait durer des années, celle de Michael Haneke crée en 2006. Inexplicablement Stéphane Lissner a voulu une nouvelle production, signée Ivo van Hove, sans aucun intérêt sinon catastrophique en 2019.
Alors Alexander Neef propose une nouvelle production qui n’a de nouvelle que de nom puisqu’elle a été créée à Salzbourg en 2008, c’est-à-dire à peu près contemporaine de celle de Haneke. Signe particulier : c’est sans doute la meilleure production de Don Giovanni qu’on ait fait depuis une vingtaine d’années. Et quand on sait combien l’opéra des opéras est difficile à mettre en scène…
Toutefois, c’est une production qui faisait son effet dans une plus petite salle (au Haus für Mozart de Salzbourg ), ici proposée sur l’immense plateau de Bastille, ce qui laisse supposer qu’elle sera revue.
Musicalement on entendra en fosse Alexander Soddy, le chef britannique qui a fait l’essentiel de sa carrière en Allemagne et Autriche et qui jusqu’à 2022 a été directeur musical au Nationatheater de Mannheim, une baguette dont on dit grand bien.
Et sur scène deux distributions l’une (A) dominée par le couple Peter Mattei/Alex Esposito avec des voix jeunes et intéressantes (Adela Zaharia, Ben Bliss), l’autre par le Don Giovanni de Kyle Ketelsen entouré de Cyrille Dubois, Tara Erraught, Julia Kleiter. Ce qui n’est pas mal non plus. À noter que Peter Mattei était déjà Don Giovanni en 2006 avec Haneke, il y a 17 ans… La mise en scène de Guth devrait fonctionner avec ce Don Giovanni plus mûr…
Aucune hésitation, il faut y courir même si on peut supposer qu’une certaine partie du public recevra l’arrêt d‘autobus de Claus Guth avec des huées, mais à Paris, le bon goût et l’intelligence se font toujours entendre.
Richard Wagner, Lohengrin
9 repr. du 23 sept au 27 oct – Dir : Gustavo Dudamel/ MeS : Kirill Serebrennikov
Avec Piotr Beczala, Johanni van Oostrum / Sinead Campbell Wallace,
Kwangchul Youn, Wolfgang Koch, Nina Stemme/ Ekaterina Gubanova, Shen Yang
Opéra-Bastille
On ne chôme pas à Paris en automne, deux premières d’importance en septembre, il est vrai que l’usine à productions qu’est Bastille le permet.
Deuxième incursion wagnérienne du directeur musical Gustavo Dudamel après un Tristan diversement accueilli. Wait and see. Après avoir traité du papa Parsifal à Vienne dans une production qui a marqué, Kirill Serebrennikov, désormais exilé en Europe occidentale s’occupe de Lohengrin, le fils. Évidemment, c’est une production qu’on ratera difficilement, même si la production de Claus Guth, coproduite avec la Scala, était une grande mise en scène et pouvait être reprise, mais deux fois Claus Guth dans le même mois, c’est sans doute dangereux pour les accidents cardiaques de certains. Il n’est pas sûr que Kirill Serebrennikov les rassérène…
Distribution très solide, avec le Lohengrin n°2 (le n°1, c’est Vogt) des scènes lyriques, Piotr Beczala, belle voix, beau contrôle, mais pas très vibrant. Plus vibrante à prévoir la Elsa de Johanni van Oostrum qui a triomphé à Munich cette saison, en alternance avec l’irlandaise Sinéad Campbell-Wallace, avec par ailleurs Wolfgang Koch et Nina Stemme (en alternance avec Ekaterina Gubanova) dans Telramund/Ortrud. Du très haut niveau, du référentiel, et tout le monde viendra car c’est immanquable.
Février-mars 2024
Vincenzo Bellini, Beatrice di Tenda
8 repr. du 9 fév au 7 mars. – Dir : Mark Wigglesworth/MeS : Peter Sellars
Avec Quinn Kelsey, Tamara Wilson, J’Nai Bridges, Pene Pati, Amitai Pati.
Opéra-Bastille
Une excellente idée que d’exhumer Beatrice di Tenda de Bellini, qui entre au répertoire de l’Opéra de Paris, et qui n’eut aucun succès à la création à Venise en 1833. Pour célébrer l’événement on fait appel à Peter Sellars, un nom légendaire qui peut encore étonner (voir sa Clemenza di Tito salzbourgeoise). Sans préjuger de la qualité de la distribution, je déplore profondément que le tropisme désespérément anglo-saxon du casting-management parisien n’ait pas trouvé un chef italien pour diriger cette œuvre, il y en a, et d’excellents, mais visiblement, ils ne s’y intéressent pas à Paris, et la distribution est du même acabit, avec Tamara Wilson, grande voix pas trop belcantiste (mais puisqu’on chante le bel canto comme Verdi aujourd’hui cela n’a aucune importance, d’autant que cette musique sera accueillie à Bastille…) et Queen Kelsey, dont je ne pense pas de bien mais qui qui est le « grand » baryton américain pour le répertoire italien, alors ça s’impose évidemment. Il y a Pene Pati, certes, pas plus italien, mais avec du style, au moins.
À voir évidemment, car c’est une occasion unique de découvrir ce chef d’œuvre.
À noter que Beatrice di Tenda est donné à Naples en version de concert, le 23 septembre 2023, dirigé par Giacomo Sagripanti, avec une distribution pas plus italienne d’ailleurs (mais dont plusieurs font essentiellement carrière en Italie), mais avec des stylistes Andrzej Filonczyk, Jessica Pratt, Matthew Polenzani. Écoutez Andrzej Filonczyk, fabuleux baryton, et comparez avec celui que nous sert Paris…
Thomas Adès, The exterminating Angel
7 repr. Du 29 fév. au 23 mars (Dir : Gustavo Dudamel/MeS : Calixto Bieito)
Avec Jacquelyn Stucker, Caroline Wettergreen, Anna Prohaska, Nicky Spence, Philippe Sly, Rodney Gilfry, Frédéric Antoun etc…
Opéra-Bastille
Poursuivant son exploration du répertoire récent anglo-saxon non encore présenté à Paris, après Bernstein (A quiet place), après Adams (Nixon in China), voici The exterminating Angel de Thomas Adès, créé en 2016 à Salzbourg d’après le film de Buñuel et qui fait le tour de toutes les bonnes maisons, parce que sa musique, très contemporaine, est accessible au plus grande nombre… En fosse Gustavo Dudamel qui fait une double opération ; d’une part il attire le public sur un titre pas vraiment connu et d’autre part, il ne risque pas les comparaisons dans ce répertoire (il risquera plus avec Lohengrin, mais on ne peut pas tout avoir…), c’est sa deuxième et dernière apparition dans la saison parisienne dans un opéra…
De beau noms dans la distribution, Wettergreen , Antoun, Gilfry, Sly. Et à la mise en scène, Calixto Bieito, capable en ce moment du meilleur (Guerre et Paix à Genève) comme du pire.
De toute manière, il ne faut pas manquer les opéras à découvrir. Alors, gageons que le public viendra.
Avril 1993
Kurt Weill, Street scene (scène de rue)
5 repr. Du 19 au 27 avtil – Dir : Yshani Perinpanayagam /MeS : Ted Huffman
Avec les artistes de l’Académie de l’Opéra National de Paris
Cet opéra comédie musicale à mi-chemin entre l’opéra de Quat’sous et West Side Story est la marque des efforts de Kurt Weill de produire une musique qui fusionne les traditions européennes et américaines, c’est en tous cas une excellente initiative de l’Opéra que d’offrir un Kurt Weill qui soit « détaché » de son travail avec Brecht, un Kurt Weill de l’exil.
Ted Huffman aime ce type de répertoire et aime travailler avec des jeunes chanteurs (voir sa Poppea d’Aix), et on découvrira une jeune cheffe qui est aussi compositrice et très en phase avec les musiques d’aujourd’hui. Tous les ingrédients sont là pour intéresser un public curieux. Mais ira-t-il jusqu’à Bobligny ?
Musiciens du CNSM
MC93, Bobligny
Avril-mai 2024
Marc Antoine Charpentier, Médée
12 repr. du 10 avril au 11 mai. – Dir : William Christie/MeS : David Mc Vicar
Avec Léa Desandre, Reinoud van Mechelen, Laurent Naouri, Ana Vieira Leite, Gordon Bintner, Emmanuelle Negri, Élodie Fonnard, Lisandro Abadie, Julie Roset, Mariasole Mainini
Orchestre Les Arts Florissants
Palais Garnier
Dans l’exploration du répertoire baroque, cette Médée a une place à part, dans la mesure où c’est le seul opéra de Marc-Antoine Charpentier, créé en 1693 à l’Académie Royale de Musique et pas représentée à l’Opéra depuis. Le livret de Thomas Corneille garantit un texte puissant, Thomas Corneille vit à l’ombre de la gloire de son frère Pierre, mais reste l’un des grands dramaturges du XVIIe. Confiée à William Christie, la production fleurera bon son baroque « historique » et avec David Mc Vicar, on ne risque pas grand chose en matière de vision scénique innovante, c’est le type de metteur « moderne » qui ne fait peur à personne, tant il est « conforme ». La distribution comporte des noms flatteurs de Naouri à Negri en passant par Van Mechelen, avec en Médée Lea Desandre, dont la brochure de l’Opéra valorise la relative jeunesse (la trentaine), marquant là une ignorance coupable. Tout comme Phèdre, Médée passe pour une matrone. Phèdre dont le film de Pierre Jourdan avec Marie Bell a fait un mal fou aux représentations de l’héroïne, la faisant passer pour une vieille dame prise du démon de l’amour pour la jeunesse. Médée, c’est pareil parce qu’on a en tête le film de Pasolini avec Callas.
En réalité, Phèdre comme Médée sont des êtres jeunes, des jeunes filles piégées, et enlevées à leur bonheur, Phèdre a toute légitimité à tomber amoureuse d’un Hippolyte qui a à peu près son âge, et Médée a de tout jeunes enfants. Pourquoi en faire des dames mûres ? Pour en faire des monstres ? Non ce sont pas des monstres, mais des victimes. Pour le reste, le retour de Médée à l’Opéra de Paris, sa maison, ne se rate pas.
Mai-juin 2024
Jules Massenet, Don Quichotte
11 repr. du 10 mai au 11 juin – Dir : Mikhail Tatarnikov/MeS : Damiano Michieletto
Avec Marianne Crebassa, Ildar Abdrazakov / Ildebrando d’Arcangelo, Étienne Dupuis, Emy Gazeilles, Marine Chagnon, Maciej Kawsnikowski, Nicholas Jones
Opéra-Bastille
Retour de Don Quichotte de Massenet, que j’avais découvert dans la belle production de Piero Faggioni avec les superbes Ruggero Raimondi et Gabriel Bacquier sur la scène de Garnier. On se souvient moins que Nicolai Ghiaurov, Viorica Cortez et Robert Massard incarnèrent les trois héros dans une production de Peter Ustinov, et aussi sous la direction de Georges Prêtre, En 2000 et 2001, Don Quichotte fut confié à Samuel Ramey et à José Van Dam dans la production de Gilbert Deflo. C’est dire que l’Opéra depuis cinquante ans a produit trois productions de Don Quichotte (c’est beaucoup), avec les plus grandes basses de l’époque. Voilà donc a priori une œuvre très bien servie mais qui à chaque fois n’a jamais été reprise, ni celle d’Ustinov, ni celle de Faggioni et celle de Deflo une seule fois.
Il faut souhaiter un autre destin à celle de Damiano Michieletto, qui offre dans sa distribution la basse la plus en vue actuellement, Ildar Abdrazakov en alternance avec un autre grand Ildebrando d’Arcangelo : la tradition est donc respectée avec Etienne Dupuis en Sancho et Marianne Crebassa en Dulcinée.
En fosse Mihail Tatarnikov, qui est un bon chef, mais était-il nécessaire d’aller chercher si loin ?
Gaspare Spontini, La Vestale
9 repr. Du 15 juin au 11 juillet. – Dir : Bertrand de Billy/MeS : Lydia Steier
Avec Michael Spyres, Julien Behr, Jean Teitgen, Florent Mbia, Elza van den Heever, Ève-Maud Hubeaux
Opéra-Bastille
Voilà un titre complètement disparu des grimoires de l’Opéra de Paris, que je n’ai vu qu’une fois à La Scala dirigé par Riccardo Muti dans une pâle mise en scène de Liliana Cavani. La Scala elle-même l’avait déjà remonté pour Callas en 1954. C’est dire quelle personnalité nécessite le personnage principal de Julia.
Spontini, compositeur favori de Napoléon, italien écartelé entre Berlin et Paris, qui a retenu notamment les leçons de Gluck et précurseur d’un certain type de Grand-Opéra revient donc à Paris par la grande porte et c’est heureux. Que Bertrand de Billy dirige est aussi un bon choix, il est plutôt bienvenu dans le répertoire XIXe, que Lydia Steier mette en scène, c’est plus désolant. Après sa Salomé imbécile qu’on va d’ailleurs revoir cette saison à Paris (et d’autres productions massacrées du même acabit), elle s’intéresse à cet autre destin de femme sacrifiée. À tout prendre il vaudrait mieux qu’elle regarde ailleurs, mais elle est désormais à la mode, alors on la voit un peu partout en Europe, en plus, c’est une américaine, et donc parée de toutes les vertus pour le staff parisien. Mais peut-être réussira-t-elle ? Qui sait ?
En revanche, belle distribution (Michael Spyres en Licinio et Van der Heever en Julia notamment). L’œuvre qui sera sans doute musicalement très bien défendue mérite la visite à Paris
REPRISES
Septembre -Octobre
Gaetano Donizettti, Don Pasquale
9 repr.. du 14 sept au 15 oct – Dir : Speranza Scappucci/ MeS : Damiano Michieletto
Avec Laurent Naouri, Florian Sempey, René Barbera, Julie Fuchs, Slawomir Szychowiak
Palais Garnier
Production tiroir-caisse.
Pure reprise de répertoire, pour remplir des caisses qui en ont bien besoin, avec une distribution solide dominée par Naouri et Sempey, et l’Adina de ma ravissante Julie Fuchs. J’ai moins d’attente pour René Barbera, jamais indigne cependant. En fosse, Speranza Scappucci, a toujours beaucoup de succès.
Octobre 2023
Leos Janáček, L’Affaire Makropoulos
5 repr. du 5 au 17 oct – Dir : Susanna Mälkki/MeS : Krzysztof Warlikowski
Avec Kartita Mattila, Pavel Černoch, Cyrille Dubois, Nicholas Jones, Károly Szemerédy, Johan Reuter etc…
Opéra-Bastille
Reprise de la production désormais culte de Warlikowski, pour qui aime King Kong et la mythologie cinématographique américaine avec une chanteuse aussi culte, Karita Mattila qui promène le rôle depuis longtemps et qui lui donne un relief incroyable, autour d’elle Pavel Černoch, toujours excellent, Cyrille Dubois et Károly Szemerédy notamment. Et en fosse, Susanna Mälkki, un choix idéal pour Janáček. Une reprise qui devrait attirer : Mattila en Emilia Marty, cela ne se manque pas.
Octobre-novembre 2023
Jules Massenet, Cendrillon
8 repr. du 25 oct au 16 nov – Dir : Keri-Lynn Wilson/MeS : Mariame Clément
Avec Jeanine de Bique, Daniela Barcellona, Paula Murrihy, Caroline Wettergreen Emy Gazeilles, Marine Chagnon, Laurent Naouri, Philippe Rouillon. Luca Sannai. Laurent Laberdesque. Fabio Bellenghi, Corinne Talibart.
Opéra Bastille
Deux Massenet en une saison qui ne soient ni Manon ni Werther, c’est signe que le répertoire s’étoffe. Distribution solide dominée par Jeanine de Bique dans la production sage et bien accueillie de Mariame Clément, dirigée par Keri-Lynn Wilson, tout c ela est bien pensé et (presque) bien-pensant : on aura constaté que les trois première reprises de la saison sont dirigées par des cheffes, ce qui est très bien, mais pas une seule Nouvelle production, ce qui l’est moins, si l’on excepte Street Scene, le spectacle de l’académie…
Novembre 2023
Giacomo Puccini, Turandot
13 repr. du 6 au 29 nov – Dir : Marco Armiliato – Michele Spotti/ MeS : Robert Wilson
Avec Sondra Radvanovsky(A)/Tamara Wilson(B), Brian Jagde(A) / Gregory Kunde(B), Ermonela Jaho(A) / Adriana Gonzalez(B), Carlo Bosi, Mika Kares, Florent Mbia, Maciej KawSnikowski, Nicholas Jones, Guilhem Worms, Fernando Velasquez, Pranvera Lehnert, Izabella Wnorowska-Pluchart
Opéra Bastille
Production tiroir-caisse
On va donc entendre Tamara Wilson dans Turandot aussi bien que dans Beatrice di Tenda (qui pour mémoire a été chanté par Mirella Freni… qui n’a jamais chanté Turandot…) c’est la science du grand écart, mais peu importe. Sondra Radvanovsky a abordé désormais Turandot, n’ayant plus rien à prouver dans le reste du répertoire. Jaho en Liù c’est magnifique, Jagde en Calaf, c’est bien pâle, on préfèrera Kunde. Deux distributions, la A avec Radvanoivsky/Jaho, la B avec Kunde. Choix cornélien.
Au niveau de la mise en scène, c’est du Wilson des familles, et donc plus aucun intérêt, mais dans la fosse, une alternance entre Marco Armiliato, bon chef italien de répertoire qu’on connaît bien, et Michele Spotti, excellent jeune chef qu’il sera intéressant d’aller entendre. On privilégiera donc les cinq soirées entre le 22 et le 29 novembre.
Novembre-décembre 2023
Jacques Offenbach, Les Contes d’Hoffmann
10 repr. du 30 nov au 24 déc. – Dir: Eun Sun Kim/MeS: Robert Carsen
Avec Benjamin Bernheim/ Dmitry Korchak, Pretty Yende, Antoinette Dennefeld, Rachel Willis-Sørensen. Christian van Horn, Leonardo Cortellazzi, Christophe Mortagne, Cyrille Lovighi, Christian Rodrigue Moungoungou, Vincent Le Texier, Angela Brower, Sylvie Brunet-Grupposo, Alejandro Baliñas Vieites
Opéra-Bastille
Production tiroir-caisse.
Que ferait l’opéra-Bastille sans cette production des Contes d’Hoffmann signée Robert Carsen 23 ans d’âge (première en 2000) ? Efficace, bien faite, tranquille, remontant à l’époque où Carsen faisait du Théâtre dans le théâtre. C’est la neuvième reprise…
Et pourtant, avant Carsen, ; il y eut Roman Polanski, Jean-Pierre Ponnelle et Patrice Chéreau (l’un de ses grands chefs d’œuvre à l’opéra). L’œuvre est bien servie, sans aucun doute.
La production est solidement distribuée aussi (on préfèrera Bernheim à Korchak cependant), et dirigée par la désormais spécialiste des reprises de répertoire dans les grands théâtres européens Eun Sun Kim, quatrième cheffe à diriger une reprise dans la saison.
Novembre-décembre 2023
Maurice Ravel, Ma Mère l’Oye / L’Enfant et les sortilèges
8 repr. du 21 nov au 14 déc. Dir : Patrick Lange / Chor. Martin Chaix:, MeS : Richard Jones/Antony McDonald
Avec les artistes en résidence à l’Académie et les élèves de l’école de danse de l’Opéra National de Paris
Palais Garnier
Une chorégraphie de Martin Chaix ad hoc pour les élèves de l’école de danse et une œuvre lyrique qui convient idéalement aux élèves de l’Académie, dans une mise en scène qui a déjà fait ses preuves (c’est la cinquième reprise depuis 1998. Un spectacle frais pour les jeunes pousses de l’Opéra qu’il faut aller encourager avec en fosse l’excellent Patrick Lange.
Janvier-février 2024
Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur
8 repr. Du 16 janv au 7 fév. – Dir : Jader Bignamini/MeS : David Mc Vicar
Avec Anna Netrebko / Anna Pirozzi, Yusif Eyvazov / Giorgio Berrugi, Ekaterina Semenchuk / Clémentine Margaine, Ambrogio Maestri, Sava Vemic, Leonardo Cortellazzi, Alejandro Baliñas Vieites, Nicholas Jones, Marine Chagnon, Ilanah Lobel-Torres, Se-Jin Hwang
Opéra-Bastille
Reprise Tiroir-caisse en or
Que souhaitez-vous Madame Netrebko ? Votre mari ? Mais bien sûr !
Votre chef favori Jader Bignamini ? Mais comment donc ! Et voilà l’affaire est faite.
Pour le reste, en distribution B, Anna Pirozzi, pas si mal, Giorgio Berrugi, qu’on commence à entendre souvent en Italie, et Clementine Margaine, qu’on va peut-être finir à considérer : elle est la Fidès du jour, l’Azucena du jour, mais on lui préfère Semenchuk pour voisiner la Netrebko…
Laissons cela.
Bignamini n’est pas un mauvais chef, Mc Vicar est comme toujours sans intérêt, mais l’intérêt est ailleurs, vous l’aurez bien compris…
Giuseppe Verdi, La Traviata
12 repr. du 25 janv au 25 fév. – Dir : Giacomo Sagripanti/MeS : Simon Stone
Avec Nadine Sierra / Pretty Yende (25 fév.), Marine Chagnon, Cassandre Berthon, René Barbera, Ludovic Tézier, Maciej Kawsnikowski, Alejandro Baliñas Vieites, Florent Mbia, Hyun-Jong Roh, Olivier Ayault, Pierpaolo Palloni
Opéra-Bastille
Reprise Tiroir-Caisse
Enfin la raison s’impose. Cette production avait été créée au Palais Garnier pour seulement 2000 spectateurs. Traviata c’est fait pour les 2700 spectateurs de Bastille et 12 représentations, dont étrangement une seule le 25 février, avec la créatrice de la production, Pretty Yende. On y retrouve Ludovic Tésier, immense, et en Alfredo René Barbera, gentillet, et pour les onze autres représentations, la délicieuse Nadine Sierra.
En fosse, Giacomo Sagripanti qui n’est pas le meilleur des chefs italiens de répertoire d’aujourd’hui, mais on n’est pas à ça près. Et la production de Simon Stone s’installe dans le paysage, à Vienne comme à Paris.
Georg Friedrich Haendel, Giulio Cesare
12 repr. Du 20 janv au 16 fév. – Dir : Harry Bicket/MeS : Laurent Pelly
Avec Emily d’Angelo, Adrien Mathonat, Wiebke Lehmkuhl, Marianne Crebassa, Lisette Oropesa, lestyn Davies, Luca Pisaroni, Rémy Brès
Palais Garnier
Superbe distribution pour cette reprise du Giulio Cesare de Haendel dans la production de Laurent Pelly dont c’est la troisième reprise depuis janvier 2011. On y trouve Oropesa en Cleopatra, la jeune et talentueuse Emily d’Angelo en Giulio Cesare, entourés par rien moins que Luca Pisaroni, Marianne Crebassa et l’excellent Iestyn Davies. En fosse, à la tête de l’Orchestre de l’Opéra Nationalm de Paris, Harry Bicket spécialiste de ce répertoire. Rappelons cepdndant que la production avait été créée par Emmanuelle Haïm et son Concert d’Astrée.
Mars-avril 2024
Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra
7 repr. du 12 mars au 3 avril. – Dir : Thomas Hengelbrock/MeS : Calixto Bieito
Avec Ludovic Tézier, Nicole Car, Mika Kares, Charles Castronovo, Étienne Dupuis, Alejandro Baliñas Vieites, Paolo Bondi, Marianne Chandelier
Opéra-Bastille
Reprise de la belle production de Calixto Bieito avec Ludovic Tézier dans le rôle-titre, ce qui est déjà suffisant. Mika Kares, voix de bronze et encéphalogramme plat au niveau de l’expressivité, Castronovo qui devrait bien convenir en Gabriele, et l’étrange choix de Nicole Car en Amelia. Il faudrait quelqu’un de plus de poids pour le rôle (à quand Oropesa ?). En fosse, Thomas Hengelbrock peu fréquent dans ce répertoire.
Mai 2024
Richard Strauss, Salomé
7 repr. du 9 au 28 mai. – Dir : Mark Wigglesworth/MeS : Lydia Steier
Avec Lise Davidsen, Gerhard Siegel, Ekaterina Gubanova, Johan Reuter, Pavol Breslik, Katharina Magiera, Matthäus Schmidlechner, Éric Huchet, Maciei Kawsnikowski, Nicholas Jones, Florent Mbia
Opéra-Bastille
En fosse, Mark Wigglesworth, qui passe de Bellini à Strauss, c’est beau les chefs qui savent tout faire. En scène, que du beau ou du très beau monde entre Davidsen qui n’aura aucun mal à remplir de sa voix immense la salle de Bastille, le couple Gubanova/Siegel et Pavol Breslik en Narraboth de très grand luxe.
Mais le neutre Johan Reuter en Jochanaan, fait tomber la pression. On aurait pu choisir un baryton au plus grand relief pour faire face à Davidsen…
Mise en scène inutile signée d’une des baudruches à la mode de la mise en scène d’aujourd’hui.
Juin-juillet 2024
W.A.Mozart, Cosi fan tutte12 repr. Du 10 juin au 9 juil. – Dir : Pablo Heras Casado/MeS : Anne Teresa de Keersmaker
Avec Vannina Santoni, Angela Brower, Hera Hyesang Park, Josh Lovell, Gordon Bintner, Paulo Szot.
Reprise tiroir-caisse : c’est Mozaaaart
Palais Garnier.
Cosi fan tutte a été diversement servi à l’Opéra de Paris, sous Liebermann, la production de Jean-Pierre Ponnelle ne fut pas une de ses plus grandes réussites, la production Ezio Toffolutti fut souvent reprise et n’avait pour avantage que de pouvoir être reprise tellement elle ne dérangeait personne, celle de Chéreau, très forte, n’eut pas l’heur de plaire ou d’être comprise. Finalement celle de Anne Teresa de Keersmaker depuis janvier 2017 suit son bonhomme de chemin, portée aux nues par les uns, honnie par les autres, elle en sera à sa cinquième reprise. Cette mise en scène ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité.
En fosse, Pablo Heras-Casado, un chef précédé d’une réputation qui se dégonfle à chaque fois qu’on l’entend. Poudre aux yeux sans intérêt. Distribution contrastée, entre des voix intéressantes (Santoni, Brower) d’autres moins (Szot) et la découverte d’un ténor à suivre, en troupe à Vienne, Josh Lovell.
Au total, une saison qui présente plus d’intérêt que les précédentes, dans le choix des œuvres notamment et dans l’intelligente présence du répertoire historique de la maison, comme le montre le retour de Médée, de La Vestale, mais aussi de Don Quichotte, trois titres sur huit, ce qui est important. Il ne s’agit pas pour moi de défendre le répertoire français, ni la langue française, je n’ai pas ces prurits identitaires inutiles et ridicules, mais il est essentiel qu’une maison témoigne de son histoire et de son passé, et qu’elle le fasse régulièrement.
Que la deuxième ligne de force de la gestion Neef soit l’accueil du répertoire anglo-saxon des cinquante dernières années n’est pas inintéressant non plus, et ne manque pas d’originalité avec ces rendez-vous annuels. Deux œuvres cette saison, Street Scene d’un Kurt Weill en exil qui écrit une œuvre déchirée entre son passé européen et son présent, et The exterminating Angel de Thomas Adès, dont il m’est avis qu’on verra dans pas très longtemps The Tempest que même la Scala a osé…
Enfin deux spectacles confiés à L’Académie, Street Scene justement et L’Enfant et les sortilèges, accouplé à un ballet dansé par l’Ecole de danse, marquent une confiance dans les forces de la maison et son avenir.
Quelque chose commence à se dessiner, une promesse que les deux dernières saisons si mornes ne laissaient pas entrevoir. C’est très positif et on espère que les bourgeons vont fleurir.
D’un autre côté, je déplore personnellement un tropisme anglo-saxon trop marqué au niveau des distributions, l’absence fréquente de chanteurs italiens : c’est une antienne que j’ai aussi reprise à propos de Munich, qui a d’autres tropismes : les directions de casting ont l’indécrottable défaut de rester fidèles à leur aire culturelle, à leurs origines, à leurs habitudes, dans un art qui demande au contraire de respirer au plus large géographiquement. Et plus d’esprit de finesse que de géométrie.
Du point de vue des mises en scène, les nouvelles productions ratissent large, ce qui n’est pas si mal. Entre Bieito, Serebrennikov, McVicar, Sellars, etc…il y en a pour tous les goûts, et il y a même du mauvais goût (Lydia Steier).
En fosse en revanche, si Dudamel est présent seulement deux fois, on ne trouve pas l’imagination au pouvoir, il y a des chefs corrects et de bonne réputation, d’autres moins, mais rien ne fait vraiment rêver…
Le Ballet
(Contribution de Jean-Marc Navarro)
L’année écoulée nous aura offert un de ces petits psychodrames à rebondissements comme seul le Ballet de l’Opéra national de Paris aime à les concocter.
- Acte I : celui d’un naufrage managérial éloquent quand le directeur de la Maison, Alexander Neef, a décidé de nommer Étoile un artiste qui, au-delà de ses qualités artistiques réelles, consacrait chacune de ses interventions médiatiques – nombreuses – depuis des années à conchier l’institution dont il était issu et l’art dont elle prétend incarner la tradition (le ballet académique). Cette décision a entraîné le départ d’Aurélie Dupont, directrice de la Danse, qui n’avait dit-on jamais envisagé une telle nomination et se trouvait désavouée par un directeur plus enclin à se payer un petit coup de pub qu’à mesurer les conséquences d’image et de gestion interne qu’aurait une telle décision au sein de sa Compagnie.
- L’histoire ne donnera pas tort à Mlle Dupont sur ce point puisque, acte II, s’en est suivie une période de flottement scandée par la perspective ou non du retour en scène du nouveau nommé. La presse se fera écho de ses petits caprices dans le choix des rôles, de ses petites délicatesses dans la gestion de son calendrier, de ses petits atermoiements dans la négociation de son contrat d’Étoile. Sept mois après sa nomination, sans avoir jamais reposé un pied sur la scène de l’Opéra, François Alu sera exfiltré de la Compagnie, départ sans doute salutaire pour l’équilibre collectif interne du Ballet.
- C’est qu’entre temps, acte III, José Martinez a été nommé directeur de la Danse, à l’issue d’un processus d’appel à candidatures très scientifique et objectif (tout ça pour en arriver à la nomination d’une ancienne Étoile de la Maison dont le nom figurait déjà parmi les favoris depuis un long moment…). Débarrassé de l’épine Alu qu’Alexander Neef avait plantée dans le pied de la Compagnie, José Martinez a eu à cœur depuis sa prise de fonction début décembre d’observer, d’imprimer une communication équilibrée sur ses ambitions et un peu falote sur son projet, de construire des distributions diverses autour de la programmation de sa prédécesseuse. Bref, d’essayer d’apaiser un peu les esprits et de remettre son petit monde au travail, en distillant une douce musique à l’oreille du public : celle d’une volonté claire de revenir à un profil de programmation de fibre plus classique que celle des dernières saisons – difficile toutefois de tomber plus bas dans la très spectaculaire évacuation du répertoire académique opérée par Aurélie Dupont (voir le billet https://wanderersite.com/danse/le-declin/)
- Acte IV : trois mois après sa prise de fonction, premier coup d’éclat du nouveau directeur de la Danse : pas une, pas deux, trois nominations ! En à peine une semaine, Hannah O’Neill, Marc Moreau (nommés le même soir), Guillaume Diop (nommé à l’issue d’une Giselle en Corée du Sud) accèdent au Graal sur proposition de José Martinez. Il convenait de renforcer les rangs des Étoiles, qui étaient apparus tristement déplumés lors des défilés du Ballet en février, et ce n’est sans doute que le début du renouvellement des cadres suprêmes du Ballet, les départs d’Étoiles expérimentés se profilant dans les prochaines saisons.
Quel sera alors l’acte V ? Dans un contexte pollué par « le cas Alu », le départ d’Aurélie Dupont, une programmation que même les plus intenses thuriféraires de la Compagnie commençaient à trouver problématique, José Martinez apparaît comme un sauveur (il faut bien lécher avant de lâcher puis de lyncher…). Il a au moins pour lui le mérite de la cohérence entre ses propos et la réalité de ses actes. À l’Opéra, on se targue d’aimer la tradition et le répertoire tout en piétinant l’une et n’entretenant pas l’autre. Martinez lui n’entre pas dans cette logique comme le montrent ses activités de chorégraphes et transmetteur de répertoire depuis ses adieux.
La saison 2023-2024 dévoilée cette semaine a été largement préparée par Aurélie Dupont, José Martinez ayant eu la pudeur de la présenter comme juste légèrement remaniée. La marque Dupont est bien là, avec deux chorégraphes qu’elle a toujours dit adorer (une belle soirée Kylian et l’entrée au répertoire du Barbe-Bleue de Pina Bausch) et la soirée d’ouverture de saison qui coche toutes les cases attendues des tutelles mais qu’on oubliera aussitôt vue (des femmes chorégraphes, chouette ! du contemporain conceptuel, trop cool !) mais offrira aussi le retour du très populaire The Seasons’ Canon de Crystal Pite.
Mais surprise du chef : la saison affiche un lot de ballets académiques dont le nombre est tout à fait standard pour le type de Compagnies auquel Paris entend appartenir mais qui apparaît désormais impressionnant à Paris tant on était habitué à devoir se limiter à une vache à lait de Noël noyée dans des saisons globalement alla Chaillot : Giselle, Don Quichotte, Le Lac des cygnes, Casse-Noisette ! Si on y ajoute La fille mal gardée et une soirée Robbins, voilà le retour en force des grandes soirées de ballet qui font la part belle à des effectifs dignes de la Compagnie et permettent aux danseurs de prendre des rôles et évoluer dans le répertoire. Voilà aussi – et cela n’est sans doute pas totalement neutre – de quoi assurer un bon petit matelas de recettes, le triple effet magique des hausses de grilles, des tripatouillages de plans de salle et des taux de remplissage systématiquement flatteurs pour les ballets académiques devant produire un plein effet.
Alors bien sûr, on peut regretter que ces titres correspondent à ceux qui ont déjà été repris ces trois quatre dernières saisons. Toujours nulle trace de La Belle au bois dormant, ni de Paquita, de Coppélia ou de Suite en blanc ; il est un peu alarmant de se dire qu’elles n’ont pas été présentées en scène depuis de plus 10 saisons pour certaines ! Dans un art de transmission immatérielle tel que le ballet, voilà qui est très préoccupant. On note également que les productions Noureev des « grands classiques » tiennent le haut du pavé quand ils mériteraient un sacré lifting.
D’autres heureuses nouvelles sont à noter par ailleurs : l’École de danse aura à nouveau droit à une série de spectacles, à une série de démonstrations et à un gala ; les occasions pour les petits rats de se produire à Garnier s’étaient raréfiées ces dernières saisons. Après Peeping Tom (!!), c’est le Béjart Ballet Lausanne qui sera de retour à Paris comme compagnie invitée. José Martinez a aussi mentionné avoir proposé à Marianela Nunez du Royal Ballet de venir danser Giselle.
Attendons de voir si ces premiers signaux se pérennisent et se transforment en marque de fabrique Martinez sur les saisons prochaines ! D’ici là, ouf, commencerait-on à entrevoir la possibilité de reprendre le chemin de la ligne 8 pour aller voir du ballet à l’Opéra, après tant de saisons de vache anorexique ?
Le reste
La saison symphonique et les récitals
C’est simple : il n’y en a pas.
Un seul concert (à la Philharmonie de Paris) de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris dirigé par Gustavo Dudamel le 2 avril, au programme Debussy Canteloube Varèse Ravel avec Julie Fuchs, repris le 5 avril 2024 au Festival de Pâques d’Aix en Provence.
Et une apostille le 31 août 2023 à Saint Jean de Luz (Programme Penderecki, Haydn, Schumann)
Il y a bien des séries de musique de chambre à l’Amphithéâtre et les Midis musicaux, mais pas d’autres concerts symphoniques que celui précité.
Est-ce le résultat de la grève des musiciens qui a contraint d’annuler la tournée prévue de l’orchestre sous la direction de son chef ? Est-ce une politique délibérée ? On se perd en conjectures.
Une saison symphonique même petite (il n’y a jamais eu à l’Opéra de véritable saison symphonique articulée) permettrait peut-être d’inviter sur quatre ou cinq concerts par an des chefs qu’on n’a pas l’habitude de voir, qui ont une surface symphonique intéressante, et de faire travailler l’orchestre hors fosse, ce qui est toujours salutaire.
C’est la morne plaine.
Il y a bien des récitals des présentations des artistes de l’académie, mais pas de récital de grandes voix d’aujourd’hui : cela se perd dans les opéras, même en Allemagne, et pourtant, un cycle de récitals s’imposerait dans une maison de cette importance, mais, vous l’aurez compris, en terme de rapport qualité-prix, de présence du public, c’est trop aléatoire, on ne va donc pas de poser la question de l’apport culturel ou de la valence artistique. N’employons pas de vilains mots.
Et puis il y a cet OVNI
2 décembre 2023
Gala Maria Callas
Dir.Mus : Eun Sun Kim / MeS : Robert Carsen
Avec Sondra Radvanovsky
Une opération tout à fait extraordinaire pour célébrer Maria Callas. Un Gala pour soutenir…La Croix rouge ? Non. Les réfugiés Ukrainiens ? Non. Les victimes du tremblement de terre en Turquie et Syrie ? Pas plus.
Lisons la brochure : À l’occasion du centenaire de la naissance
de Maria Callas, le 2 décembre 1923, l’Opéra national de Paris propose un gala exceptionnel au bénéfice des activités de l’institution, le jour même de cet anniversaire.
Les tarifs n’en sont pas communiqués, c’est un Gala de Bienfaisance pour une Institution nécessiteuse : L’Opéra National de Paris.
On croit rêver.
J’ose espérer que l’institution en question fait de l’auto-ironie, soulignant que cette institution publique fait la quête parce que l’État ne lui donne pas assez d’argent.
Nous avons souligné par ailleurs que l’État traitait l’Opéra comme un boulet, nous ne cessons de souligner l’absence de politique du Ministère de la Culture et nous observons la situation difficile des Opéras en région, mais une telle manifestation a quelque chose d’étrange, acceptable ou admissible dans un état libéral comme les USA, où les Opéras doivent chercher leurs financements, inadmissible pour notre première scène nationale, alors que la Culture est l’une des prérogatives de l’État. Dérive libérale de la culture, comme d’autres dispositifs (le Pass Culture pas exemple) et désintérêt au sommet de l’État-Macron, on l’avait compris depuis longtemps et on en a la confirmation. Ce n’est pas l’Opéra de Paris qui est lamentable en l’occurrence, c’est sa tutelle.
Quelques éléments sur la politique tarifaire
Et puisqu’on parle gros sous quelques mots sur les tarifs.
Soyons honnêtes, dans le paysage européen, les tarifs pratiqués à l’Opéra de Paris sont diversifiés et dans la moyenne des salles (haute) de ce niveau, moins chers qu’à Londres, Vienne, et à la Scala bien plus chers qu’à Munich (maximum en saison 163 Euros) et qu’à Hambourg ou Francfort, deux excellents théâtres où le prix maximum n’excède pas 130 Euros L’échelle est large, elle va pour l’Opéra de 10 (Garnier)/15 (Bastille) à 220 Euros (prix maximum) et pour le ballet du même minimum au maximum de 170 Euros, sachant que le ballet rapporte bien plus à salle complète que l’opéra (vu que le corps de ballet et les solistes forment troupe). Le prix maximum est fonction de l’œuvre, indépendamment qu’elle soit nouvelle production ou reprise, et de ce qu’on suppose de la venue du public. Étrangement d’ailleurs Adriana Lecouvreur avec Netrebko n’est pas au tarif maximum, sans doute parce qu’elle ne les fait pas toutes, et que le reste du cast, chef compris n’est pas trop cher). Mais peu importe, on voit bien quelles reprises servent de tiroir-caisse, quels ballets sont supposés attendus par le public. Apparemment Giselle, Casse-Noisette et l’inévitable Lac des Cygnes rapporteront beaucoup. A noter que La Vestale bénéficie d’une baisse de tarif en juillet, puisque le public d’opéra est en vacances ou à Aix…
Bien sûr la brochure prévoit des tarifs spéciaux pour les familles, les étudiants, les handicapés, les chômeurs et une infinité de moyens d’accéder au Graal pour moins cher ; c’est un labyrinthe savant, mais il reste que les tarifs, les plans de salle sont assez tortueux, et que le débat continue sur l’accessibilité à cette maison.
Conclusion
On peut se réjouir de l’esquisse d’un apaisement dans le ballet, après les crises des années précédentes, on peut se réjouir d’une programmation lyrique plus inventive et plus élaborée avec des lignes de force importantes (répertoire historique de l’Opéra de Paris, créations d’œuvres anglo-saxonnes qui manquaient à Paris), tout cela est positif et mérite d’être signalé.
On peut saluer l’effort pour valoriser l’Ecole de Danse et l’Académie, même si la troupe tant souhaitée commence à être formée et qu’elle sera sans doute étoffée les années prochaines.
On peut d’un autre côté déplorer dans les distributions un tropisme anglo-saxon excessif, l’absence de chefs d’envergure, d’autant plus marquée que Gustavo Dudamel assure deux titres et un concert, ce qui n’est pas énorme sur 20 productions.
On peut enfin déplorer qu’en dehors du ballet et du lyrique, il n’y ait pas l’esquisse d’une saison symphonique, ni une saison de récitals. On sent une maison qui fait des efforts, dans un univers qui ne lui est pas très favorable et avec une situation financière critique. On est, disons, dans une remontée lente et plutôt positive. Et c’est déjà beaucoup. En ce sens, cette saison marque un tournant.


 On ne reviendra pas sur les péripéties des dernières années de l’Opéra de Paris, entre grèves, confinement, passage accidenté du relais entre Stéphane Lissner et Alexander Neef. Le seul fait que soit annoncée une saison entière est déjà un gage que les choses retournent à la normalité et cela ne peut que réjouir les observateurs et les amateurs.
On ne reviendra pas sur les péripéties des dernières années de l’Opéra de Paris, entre grèves, confinement, passage accidenté du relais entre Stéphane Lissner et Alexander Neef. Le seul fait que soit annoncée une saison entière est déjà un gage que les choses retournent à la normalité et cela ne peut que réjouir les observateurs et les amateurs.