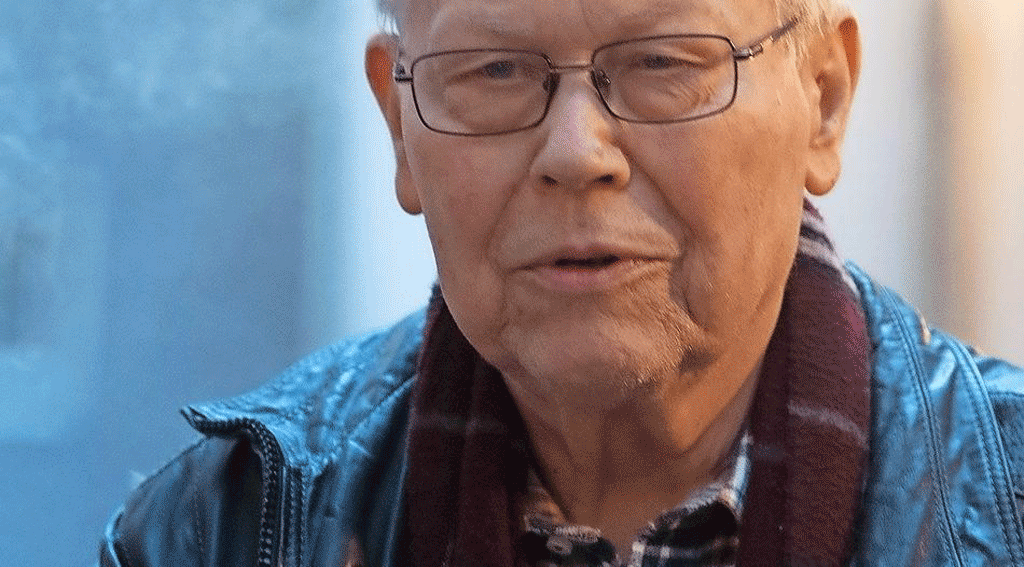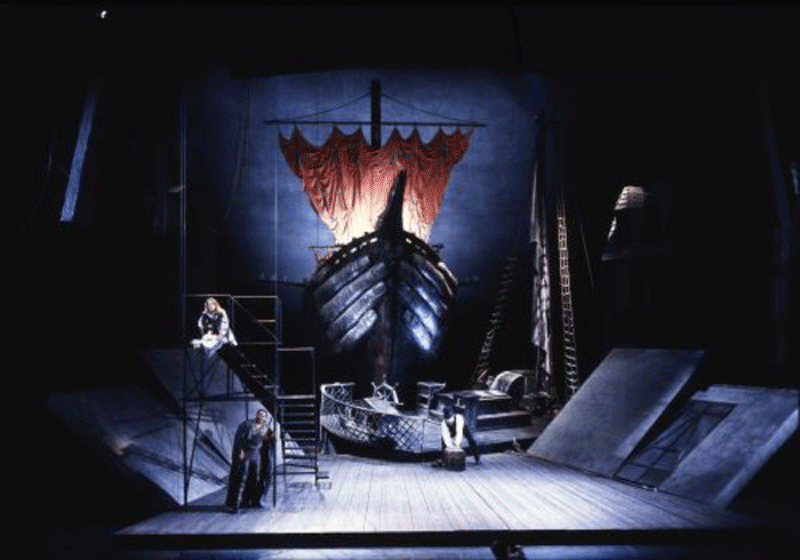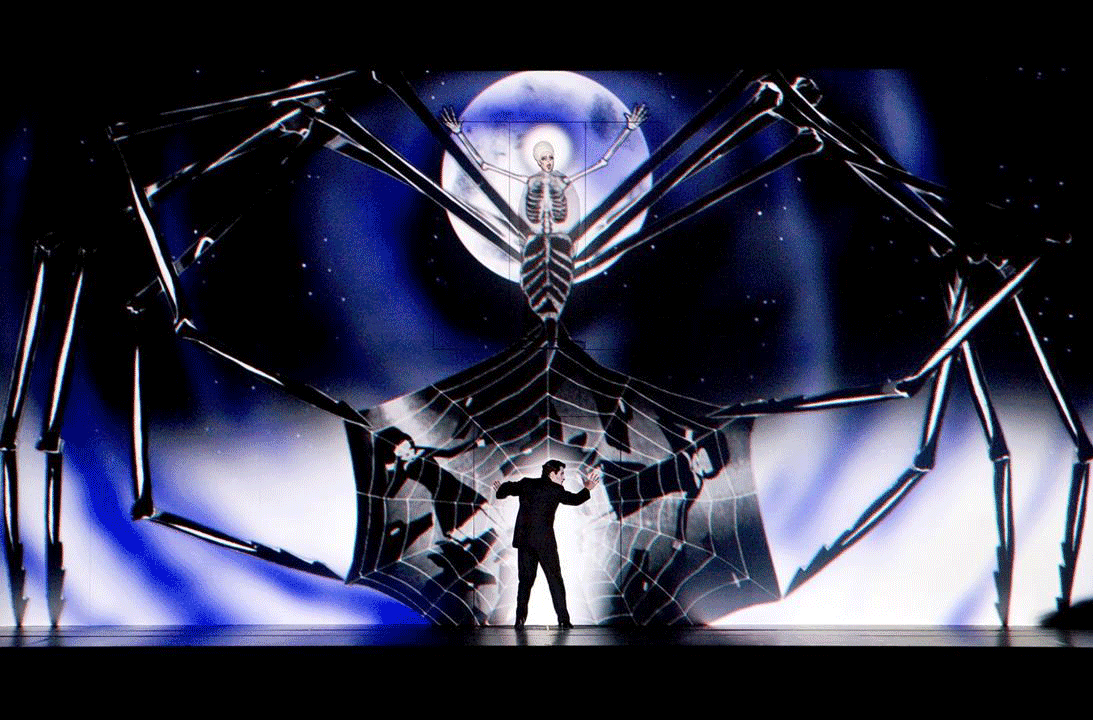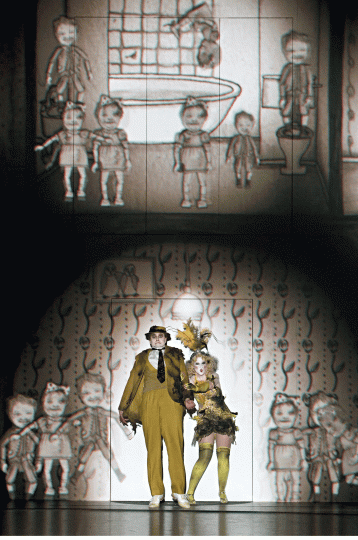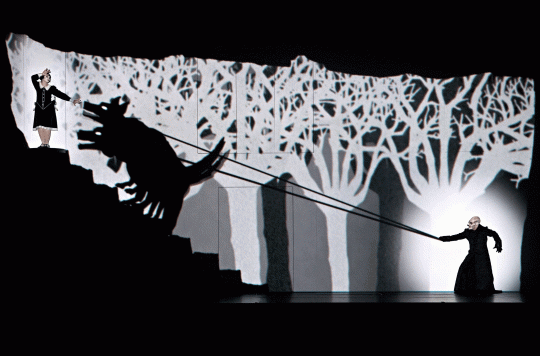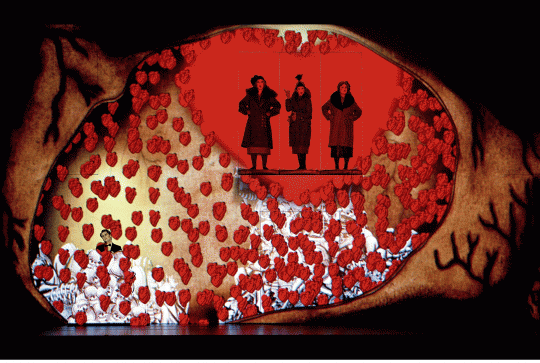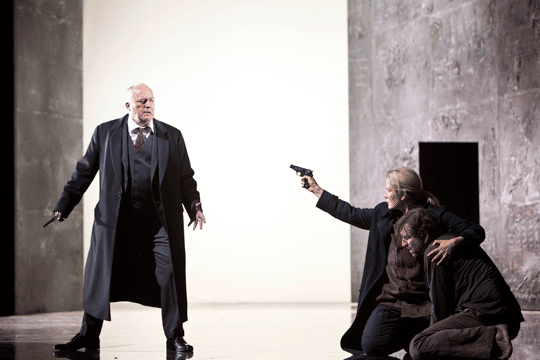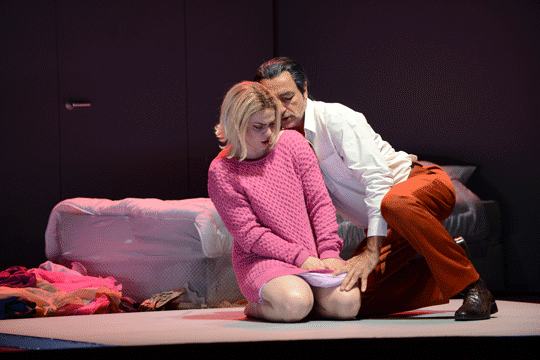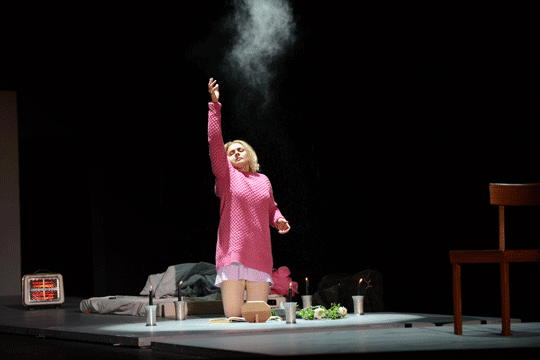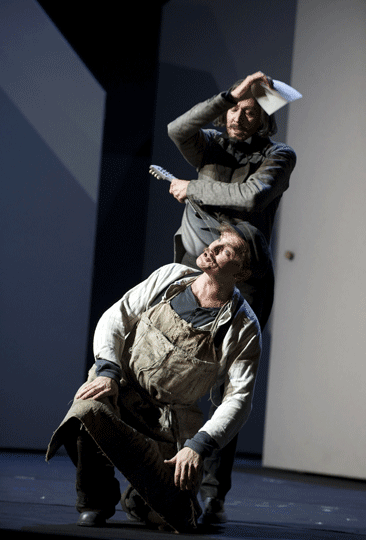Le paysage berlinois a trois salles d’opéra ce qui est un résultat de l’histoire, bien que la ville au XXe ait toujours eu plusieurs salles d’opéra
- La Deutsche Oper Berlin est l’ex-opéra de Berlin-Ouest, lui-même héritier du Deutsches Opernhaus, ouvert en 1912
- La Komische Oper de Berlin, héritière du Metropol Theater créé à la même adresse en 1898, puis installé dans d’autres lieux de Berlin-Mitte, un théâtre d’opérettes et de revues.
- La Staatsoper de Berlin, située au centre historique institutionnel de Berlin, à deux pas de la Cathédrale ou du Palais impérial. C’est l’opéra historique de Berlin, inauguré en 1742, avec dans la fosse l’orchestre symbolique de la ville, la Staatskapelle Berlin fondée quant à elle au XVIe siècle.
Ces deux derniers théâtres sont situés dans ce qui était Berlin-Est avant la chute du mur , où se trouvaient aussi les principaux théâtres et l’essentiel des Musées. Ainsi, Berlin Ouest a dû ouvrir des lieux de spectacles nouveaux, dans des quartiers qui n’étaient pas a priori des quartiers de vie nocturne.
À la chute du mur, Berlin s’est retrouvé avec trois salles d’opéra dont deux à peu près similaires, la Deutsche Oper et la Staatsoper, toutes situées sur l’axe central de la ville à plusieurs kilomètres les unes des autres, et deux principales salles de concert, la Philharmonie à l’Ouest, construite à deux pas du Mur et le Konzerthaus à l’Est, qui est la salle de concerts historique…
La Komische Oper, héritière de la très riche tradition d’opérette de la ville et d’oeuvres musicales légères, a un rôle très différent, c’est des trois le théâtre qui a la couleur la plus claire (opéra populaire, genres très diversifiés).

La fonction « historique » de la Staatsoper est aussi soulignée par sa situation, donnant sur la prestigieuse Unter den Linden et sur la Bebelplatz, l’ex Forum Fridericianum, délimité par la Staatsoper, l’Université Humboldt et la cathédrale catholique Sainte Edwige, la plus ancienne église catholique de Berlin. C’est donc une des esplanades les plus emblématiques du passé de la ville.
Cette position prestigieuse est renforcée depuis 1992, par la présence comme directeur musical de Daniel Barenboim, qui, licencié de manière brutale et humiliante par Pierre Bergé, alors tout puissant président du Conseil d’administration de l’Opéra de Paris, se trouvait être disponible. À quelque chose malheur est bon : il aurait peut-être raté Berlin alors qu’il n’aurait de toute façon pas fait très long feu à Paris, à cause des errances de la politique culturelle (si politique il y a d’ailleurs) à cause de la valse des excellences à la tête de l’Opéra et aussi à cause de sa propre personnalité, qui s’accommode mal d’une tutelle même légère.
À la Staatsoper de Berlin, les intendants passent (Georg Quander, Peter Mussbach, Ronald Adler (commissaire), Jürgen Flimm, Matthias Schultz), Barenboim reste. La ville tient plus à son directeur musical qu’à ses intendants, c’est un peu comme le Roi et ses gouvernements. L’illustration parfaite de l’adage « L’intendance suivra… ».
De fait, Daniel Barenboim, par sa puissance de feu, ses réseaux, sa capacité à mobiliser des fonds, mais aussi ses positions politiques (notamment sur la question de la Palestine et d’Israel, qui lui fait honneur) et bien sûr son génie musical est devenu le vrai successeur de Karajan à Berlin en termes de pouvoir (et Karajan ne régnait que sur Berlin-ouest…).
À ce titre aussi, au début du mois de janvier 2020, le récent concert de Kirill Petrenko avec Daniel Barenboim comme soliste était une sorte d’entrevue du Camp du Drap d’Or, au pied musical…Les deux phares musicaux berlinois, l’ancien et le nouveau, se rencontraient. C’était obligatoire.
Les longs travaux de consolidation et restauration de la Staatsoper (sept ans) ont installé à portée de corridor l’opéra, la Fondation Barenboim-Saïd et la Pierre-Boulez Saal, siège du West-Eastern Diwan orchestra. Administration, salles de répétitions, Fondation Saïd-Barenboim sont donc géographiquement solidaires : au cœur de Berlin – le mélomane ne s’en plaindra pas, c’est Barenboim-Quarter dont la Pierre-Boulez Saal, un outil architectoniquemement extraordinaire (un « cadeau » de Frank Gehry à Barenboim), est en quelque sorte la salle de musique privée du Maître, qui y dirige, qui y joue et qui a la main sur tous les programmes en patron de la Fondation.
Barenboim, maître de maison de tout ce dispositif, dirige à l’opéra essentiellement Wagner, mais aussi un certain nombre de premières de toutes sortes : ces dernières années il a abordé un répertoire qui lui était tout à fait étranger, comme le répertoire italien, voire français (jamais on aurait imaginé l’entendre dans Les Pêcheurs de Perles de Bizet ou Medea de Cherubini) ou russe (il va revenir à Bastille dirigeant La Dame de Pique) qu’il abandonne ensuite aux Kapellmeister de la maison ou à des jeunes chefs qu’il choisit et dont il lance la carrière..
Ce système a donné des productions de référence qui ont fait de la Staatsoper de Berlin le théâtre vers lequel tous les regards se portent, avec la présence de metteurs en scène parmi les plus emblématiques du dernier XXe siècle, Chéreau (avec qui Barenboim avait prévu plusieurs productions pour Bastille quand il devait en être le directeur musical), Kupfer (long compagnonnage depuis le Ring de Bayreuth) et maintenant Dmitry Tcherniakov, qui a signé à Berlin de très nombreuses productions, de Rimsky-Korsakov à Prokofiev en passant par Wagner : on lui doit notamment un Tristan et un Parsifal qui vont entrer de plain-pied dans la légende.
Plus que d’autres, Barenboim travaille par affinités électives, c’est un homme de fidélités à des metteurs en scène, à des chanteurs : à ce titre sa production des Meistersinger von Nürnberg est un hommage à tous les chanteurs avec qui il a fidèlement travaillé dans sa carrière.
La programmation n’en est pas pour autant un concerto pour Barenboim et orchestre. Il est bien trop prodigieusement intelligent pour éviter qu’on lui fasse de l’ombre, notamment dans une ville où il a peu de rivaux…Daniel Barenboim a toujours veillé par exemple pour les raisons expliquées plus haut à entretenir des relations excellentes avec le Philharmonique de Berlin, du temps d’Abbado bien sûr, à cause de la longue amitié qui les liait, où il y eut un Falstaff, et du temps de Simon Rattle, avec plusieurs productions notables, dont De la Maison des morts de Leoš Janáček (celle de Chéreau venue d’Aix); il devait diriger cette saison Idomeneo (annulé pour cause de virus) et ce sera la saison prochaine une Jenufa qui fera évidemment courir.
Mais on y voit aussi fréquemment Zubin Mehta, amicalement lié à Barenboim comme il l’était à Abbado.
À l’autre bout, Barenboim n’hésite pas à inviter à diriger de jeunes chefs et ainsi les lancer, ce fut naguère le cas de Omer Meir Wellber, c’est aujourd’hui celui de Thomas Guggeis, arrivé in extremis pour remplacer Christoph von Dohnanyi dont il était l’assistant dans la production de Salomé (Hans Neuenfels) et qui dirige cinq productions cette année.
Mais on a beaucoup accusé Barenboim (78 ans cette année) de s’accrocher à son post : aux tout nouveaux Oper ! Awards 2019, il a eu le prix de la GRÖSSTES ÄRGERNIS (La plus grosse colère) pour la prolongation de son contrat jusqu’à 2027 – il aura alors 85 ans.
Son activité continue d’être débordante entre concerts, récitals de piano, opéras, mais on remarque qu’il va un peu ralentir son rythme la saison prochaine, où il va diriger deux nouvelles productions (Quartett de Francesconi et Le nozze di Figaro. Il devait cette année diriger Cosi fan Tutte, mais le coronavirus en a décidé autrement et Cosi fan Tutte, inscrit dans la saison au titre de répertoire, sera de fait une nouvelle production reportée. Proposant une nouvelle trilogie Mozart/Da Ponte mise en scène par Vincent Huguet, il était important d’afficher un titre par an – il y en aura donc deux la saison prochaine. Et on verra sans doute Don Giovanni en 21/22.
Dans les reprises, il sera au pupitre de ce Così fan tutte (une reprise, qui sera donc une première) et de Parsifal, comme presque chaque année (il ne dirige aucun des trois autres Wagner). Au total Daniel Barenboim dirige 17 représentations ce qui est peu.
Les apparitions raréfiées cette prochaine saison annoncent-elles un début de retrait ? Quand on connaît l’énergie du personnage, cela ne laisse pas d’étonner. La saison 2019-2020, interrompue l’a vu diriger deux nouvelles productions Die Lustigen Weiber von Windsor et Samson et Dalila et il aurait dû diriger Così fan tutte à Pâques, et les reprises du Ring de Wagner en septembre 2019, et Carmen en mars. Il est nettement moins impliqué dans la saison qui vient.
Alors inévitablement se pose la question de l’après-Barenboim, qui est une question fort lourde pour une institution qu’il a dirigée depuis 1992, soit pour l’instant 28 ans en lui redonnant un lustre international qu’elle n’avait plus (même si c’était quand même un grand théâtre de tradition).
Par ailleurs, cette saison, parmi les chefs invités, on note des noms rares à Berlin (et ailleurs) à l’opéra, comme Matthias Pintscher ( Nouvelle production Lohengrin et Wozzeck de répertoire) ou rares à Berlin mais pas ailleurs comme Antonio Pappano (Nouvelle production La Fanciulla del West), tandis qu’on remarque que Marc Minkowski (Nouvelle production Mitridate Re di Ponto de Mozart et reprise d’Orfeo ed Euridice de Gluck) Simon Rattle (Nouvelle production Jenufa) et Simone Young dans trois productions (reprises) (Khovantschina, Die Frau ohne Schatten, Der Rosenkavalier) seront au pupitre berlinois cette année.
Panorama étrange et contrasté avec des choix incontestables, et d’autres plus étonnants.
Par ailleurs, se pose aussi notamment cette année une autre question : le niveau artistique est un peu en dents de scie, il y a certes des grands chefs et de belles distributions, mais bien des reprises restent d’un niveau modeste, même si on essaie de faire appel à de nouveaux chefs ou de nouvelles voix (Vida Miknevičiūtė dans Salomé) et donc c’est l’hétérogénéité de l’offre qui frappe, notamment quand on compare cette saison à celle de Munich, plus imaginative ou surtout à celle de Zurich, plus homogène et aux reprises plus stimulantes. C’est une année un peu en creux, mais sans doute aussi les circonstances l’ont-elles imposée.
Nouvelles productions :
8 Nouvelles productions (sans compter les fausses reprises de productions de 2019-2020 non créées que nous évoquerons dans la partie “Répertoire” ) dont 2 en version chambriste (un opéra pour enfant et un opéra de chambre contemporain)
Oct. 2020
Luca Francesconi, Quartett, (5 repr.), MeS : Barbara Wysoka Dir : Daniel Barenboim avec Mojka Erdmann et Thomas Oliemans
Tandis que la Bayerische Staatsoper crée Timon of Athens (voir notre présentation de la saison bavaroise), Berlin propose l’un des grands succès de Francesconi, Quartett, créé à la Scala en 2011, d’après la pièce d’Heiner Müller, tirée elle-même des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Barenboim dirige, ce qui est un signe important, deux chanteurs, l’excellent baryton Thomas Oliemans et Mojca Erdmann, qui sera aussi à l’affiche plus tard dans la saison dans un autre opéra contemporain de Jörg Widmann, Babylon (l ’opéra contemporain aime les voix suraiguës). La mise en scène est assurée par Barbara Wysocka, qui il y a quelques années avait mis en scène Lucia di Lammermoor à Munich dirigée par Kirill petrenko, qu’on vient de revoir en streaming.
Nov. 2020
W.A.Mozart, Mitridate, re di Ponto, (5 repr.), MeS : Satoshi Myagi Dir : Marc Minkowski avec Pene Pati, Julie Fuchs, Elsa Dreisig, Jakub Józef Orliński, Anna Prohaska etc…
C’est la production phare des Barocktage 2020, dirigée par Marc Minkowski et surtout mise en scène dans l’esprit du Kabuki par l’un des plus grands metteurs en scène japonais, Satoshi Myagi, ce qui devrait être vraiment intéressant vu ses relectures des grands classiques occidentaux. Dans la distribution, rien que des chanteurs actuellement très demandés, Julie Fuchs, Elsa Dreisig, Jakub Józef Orliński, Anna Prohaska et un nouveau venu, le ténor néozélandais Pene Pati qui a fait des débuts remarqués à San Francisco (mais aussi à Bordeaux dans le rôle de Percy d’Anna Bolena en 2018 et qui devait chanter Romeo en ce dernier mois de mars), voix claire, idéale pour le bel canto.
Déc.2020/Janv. 2021
Richard Wagner, Lohengrin, (6 repr.), MeS : Calixto Bieito Dir : Matthias Pintscher avec Roberto Alagna, Sonya Yoncheva, Martin Gantner, Ekaterina Gubanova, Adam Kutny
On se précipitera pour le couple vedette Alagna/Yoncheva. Cette production, qui succède à celle un peu irrégulière de Stefan Herheim en 2009, est confiée à Calixto Bieito qui va proposer sa vision aussitôt après avoir proposé son Ring à Paris ( plongeon dans Wagner et jonglage d’agenda en vue ). Roberto Alagna cette fois-ci devrait s’y coller, et Sonya Yoncheva qui s’essaie à tout s’essaie aussi à Wagner. Plus classiques Martin Gantner et Ekaterina Gubanova dans les rôles des méchants. Et puis au pupitre on expérimentera Matthias Pintscher un nouveau venu à l’opéra autre que contemporain (il a dirigé à la Staatsoper Violetter Schnee de Beat Furrer et à Vienne la première mondiale d’Orlando d’Olga Neuwirth, d’après Virginia Woolf) à qui sera aussi confié Wozzeck dans la saison. Sans doute désire-t-il comme beaucoup de chefs catalogués dans un répertoire, à élargir ses interventions. Au total un Lohengrin plein de nouveautés et de risques, qui va sans nul doute exciter la curiosité.
Février 2021
Leoš Janáček, Jenufa, (6 repr.), MeS : Damiano Michieletto Dir : Simon Rattle avec Hanna Schwarz, Stuart Skelton, Ladislav Elgr, Evelyn Herlitzius, Camilla Nylund etc…
Rattle-Michieletto-Nylund-Herlitzius sont des noms qui sur une affiche ne laissent aucun fan d’opéra indifférent. Damiano Michieletto enfant terrible plus habituel dans le répertoire italien s’attaque à Janáček, Sir Simon Rattle est en général remarquable dans ce répertoire, et Nylund et Herlitzius devraient y faire merveille sans oublier la vénérable Hanna Schwarz, la Fricka du Ring de Chéreau. Voilà qui suffit pour justifier un voyage.
Mars 2021 (Feststage)
W.A.Mozart, Le nozze di Figaro, (3 repr.), MeS : Vincent Huguet Dir : Daniel Barenboim avec Gyula Orendt, Nadine Sierra, Marianne Crebassa, Siegfried Jerusalem, Waltraud Meier, Elsa Dreisig, Riccardo Fassi, Stephan Rügamer etc…
Il faudra évidemment aller voir Cosi fan tutte et ces Nozze di Figaro, d’abord parce qu’elles marquent le goût ancien pour l’opéra mozartien du maître des lieux : rappelons qu’il enregistra très tôt (dans les années 70) Don Giovanni et Le Nozze di Figaro, un peu plus tard Così fan tutte, et que jamais il n’a marqué une distance par rapport à ce répertoire. C’est donc toujours un événement quand il retourne au pupitre pour diriger un opéra de Mozart. C’est par ailleurs aujourd’hui la mode que de proposer au même metteur en scène la trilogie Mozart/Da Ponte, une mode qui ne me convainc pas ( La trilogie Da Ponte/Mozart n’est pas le Ring) même si cela affiche un projet cohérent de confier à un univers unique les trois opéras de Mozart. Strehler de dix ans en dix ans (grosso modo) l’avait entrepris, mais si Le nozze di Figaro à Paris (1973) étaient un coup de génie, ni Don Giovanni (1987) à la Scala ni Così fan tutte (1998) au Piccolo Teatro de Milan n’avaient atteint ce degré de réussite.
C’est donc Vincent Huguet qui s’y attaque. Les précédents spectacles de Vincent Huguet ne m’ont pas vraiment convaincu. Espérons que ces Mozart casseront cette impression. La distribution faite d’une nouvelle génération d’excellents chanteurs (Gyula Orendt, Marianne Crebassa, Nadina Sierra, Elsa Dreisig etc…devrait exciter la curiosité, et encore plus la présence d’une Marcellina aussi luxueuse qu’inattendue, Waltraud Meier tout comme le Don Curzio de Siegfried Jerusalem: jamais un Don Curzio ne suscitera autant de curiosité. On fait à Berlin comme à Vienne où les gloires du passé furent souvent employées dans les tout petits rôles (je vis à Vienne Erich Kunz dans Benoit de La Bohème par ex).
Juin 2021
Giacomo Puccini, La Fanciulla del West (7 repr.) MeS: Lydia Steier, Dir: Antonio Pappano avec Anja Kampe, Yusif Eyvazov, Michael Volle, Graham Clark etc…
Antonio Pappano dirige très peu l’opéra en dehors de Londres, c’est d’autant plus intéressant de le voir à Berlin. Comme c’est un chef au très large répertoire, italien comme allemand, rien d’étonnant à le voir diriger Puccini, et un Puccini pas si fréquent. La production est confiée à Lydia Steier, qui là où elle passe, provoque la polémique dans le public ou la critique, et quelquefois même à la direction du théâtre (Genève). Et dans la distribution Anja Kampe, qui a déjà interprété le rôle de Minnie à Munich (voir le compte rendu dans Wanderersite.com), Michael Volle dans Jack Rance qui devrait être évidemment très attendu et Yusif Eyvazov dans Dick Johnson qui me laisse plus perplexe vu ses capacités d’acteur, et là aussi, dans les « petits rôles » une vieille connaissance, Graham Clark, qui participa y compris à Bayreuth à de nombreuses productions dirigées par Barenboim
Opéras pour enfants et opéras de chambre (dans l’ancienne salle de répétition d’orchestre)
Janv.2021
Lucia Ronchetti, Pinocchios Abenteuer, Instrumentale Komödie (Comédie instrumentale) (à partir de 6 ans), (15 repr.) pour soprano et cinq musiciens, MeS : Swaantje Lena Kleff, Dir : Adrian Heger avec en alternance Sophia Aristidou et Hanna Herfurtner.
Adaptation des aventures de Pinocchio pour prouver son courage, notamment en combattant des bêtes, des personnages louches, une baleine.
Avril 2021
Georg Friedrich Haas, Thomas, Kammeroper (2013), (8 repr.), MeS: Barbora Horáková Joly Dir: Max Renne avec les membres de l’Opéra Studio et des membres de la Staatskapelle Berlin ainsi que des artistes invités.
Un opéra de chambre sur la réaction devant la mort d’un ami : Matthias meurt à l’hôpital et Thomas, entouré de l’agitation des soignants, est laissé seul, avec ses souvenirs et son deuil. D’une effrayante actualité.
Répertoire:
26 reprises (dont deux ou trois « fausses » reprises de nouvelles productions qui n’ont pas eu lieu en 2019-2020)
Sept.2020
Giuseppe Verdi, Il trovatore, (6 repr.), MeS: Philipp Stölzl, Dir: Massimo Zanetti avec Liudmyla Monastyrska, Vladislav Sulimsky, Marcelo Alvarez, Violeta Urmana, Adrian Sâmpetrean
Reprise alimentaire : septembre est musicalement très riche à Berlin et il faut proposer des titres qui attirent. Massimo Zanetti est un bon professionnel, la distribution est digne d’intérêt surtout pour Urmana en Azucena et Sulimsky, le baryton qui monte, en Luna. Alvarez est de plus en plus routinier, et Monastyrska qui est une bonne soprano dramatique d’agilité (Abigaille, Odabella), manque de ce lyrisme et de cette apparente fragilité qui font les grandes Leonora.
Otto Nicolaï, Die lustigen Weiber von Windsor, (4 repr.), MeS: David Bösch, Dir: Daniel Barenboim/Thomas Guggeis avec Michael Volle, René Pape, Pavol Breslik, Wilhelm Schwinghammer, Linard Vrielink, Mandy Fredrich, Michaela Schuster, Anna Prohaska, David Oštrek
Deux représentations dirigées par Barenboim et deux par Guggeis. La mise en scène de David Bösch assez réussie et bénéficie surtout d’une distribution splendide de chanteurs acteurs, dominée par les voix masculines, Michael Volle, René Pape, Pavol Breslik et Linard Vrielink, tous remarquables, et les voix féminines ne déméritent pas et sont très homogènes ; à voir sans aucun doute, d’autant que l’œuvre est rare, voire inexistante en France ou en Suisse.
Richard Wagner, Der fliegende Holländer, (4 repr.), MeS: Philipp Stölzl, Dir: Thomas Guggeis avec Matthias Goerne, Peter Rose, Ricarda Merbeth et Stephan Rügamer.
Thomas Guggeis est encore au pupitre, pour cette reprise de la production de Philipp Stölzl, proche par son esprit de la légendaire production d’Harry Kupfer à Bayreuth. La distribution est de bon niveau, Matthias Goerne, Peter Rose, Ricarda Merbeth et l’excellent Rügamer font partie de la crème du chant allemand.
Sept. 2020/Juin 2021
Walk the Walk, (9 repr.)
Performance du compositeur et installateur danois Simon Steen-Andersen.
Oct. 2020
Modest Mussorgsky, Khovantchina, (5 repr), MeS: Claus Guth, Dir: Simone Young avec Mika Kares, Sergey Skorokhodov, john Daszak, Vladislav Sulimsky, Alexey Tikhomirov, Marina Prudenskaya etc…
Voilà une reprise qui pourrait bien être une nouvelle production car on peut douter que la première ait lieu en juin 2020, au rythme où vont les choses.Une reprise (?) de 5 représentations qui devraient être prises d’assaut. Un metteur en scène qui fait toujours discuter, mais qui travaille toujours intelligemment, on aurait aimé que Vladimir Jurowski puisse diriger cette reprise, c’est quand même un des grands chefs de ce temps, et ce sera Simone Young, évidemment moins stimulante, même si bonne cheffe. Mais il y a une distribution de très haut niveau, réunissant quelques-uns des meilleurs chanteurs de la nouvelle génération, dont l’excellent Mika Kares, mais aussi Vladislav Sulimsky ou Alexey Tikhomirov. À voir évidemment !
Georges Bizet, Les pêcheurs de perles (3 repr.) MeS: Wim Wenders, Dir: Victorien Vanoosten avec Olga Peretyatko, Pavol Breslik, Alfredo Daza.
Reprise de la production de Wim Wenders du chef d’œuvre de Bizet, avec notamment Olga Peretyatko et Pavol Breslik, et le baryton maison Alfredo Daza. Notons l’appel à Victorien Vanoosten, un des chefs français de nouvelle génération, qui a étudié à Paris, mais aussi à Helsinki notamment avec Esa Pekka Salonen (école finlandaise, aujourd’hui la plus considérée), et d’autres. Il a été l’assistant de Daniel Barenboim pour Les Pêcheurs de Perles et reprend la production qu’il a déjà dirigée en 2018.
Oct-nov 2020/Avril 2021
Richard Wagner, Tannhäuser (6 Repr.), MeS : Sasha Waltz, Dir : Thomas Guggeis avec Klaus Florian Vogt, Rachel Willis-Sørensen, Wilhelm Schwinghammer, Lauri Vasar, Marina Prudenskaya.
La production chorégraphiée et si originale de Sasha Waltz, dirigée par le très sollicité Thomas Guggeis, dans une distribution nouvelle, dominée par Klaus Florian Vogt avec l’Elisabeth de Rachel Willis-Sørensen et la Venus de Marina Prudenskaya. Si vous êtes à Berlin…
Oct-nov 2020
Benjamin Britten, The Turn of the screw (4 Repr.), MeS : Claus Guth Dir : Finnegan Downie Dear avec Stephan Rügamer, Maria Bengtsson, Angela Denoke etc…
La production de Claus Guth (à qui les questions de psychisme conviennent toujours) et la direction de Finnegan Downie Dear, directeur musical du Shadwell Opera, une des compagnies anglaises les plus inventives, peuvent stimuler la curiosité, mais aussi la distribution où l’on note Stefan Rügamer, magnifique chanteur acteur, de la troupe locale, mais aussi le retour de la grande Angela Denoke, dans le rôle de la gouvernante Mrs. Grose.
Nov.2020
Orpheus-festival (dans le cadre des Barocktage 2020)
Les Barocktage 2020, outre Mitridate re di Ponto proposent un focus sur le mythe d’Orphée, avec trois Orphée différents, celui, berlinois, de Carl Heinrich Graun (1704-1759), celui, italien, de Monteverdi et celui viennois de Gluck
Carl Heinrich Graun, Orfeo (1 repr. concertante) Dir: Howard Arman avec Lucile Richardot, Sophie Karthäuser, Andrew Watts etc…
Akademie für Alte Musik
Jolie distribution pour cette unique représentation concertante dirigée par Howard Arman plus connu comme chef de chœur ( il dirige actuellement le Chor des Bayerischen Rundfunks, l’un des meilleurs sinon le meilleur au monde) que chef d’orchestre. Carl Friedrich Graun, compositeur à la cour de Frédéric II, est lié à Berlin et la distribution est dominée par les remarquables Lucile Richardot et Sophie Karthäuser.
Claudio Monteverdi, L’Orfeo (3 repr.) MeS: Sasha Waltz Dir: Jonathan Cohen avec Georg Nigl, Ana Lucia Richter, Katharina Kammerloher
Le spectacle qui lie opéra et danse a fait le tour de l’Europe (Amsterdam, Lille, Luxembourg, Bergen etc…) avec les mêmes protagonistes Georg Nigl et Ana Lucia Richter, le Vocalconsort Berlin et les Freiburger Barockconsort et donc, si vous l’avez raté, c’est l’occasion de le voir. Vaut le détour.
Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice (3 repr.) MeS: Jurgen Flimm Dir: Marc Minkowski avec Bejun Mehta, Valentina Nafornița, Victoria Random
La version italienne de 1762 de Ranieri de’ Calzabigi, dirigée par Marc Minkowski (qui a souvent dirigé l’œuvre, notamment en français) avec comme particuarité Bejun Mehta en Orfeo contreténor, dans la mise en scène noire de Jürgen Flimm et les décors du grand architecte américain Frank Gehry. Vaut vraiment le détour aussi !
Never look back, ein Orpheus-Festival (5 repr.) dans l’ancienne salle de répétitions d’orchestre, une série de propositions sur le thème d’Orphée des écoles d’art berlinoises.
Nov-déc 2020/Janv.2021
Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, (7 repr.) MeS: Achim Freyer Dir: Thomas Guggeis avec Gyula Orendt, Anna Samuil, Katrin Wundsam, Adriane Queiroz etc..
Reprise tout à fait traditionnelle en période de Noël de Hänsel et Gretel, si populaire en Allemagne…dans la production d’Achim Freyer (2017). Le Freyer plasticien donne à cette production le caractère très particulier de son univers. Encore une fois Thomas Guggeis au pupitre.
Déc. 2020
Giuseppe Verdi, Rigoletto (5 repr.), MeS: Bartlett Sher Dir: Karel Mark Chichon avec Luca Salsi, Irina Lungu, Piotr Buszewski etc…
Reprise de la nouvelle production de juin 2019 de Bartlett Sher, transposée dans les années 20, dans une ambiance mélangeant l’expressionnisme d’Otto Dix et le maniérisme de Giulio Romano à Mantoue (Palazzo Te), on dirait donc manieristo-expressionniste…Toute nouvelle distribution à commencer le chef Karel Mark Chichon familier de ce répertoire et assez apprécié en général, Luca Salsi dans Rigoletto, Irina Lungu dans Gilda tandis que la plus grande curiosité viendra du Duca du tout jeune ténor polonais Piotr Buszewski, voix claire de ténor lyrique, qui commence à peine à chanter en Europe (Leipzig, Berlin, après quelques apparitions aux USA).
Déc. 2020/Janv-fév-avril2021
W.A.Mozart, Die Zauberflöte (12 repr.) MeS August Everding, Dir: Oksana Lyniv avec Mauro Peter, Jan Martiník, Evelin Novak, Serena Sáenz, Gloria Rehm, Roman Trekel etc…
Distribution passe partout (avec Mauro Peter, bien installé comme ténor mozartien, qui s’appuie sur la troupe (Jan Martinik comme Sarastro), mais la programmation joue sur les deux productions de Zauberflöte du répertoire de Berlin, la plus récente production Yuval Sharon, présentée en décembre 2019, et celle d’August Everding, légendaire, qui appartient au répertoire de Berlin comme de Munich. En 2019/2020, les deux productions devaient être proposées dans la même saison (décembre et avril) avec des distributions et des chefs différents. C’est en 2020/2021 la production d’August Everding qui est proposée sur 12 représentations (puisque les représentations d’avril ont été annulées). Au pupitre, Oksana Lyniv qui désormais est une inévitable des théâtres.
Janvier 2021
Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten, (4.repr) MeS: Claus Guth Dir: Simone Young avec Eric Cutler, Vida Miknevičiūtė, Michaela Schuster, Georg Nigl, Wolfgang Koch etc…
Une des grandes productions de la maison (Claus Guth), dans une distribution modifiée (Eric Cutler en Empereur, Vida Miknevičiūtė en impératrice) et au pupitre la solide Simone Young.
Janvier 2021
W.A.Mozart, Idomeneo (4 repr.) MeS, David Mc Vicar Dir: Louis Langrée avec Andrew Staples, Lea Desandre, Victoria Randem, Olga Peretyatko etc…
La nouvelle production d’avril 2020 (Festtage 2020, direction Simon Rattle) a été annulée pour cause de virus, elle est proposée en reprise (mais en réalité ce sera donc une nouvelle production) en janvier 2021 avec au pupitre Louis Langrée et une distribution différente, toujours Andrew Staples en Idomeneo, toujours Olga Peretyatko en Elettra, mais Léa Desandre (excellent choix) au lieu de Magdalena Kožená en Idamante et Victoria Randem au lieu d’Anna Prohaska en Ilia.
Janv-fév 2021
L.v.Beethoven, Fidelio (6 repr.), MeS: Harry Kupfer, Dir: Lahav Shani avec Simone Schneider, Greer Grimsley, René Pape, Andreas Schager/David Butt Philip, Evelin Novak, Florian Hoffmann, Arttu Kataja.
Une reprise de la production Kupfer, discutée lors des premières représentations, cette fois dirigée par le très doué Lahav Shani, chef israélien vainqueur du concours Mahler de direction d’orchestre de Bamberg, et aujourd’hui successeur de Nézet-Séguin à Rotterdam. La distribution affiche Andreas Schager sur 4 soirées, David Butt Philip sur les deux dernières, et René Pape en Rocco, Simone Schneider en Fidelio/Léonore, Greer Grimsley en Pizarro. Pour le chef d’abord.
Fév. – mars 2021
W.A.Mozart, Così fan tutte (3 repr.) MeS : Vincent Huguet, Dir: Daniel Barenboim avec Barbara Frittoli, Elsa Dreisig, Marianne Crebassa, Paolo Fanale, Gyula Orendt, Ferruccio Furlanetto
Ce devait être une reprise, ce sera une première, pour trois représentations du Cosi fan Tutte prévu cette année qui a dû être annulé. Même distribution composée de la nouvelle génération: Elsa Dreisig en Fiordiligi et Marianne Crebassa en Dorabella, ce devrait être excellent, Paolo Fanale en Ferrando et Gyula Orendt en Guglielmo tout autant, Orendt est un magnifique chanteur et Fanale un ténor très sensible. Les surprises viennent de Barbara Frittoli en Despina (dans un rôle où je ne la sens pas trop) et un Alfonso aussi luxueux qu’inattendu, Ferruccio Furlanetto.
Fév-mars 2021
Giacomo Puccini, Tosca, (6 repr.), MeS: Alvis Hermanis, Dir: Massimo Zanetti/Julien Salemkour avec Angel Blue, Brian Jagde/Marcelo Puente, Lucio Gallo, Jan Martiník.
Pure reprise alimentaire avec la jeune Angel Blue, la Tosca d’Aix, et deux ténors dont on parle Brian Jagde (2 premières rep.) et Marcelo Puente (4 dernières), ainsi qu’en Scarpia Lucio Gallo, qu’on n’a pas vu depuis très longtemps. Direction Massimo Zanetti et pour les deux dernières, Julien Salemkour, ex-assistant de Barenboim. Une reprise sans véritable intérêt
Mars 2021
Richard Strauss, Der Rosenkavalier, (4.repr) MeS: André Heller / Wolfgang Schilly, Dir: Simone Young avec Camilla Nylund, Günther Groissbock, Adrian Angelico, Nadine Sierra, Jonathan Winell etc…
Simone Young dirige cette reprise avec une belle distribution: Nylund, Groissböck, le meilleur Ochs aujourd’hui et la jeune et fraîche Nadine Sierra en Sophie, ainsi que dans Octavian, Adrian Angelico, le mezzo-trans norvégien qui a tant fait parler et qui a déjà chanté Octavian à Oslo et Stockholm. Un ensemble solide dans une production très « wienerisch »
Mars-avril 2021
Richard Wagner, Parsifal (3 repr.) MeS: Dmitry Tcherniakov, Dir: Daniel Barenboim, avec René Pape, Marina Prudenskaya, Andreas Schager, Falk Struckmann, John Tomlinson etc…
Reprise de ce Parsifal qui va devenir légendaire, pour trois représentations seulement, avec toujours Andreas Schager (Parsifal) et René Pape (Gurnemanz) les piliers de la production, mais Falk Stuckmann en Klingsor et Marina Prudenskaia en Kundry. Cette dernière fera difficilement oublier Anja Kampe et Waltraud Maier, qui fit ses adieux au rôle dans cette production. Mais si vous n’avez pas vu ce Parsifal, il faut évidemment y aller ventre à terre.
Avril-Mai 2021
Giacomo Puccini, La Bohème, (5 repr.) MeS : Lindy Hume, Dir : Rafael Payare avec Aida Garifullina, Elsa Dreisig, Dmitry Korchak, Alfredo Daza etc…
Une reprise alimentaire, avec le couple Garifullina/Korchak en Mimi et Rodolfo, Dreisig/Daza en Musetta/Marcello (Adriane Queiroz pour la dernière). Le chef vénézuélien Rafael Payare, issu du Sistema de José Antonio Abreu, qui fut assistant de Claudio Abbado et de Daniel Barenboim est au pupitre.
Mai 2021
Giuseppe Verdi, La Traviata, (6 repr.) MeS: Dieter Dorn, Dir: Eun Sun kim avec Elsa Dreisig, Freddie De Tommaso/Rame Lahaj, George Petean etc…
Autre reprise alimentaire avec Elsa Dreisig très présente dans les distributions parce qu’elle appartient à la troupe de la Staatsoper. Et deux ténors à l’orée de la carrière, Freddie De Tommaso et Rame Lahaj, ainsi que l’excellent George Petean comme Germont. Quant à Eun Sun Kim, on la voit de plus en plus diriger en Allemagne.
Alban Berg, Wozzeck, (4 repr.), MeS: Andrea Breth, Dir: Matthias Pintscher avec Matthias Goerne, Eva-Maria Westbroek, Florian Hoffmann, Graham Clark, John Daszak, Katharina Kammerloher, Heinz Zednik etc…
Comme souvent désormais, les gloires du passé dans les productions actuelles et dans de petits rôles c’est le cas de Heinz Zednik ici dans Der Narr (le fou), et des moins petits (Graham Clark dans Der Hauptmann – Le Capitaine). Le couple Wozzeck/Marie c’est Matthias Goerne et Eva Marie Westbroek, John Daszak est le tambour major, distribution très solide, presque référentielle. Le chef est Matthias Pintscher qui aborde le grand répertoire d’opéra.
Richard Strauss, Salomé (4 repr.), MeS : Hans Neuenfels, Dir : Thomas Guggeis avec Vida Miknevičiūtė, John Daszak, Waltraud Meier, Johan Reuter, Siyabonga Maqungo etc…Certes, c’est Waltraud Meier qui chante Herodias, et John Daszak Herodes mais plus d’Ausrine Stundyté en Salomé, on va découvrir Vida Miknevičiūtė qui aura aussi été Die Kaiserin dans Die Frau ohne Schatten cette saison. À découvrir donc, sous la direction de Thomas Guggeis, qui a créé la production encore récente de Hans Neuenfels.
Mai-juin 2021
Carl-Maria von Weber, Der Freischütz, (5 repr.) MeS: Michael Thalheimer Dir: Alexander Soddy avec Victoria Randem, Evelin Novak, Stephan Rügamer/Andreas Schager, Falk Struckmann etc…
Un Freischütz c’est toujours à prendre, parce que l’œuvre est rare et difficile. C’est une reprise de la production de 2015 de Michel Thalheimer diversement accueillie. Au pupitre Alexander Soddy, GMD du Nationaltheater Mannheim et ex assistant de Petrenko dans le Ring de Bayreuth. Distribution solide comprenant le Max de Stefan Rügamer, ténor excellent de la troupe de la Staatsoper, qui va étrangement alterner avec le puissant Andreas Schager, deux voix très différentes, presque opposées par le timbre et le volume. Agathe est Evelin Novak dans une distribution largement puisée dans la troupe. Survivant de la création, Falk Struckmann en Kaspar…
Juin-Juil. 2021
Jörg Widmann, Babylon, (4 repr.) MeS : Andreas Kriegenburg, Dir : Christopher Ward avec Mojca Erdmann, Susanne Elmark, Charles Workman, Willard White, Marina Prudenskaya
La saison s’achève sur 4 représentations de Babylon, l’opéra de Jörg Widmann, livret du philosophe Peter Sloterdijk créé à Munich en 2012 sous la direction de Kent Nagano.
À Berlin, la production d’Andreas Kriegenburg qui remonte à la saison 2018-2019 (mars 2019) a été dirigée à la création par Daniel Barenboim, et sera reprise la saison prochaine par Christopher Ward, GMD d’Aix la Chapelle, et ex-assistant de Simon Rattle pour le Ring d’Aix et de Kent Nagano lorsqu’il dirigeait Munich. La distribution est sensiblement identique à celle de la première. Seule exception Willard White succède à John Tomlinson comme Roi-Prêtre. Saluons le fait qu’un opéra contemporain soit repris et entre au répertoire.
Conclusions :
À vrai dire, l’impression laissée par cette saison est mitigée. Elle semble moins brillante et moins inventive que la précédente. D’abord nous l’avons souligné, l’impression d’un Daniel Barenboim en retrait, ensuite, certains choix de distribution étranges (l’alternance Rügamer/Schager dans Freischütz non par rapport à la qualité intrinsèque des deux artistes, mais à leur voix complètement différentes sur le même rôle).
D’un autre côté, Berlin fait résolument appel notamment dans les reprises de répertoire, à des jeunes chanteurs, quelquefois tout à fait débutants, y compris dans des rôles importants (Vida Miknevičiūtė à la fois Kaiserin dans Die Frau ohne Schatten et Salomé, les ténors Freddie De Tommaso, Rame Lahaj dans Traviata, Piotr Buszewski dans Rigoletto, ou David Butt Philip alternant dans Florestan avec Andreas Schager) et surtout à des jeunes chefs, nous avons signalé plus haut Thomas Guggeis, mais nous pourrions évoquer aussi Victorien Vanoosten, Finnegan Downie Dear, Lahav Shani, sans oublier Matthias Pintscher, pas si jeune mais rare à l’opéra qui aborde des œuvres étrangères à son répertoire habituel. Tout cela peut être défendu, d’autant que dans l’ensemble il est plutôt fait appel dans les productions de référence à la jeune génération des chanteurs (voir les Mozart par exemple : qui connaît Gyula Orendt, qui va chanter et Guglielmo et il conte ? C’est pourtant un chanteur qui fut un Zurga remarquable dans Les Pêcheurs de Perles de Wenders lors des premières dirigées par Barenboim, ou un Galveston de grand niveau dans Lessons in love and violence de George Benjamin (à Lyon la saison dernière).
Du positif et du discutable donc.
Mais la situation elle-même à cause du coronavirus est lourde de conséquences sur la saison prochaine : trois productions prévues Cosi fan tutte, Idomeneo, Khovantchina n’ont pas eu lieu ou n’auront pas lieu cette saison : il est fort douteux que les théâtres rouvrent avant l’été, et à supposer que ce soit possible, dans quelles conditions ? Avec quelle distanciation sociale ? Avec quel public pour un opéra international ou un Festival quand le public international ne sera pas dans les mêmes situations sanitaires selon les pays ?
Pour Berlin, c’est déjà le cas pour Cosi fan tutte et Idomeneo, et Khovantchina prévu en juin reste lourdement menacé. D’où l’affichage de ces titres la saison prochaine qui s’ajoutent de facto aux nouvelles productions prévues et que l’on propose sur de très courtes périodes (3 repr. pour Così fan Tutte, exactement comme prévu la saison actuelle (report sine die dans les mêmes conditions ?), 4 représentations pour Idomeneo au lieu de 5 cette saison, mais avec changement de chef et d’Idamante (Rattle pas libre et donc du même coup Magdalena Kožená), avec l’avantage que ces productions étaient prêtes en mars et n’auront pas besoin de longues semaines de répétitions. Pour Khovantchina prévu pour cinq représentations, au lieu des six affichées en juin, c’est un peu différent. Si la production comme c’est à craindre est annulée en juin, elle sera affichée en octobre (mais avec Simone Young et sans Vladimir Jurowski) , à un moment où tout reprendra progressivement, ce qui laisse le temps pour des répétitions en septembre, voire en juin (si c’est possible). Cela permettra-t-il de valider au moins partiellement des billets déjà achetés, de ne pas dénoncer les contrats, autant de questions qui me paraissent légitime de poser, et pas seulement pour Berlin.
C’est à la fois la conséquence de la situation que nous vivons, et aussi du système de répertoire qui permet un appel fort à la troupe, et d’afficher en peu de temps certaines reprises, notamment quand la troupe est bonne, comme c’est le cas à la Staatsoper de Berlin. Ainsi les grands standards sont-ils forcément affichés chaque saison (ce que j’appelle les productions « alimentaires ») et en 2020-2021, il y en aura au moins cinq Tosca, Traviata, La Bohème, Rigoletto, Die Zauberflöte, susceptibles d’attirer du public.
Ne nous berçons pas d’illusions : le monde du spectacle va se relever lentement de la situation inédite et dramatique qu’il connaît actuellement, et les saisons déjà présentées sur ce blog trahissent en creux pour la plupart, les problèmes que les théâtres affrontent actuellement. Il n’est pas sûr qu’au final elles se déroulent comme elles sont annoncées sur le papier. Mais il faut y croire.