
Le Teatro alla Scala mérite toujours un approfondissement particulier parce qu’on fait bien des erreurs sur son histoire et ses traditions. Aussi, exceptionnellement, avons-nous opté pour une vision globale de la saison (ballet excepté), mais aussi d’un regard sur d’autres saisons du passé, non seulement par comparaison, mais aussi pour raviver quelques souvenirs et surtout pour lutter contre certaines idées reçues du plus lointain passé. En route pour notre Wanderung scaligère…
————————-
Nous avons brièvement évoqué dans un récent post la situation de la Scala, et la présentation de la saison prochaine permet d’en savoir plus sur l’avenir de ce théâtre aimé entre tous.
Dominique Meyer a pris les rênes dans une période troublée, aussi bien à l’intérieur du théâtre à cause du départ anticipé d’Alexander Pereira, qu’à cause du contexte de pandémie, qui a contraint les salles à fermer pendant plusieurs mois au minimum, sinon plus d’une année.
C’est une situation difficile à maîtriser en ces temps extraordinaires. Manque de rentrées, initiatives sporadiques, programmation dans la brume de l’incertitude. On pourrait souhaiter mieux pour les théâtres et leurs managers.
Les choses se lèvent et la plupart des institutions présentent leurs saisons à la presse, en sollicitant les Dieux et les Muses pour que les salles ne soient pas à nouveau contraintes de fermer.
Fin de saison 2020-2021
Dominique Meyer a donc aussi programmé la fin de la saison 2021 (septembre à fin novembre) pour essayer d’attirer le public par des titres appétissants. Contrairement à d’autres maisons, il n’a pas repris les titres qui avaient été prévus avant la crise du covid. Ainsi, l’Ariodante initialement prévu avec Cecilia Bartoli qui avait annulé « par solidarité » avec Alexander Pereira non reconduit, avait-il été conservé sans Bartoli, mais toujours avec Gianluca Capuano, ainsi aussi du Pelléas et Mélisande très attendu qui devait être dirigé par Daniele Gatti (dans une mise en scène – moins attendue- de Matthias Hartmann). Deux spectacles annulés pour cause de Covid que nous ne verrons pas. Mais comme Matthias Hartmann est programmé dans la saison 2021-2022 peut-être lui a-t-on échangé Pelléas contre autre chose.
En septembre 2021, la saison (esquissée fin juin avec la production de Strehler des Nozze di Figaro dirigée par Daniel Harding) trois Rossini bouffes ouvrent l’automne lyrique
Septembre/octobre 2021
Gioachino Rossini, L’Italiana in Algeri (MeS : Jean-Pierre Ponnelle/Dir : Ottavio Dantone)
Avec Gaelle Arquez, Maxim Mironov / Antonino Siragusa, Mirco Palazzi, Giulio Mastrototaro etc…
Le retour de la production Ponnelle avec cette fois Gaelle Arquez dans le rôle d’Isabella, ce qui est une très bonne idée et les spécialistes Mironov et Siragusa dans Lindoro, avec Mirco Palazzi en Mustafa, le rôle immortalisé par Paolo Montarsolo. Bon début de saison automnale avec en fosse Ottavio Dantone, une sécurité.
(4 repr. du 10 au 18 septembre
Gioachino Rossini, Il barbiere di Siviglia (MeS : Leo Muscato /Dir : Riccardo Chailly)
Avec Maxim Mironov / Antonino Siragusa, Cecilia Molinari, Mirco Palazzi, Mattia Olivieri.
La Scala avait gardé jusqu’ici la trilogie bouffe rossinienne Italiana, Barbiere, Cenerentola, signée Jean-Pierre Ponnelle, précieux trésor scénique qui n’a pas trop pris de rides quand on voit les Rossini bouffes d’une grande banalité qui essaiment les théâtres. Le Barbiere de Ponnelle arrivé de Salzbourg à la Scala en 1969, inaugurant cette série de Rossini bouffes qui vont être immortalisés par Claudio Abbado.
Cette année en remisant Ponnelle au placard, on appelle Leo Muscato, celui qui avait eu la géniale idée de changer la fin de Carmen pour être plus dans l’air #Metoo du temps… Il a commis comme perles à un collier d’autres productions sans intérêt.
De Ponnelle à Muscato… plus dure sera la chute.
En compensation, Riccardo Chailly reprend la baguette dans un répertoire qu’il a abandonné depuis des années, et ça c’est heureux, très heureux même, on a hâte. Mais quelle gueule ça aurait eu qu’après Abbado, Chailly reprenne la production Ponnelle ! Non, on préfère la médiocrité scénique…Solide distribution, on attend avec gourmandise le Figaro de Mattia Olivieri et la Rosina de la jeune et talentueuse Cecilia Molinari.
(6 repr. du 30 sept. au 15 oct)
Gioachino Rossini, Il turco in Italia (MeS : Roberto Andò/Dir : Diego Fasolis)
Avec Rosa Feola, Erwin Schrott, Antonino Siragusa, Alessio Arduini
Même si je ne suis pas convaincu par Fasolis dans Rossini, ce Turco in Italia s’annonce vocalement intéressant avec un Erwin Schrott qui sûrement en fera des tonnes et la très lyrique Rosa Feola. Production distanciée et cynique de Roberto Andò qui eut bien du succès à la création en février 2020, avec une carrière interrompue par le Covid. On la reprend donc et c’est justice.
(5 repr. du 13 au 25 octobre)
Octobre-novembre 2021
Francesco Cavalli, La Calisto (MeS : David McVicar/Dir : Christophe Rousset)
Avec Chen Reiss, Luca Tittoto, Véronique Gens, Olga Bezsmertna, Christophe Dumaux
Très belle distribution avec la délicieuse et talentueuse Chen Reiss et Véronique Gens, mais aussi les excellents Luca Tittoto et Christophe Dumaux. MeS de David McVicar, c’est à la modernité sans effrayer le bourgeois et les âmes si sensibles du public de la Scala. Direction confiée à Christophe Rousset, qui l’a enregistré avec Les Talens Lyriques : ce sera sans nul doute solide, mais pour ce qui est de l’inventivité ou de l’imagination… N’y avait-il aucun chef italien disponible pour cette œuvre vénitienne ??
(5 repr. du 30 octobre au 13 novembre)
Novembre 2021
Gaetano Donizetti, L’Elisir d’amore (MeS : Grisha Asagaroff/Dir : Michele Gamba)
Avec Davide Luciano, Aida Gariffulina, René Barbera, Carlos Alvarez
Beau quatuor pour ce marronnier des scènes lyriques : Carlos Alvarez dans un rôle comique ce sera explosif, et David Luciano en Belcore sera sans doute là aussi très drôle. La production de Grisha Asagaroff est professionnelle et la direction de Michele Gamba, jeune chef appréciable, mais diversement apprécié dans sa prestation de 2019, dernière série de cette production régulièrement présentée depuis 2015, alors que la précédente (Laurent Pelly) ne l’a été qu’une saison.
(5 repr. du 09 au 23 novembre)
Cette saison d’automne constitue donc une bonne introduction à la saison 2021-2022. On peut même dire que saison d’automne 2020-2021 et saison 2021-2022 doivent presque être considérées globalement, puisqu’il n’y a en 2021-2022 ni Rossini ni baroque.
De plus, au total, on n’aura jamais autant vu Riccardo Chailly (on s’en réjouit) que pendant cette saison 2020-2021 tronquée : inauguration 2020 (le spectacle A riveder le stelle), Salomé, Die Sieben Todsünden/Mahagonny Songspiel, Il barbiere di Sivlglia, c’est deux fois plus que d’habitude… Vive les pandémies…

Saison 2021-2022
Ainsi donc la saison 2021/22 est-elle la première effective de Dominique Meyer, avec un jeu de propositions où le maître mot est « équilibre » à tous prix.
Treize productions étalées de décembre 2021 à novembre 2022 soit à peu près une par mois, plus des soirées de ballet (Dominique Meyer est depuis longtemps un grand amoureux du ballet et il a amené dans ses valises Manuel Legris, artisan d’un splendide travail à Vienne), et de nombreux concerts de tous ordres que nous détaillerons.
Mais le projet de Dominique Meyer est plus global et plus articulé :
En effet, il affiche aussi une vraie saison musicale et instrumentale, très bien structurée, et alléchante que nous allons d’abord évoquer.
Dominique Meyer est un passionné de musique, et notamment de musique symphonique, sans doute plus mélomane que lyricomane : on le perçoit dans la manière dont il structure l’offre « hors-opéra » de la Scala : il y a très longtemps que l’offre n’avait pas été aussi complète, avec de nouvelles propositions très heureuses.
Concerts et récitals
Les concerts avec l’orchestre de la Scala annoncés, avec la présence d’Esa Pekka Salonen, de Riccardo Chailly, qui est sans doute un plus grand chef symphonique que lyrique, et de Tughan Sokhiev, directeur musical du Bolchoï et dernier de la lignée des grands chefs russes, ainsi que de deux jeunes, Speranza Scappucci présence qui sans doute annonce un futur opéra (ce serait une excellente idée) et Lorenzo Viotti, qui est là pour Thais et ainsi sera entendu dans un répertoire symphonique ce qui est intéressant pour mieux le connaître.
Il y a aussi de beaux récitals de chant, une tradition qu’il faut absolument faire revivre et Dominique Meyer a bien raison de reconstruire une saison de récitals, comme la Scala en faisait jadis chaque année : Ildar Abdrazakov (nov. 2021), Waltraud Meier (janv), Ekaterina Sementchuk (janv.), Ferruccio Furlanetto (avr.), Juan Diego Florez (mai), Anna Netrebko (mai), Asmik Grigorian (sept.2022) sont affichés, alternant mythes et voix nouvelles ou encore moins connues à Milan avec quelque sommets comme la venue de Waltraud Meier. Il faut espérer que ces soirées réenclencheront la passion des milanais pour les voix et contribueront à attirer un public curieux.
Quelques événements exceptionnels aussi avec un concert de l’Académie avec Placido Domingo (2 décembre), le concert de Noël avec le Te Deum de Berlioz dirigé par Alain Altinoglu (18 décembre), et une soirée Anne-Sophie Mutter-Lambert Orkis le 13 février 2022.
Belle idée aussi qu’un cycle de musique de chambre avec les musiciens de l’orchestre de la Scala dans le Foyer (un concert mensuel), c’est si rare dans ce théâtre qu’on se réjouit de ce type d’initiative qui fait mieux connaître la qualité des musiciens et les valorise et surtout affiche la musique de chambre comme un moment d’écoute privilégié, car c’est la musique de chambre qui fait comprendre à l’auditeur ce qu’est « faire de la musique ensemble » et affine son écoute.
Enfin des orchestres invités et pas des moindres :
Novembre 2021 : Staatskapelle Berlin, direction Daniel Barenboim (2 concerts)
Février 2022 : Orchestre de Paris, Esa Pekka Salonen (1 concert)
Avril 2022 : Mariinsky Teatr, Valery Gergiev (1 concert)
Mai 2022 : East-Western Diwan Orchestra, Daniel Barenboim (1 concert)
Sept. 2022 : Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann (2 concerts)
Ainsi reverra-t-on Daniel Barenboim à la Scala pour trois concerts, il n’était pas revenu après avoir quitté son poste de directeur musical, et ainsi verra-t-on Christian Thielemann très rare en Italie, alors qu’il y a souvent dirigé dans sa jeunesse. Tout cela est de très bon augure. Des bruits courent d’ailleurs sur la venue de Thielemann pour la première fois dans la fosse de la Scala… On parle même d’un Ring… Wait and see…
Voilà une « saison symphonique » séduisante, bien articulée, intelligente, qu’il faut accueillir avec plaisir, et même gourmandise.
Les autres annonces
Pêle-mêle d’autres annonces ont été faites ou confirmées :
- Début des travaux d’agrandissement des espaces de travail du théâtre qui vont offrir une scène plus vaste, des espaces nouveaux pour la partie administrative et surtout des espaces pour les répétitions d’orchestre et les enregistrements qui seront à l’avant-garde. Avec un regret éternel pour la disparition de la très utile Piccola Scala depuis plusieurs décennies…
- Projet de construction d’une cité du théâtre et de la musique, une sorte de « Teatrocittà » comme existe « Cinecittà » à Rome dans le quartier périphérique sud de Rubattino, qui devrait regrouper des entrepôts, des ateliers et des possibilités de production artistique. Une cité intégrée pour les arts de la scène, c’est un projet à peu près unique au monde.
- À l’intérieur du théâtre, Dominique Meyer importe de Vienne le même dispositif de traduction et sous titres par tablette qui substituera les petits écrans derrière les fauteuils actuels, qui avaient été eux aussi à l’époque copiés sur l’opéra de Vienne. Pour l’avoir expérimenté à Vienne, ce système de tablettes est très efficace et particulièrement convivial pour le spectateur (en huit langues). Par ailleurs un plan de numérisation des documents musicaux est lancé.
- L’accessibilité au théâtre devrait être améliorée et élargie par une nouvelle carte des prix des billets, un nouveau plan de billetterie qui devrait créer de nouvelles catégories, notamment en Platea (Orchestre) et dans les loges. Le constat unanime était que les prix institués dans la période Pereira étaient bien trop élevés (en soi et eu égard à la qualité moyenne) ce qui contraignait stupidement à vendre les billets invendus le dernier jour à 50%. Il est aussi question d’une Scala plus « inclusive », mais là on est plutôt dans la vulgate de toute institution aujourd’hui…
En bref, Dominique Meyer est réputé pour être non seulement un bon organisateur, mais aussi un bon gestionnaire. Le voilà à l’épreuve d’un théâtre qui en la matière n’en finit pas de virer sa cuti.
Quant au cœur du métier Scala, la programmation lyrique, le paysage est hélas nettement plus contrasté
Opéra
En ce qui concerne le lyrique, l’offre se profile de manière assez traditionnelle à l’instar d’autres saisons scaligères avec un plateau de la balance lourd sur le répertoire italien, et plus léger sur le répertoire non italien : un opéra français (Thaïs), un opéra russe (La Dame de Pique), un opéra du répertoire allemand (Ariadne auf Naxos), un Mozart (Don Giovanni) et une création contemporaine à Milan d’un opéra de Thomas Adès, The Tempest, d’après Shakespeare, créé à Londres en 2004, voilà l’offre non italienne, un saupoudrage auquel le théâtre nous a habitués depuis des décennies.
Le reste des titres (huit) appartient au répertoire italien avec un poids assez marqué pour Verdi et le post verdien : un Cimarosa (Il Matrimonio Segreto), pour l’académie, un Bellini (I Capuleti e i Montecchi), trois Verdi (Macbeth, Un ballo in maschera, Rigoletto), et trois post-verdiens (La Gioconda, Fedora, Adriana Lecouvreur). Une manière de revendiquer l’italianità du théâtre avec des titres qui n’ont pas été repris depuis très longtemps pour certains, comme Capuleti e Montecchi ou Matrimonio segreto, mais aussi une accumulation de trois titres de la dernière partie du XIXe, Ponchielli, Giordano, sans un seul Puccini qui il est vrai a été bien servi les saisons précédentes, et sans baroque ni Rossini très bien servis de septembre à novembre 2021, ce qui justifie leur absence. Nous commenterons au cas par cas et essaierons d’en tirer des conclusions générales sur une saison qui ne suscite pas un enthousiasme débordant.
Nouvelles productions :
Décembre 2021
Verdi, Macbeth (MeS: Davide Livermore /Dir. : Riccardo Chailly)
Avec Luca Salsi, Anna Netrebko/Elena Guseva (29/12), Francesco Meli, Ildar Abdrazakov etc…
(8 repr. Du 4 (jeunes) au 29 décembre).
La première production est toujours la plus emblématique. Riccardo Chailly revient à Verdi, et à l’un de ses opéras les plus forts avec une distribution évidemment en écho : Anna Netrebko (la dernière sera chantée par la remarquable Elena Guseva) et Luca Salsi forment le couple maudit. Pour des rôles qui exigent beaucoup de subtilité, il n’est pas sûr qu’ils soient les chanteurs adéquats, et pour un rôle pour lequel Verdi ne voulait pas d’une belle voix, il n’est pas certain non plus qu’Anna Netrebko douée d’une des voix les plus belles au monde soit une Lady Macbeth… Meli et Abdrazakov en revanche sont parfaitement à leur place. Mais pour la Prima, il faut des noms et Netrebko a pris l’abonnement… Quant à la mise en scène, c’est l’inévitable Davide Livermore, un excellent « faiseur »; comme metteur en scène, c’est autre chose… Mais depuis quelques années il est adoré à la Scala friande de paillettes et où l’on aime de moins en moins qu’une œuvre soit un peu fouillée. Étrange tout de même l’histoire de ce titre dans les 45 dernières années. D’abord Giorgio Strehler au milieu des années 1970, la production mythique d’Abbado avec Cappuccilli et Verrett, puis, un gros cran en dessous, la production Graham Vick avec Riccardo Muti, puis encore un cran en dessous Giorgio Barberio Corsetti avec Gergiev en fosse : pas de problème du côté des chefs, mais du côté des productions, jamais le souvenir magique de Strehler ne s’est effacé. On relira par curiosité ce que ce Blog écrivait de la production Gergiev/Barberio Corsetti où l’on faisait déjà le point sur la question https://blogduwanderer.com/teatro-alla-scala-2012-2013-macbeth-de-giuseppe-verdi-le-9-avril-2013-dir-mus-valery-gergiev-ms-en-scene-giorgio-barberio-corsetti.
Voilà la quatrième production, et Davide Livermore face à Strehler, c’est McDonald’s face à Thierry Marx ou un trois étoiles Michelin… On sait que Riccardo Chailly n’aime pas les mises en scènes trop complexes : avec Livermore, pas de danger. Mais quel signe terrible de l’intérêt pour la mise en scène de ce théâtre.
Quo non descendas…
Janvier-Février 2022
Bellini : I Capuleti e I Montecchi (MeS : Adrian Noble /Dir : Evelino Pidò)
Avec Marianne Crebassa, Lisette Oropesa, René Barbera, Michele Pertusi, Yongmin Park,
(5 repr. du 18/01 au 2/02)
Une œuvre merveilleuse, l’une des plus belles du répertorie belcantiste revient après plus de deux décennies, c’est évidemment heureux. Entre Crebassa et Oropesa, Pertusi et Barbera, on tient là une distribution excellente qui ne mérite que l’éloge.
Mais aller chercher le médiocre Adrian Noble pour succéder à la merveilleuse production Pizzi est pire qu’une erreur, une faute.
Au pupitre Evelino Pidò, comme il y a 14 ans à Paris dans la même œuvre (avec à l’époque Netrebko et DiDonato), et comme dans tant de reprises de répertoire à Vienne les dernières années. Je n’ai rien contre ce chef excellent technicien qui est pour les orchestres une garantie de sûreté surtout dans une perspective de système de répertoire ou de reprise rapide, mais il y avait peut-être d’autres noms à tenter pour une nouvelle production… D’autant que le monde lyrique est plein de chefs italiens très talentueux à essayer.
Février-mars 2022
Massenet, Thais (MeS: Olivier Py/Dir. : Lorenzo Viotti )
Avec Marina Rebeka, Ludovic Tézier, Francesco Demuro, Cassandre Berthon.
Une œuvre représentée une seule fois à la Scala, en 1942. Puisqu’elle revient à la mode, c’est une bonne idée que de la proposer avec Lorenzo Viotti en fosse, qui avait bien séduit à la Scala dans Roméo et Juliette de Gounod.
Olivier Py est un grand nom de l’écriture et de la mise en scène, mais il y a quelque temps qu’il n’a plus rien à dire, sinon faire du Py et se répéter: gageons que ce « rien » sera déjà quelque chose. Quant à la distribution, c’est le calque de celle de Monte Carlo en mars dernier, et on est surtout très heureux de voir Ludovic Tézier revenir à la Scala après bien des années.(6 repr. du 10/02 au 2/03)
Tchaïkovski, La Dame de Pique (MeS : Mathias Hartmann /Dir. : Valery Gergiev)
Avec Najmiddin Mavlyanov, Roman Burdenko, Asmik Grigorian/Elena Guseva, Olga Borodina, Alexey Markov etc…
(5 repr. du 23/02 au 15/03)
Mathias Hartmann, un metteur en scène très « fausse modernité », qui fait peut-être Dame de Pique parce que le Pelléas prévu a été annulé mais on s’en moque puisque Gergiev, Borodina, Grigorian etc… Et donc une distribution de très haut vol dont il faudra bien profiter. En plus, Gergiev est l’une des rares grandes baguettes présentes cette saison, il faut saisir cette chance, même si l’on connaît son côté un peu fantasque, boulimique du kilomètre et peu des répétitions…
Mars 2022
Cilea, Adriana Lecouvreur (MeS : David Mc Vicar /Dir : Giampaolo Bisanti)
Avec Freddie De Tommaso (4 au 10/03)/Yusif Eyvazov (9 au 19/03) Maria Agresta (4 au 10/03)/Anna Netrebko (9 au 19/03), Anita Rashvelishvili(4, 6, 16, 19/03) /Elena Zhidkova (9,10,12/03), Alessandro Corbelli (4 au 10/03)/Ambrogio Maestri (9 au 19/03)
(7 repr. du 4 au 19/03)
Co-Prod Liceu, San Francisco Opera, Paris, Vienne, Royal Opera House
Une large co-production pour ce retour à Milan d’Adriana Lecouvreur après une quinzaine d’années d’absence et surtout après une production Lamberto Pugelli qui a duré deux décennies. De David McVicar il faut s’attendre à un travail bien fait (encore un qui fait de l’habillage moderne d’idées éculées) qui n’effarouchera pas le public peu curieux de la Scala, mais on se demande bien quelle différence de qualité avec la production précédente, sinon l’habillage d’une nouveauté factice.
Mais une distribution étincelante où l’on découvrira (courez-y) le nouveau ténor coqueluche de toute l’Europe lyrique, le britannique Freddie De Tommaso en alternance avec « Monsieur » Netrebko. Une production idéale pour période de foire et selfies en goguette.
Et puis, last but not least, un chef qu’on commence à entendre à l’extérieur de l’Italie, Giampaolo Bisanti, directeur musical du Petruzzelli de Bari. Applaudissons à ce choix
Avril-mai 2022
Strauss (R) Ariadne auf Naxos (MeS : Sven Erich Bechtolf /Dir : Michael Boder)
Avec Krassimira Stoyanova, Erin Morley, Stephen Gould, Sophie Koch, Markus Werba etc…
(5 repr. du 15/04 au 03/05)
Co-Prod Wiener Staatsoper Salzburger Festspiele)
Venue d’une production viennoise et salzbourgeoise, élégante et creuse qui mérite les poussières ou les oubliettes de l’histoire : Bechtolf en effet n’a jamais frappé les foules par son génie, ni par ses trouvailles. Distribution en revanche de très haut niveau (comme la plupart des distributions cette saison) Stoyanova, Gould, Koch sont des garanties pour l’amateur de lyrique. Chef solide de répertoire, familier de Vienne. Mais pour une nouvelle production d’un Strauss aussi important, on pouvait peut-être afficher une autre ambition notamment au niveau du chef.
Mai 2022
Verdi, Un Ballo in maschera (MeS : Marco-Arturo Marelli /Dir : Riccardo Chailly)
Avec Francesco Meli, Sondra Radvanovsky, Luca Salsi, Iulia Matochkina (4, 7, 10, 12/05), Raehann Bryce-Davis (14, 19, 22/05) Federica Guida
(7 repr. du 04 au 22/05).
Magnifique distribution, avec l’Amelia la meilleure qui soit sur le marché aujourd’hui (on peut même dire la verdienne du moment), qui était déjà l’Amelia de la production précédente (Michieletto/Rustioni) et direction musicale du maître des lieux qui dirige un deuxième Verdi, comme il sied à tout directeur musical scaligère, mais il ne nous avait pas habitué à un tel festin.
Avec Marco-Arturo Marelli comme metteur en scène, c’est plutôt l’inquiétude en revanche, tant ont fait pschitt les espoirs qu’on mettait en lui dans les années 1980 (sous Martinoty il avait signé à Paris un Don Carlos programmé par Bogianckino bien peu convaincant) et tant ses nouvelles productions viennoises malgré leur nombre n’ont pas remué le Landerneau lyrique (Capriccio, Cardillac, Die Schweigsame Frau Der Jakobsleiter sous Holänder et Zauberflöte, Falstaff, Gianni Schicchi, La Fanciulla del West, Medea, La Sonnambula, Orest, Pelléas et Mélisande, Turandot pendant le mandat de Dominique Meyer). Le voilà à la Scala, vous conclurez vous-mêmes…
Juin 2022
Ponchielli, La Gioconda (MeS : Davide Livermore /Dir : Frédéric Chaslin)
Avec Sonya Yoncheva, Daniela Barcellona, Erwin Schrott, Fabio Sartori, Judith Kutasi, Roberto Frontali
(6 repr. du 7 au 25/06)
Sonya Yoncheva veut marcher dans les pas de Callas et s’empare de ses rôles les uns après les autres (Tosca, Médée, et maintenant La Gioconda), la voix est belle, mais le reste n’est pas à l’avenant. N’est pas Callas qui veut, même quand on est soi-disant un nom. Le reste de la distribution est en revanche vraiment très convaincant.
Le metteur en scène est encore une fois Davide Livermore qui fait du (quelquefois bon, reconnaissons-le) spectacle (les américains appellent cela entertainment) et surtout pas plus loin : vous grattez les paillettes, et c’est du vide qui sort.
Il est singulier, voire stupéfiant que Livermore soit tant sollicité à la Scala depuis quelques années et ça en dit long sur les ambitions artistiques de l’institution en matière de mise en scène… Bon, pour Gioconda, ça peut mieux passer que pour Macbeth. Moins gênant en tous cas… Direction musicale confiée à Frédéric Chaslin, très aimé de Dominique Meyer qui lui a confié à Vienne de nombreux titres de répertoire (à peu près 25) de tous ordres.
Juin-Juillet 2022
Verdi, Rigoletto (MeS : Mario Martone /Dir. : Michele Gamba)
Avec Piero Pretti, Enkhbat Amartüvshin, Nadine Sierra, Marina Viotti, Gianluca Buratto …
(8 repr. du 20 juin au 11 juillet)
Production de juillet, quand les touristes viennent, le Verdi des familles, signé Mario Martone (sa présence deux fois dans la saison compensera en mieux l’autre présence double, celle de Livermore…) qui est un metteur en scène « classique » mais intelligent et fin, après des dizaines années de règne incontesté de la production Gilbert Deflo : il était effectivement temps de changer.
Distribution solide avec le Rigoletto confié à Enkhbat Amartüvshin, une voix d’airain, mais un interprète peut-être à affiner encore, et accompagné de la délicieuse Nadine Sierra et du pâle mais vocalement très correct Piero Pretti. En fosse, un des jeunes chefs italiens digne d’intérêt, Michele Gamba que le public aura entendu déjà dans L’Elisir d’amore en novembre 2021 (voir plus haut).
Septembre 2022
Cimarosa, Il Matrimonio segreto (MeS : Irina Brook /Dir : Ottavio Dantone)
Accademia del Teatro alla Scala
Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala
(6 repr. du 7 au 22/09)
La production traditionnelle et annuelle de l’académie, aux mains d’une équipe équilibrée et très respectable. C’est de bon augure pour une œuvre qu’on n’a pas vue à la Scala… depuis 1980 !
Octobre/Novembre 2022
Giordano, Fedora (MeS : Mario Martone /Dir : Marco Armiliato)
Avec Sonya Yoncheva, Mariangela Sicilia, Roberto Alagna (15 au 21/10), Fabio Sartori (24/10 au 3/11), George Petean.
(7 repr. du 15/10 au 3/11).
Là aussi, Lamberto Puggelli a signé une mise en scène restée au répertoire longtemps dont la dernière reprise remonte à 2004 qui était bien faite et c’est Mario Martone qui signera la nouvelle mise en scène. Dans le naufrage des mises en scènes de la saison, c’est la garantie d’un travail digne.
Distribution en revanche somptueuse qui marque le retour à la Scala de Roberto Alagna après des années d’absence, dans un rôle (Loris) très peu familier du public français, raison de plus pour y aller. Fedora, un rôle que les sopranos abordent sur le tard, est ici Sonya Yoncheva, actuellement loin d’être en fin de carrière mais j’ai beau aller souvent l’écouter, je trouve la voix très belle mais peu d’intérêt au-delà.
Et le chef, Marco Armiliato, efficace, solide, écume les scènes du monde.
Mon unique Fedora à la Scala (et ailleurs) était dirigée par Gianandrea Gavazzeni, avec Freni et Domingo.
Gavazzeni réussissait à faire respecter cette musique, voire la faire aimer… Il en fallait du génie pour faire de ce plomb de l’or.
Novembre 2022
The Tempest (MeS : Robert Lepage /Dir : Thomas Ades)
Avec Leigh Melrose, Audrey Luna, Isabel Leonard, Frederic Antoun, Toby Spence
(MET, Opéra National du Québec, Wiener Staatsoper)
(5 repr. du 5 au 18 nov.)
Une des rares créations (2004) qui ait fait carrière, signée Thomas Adès (compositeur et chef) avec la mise en scène « magique » de Robert Lepage, maître en images et en technologie scénique. Pour la plus baroque des pièces shakespeariennes, il fallait au moins ça, avec une distribution de très grande qualité (Antoun, Spence) dominée par le magnifique Leigh Melrose. Une bonne conclusion de la saison, une respiration “ailleurs” avec un niveau musical et scénique garanti.
Reprise :
Mars-avril 2022
Mozart, Don Giovanni (MeS : Robert Carsen/Dir : Pablo Heras-Casado)
Avec Günther Groissböck/Jongmin Park (5, 10 apr.), Christopher Maltman, Alex Esposito, Hanna Elisabeth Müller, Emily d’Angelo, Andrea Caroll
Reprise de la médiocre mise en scène de Robert Carsen, théâtre dans le théâtre (comme d’habitude…) qui n’a pas marqué les esprits, mais il est vrai que trouver une production de Don Giovanni satisfaisante est un vrai problème. La production précédente de Peter Mussbach n’a pas marqué, et celle de Giorgio Strehler n’a pas non plus été à la hauteur de ses Nozze di Figaro légendaires. Donc, on accepte ce Carsen sans saveur pour jouir de l’excellente distribution et d’un chef qu’on dit très bon, mais qui ne m’a jamais vraiment convaincu.
(7 repr. du 27/03 au 12/04)
Conclusions :
Quelques lignes se dégagent :
- Des distributions solides, voire exceptionnelles, il n’y a là-dessus pas l’ombre d’un doute, nous sommes bien à la Scala et l’excellence est dans chaque production
- Des choix de chefs éprouvés, souvent familiers du répertoire à l’opéra de Vienne, et capables de bien gérer une représentation parce que ce sont souvent des chefs solides, mais en aucun cas ils n’ont offert de grandes visions artistiques ou de lecture d’une particulière épaisseur par le passé. Sans doute la saison préparée rapidement nécessitait de parer au plus pressé mais sans doute préside aussi l’idée que les chanteurs affichés suffiront à faire le bonheur du public. Des chefs pour la plupart au mieux efficaces, et donc à mon avis inadaptés à la Scala-plus-grand-théâtre-lyrique-du-monde comme « ils » disent…
- Des choix de metteurs en scène sans aucun intérêt, à une ou deux exceptions près, voire souvent médiocres. Des choix de tout venant qui affichent l’opéra comme un divertissement pour lequel la complexité n’est pas conseillée: des metteurs en scène pour consommation courante, pas pour une vraie démarche artistique.
Où est la Scala des Strehler, des Ronconi, des Visconti ? (Et même des Guth, Kupfer, ou Chéreau plus récemment) ?
Mon trépied de l’opéra chant-direction-mise en scène est bien bancal à la Scala cette année. Jamais la seule brochette de grands chanteurs dans une production n’a suffi à faire une grande soirée.
Il faudra sans doute attendre la saison 2022-2023 pour clarifier les choses puisqu’on espère qu’il n’y aura pas d’accident covidien en cours de route et voir si c’est ce chemin qu’on va emprunter.
Alors, pour essayer d’éclairer le lecteur, j’ai voulu remonter dans le temps, du récent (2012) au plus ancien (1924) pour voir à quoi dans le temps ressemblait vraiment la Scala, car en matière de Scala, le mythe construit dans les années 1950 est tel qu’on croit des choses qui n’ont existé que très récemment. En présentant deux saisons d’avant-guerre (avant deuxième guerre mondiale), à lire évidemment avec des clefs différentes nous avons eu de singulières surprises. Toujours mettre en perspective, c’est la loi du genre, sans jamais de jugements qui ne soient pas nés de l’expérience…

Plongeons dans l’histoire de la Scala
En conclusion de ce post mi-figue mi-raisin, j’ai donc voulu pour la première fois faire profiter le lecteur d’un de mes hobbies préférés, le plongeon dans les archives du théâtre pour mettre tout ce qu’on a pu écrire face au réel de l’histoire, et non face au rêve. Comme on pourra le constater, il y a à la fois des souvenirs, encore vifs, mais aussi des surprises de taille.
En plongeant dans cette histoire, se confronter avec d’autres saisons fait revenir à la raison ou relativiser (ou confirmer) nos déceptions. J’ai donc fixé comme critère des saisons où Macbeth était dans les productions prévues.
- Une saison d’avant la deuxième guerre mondiale et une saison « Toscanini »
On devrait plus souvent se pencher sur les saisons de la Scala au temps de Toscanini et autour, on verrait l’extrême diversité de l’offre lyrique, et notamment aux temps de Toscanini, la présence quasi permanente du chef légendaire au pupitre. On verrait aussi que Verdi était bien moins représenté que de nos jours, avec quelques œuvres mais en aucun cas la large palette que les théâtres de tous ordres offrent dans Verdi. <
Ainsi Macbeth n’est pas représenté entre 1873 et 1939, année où l’œuvre de Verdi ouvre la saison (à l’époque le 26 décembre) dirigée par l’excellent Gino Marinuzzi.
Pour donner une indication encore plus surprenante : il y a 23 titres de tous ordres dont nous allons simplement donner la liste, et deux Verdi (Macbeth pour 4 repr. et La Traviata pour 11), tous deux dirigés par Gino Marinuzzi. Voici la liste des œuvres données en 1939, quelquefois inconnues de nos jours, et les œuvres étrangères données toutes en italien :
- Verdi, Macbeth
- Massenet, Werther
- Mulé, Dafni
- Bellini, La Sonnambula
- Puccini, La Bohème
- Rabaud, Marouf, savetier du Caire
- Puccini, Turandot
- Wolf-Ferrari, La Dama Boba
- Wagner, Tristan und Isolde
- Verdi, La Traviata
- Leoncavallo, Pagliacci
- Cilea, Adriana Lecouvreur
- Humperdinck, Haensel und Gretel
- Pizzetti, Fedra
- Catalani, Loreley
- Mascagni, Il Piccolo Marat
- Beethoven, Fidelio
- Wagner, Siegfried
- Ghedini, Maria d’Alessandria
- Boito, Nerone
- Donizetti, La Favorita
- Giordano, Fedora
- Paisiello, Il Barbiere di Siviglia ovvero la precauzione inutile
Ainsi, on voit la grande diversité de l’offre, avec beaucoup d’œuvres « contemporaines » ou récentes à l’époque, pas un seul Rossini (la Rossini Renaissance sera pour plus tard).
On peut être surpris sur le nombre de titres affichés, mais c’était l’époque où la mise en scène n’était pas essentielle ou tout simplement n’existait pas au profit d’une mise en espace devant des toiles peintes, faciles à changer d’un jour à l’autre, sans décors construits. Une alternance plus rapide était plus facile à mettre en place.
Nettoyons nos idées reçues sur la Scala : à peine le nez dans son histoire qu’on découvre que tout ce qu’on raconte sur la Scala et Verdi, demande au moins une révision des rêves d’aujourd’hui sur un hier mythique.
Toscanini a beaucoup dirigé Verdi à la Scala, mais pas tous les titres, et il a autant dirigé Wagner et d’autres compositeurs. Prenons la saison 1924, celle du fameux Tristan und Isolde pour lequel Toscanini, arguant qu’il était ouvert à tout ce qui était novateur (les temps ont changé), avait appelé Adolphe Appia pour la mise en scène.
En 1924, voici les 24 titres, avec seulement trois chefs, Arturo Toscanini, Arturo Lucon, Vittorio Gui (un magnifique chef, si vous trouvez des enregistrements, n’hésitez pas, c’est un des plus grands chefs italiens, mort à 90 ans en 1975).
- Strauss, Salomé (Vittorio Gui) (Ouverture de saison)
- Riccitelli, I Compagnacci (Vittorio Gui)
- Mozart, Zauberflöte (Arturo Toscanini)
- Verdi, Aida (Arturo Toscanini)
- Verdi, La Traviata (Arturo Toscanini)
- Donizetti, Lucia di Lammermoor (Arturo Lucon)
- Puccini, Manon Lescaut (Arturo Toscanini)
- Wagner, Tristan und Isolde (Arturo Toscanini)
- Mascagni, Iris (Arturo Toscanini)
- Rossini, Il Barbiere di Siviglia (Arturo Lucon)
- Bellini, La Sonnambula (Vittorio Gui)
- Puccini, Gianni Schicchi (Vittorio Gui)
- Gluck, Orfeo ed Euridice (Arturo Toscanini)
- Alfano, La leggenda di Sakuntala (Vittorio Gui)
- Verdi, Falstaff (Arturo Toscanini)
- Verdi, Rigoletto (Arturo Toscanini)
- Bizet, Carmen (Vittorio Gui)
- Pizzetti, Debora e Jaele (Arturo Toscanini)
- Charpentier, Louise (Arturo Toscanini)
- Wagner, Lohengrin (Vittorio Gui)
- Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg (Arturo Toscanini)
- Moussorgski, Boris Godunov (Arturo Toscanini)
- Boito, Nerone (Arturo Toscanini)
- Giordano, Andrea Chénier (Vittorio Gui).
Sur 14 titres dirigés, Arturo Toscanini dirige Verdi (4), Mozart (1), Gluck (1) Puccini (1), Mascagni (1), Moussorgski (1) Boito (1) Charpentier (1) Pizzetti (1) Wagner (2).
Plus près de nous, les saisons d’Abbado ressemblent par leur organisation aux saisons d’aujourd’hui. Vous pourrez constater que c’est à juste titre qu’on peut « mythifier » la période :
- Une saison du temps de Claudio Abbado et Paolo Grassi
- 1975-1976
- Macbeth (Abbado/Strehler)
- Io Bertold Brecht (Tino Carraro/Milva/Strehler) ) à la Piccola Scala
- La Cenerentola (Abbado/Ponnelle)
- L’Heure Espagnole/L’Enfant et les sortilèges/Daphnis et Chloé (Prêtre/Lavelli)
- Cosi fan tutte (Böhm/Patroni-Griffi)
- Simon Boccanegra (Abbado/Strehler)
- Aida (Schippers/Zeffirelli)
- Werther (Prêtre/Chazalettes)
- Benvenuto Cellini (Davis/Copley) Tournée du ROH London (et la Scala est à Londres)
- Peter Grimes (Davis/Moshinsky) Tournée du ROH London (et la Scala est à Londres)
- La Clemenza di Tito (Pritchard/Besch) Tournée du ROH London (et la Scala est à Londres)
- Der Rosenkavalier (Kleiber/Schenk)
- Luisa Miller (Gavazzeni/Crivelli)
- Turandot (Mehta/Wallmann)
Tournée aux USA pour le bicentenaire de l’indépendance américaine
– La Bohème (Prêtre-Zeffirelli)
– La Cenerentola (Abbado-Ponnelle)
– Simon Boccanegra (Abbado-Strehler)
– Macbeth (Abbado-Strehler)
Considérons le niveau des chefs invités à la Scala en dehors d’Abbado, Böhm, Prêtre, Kleiber, Mehta, Gavazzeni, Colin Davis : c’est le « festival permanent »… on comprend pourquoi le public était difficile…
Au temps de Muti, la saison 1997 a aussi ouvert par Macbeth, c’est moins festivalier que la saison 1975, mais cela reste assez solide avec trois titres dirigés par Muti sur dix.
- Une saison du temps de Riccardo Muti et Carlo Fontana
1997-1998 - Macbeth (Muti/Vick)
- Il Cappello di paglia di Firenze (Campanella/Pizzi)
- Die Zauberflöte (Muti/De Simone)
- Khovantschina (Gergiev/Barstov)
- Linda di Chamounix (A.Fischer/Everding) (Prod.Wiener Staatsoper)
- Der Freischütz (Runnicles/Pier’Alli)
- Manon Lescaut (Muti/Cavani)
- Lucrezia Borgia (Gelmetti/De Ana)
- L’Elisir d’amore (Zanetti/Chiti)
- Carillon (Pesko/Marini) au Piccolo Teatro Strehler
Même impression pour cette saison Lissner/Barenboim : Lissner a été décrié par le public local, pourtant, à lire la saison 2012 (il n’y a que 9 ans), on est tout de même séduit par la diversité de l’offre et la qualité moyenne… afficher dans une saison un Ring, un Lohengrin, un Don Carlo, une Aida etc… Ça laisse un peu rêveur…
- Une saison du temps de Daniel Barenboim et Stéphane Lissner
2012-2013 - Lohengrin (Barenboim/Guth)
- Falstaff (Harding/Carsen)
- Nabucco (Luisotti/D.Abbado)
- Der fliegende Holländer (Haenchen/Homoki)
- Cuore di Cane (Brabbins/McBurney)
- Macbeth (Gergiev/Barberio-Corsetti)
- Oberto, conte di San Bonifacio (Frizza/Martone)
- Götterdämmerung (Steffens-Barenboim/Cassiers)
- Der Ring des Nibelungen (Barenboim/Cassiers)
- Un ballo in maschera (Rustioni/Michieletto)
Tournée au Japon : Falstaff/Rigoletto/Aida
- La Scala di Seta (Rousset/Michieletto)(Accademia)
- Don Carlo (Luisi/Braunschweig)
- Aida (Noseda/Zeffirelli)
De cette manière le lecteur tient des éléments de comparaison. L’intérêt de se plonger dans les archives, c’est de faire des découvertes, de rétablir des vérités contre les idées préconçues et surtout les mythes d’aujourd’hui :
- quand on voit ce que dirige Riccardo Chailly, directeur musical (2 productions) et ce qu’ont dirigé encore près de nous Barenboim, Muti, un peu plus loin Abbado, et encore plus loin Toscanini, on se dit que le titre est usurpé parce qu’il est évident que Riccardo Chailly ne donne pas grand-chose à ce théâtre. À ce niveau, c’est plutôt la Scala qui sert la soupe à un grand absent.
- quand on voit la saison 1975-1976 à la Scala on comprend pourquoi ces années-là semblent un rêve éveillé. Inutile même de comparer, c’est trop douloureux, mais à regarder la saison Muti et la saison Barenboim, la comparaison est aussi éloquente.
- Personnellement, je revendique l’intérêt de mises en scène contemporaines, qui parlent aux sociétés d’aujourd’hui et pas de mises en scènes qui ne sont qu’un cadre divertissant à la musique : c’est une erreur profonde de penser que l’opéra c’est musique et chant + guirlandes. Qu’importe d’ailleurs que la mise en scène soit traditionnelle ou novatrice, si elle a du sens.
La saison lyrique 2021-2022 à la Scala, est grise et ne soulève pas l’enthousiasme. Il y a peut-être des raisons objectives à ces choix qui laissent un peu perplexes, mais sans penser qu’on doit faire de la saison un festival permanent (c’est pourtant le sens du système stagione : faire de chaque production un moment d’exception), il y a peut-être à trouver une voie un peu plus stimulante. Je peux comprendre des difficultés dues au contexte, mais ce programme ne donne aucun signe d’avenir, et c’est là la question. On compensera sa déception par une saison symphonique et musicale intelligente et bien construite qui est-elle tout à fait digne de cette maison.
On souhaite alors ardemment que la saison symphonique par son organisation et son offre, trace un sillon que suivra la saison lyrique les années prochaines pour un théâtre qui sait, quand il faut, être le plus beau du monde.
Mais, dans la déception comme dans le triomphe, on continue de l’aimer éperdument… Et lucidement, car on le sait, la passion va de pair avec la lucidité, comme chez Racine.




























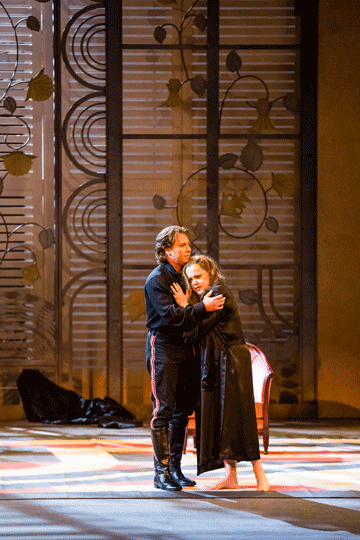

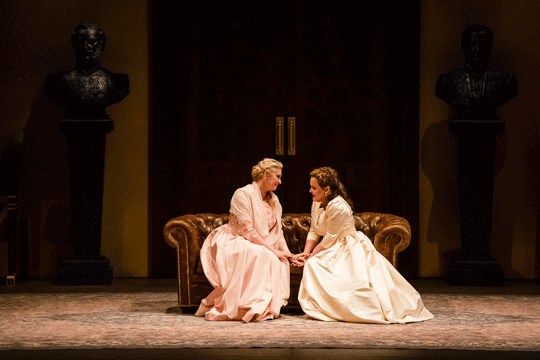




 Qu’en est-il de tout cela dans la production parisienne?
Qu’en est-il de tout cela dans la production parisienne?
 AFP, photo Gérard Julien
AFP, photo Gérard Julien AFP, photo Gérard Julien
AFP, photo Gérard Julien