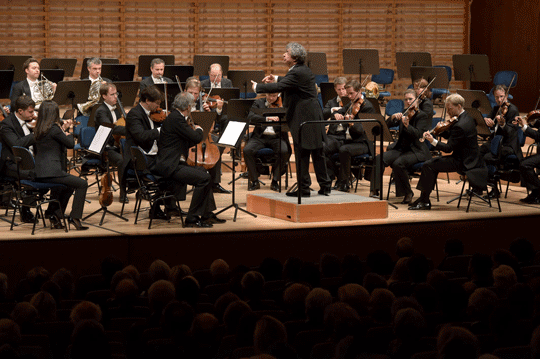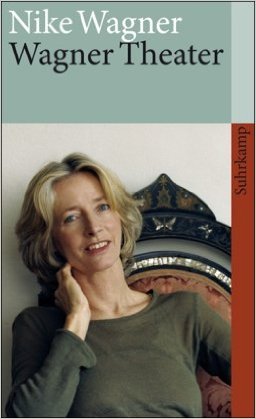Edward Elgar manque sans conteste à ma culture musicale. Je fais partie d’une génération où d’Elgar en France le mélomane connaissait exclusivement Pomp and Circumstance, régulièrement intégré à des disques d’extraits classiques célèbres, associé à un autre marronnier de l’époque, Sur un marché persan de Ketelbey., que je n’entends plus aujourd’hui et que tout mélomane débutant trouvait sous l’arbre de Noël pour peu que sa famille essayât de lui suggérer des goûts allant au-delà de la vague yéyé.
L’évolution du marché du disque, la limitation du grand répertoire classique que désormais les maisons de disques et les organisateurs de concerts essaient d’élargir, d’un côté par le baroque, de l’autre en proposant d’autres pistes et d’autres auteurs des XIXème et XXème font qu’on découvre (on devrait dire redécouvre: l’analyste ne découvre jamais, il redécouvre, comme le lecteur verdurinesque ne lit jamais, mais relit…). Je le répète souvent (ce doit être l’âge) mais peut-on imaginer qu’en 1980 on ne jouait pratiquement jamais les opéras de Janaček ni ceux de Chostakovitch, on a avait à peine découvert la version originale du Boris Godunov de Moussorgski, puisque jusqu’à 1979 les grands théâtres jouaient la version Rimski-Korsakov, dont nous avons un témoignage somptueux par le Boris Godunov de Karajan.
Dans ce monde ancien fait d’ignorance et d’oublis qui fut celui de ma jeunesse, Elgar ou Britten étaient des produits exclusivement locaux réservés au public britannique, et ne passaient pratiquement jamais le Channel, bien qu’en l’occurrence, le succès de The dream of Gerontius soit venu de la première exécution à Düsseldorf le 19 décembre 1901 sous la direction de Julius Buths (en présence de Richard Strauss enthousiaste) et non de la création à Birmingham le 3 octobre 1900 dirigée par Hans Richter qui avait reçu la partition la veille de la première répétition orchestrale.
Par bonheur, l’élargissement nécessaire des répertoires a fait que d’Elgar les Variations Enigma ont conquis les publics de la musique classique, mais pas The dream of Gerontius, son grand ‘œuvre, oratorio composé au début du siècle sur un texte adapté du cardinal John Henry Newman , qui arrivait le 13 septembre à Lucerne pour la première fois pour conclure alla grande le Festival 2015 .
Il y a dix ans à peine, c’eût été une œuvre jouée par un orchestre britannique lors d’une tournée. Signe des temps, ce sont les Wiener Philharmoniker qui s’en sont emparés, aidés par Sir Simon Rattle : Rattle et les Wiener sont une affiche suffisamment attirante pour se permettre de proposer une œuvre de consommation exclusivement nationale qui n’appartient pas au grand répertoire international. Et de fait le KKL de Lucerne était presque plein, comme souvent pour des concerts choraux, toujours impressionnants ; on se souvient dans cette même salle du succès du War Requiem de Britten, par Mariss Jansons et le Symphonieorchester des Bayerischen Runfunks, une autre œuvre d’internationalisation récente, malgré un succès jamais démenti.
L’oratorio d’Elgar est moins impressionnant, parce que sans doute plus retenu, vu le sujet : Gerontius se voit mourir et interpelle les forces de l’au-delà au seuil du trépas, puis, étant passé de l’autre côté, se retrouve devant le Juge suprême, accompagné par un Ange, et finira pour un temps au purgatoire. Ce récit ressemble aux récits mythologiques de descente aux Enfers, et nous montre au passage que les religions passent et les motifs restent. Belle leçon de relativisme que d’aucuns pourraient méditer.
C’est donc un sujet grave, intérieur, qui est abordé, et un sujet partagé par tous : qu’arrive-t-il lorsque les portes de la mort sont passées? Le sujet, Gerontius (littéralement le vieillard), vit ses dernières heures au début et passe de vie à trépas : la première partie se conclut par l’apparition du Prêtre (Roderick Williams, baryton) qui accompagne de l’autre côté Gerontius agonisant.
On est passé de l’autre côté et la deuxième partie s’ouvre sur l’âme de Gerontius accompagné d’un ange (Magdalena Kožená, mezzo soprano) qui va se présenter devant le juge suprême, c’est la partie la plus longue qui se conclut par le jugement tant attendu (on le comprend) rapide, expéditif, presque elliptique : Gerontius est envoyé brièvement au Purgatoire (malgré une intervention menaçante des démons) et pourra ensuite profiter du Paradis pour l’éternité.
D’une histoire somme toute banale (cette histoire qui nous attend tous si on est croyant), Elgar a voulu faire une pièce à la fois mystique, évidemment influencée par Bach, mais aussi un peu plus théâtrale (et donc on l’a appelée le Parsifal anglais), même si le suspens est assez mince et que l’intrigue reste sommaire. Il s’agit d’un Weihfestspiel, d’un Festival sacré, qui prolonge la tradition des mystères médiévaux dans une volonté de représenter le sacré, mais aussi de représenter la mort, ou même celle des oratorios romantiques à la Mendelssohn. Le passage de vie à trépas est justement le silence entre première et seconde partie. À la solitude du vivant (Gerontius agonisant), et au cérémonial d’accompagnement symbolisé par le prêtre qui intervient en fin de première partie, fait pendant en deuxième partie la présence de l’ange, qui casse la solitude initiale, comme si en quelque sorte la seconde vie était plus réconfortante que la première, et que l’âme n’était pas seule face à l’angoisse du Jugement comme le mortel l’était face à la mort.
La musique de Elgar est une musique recueillie, très élaborée, avec des niveaux sonores qui composent un tissu tressé avec soin, avec des interventions du chœur sublimes : en est-elle plus émouvante ? J’avoue ne pas avoir été sensible à cette harmonie monumentale, un peu froide pour mon goût et sans vraie élévation. Du moins l’ai-je ressentie ainsi. Une partition complexe, un monument bien construit et avec quelques moments réussis, mais une partition qui ne porte pas l’auditeur, comme Parsifal par exemple peut porter, ou comme une passion de Bach peut contraindre à regarder en soi.

Il serait évidemment nécessaire d’écouter cette musique plusieurs fois pour en découvrir d’autres secrets. Il reste que l’exécution pouvait difficilement être plus réussie. Sir Simon Rattle, en bon britannique, en connaît les ressorts et propose un travail millimétré, d’une rare précision, attentif à toutes les inflexions dont il indique le mouvement. Le travail sur le son est prodigieux, sur le dosage des volumes, sur les équilibres entre solistes et chœur dans une salle où il n’est pas toujours facile de travailler les voix. Il est même fascinant de constater comment il donne une direction contenue à l’orchestre, jamais tonitruante, toujours très équilibrée, favorisant l’intériorité.
Les Wiener Philharmoniker je l’espère, enregistreront cette œuvre tant leur son fait merveille, à la fois chaleureux et somptueux, mais en même temps jamais démonstratif et tendant toujours vers le méditatif. Même les cuivres jamais ne se détachent de cette impression d’un son global et velouté avec des moments proprement stupéfiants, comme lorsqu’il accompagne le chœur des âmes du Purgatoire (Bring us not, Lord, very low…come back again, O Lord) ou l’âme de Gerontius (My soul is in my hand) dans une sorte de sorcellerie sonore.
Le chœur, le BBC Proms Youth Choir, dirigé par l”inévitable et remarquable Simon Halsey, rompu à ce répertoire, est absolument magnifique de présence, sans jamais être spectaculaire lui non plus, mais souvent aérien, souvent tendu aussi comme. Vrai personnage du drame, il est le chœur antique qui participe à l’action en la commentant. Là où il m’a séduit le plus, c’est au moment de l’apparition des démons, où l’on entend le Berlioz de la Damnation de Faust et notamment la Course à l’abîme (By a new birth and a an extra grace…).
C’est bien là ce qui m’a frappé : il y a comme un retour à l’antique, mais pas à l’antiquité, à une antiquité revue par la Renaissance, une antiquité lue par Raphaël et les milieux néoplatoniciens. C’est un peu pourquoi j’ai parlé à mes amis d’une exécution préraphaélite. J’ai ressenti non pas un romantisme ou un post romantisme, mais une volonté de se placer bien en amont, dans une renaissance revisitée par le XIXème, mais avec la même rigueur et les mêmes couleurs chatoyantes que celles qu’on peut contempler ou dans les tableaux de Benozzo Gozzoli ou dans les Loges de Raphael, mais surtout dans les tableaux de Hunt, de Rossetti ou de Millais, antérieurs d’une cinquantaine d’années, mais que cette musique m’a évoqué, à la fois dans sa froideur et sa chatoyance.

Au service de cette exécution, trois solistes: le baryton Roderick Williams, un artiste vu à Lyon dans Sunken Garden le printemps dernier, n’a peut-être pas la noblesse de timbre voulue par le rôle du prêtre, il en fait un prêtre un peu trop terrestre; il chantera aussi à la fin l’ange de la mort, élevé auprès de l’orgue (il est pour mon goût meilleur en Ange de la mort qu’en prêtre) accompagné par un orchestre à dire vrai sublime.
Magdalena Kožená est un ange magnifique, la voix est allégée, très attentive à l’expression et à la diction. J’ai souvent exprimé des doutes sur certains des rôles qu’elle a chantés récemment pour applaudir sans réserve cette fois à une prestation à la fois sensible, avec une voix très présente et en même temps allégée de manière surprenante, avec de beaux aigus bien déployés. Son rôle m’a rappelé celui de l’Ange dans une autre cérémonie religieuse qu’est le Saint François d’Assise de Messiaen. Il n’y a pas tant d ‘anges à l’opéra, et celui-ci lui sied bien : elle avait d‘ailleurs pour l’occasion revêtu une robe blanche, très simple et évidemment très en phase. On retiendra des moments vraiment séraphiques comme les alleluia initiaux ou l’extrême légèreté presque impalpable de The eternal blessed His child, ou de l’émouvant Farewell final.

Toby Spence enfin : nous connaissons depuis longtemps cette voix de ténor très claire, voire quelquefois mate, douée d’une superbe technique et d’une diction impeccable. On aurait pu craindre que la voix ne se perde dans cet océan orchestral et choral ; il n’en est rien. Même si la voix de Spence est ténue, elle convient bien à ce personnage de vieillard agonisant puis d’âme de vieillard .
Sir Simon Rattle veille aux équilibres dans une salle qui n’est point sympathique aux voix, et Toby Spence sait doser son volume, et surtout sait poser et projeter sa voix, ce qui est nécessaire vu la longueur de la partie, qui est le rôle principal. Il y a des moments proprement stupéfiants par exemple lorsqu’il prononce de manière si lyrique Then I will speak. Ou dans la partie finale, That sooner I may rise, and go above. Le rôle rappelle par son importance celui de l’évangéliste dans la Passion selon Saint Mathieu de Bach, à la différence qu’ici nous sommes entre l’oratorio et le Mystère, avec des personnages qui jouent en même temps des rôles, l’œuvre est toujours à la limite entre les deux et je serais curieux de voir un Sellars s’en emparer, ce qui est imaginable vu qu’il a travaillé sur Bach avec Sir Simon Rattle.
En attendant, il y avait de quoi être ravi de ce final grandiose du Festival 2015, exécuté avec un engagement phénoménal, et même si, emporté avec enthousiasme par les musiciens, je n’ai pas été emporté par la musique. [wpsr_facebook]