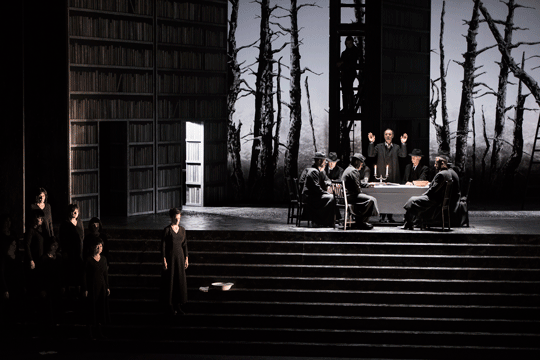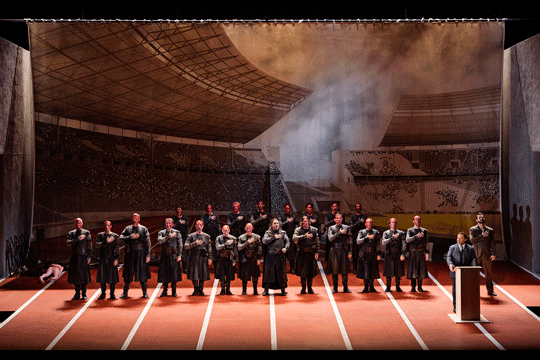Voilà un Donizetti rarissime, une pochade un peu folle traversée par tous les poncifs sur l’opéra, rivalité des chanteurs, librettiste médiocre, compositeur contraint de s’adapter, en fait tous les ingrédients futurs d’Ariane à Naxos de Strauss mais aussi passés de Der Schauspieldirektor de Mozart. Nous sommes donc clairement dans un lieu commun du genre, qui décortique l’opéra par tous ses petits travers, révélateur d’un système privé dépendant et du bon vouloir des financiers, et de la rouerie des imprésarios, qui comme on le sait dominaient la scène italienne (Barbaja !) pendant la première partie du XIXème. Musicalement, c’est très clair : dans un monde musical dominé par Rossini, la musique de Donizetti , encore jeune compositeur (même s’il a déjà écrit 19 opéras sur un total de 72) compose en 1827 (pour Naples) ou 1831 (pour Milan) deux versions de l’opéra dont le titre premier est Convenienze teatrali , puis Convenienze e inconvenienze teatrali et enfin, on se sait trop pourquoi arrivera le titre Viva la Mamma qui n’est pas de Donizetti. Un Donizetti qui ne cesse de faire référence au « pesarese » qui continuera de dominer la scène italienne de nombreuses années encore, insinuant que pour qu’un jeune compositeur réussisse, il faut qu’il fasse du Rossini-bis, serio ou buffo, même si l’air de Daria de l’acte II est clairement plus tourné vers le futur que vers Rossini. On répète donc un opera seria à la mode rossinienne, mais de manière bouffe et détournée.
L’histoire, inspirée d’une comédie vénitienne de Antonio Simone Sografi (1794) est simple : on répète à Lodi (une petite ville à une trentaine de kilomètres au sud de Milan où l’opéra ne pénètre sans doute pas si souvent) un opera seria Romulus e Ersilia avec des chanteurs caricaturaux, une primadonna qui ne s’en laisse pas compter, une seconda donna qui veut être prima, un ténor allemand vaniteux incapable d’aligner un mot d’italien sans un épouvantable accent et comme dans les opere serie, un contre-ténor, pour l’occasion chanté par une femme. En face, librettiste et compositeur-chef d’orchestre, et les « gestionnaires », directeur de salle, financeur, impresario. Tout fonctionnerait peut-être si ne venait pas perturber le jeu la mère de la seconda donna, interprétée par un baryton-basse (ici Laurent Naouri, dans une composition délirante) venue pour imposer sa fille face à la vedette. Mon expérience personnelle en la matière me fait dire que cette situation peut n’être pas imaginaire: j’ai connu un père abusif de soprano qui perturbait des répétitions, et qui a été l’artisan de la ruine de la carrière de sa fille, demandant au metteur en scène de mieux la mettre en valeur, ou au chef de modifier tempo et volume pour mieux faire entendre la voix (en l’occurrence magnifique) de sa progéniture.
Nous sommes donc dans un monde qui se réfère à des realia à peine exagérées du genre. Les situations théâtrales se compliquent chez Donizetti sous l’effet de cette mère abusive, qui réussit à chasser ténor et contre-ténor, créant une situation où elle remplacera un des chanteurs partis, et où le mari de la prima donna qui défend son épouse avec énergie lui aussi sera amené à faire de même, provoquant au final l’annulation du spectacle, le financeur n’y trouvant pas son compte.
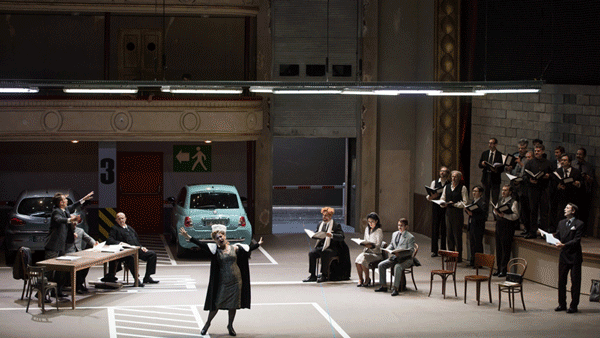
Deux parties très différentes dans l’opéra (en un acte ou deux), une première partie qui est la mise en place de plus en plus hasardeuse de la représentation, partie bouffe échevelée, avec des ensembles, des moments vocaux acrobatiques, une agitation permanente, et une seconde partie, plus courte, mais plus ordonnée, plus raffinée musicalement aussi, où l’on répète le spectacle avec ses numéros solistes et ses catastrophes, dont le sommet est l’air de Mamma Agata, est l’air de Mamma Agata, Assisa a’ piè d’un sacco, parodie de Assisa a’ piè d’un salice de la fameuse chanson du saule de Desdemona dans l’Otello de Rossini.
Viva la Mamma sera peut-être une pochade, il reste que la production de Laurent Pelly à Lyon est une production lourde, au décor impressionnant, qui raconte quelque chose sur le genre opéra, et bien sûr des références particulières au cinéma muet par le travail sur les expressions , mais aussi au musical, par des mouvements presque chorégraphiques, particulièrement bien réglés, dans une mécanique qui provoque immédiatement le rire.
Le décor hyperréaliste de Chantal Thomas est celui d’un théâtre, désaffecté, dans lequel on a fait un parking. Il y a 800 théâtres en Italie, certains fermés, certains en activité partielle, d’autres transformés. Bien des théâtres parisiens ont fini dans les gravats, ou servent aujourd’hui à tout autre chose. C’est un destin commun que la disparition des théâtres et Pelly propose au lever de rideau une vision du réel: une dame parquant sa voiture, sortant avec une charge impressionnante de courses et laissant le garage désert.
Aussitôt après cette étrange scène d’un théâtre transformé en garage, arrivent en silence les membres de la compagnie, portant chaises et tables, presque fantomatiques, puis un à un les chanteurs, pour se clore par l’arrivée de la primadonna, ostensiblement à part, lisant un magazine plutôt que le livret : ils s’emparent d’un espace qui n’est plus fait pour ça : cet heureux temps n’est plus.

Cette farce sur l’opéra, est en quelque sorte presque , apotropaïque, elle repousserait le mauvais esprit menaçant le genre. Laurent Pelly propose la vision d’un fantôme d’opéra qui réoccuperait des lieux désaffectés comme pour une dernière célébration,la dernière messe basse de l’opéra en quelque sorte. C’est une manière de dire aussi que les lieux gardent un esprit, au-delà de l’évolution de leurs fonctions : là où il y eut théâtre, le théâtre est toujours là. Alors du même coup tout peut-être échevelé, parce qu’il s’agit presque d’un sabbat théâtral, le sabbat de l’opéra où tout est possible, où chaque rôle devient caricature certes mais aussi emblème d’un système qui était celui de l’opéra d’alors, mais qui reste aussi par bien des aspects celui d‘aujourd’hui. Donizetti et Pelly nous disent : qu’est-ce que l’opera (seria) rossinien ? Un ténor, une prima donna, une seconda donna, un contreténor (ou un castrat, ou un mezzosoprano) et qu’est-ce qu’une distribution ? c’est la conjuration des Ego. Face à eux, librettiste et compositeur-chef d’orchestre, qui ne cessent de s’adapter aux exigences des chanteurs, pour éviter la crise, pour mener à bien l’entreprise, d’où on le sait, les modifications de dernière minute, les ajouts d’un air ou d’un duo, les coupures dont Rossini était un grand spécialiste et dont l’histoire du genre est pleine. C’était au temps où l’opéra vivait, triomphant et populaire, qui exigeait sa nourriture au quotidien d’airs à la mode.
Enfin dernière catégorie, les organisateurs, financiers, impresarios, directeurs de salle dont dépend toute la machine. Pelly met en scène tout cela avec une maestria et une précision d’orfèvre, mouvements et ensembles, parfaitement en phase avec la fosse, qui suit en rythme métronomique les mouvements du plateau. Ce bel ordonnancement, un élément perturbateur va le détruire, c’est Mamma Agata, un Laurent Naouri étourdissant de drôlerie, qui envahit la scène comme un ouragan. Bien sûr nous restons là aussi dans une tradition séculaire de l’interprétation d’une femme par un homme, née deux siècles auparavant pour le personnage d’Arnalta de L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi. Si la femme peut impunément interpréter un homme (et on l’a sur le plateau dans le personnage fugace de Pippetto), c’est aussi bien dans le serio (La Clemenza di Tito) que le buffo (Le nozze di Figaro), tandis qu’un homme interprétant une femme est forcément buffo. Ainsi l’arrivée de Mamma Agata, est-elle saluée par l’éclat de rire général, et le personnage va collectionner les outrances, scéniques et vocales. Pelly travaille beaucoup sur les gestes, les mimiques, les rapports entre les personnages : il a autour de lui une équipe de chanteurs acteurs exceptionnels. Attardons-nous sur le ténor allemand (Enea Scala, un ténor rossinien de très grande qualité), il entre en scène emmitouflé avec un grand chapeau, qu’il ôte en laissant apparaître de manière désopilante une chevelure frisée d’un blond-roux caricatural presque de bande dessinée, hiatus qui fait déjà sourire, puis s’assoit sur sa chaise, enlevant puis remettant nerveusement son écharpe (il faut protéger sa voix). La première partie n’est que succession de gags grossiers ou plus fins, mais là n’est pas l’important : l’important chez Pelly, c’est la mécanique qui va provoquer le rire, les jeux vocaux qui portent la voix à la limite et qui utilisent même les raideurs vocales de certains pour en faire des atouts comiques.

C’est la deuxième partie (les scènes XI et suivantes) qui va donner sens à l’ensemble. Le décor a changé, c’est celui du théâtre précédent, mais au temps de sa splendeur, quand il était théâtre et non garage, avec ses fauteuils, sa scène, ses éclairages, un théâtre en état de marche. Et cela commence par une scène mélancolique qui va éclairer d’un jour nouveau la mise en scène. Le ténor, Guglielmo, qui a quitté la production, arrive dans la salle, se dissimule aux regards et lorsqu’il se retrouve seul, regarde le théâtre en pleurant, puis entame son air serio, l’air qu’il devait peut-être chanter dans la production, qui a tout l’air d’un adieu. On passe d’une ambiance où le théâtre enfoui dans la mémoire avait disparu des lieux pour ne renaître que de manière fantomatique, à un théâtre de la mélancolie et de l’adieu, le passage du ténor est ce signe un peu amer d’une fin.
Une fin qui se prépare comme une représentation, tant bien que mal, les protagonistes répètent. À la manière des opéras où les deuxièmes parties sont souvent une succession d’airs virtuoses de plus en plus acrobatiques qui vont provoquer le délire du public. Moins de mouvements, mais encore de la loufoquerie, un peu moins démonstrative : ce sont les scènes représentées, le théâtre dans le théâtre en quelque sorte, une succession de pezzi chiusi qui vont se déglinguer et désespérer les spectateurs de la répétition (chef, impresario etc…). Ainsi se succèdent Luigia la seconda donna, costumée comme une sorte de Nedda de Pagliacci, puis la prima donna accompagnée d’un chœur loufoque de hallebardiers , Mamma Agata et son air imité de l’Otello de Rossini (et son jeu avec le souffleur), et Procolo (excellent Charles Rice), le mari de la prima donna qui se succèdent sur scène, jusqu’au moment où l’on annonce que le financier renonce, devant la succession de contretemps et de catastrophes.
Tous, ayant déjà bien entamé l’avance de cachet fuient, laissant un espace vide qui s’écroule sous l’effet des marteaux-piqueurs, chute de gravats qui marquent la fin de l’aventure et du théâtre.
Ainsi Laurent Pelly travaille-t-il la maigre intrigue de l’opéra en l’insérant dans un contexte plus large, celui de la fin d’une histoire ou d’un genre, qui est célébré par un beau décor si monumental qu’il répond peu à la minceur du propos Il est clair que ce qui intéresse Pelly est plus le contexte qu’un propos spécifique déjà vu. Le beau théâtre de la deuxième partie finit sous les gravats, celui de la première partie était garage, et la représentation ouvre sur un théâtre disparu et ferme sur un théâtre qu’on détruit. Le burlesque que nous avons vu conjure quelque chose qui ressemble à la mort. Il y a donc derrière deux niveaux de lecture :
- d’une part un jeu donizettien sur la fossilisation d’un genre, et à l‘époque (autour de 1830), c’est l’opera seria de style XVIIIème qui a jeté ses derniers feux avec Rossini et qui n’en peut plus, tout comme la tragédie en France : les grandes révolutions romantiques s’annoncent (la bataille d’Hernani mais aussi l’Anna Bolena de Donizetti datent de 1830) qui mettent à bas des genres anciens, en survie.
- D’autre part un jeu de Pelly qui pose la question de la survivance de l’opéra ailleurs que dans la mémoire des genres disparus et dans la reprise éternelle de recettes, sans création, sans nouveauté, dans une sorte de retour éternel sur soi, qui amène inévitablement à la fermeture progressive des salles, faute de public.
Tout cela Pelly le susurre par le seul jeu du décor et par la seule scène du ténor à l’ouverture de la deuxième partie, avec une délicatesse et une intelligence, une subtilité et aussi une profondeur qui ne sacrifie rien au burlesque, à la farce, à l’éclat de rire qui est rendez-vous ultime de la mort joyeuse.
À ce propos qui n’est pas si anodin, appuyé sur une œuvre apparemment sans enjeux, mais contemporaine de bouleversements artistiques notables dans l’Europe entière, répond une réalisation musicale impeccable, fondée sur l’implication d’une distribution engagée dans la mise en scène et le jeu, et sur une direction d’orchestre supérieurement conduite en parfaite symbiose rythmique avec la scène.
Ce type d’œuvre demande de la part des chanteurs une maîtrise technique très grande car il faut à la fois chanter et parodier un chant en soi particulièrement acrobatique (nous sommes dans la parodie de l’opera seria). En premier lieu les rôles de chanteurs sont très sollicités de manière tout à la fois démonstrative et déglinguée . Mais comme toujours, c’est le contexte et la qualité de l’ensemble de la distribution qui permet de tenir le niveau de la représentation.
C’est évidemment le cas ici, où sans avoir d’airs à proprement parler, Pietro di Bianco (Biscroma, chef d’orchestre) Enric Martinez-Castignani (Cesare, poète-librettiste) et Piotr Micinski (l’impresario), composent un trio de basses et barytons très agiles, désopilants, particulièrement précis dans les ensembles, par exemple, le sextuor Livorno, dieci aprile, avec une note particulière pour l’excellent Pietro di Bianco en chef d’orchestre au bord de la crise de nerfs, remarquable dans les scènes où il accompagne au piano les chanteurs . Un bon point aussi pour le joli Pippetto (le contreténor) de Catherine Aitken, voix fraîche et claire de mezzosoprano qui devait sans doute masquer un castrat.
Dans cet engagement général d’une distribution très homogène dans le jeu et dans la dynamique scénique et musicale, ceux qui interprètent les chanteurs sont évidemment au centre de m’attention car ils interprètent évidemment leur propre caricature. Charles Rice est Procolo, le mari de Daria la primadonna, joli timbre de baryton assez clair qui finit par remplacer le ténor parti. Style impeccable, belle diction, et une distance élégante de bon aloi : après son air très réussi au premier acte che credete che mia moglie, son interprétation de Vergine sventurata adressé à Mamma Agata est à la fois très drôle, mais sans jamais exagérer les attitudes ni les mimiques, il est vrai qu’il arbore un habit d’opéra baroque assez divertissant qui se suffirait presque à lui-même, dans le même style de celui de Daria.

Le ténor apparaît dans la première partie, mais disparaît assez vite. Dans l’opéra original (on connaît les problèmes de composition – deux versions en 1827 et 1831- et d’édition de l’œuvre) il n’y pas d’air de ténor et celui qu’on entend déplacé au début de la deuxième partie, est traditionnellement un air extrait d’un autre opéra: C’est un air (Non é di morte il fulmine) extrait d’Alfredo il Grande qui a été choisi, de Donizetti, créé à Naples en 1823 et qui n’a jamais été repris: il fait figure ici de morceau de bravoure un peu inutile comme une sorte d’air du chanteur esseulé, qui regarde le théâtre avec tristesse et regrets accompagné par une longue introduction musicale comme un long lamento serio dans ce nouveau décor plus somptueux, suivie d’une rupture de rythme et d’un air acrobatique à la Rossini: cela devient donc un air « à part », rajouté, qui est l’adieu héroïque du personnage comme ouverture à la deuxième partie, en dehors de la trame qui va voir les personnages se succéder pour chanter leur pezzo chiuso. Le ténor est ainsi vu sur le départ, se dissimulant aux autres, et pleurant. C’est Enea Scala qui chante, ténor belcantiste, au beau contrôle, et à l’impeccable phrasé, avec des aigus sûrs, magnifiquement projetés, et surtout une voix moins légère et un timbre moins clair qu’habituellement sur ce type de rôle, qui le prédispose aux héros mâles rossiniens. Un joli moment, très réussi, avec de belles agilités et un vrai relief. Enea Scala mérite une belle carrière. Et toute la mise en scène de ce moment justifie l’image finale de destruction.

La seconda donna de Clara Meloni, a l’habit de la jeune première, et elle chante son air, très bien contrôlé aussi, avec un jeu désopilant non sans émotion : elle chante d’abord avec une certaine retenue et une grande délicatesse, puis Pelly lui fait opérer mouvements du corps et des épaules très drôles, mais elle chante aussi d’une voix claire, bien projetée, bien posée. La figure en est intéressante, bien sûr, car elle est la jeunesse qui monte et qui veut sa place au firmament. Ainsi Donizetti bien traditionnellement affiche une situation que Patrizia Ciofi soulignait dans son interview sur Wanderer : « C’est terrible, surtout lorsque l’on approche de la cinquantaine et que l’on est obligé de faire le bilan : nous savons pertinemment que nous ne sommes plus comme par le passé, que la concurrence est là, constituée de jeunes talents pour qui tout est plus facile ». C’est la jeune qui va prendre la place bientôt de la plus mûre.

Et la plus mûre c’est justement Patrizia Ciofi, éclatante d’aisance et incroyablement agile, vive, impliquée, avec un immense professionnalisme ; elle occupe littéralement la scène, dans son magnifique costume dessiné par Laurent Pelly (qui a signé aussi les costumes). C’est dans son interprétation l’intelligence des situations, la précision des mouvements, en rythme avec le chant, qui impressionne presque autant qu’un chant éclatant, avec une voix qui certes n’a plus la « pureté » juvénile d’antan, avec quelques âpretés et quelques sons métalliques dans le suraigu, mais qu’importe quand l’ensemble est si naturel, et que la voix se fait expression pour enrichir le personnage. Sa composition est remarquable et l’entente avec Laurent Pelly visible, tant elle rentre dans chaque geste, chaque intention, chaque respiration voulue par la mise en scène. Du grand art.
Enfin Laurent Naouri est Mamma Agata. C’est une composition évidemment référentielle, d’abord parce que Naouri joue sans cesse, du corps, de l’expression, du geste, et bien sûr de la voix : tantôt on reconnaît son beau timbre chaud de baryton-basse, tantôt il passe à l’aigu, à la voix de tête, tantôt il est totalement à côté, chante joyeusement faux, de manière délirante, tantôt il susurre, avec de fausses nuances : son air Assisa a’ piè d’un sacco est du pur délire, avec le sac posé contre le trou du souffleur, sur lequel Mamma Agata va s’asseoir, avec ses variations sur sa voix naturelle et sa voix de falsetto avec des agilités et une souplesse vocale notables. Les ressources comiques de Naourisont infinies dans la voix, le comportement, la démarche, le pas lourd, et les petit gestes féminins (la fouille dans le sac) . Sa composition est bien sûr au centre de l’œuvre, et sa présence est telle que même silencieux, le public n’a d’yeux que pour un soupir, une mimique, un regard. Il serait un Falstaff délirant, s’il était aussi bien dirigé car dans son cas aussi le travail de Pelly sur le personnage est millimétré, avec les jeux évidents sur le genre, à une époque où se mélangent castrats, mezzos, sopranos, ténors et basse et où chacun campe un personnage qui n’est pas forcément celui qu’on attend.
Enfin, soulignons la belle prestation du chœur d’hommes – le chœur de Lyon est vraiment intéressant- mais c’est aussi et surtout de la fosse que vient la plus grande découverte. Lorenzo Viotti, fils du chef disparu Marcello Viotti, a été primé à Salzbourg en 2015 comme jeune chef prometteur.
On est frappé notamment en première partie par le rythme et la respiration de sa direction qui suit le plateau de manière parfaitement synchrone avec la mise en scène, sans aucun problème avec l’orchestre, qui a un son rond, sans aucune scorie et qui semble avoir ce répertoire dans les gènes. Mais c’est surtout en seconde partie qu’il impressionne: dans les introductions orchestrales, au début du second acte, qu’on entend des subtilités, les ciselures, des raffinements étonnants. Cette direction est celle d’un chef particulièrement doué, qui a un sens inné de la scène et du théâtre, qui sait dessiner des ambiances, qui sait donner une ligne à l’ensemble, et qui sait jouer aussi sur l’ironie et sur l’imitation, avec style, avec élégance, sans jamais faire surjouer l’orchestre mais cherchant toujours la fusion avec les voix, cherchant toujours à les soutenir. J’imagine ce qu’il pourrait rendre dans Viaggio a Reims ou Tancredi. Il réussit à mettre en valeur les détails musicaux de cette œuvre secondaire en faisant sonner à la fois buffo et serio : on a cité l’ouverture du second acte, on pourrait aussi citer l’introduction avec le solo de violoncelle de l’air de la seconda donna ou la manière dont est dirigée la « marche funèbre » finale, qu’on pourrait imaginer issue d’un autre opéra bien plus sérieux d’un Donizetti de la maturité, sans compter la clarté de la lecture, la transparence de l’orchestre, les crescendos maîtrisés. Lorenzo Viotti est un chef (de 26 ans) avec lequel il va falloir très vite compter.
Alors, une seule décision, une fois de plus courir à Lyon, mais pour rire aux éclats, après une saison qui fut éminemment sérieuse et dramatique. [wpsr_facebook]