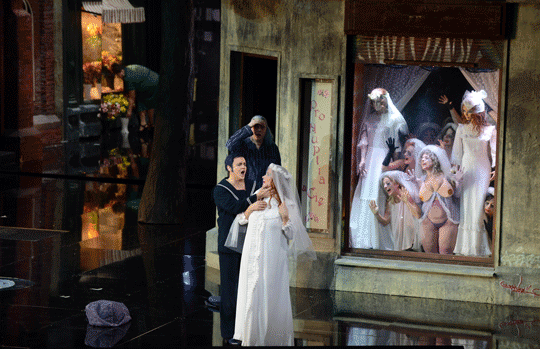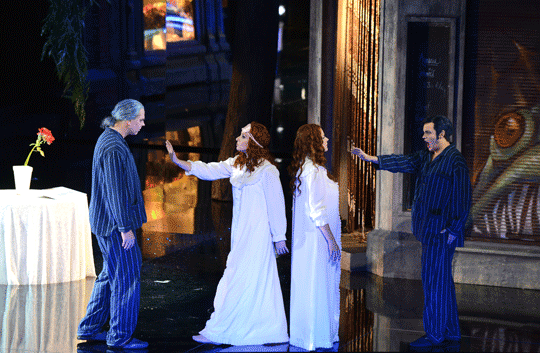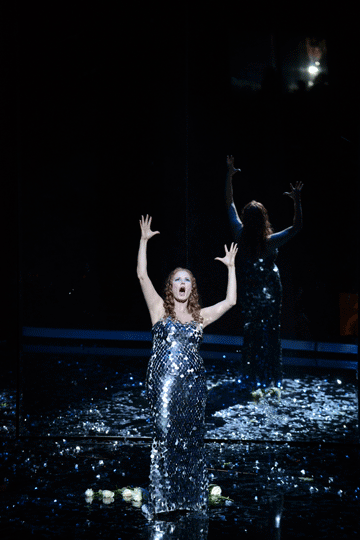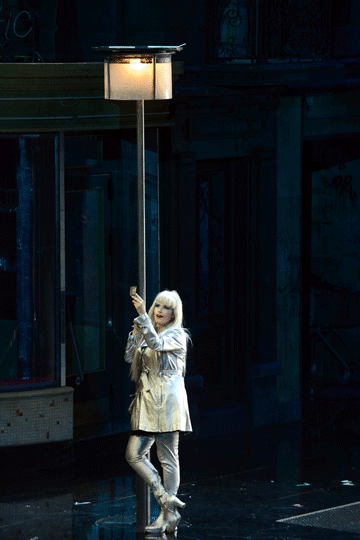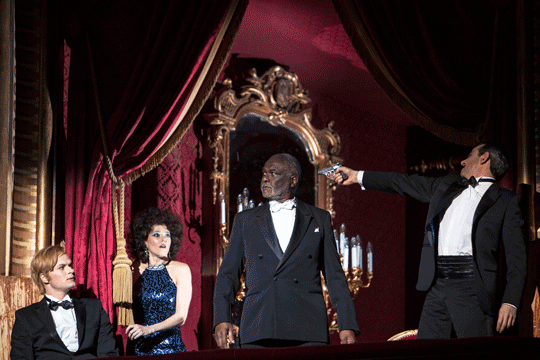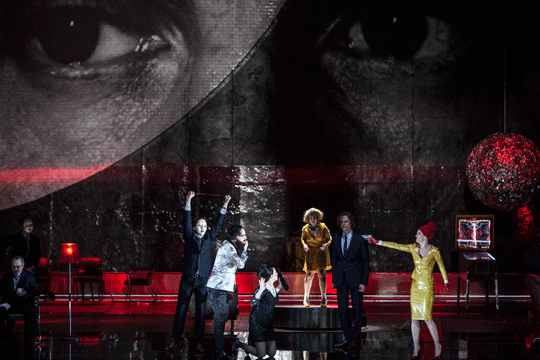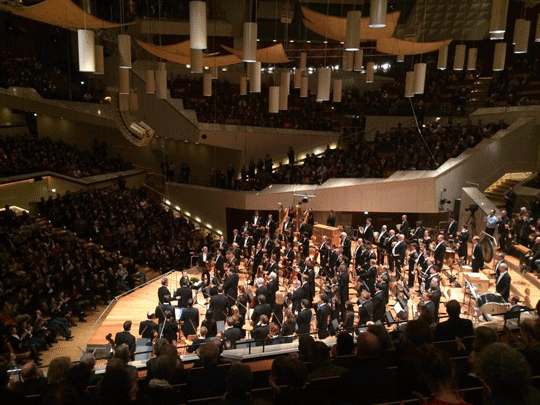On ne reviendra pas sur la complexité des Meistersinger von Nürnberg, labourée de manière approfondie lors du compte rendu de l’excellente production de Tobias Kratzer à Karlsruhe (voir le texte) qui posait la question centrale de l’interprétation et de la réception de l’œuvre. C’est bien la question fondamentale qui est posée ici par la production d’Otto Schenk qui a à peine plus de 20 ans, et qui pourrait en avoir 40, 50, 80 tant elle respire la poussière à première vue. S’il y avait des toiles peintes, on dirait qu’on l’a sortie du XIXème.

Mais les décors, signés du grand Günther Schneider Siemssen, sont construits, et de manière si impressionnante qu’ils provoquent encore aujourd’hui au MET des applaudissements à scène ouverte (au lever de rideau du 2ème acte et à la Festwiese). Nous sommes dans l’hyperréalisme, il ne manque pas un bouton de guêtre (normal vu que Sachs est cordonnier), pas un géranium, pas un colombage, comme si la comédie devait être par force réaliste. Déjà Wieland Wagner 40 ans avant la première de cette production au MET avait remis en cause cet axiome.
Plus profondément, cette production qui on va le voir, n’est pas complètement has been, pose la question de la modernité au MET, qui en ce moment éprouve de graves difficultés identitaires. Peter Gelb a essayé de moderniser les spectacles par tous les moyens, s’associant à des théâtres européens pour certaines productions (De la Maison des morts, Chéreau) faisant appel à des metteurs en scènes à la mode (Tcherniakov) ou modernes au sens de Broadway. C’est pourtant cette production sans âge qu’on applaudit avec ferveur…Problème de public qui vieillit sans être remplacé, problème d’éducation au théâtre et de tradition de cette scène qui a longtemps considéré la mise en scène comme une mise en image d’une version de concert, ou qui a confondu mise en scène et grand spectacle avec foule, couleurs et beaux décors (voir aussi La Bohème de Zeffirelli).

La salle était loin d’être complète : rangs entiers vides, spectateurs quittant par grappes le théâtre au 2ème entracte ou vers 23h30 (derniers trains de banlieue ?) alors que le spectacle se terminait vers minuit. Et pourtant, indescriptible triomphe autour du chef et de la distribution réunie. Mais à l’opéra, le pari de la musique ne suffit pas.
Je le dis et le répète à longueur de textes, Otto Schenk, très traditionnel dans sa vision, n’est pas néanmoins un mauvais metteur en scène. D’abord par le soin extrême apporté aux détails, aux petits faits vrais, il rend son travail très vivant, mais aussi grâce à l’individualisation des foules, enfants qui jouent, jeux de regards, échanges entre les gens, il fait un vrai travail de théâtre au miroir, permettant aux spectateurs de se reconnaître: la sortie de la messe au 1er acte en est un exemple.

Chacun a quelque chose à faire, il se passe toujours quelque chose. Ensuite par la caractérisation des personnages, jamais forcée, jamais exagérée, même pour Beckmesser, magnifiquement personnifié, incarné même par Johannes Martin Kränzle, fantastique acteur, naturel, ridicule mais pas trop, pathétique mais pas trop. La Eva (chantée ici par Annette Dasch) est aussi très bien dessinée, dans sa séduction trouble envers Hans Sachs et Schenk touche là à ce que Kratzer avait noté sur l’ambiguïté du personnage, sur ses hésitations, sur sa gentille rouerie aussi. Le jeu de Dasch s’adapte parfaitement à cette complexité là. La mise en scène d’Otto Schenk (ou ce qu’il en reste après 20 ans), n’est pas aussi fine pour Hans Sachs, dont il ne travaille peut-être pas assez les contradictions et les doutes, les colères et les troubles, ni pour Walther, mais vu les dons d’acteur limités de Johan Botha, c’est peut-être plus sûr et le personnage lui-même est moins intéressant.

En tous cas, tout n’est pas méprisable dans ce travail, même s’il faut bien dire aussi qu’on y retrouve au premier degré, ce sur quoi ironisait Kratzer dans son deuxième acte à Karlsruhe quand il évoquait les mises en scène réalistes ou archéologiques (rondes des apprentis, farces bon enfant etc…).
Il reste qu’on est bien dans la comédie et que, c’est à noter, le public répond, rit beaucoup, est bien plus participatif que le public européen, sans doute blasé, notamment en Allemagne. Die Meistersinger sont tellement rares hors d’Allemagne que cela ne se pose même pas ailleurs. On soulignera donc les décors monumentaux des premier et deuxième acte : la rue de Nuremberg est incroyable… et au troisième acte la maison de Sachs, pleine à craquer de toutes sortes d’objets. Seule la Festwiese manque à mon avis d’espace, bloquée en arrière plan par le rempart, qui permet de concentrer le chœur au premier plan et de voir enfin un vrai défilé des corporations au lieu des élucubrations à la Katharina Wagner (!). En fait, c’est un concentré des mises en scène qu’on voyait dans les années 50, 70 ou 80, comme celle d’August Everding à Munich ou comme celle(s) de Wolfgang Wagner à Bayreuth. La mise en scène de Schenk n’est jamais ridicule, même si je n’en défends pas les options. Il me semble cependant que le final du 2ème acte manque de rythme scénique : en la matière, Wolfgang Wagner avait réussi à Bayreuth dans le genre un final époustouflant au crescendo scénique d’une redoutable précision qui accompagnait le crescendo musical. Jamais vu mieux depuis. Et ici, le chœur chantant d’un côté et les danseurs ou les mimes se battant au centre donnent une impression d’artificiel : quand, comme chez Wolfgang Wagner, le chœur se déchainait en chantant, l’impression était bien plus forte et bien plus folle. À part ce moment, l’ensemble est passable, illustratif, mais jamais ennuyeux, ce qui est un tour de force vu le genre suranné de ce travail.
C’est que musicalement, nous sommes vraiment au sommet.
C’est bien la marque du MET que d’avoir toujours défendu au plus haut niveau l’excellence musicale et le parfait équilibre des distributions, dans un parti pris idéologique qui fait de toute représentation d’opéra une représentation de concert illustrée. La distribution réunie est sans doute l’une des meilleures que l’on puisse voir, à partir des excellents seconds rôles tenus par des chanteurs plus ou moins maison comme la très bonne Magdalena de Karen Cargill , voix grave, beau timbre, jolie présence et le non moins excellent David de Paul Appleby, voix bien posée et projetée, jolis aigus, jeu déluré . Un futur Mime ?

Le Pogner de Hans-Peter König, a sa belle voix grave, chaude, à la couleur toujours très humaine. Ce chanteur a le privilège d’humaniser chaque personnage qu’il aborde. Un méchant chanté par König n’est jamais tout à fait méchant, quelque chose en lui sonne fragile et tendre, comme son Hunding sur cette même scène dans la mise en scène de Lepage. Son Pogner est émouvant, souriant, rassurant. Belle figure.
On aura aussi noté Martin Gantner, qui a fait les beaux soirs de Zurich, excellent Kothner et le très bon Nachtwächter de Matthew Rose à la voix profonde et juvénile.
Johannes Martin Kränzle, sans avoir le timbre séduisant et la parfaite diction des grands Beckmesser (Hermann Prey, Michael Volle), a une voix forte et bien projetée, un naturel confondant en scène, une expressivité unique dans son chant, il est incarnation encore plus qu’interprétation. Il propose un Beckmesser un peu pataud, qui fait souvent sourire et quelquefois rire, et il a la qualité des grands : il sait dire un texte, en le jouant, en le distillant, avec une présence rare. Grand moment.

Eva est sans doute l’un des rôles les plus accomplis d’Annette Dasch. Elle est totalement convaincante car le rôle sied parfaitement à sa voix, elle y est émouvante, délicate, énergique : on se demande pourquoi Bayreuth qui l’a utilisée pour une Elsa où elle n’est pas à 100% de ses moyens a usé des Eva inutiles pendant cinq ans alors qu’elle est splendide. Une voix pure, bien placée, magnifiquement projetée : elle est sublime dans le quintette et vive, naturelle, jeune, fraiche en scène notamment dans le deuxième acte. Elle s’est emparée du personnage pour lui donner une vraie présence. J’avais dans mon souvenir Harteros dans ce rôle où elle était extraordinaire, j’y rajoute Annette Dasch. C’est pour moi aujourd’hui la meilleure des Eva.

À côté sans doute du meilleur des Walther, Johan Botha, extraordinaire. Dans une mise en scène qui ne lui demande que de se planter sur scène, il est totalement bluffant, les aigus sortent avec une facilité confondante, le timbre est velouté, il est Walther, avec une suavité que je n’ai pas connue depuis longtemps. Vogt était magnifique, comme il l’est dans Lohengrin, et il jouait, mais je crois que sur le plan purement vocal et stylistique, Botha est ici supérieur. Il a d’ailleurs remporté un phénoménal succès.

Vu d’Europe, on pensait James Morris en retraite, il a été à un moment l’un des plus beaux Wotan qui soit, un miracle de style. J’ai toujours aimé cette voix claire et étendue, cette délicatesse. Il a certes un peu vieilli, mais il a gardé ce qui faisait son prix : un chant d’une élégance unique, d’une douceur ineffable, un timbre d’une clarté étonnante pour un baryton basse. Il est un Sachs au-delà, qui a dépassé les crises, un sage distancié, rien à voir avec Renatus Meszar à Karlsruhe, ardent, amoureux, révolté, rien à voir même avec la personnalité forte et virile d’un Michael Volle. Il est ailleurs. Certes, le rôle est écrasant et les aigus les plus hauts lui sont difficiles, la voix bouge un peu, certaines attaques n’ont plus la netteté d’antan, notamment dans le troisième acte mais quelle noblesse de chant, quelle attention au texte, quelle clarté dans l’expression : son monologue du troisième acte est à ce titre anthologique. Un pur produit de la formation américaine, d’une propreté presque inaccessible. Un chant qui par le soin donné à chaque parole, est émouvant. Quel plaisir de l’entendre et d’entendre encore des qualités globales qui restent rares.
Et au milieu de ce plateau de très haut niveau, James Levine emporte la conviction du public, littéralement en délire dès qu’il se retourne vers le public en faisant mine de le serrer dans ses bras. Rarement théâtre ne s’est autant identifié à son directeur musical. On le pensait perdu pour la musique, on faisait des plans pour sa succession et il est là incroyable d’énergie, de profondeur, emportant l’orchestre pendant l’ouverture avec une incroyable dynamique malgré son tempo toujours un peu plus lent que d’autres. Son Wagner est somptueux, on lui reprochait souvent de ne pas avoir beaucoup à dire sinon une sorte de recherche formelle sans intérêt, on reprochait à son Parsifal sa lenteur désespérante quelquefois et on a là un travail d’une profondeur et d’une précision incroyables, avec une lisibilité du tissu musical qui permet d’écouter les différents niveaux avec facilité, même si on ne peut dire qu’il ait la clarté cristalline de certains autres chefs, ni même le raffinement. Mais c’est d’abord un chef de théâtre, ne couvrant jamais le plateau, attentif aux rythmes de la scène. Il y eut des moments d’une grande émotion, comme certaines scènes du second acte, et évidemment tout le troisième acte. Le quintette fut bouleversant et l’ensemble de la Festwiese, dynamique, joyeuse, énergique sans être tonitruante, soutenu également par le magnifique chœur du MET dirigé par Donald Palumbo. Un grand moment musical. On pensait qu’il n’avait plus rien à dire, mais son récent Mahler et son Wagner nous disent tout au contraire plein de choses, avec une grande sensibilité, et presque une tendresse qu’on ne lui connaissait pas.
Ce fut un beau cadeau de Noël. La Saint jean à Noël…de solstice à solstice…
Joyeux Noël aux lecteurs du jour
[wpsr_facebook]