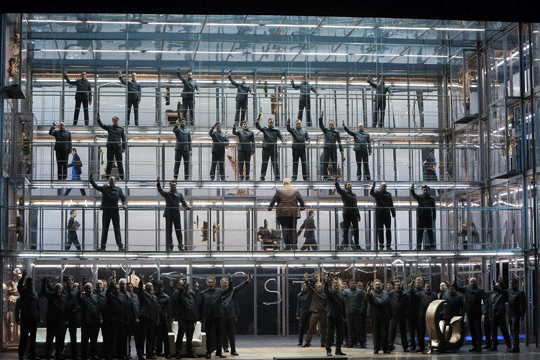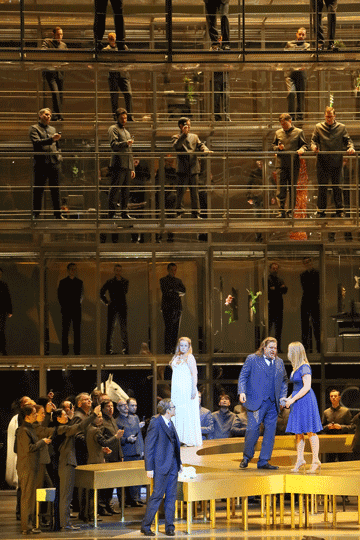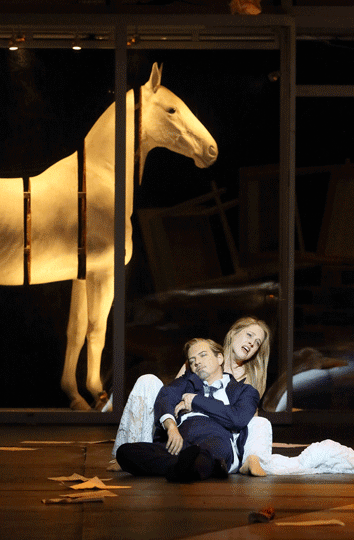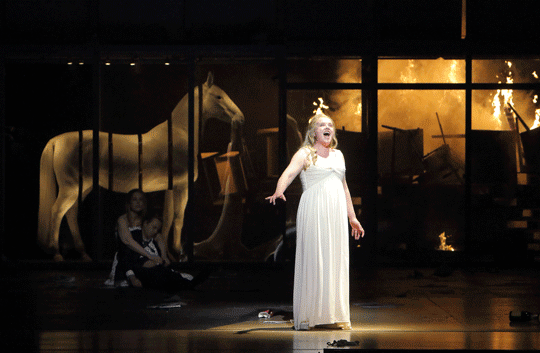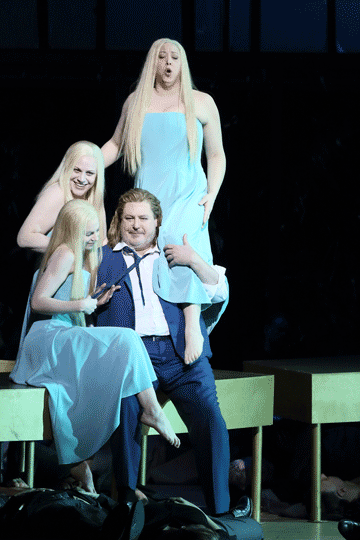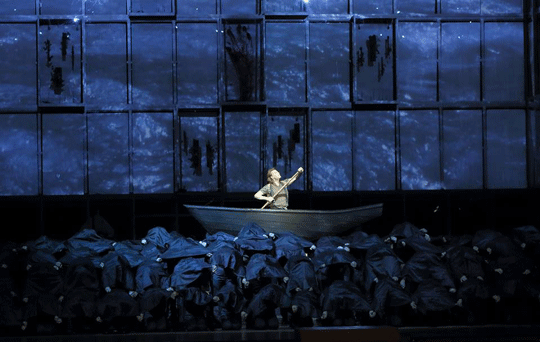
C’était le cinquième Götterdämmerung dirigé par Kirill Petrenko que je voyais cette année (deux à Munich, trois à Bayreuth) et par ailleurs le troisième[i] dans cette production découverte en janvier 2013: un Götterdämmerung dirigé par Kirill Petrenko ne se rate pas, même dans une production désormais rodée, vue et revue, mais dont l’intelligence et la justesse ne lasse jamais, qui en fait probablement la production la meilleure du Ring aujourd’hui, et de Götterdämmerung en particulier. Cinq fois Petrenko dans la même œuvre, et ce fut encore différent, car il est de la race des chefs qui ne se répètent jamais et qui vous emmènent toujours ailleurs.
J’ai longuement rendu compte de cette production plusieurs fois, et je n’infligerai pas une analyse déjà développée, j’en rappelle seulement les éléments principaux. Andreas Kriegenburg souligne l’aspect parabolique de cette histoire, qui commence dans le mythe et finit dans le monde, qui commence par le mensonge et finit par le mensonge, qui commence par le refus de l’amour et finit en rédemption par l’amour. Kriegenburg en fait une fable où triomphe une humanité solidaire, après avoir traversé la ruse (Rheingold), la raison d’Etat (Walküre), le conte (Siegfried). On se souvient que la mise en scène utilise pour ses tableaux des dizaines de figurants justement figurant le Rhin, les arbres, la forge, et plus généralement tous les lieux de l’histoire. Götterdämmerung abandonne ces images pour tomber dans l’hyperréalisme du monde, les Nornes évoluent au milieu d’un groupe de réfugiés radioactifs post-Fukushima (le monde est donc déjà mort ou quasi) Siegfried et Brünnhilde chantent leur duo d’amour initial dans un espace encore imagé (le Rhin fait de figurants, encore une fois dans “Le voyage de Siegfried sur âme Rhin”), puis Siegfried, qui ignore le mensonge et la tromperie tombe dans un monde où il est perdu, où il est ignoré, dans la foule anonyme d’employés qui courent partout au milieu d’un espace déshumanisé, un outlet de mode fait de verre et de métal, où la seule loi est le profit (le mot Gewinn est projeté à satiété) et dont les chefs ne vivent que d’alcool et de jouissance sexuelle exercée sur le petit personnel.

Siegfried n’est pas préparé, découvre les habitudes étranges de ce petit monde gavé (les cocktails par exemple) et à la faveur du filtre préparé par Hagen découvre aussi la femme merveilleusement incarnée dans la Gutrune de Anna Gabler, prodigieuse actrice, la meilleure Gutrune scénique possible. Siegfried victime d’un monde qui n’est pas le sien, trompé et puis trompeur, emmêlé dans les mensonges et les contradictions (vol de l’anneau à Brünnhilde), finit misérablement.
Dans ce monde pourri jusqu’à la moëlle (le nôtre ?), Hagen et Alberich ne sont pas les pires qui après tout cherchent à récupérer leur bien, et méprisent ces petits êtres politicards et jouisseurs que sont les Gibichungen.

Au final, Brünnhilde rétablit l’ordre du monde perverti par l’or. Reste sur scène Gutrune, qui a tout perdu, richesse, puissance, Siegfried, Gunther son frère et qui se retrouve seule au milieu des ruines de ce monde factice, mais qui est récupérée par l’humanité pure du début de l’histoire (Rheingold) qui l’entoure et forme une grande fleur blanche qui est l’espoir d’un avenir plus radieux.
Andreas Kriegenburg nous raconte une grande, terrible, mais belle histoire, par une vraie lecture qui en épouse parfaitement la dramaturgie, et qui laisse une trace incroyable chez le spectateur. A chaque vision, on retrouvre l’intelligence du propos, l’ironie de la lecture des personnages, quelquefois même l’humour, et toujours la très grande humanité d’un regard à la fois juste et tendre. Je l’affirme encore une fois, c’est la plus grande mise en scène du Ring aujourd’hui, sans aucun contredit possible. Castorf a une lecture d’une profondeur et d’une froideur impitoyable, une lecture destructrice et pessimiste, qui refuse le conte et le rêve, et c’est un choc, mais Kriegenburg, qui lit le monde de la même manière, reste ouvert sur un possible avenir, et son optimisme et son sourire ne quittent pratiquement jamais la scène, et cela n’a pas de prix par les temps qui courent, qui montrent chaque jour la vérité prophétique de la lecture wagnérienne.
Alors, on allait à ce Crépuscule, parce qu’un Wagner à Munich « la seconde Maison » ne se refuse pas, parce que Petrenko dans Wagner ne se refuse pas, et parce qu’on ne se lasse pas des grands spectacles.
La distribution proposait dans les deux rôles principaux Lance Ryan, jeté de Bayreuth dans les conditions qu’on sait, pour la première fois dans cette production (de Götterdämmerung) et Petra Lang dont la Brünnhilde est pour le moins discutée.
Pour le reste de la distribution, que du lourd, mais bien des nouveaux, Markus Eiche en Gunther, Hans-Peter König en Hagen, Anna Gabler en Gutrune, Christopher Purves en Alberich, Michaela Schuster en Waltraute et les filles du Rhin et les Nornes magiques, faites pour partie d’éléments de la troupe (Eri Nakamura, Okka von der Damerau par exemple) et donc somptueuses.
Lance Ryan fut un très grand Siegfried, il le fut à ses débuts dans le rôle, à Karlsruhe, il le fut il y quelques années à Valencia, il le fut moins à Bayreuth. Mais il y a quelques années comme aujourd’hui, il est un acteur prodigieux de vérité et d’engagement, et d’intelligence et de générosité. Et ce soir, il a été un grand Siegfried, scéniquement et vocalement.
Car le problème de Lance Ryan, c’est le timbre : un timbre nasal, très ingrat quand il est fatigué et très désagréable avec des sons à la limite du supportable. Mais quand il est en forme, les choses passent bien, grâce à un sens de la couleur exceptionnel, un sens de la parole, et une capacité à tenir des notes, à varier les facettes de sons, et une voix juvénile et claire qui convient parfaitement au personnage.
Son premier acte fut exceptionnel à tous points de vue, naïveté, violence, brutalité, puissance, présence incroyable. Plus fatigué dans le deuxième acte où certaines notes passaient mal, il a été phénoménal dans un troisième acte en tous points exceptionnel pour tous. Au total, il a vraiment été convaincant et il y a longtemps qu’on ne l’avait pas entendu dans une telle forme.

Petra Lang qui a une voix immense chante Ortrud à tous les étages, quel que soit le rôle (ce sera sans doute étrange dans Isolde l’an prochain à Bayreuth). On connaît ses qualités d’engagement vocal, on connaît aussi les défauts qui en découlent quelquefois : une voix pas toujours stable, souvent de lourds problèmes de justesse, des sons manquant de propreté. En bref, une chanteuse engagée et enflammée, mais avec des risques permanents de dérapage.
Honnêtement, sa Brünnhilde en ce 13 décembre n’a pas démérité : elle a été prodigieuse au premier acte, aussi bien dans sa scène avec Siegfried que dans celle avec Waltraute, et vraiment convaincante, engagée, vocalement sans failles au deuxième acte; elle a un peu payé cet engagement à 100% dans un troisième acte moins réussi, même si correct (mais pas au-delà). Ce fut quand même sans conteste un de ses meilleurs soirs, je ne l’ai jamais entendue aussi émouvante, notamment au premier acte. Je sais qu’elle n’est pas très appréciée et que certains lecteurs afficheront leurs doutes, mais en chant, les choses ne sont jamais définitives et Petra Lang ce soir fut une grande artiste, estimable, touchante, incroyablement engagée.
Hans-Peter König est un Hagen humain. Il a cette chaleur dans la voix qui fait que même dans les pires des rôles (Hunding..) il conserve un espace pour l’humanité. Et c’est pour cela qu’il me plaît. Il n’est pas un Hagen tout d’une pièce fait de noir désir, il y a comme une lueur…la voix a aussi ce côté un peu rassurant : même si elle reste puissante et sonore elle est légèrement, très légèrement voilée, et la couleur n’est ainsi pas uniforme, plus subtile, plus travaillée. C’est vraiment une présence, et qui réussit à faire de Hagen un personnage intéressant, une sorte de perdant plein d‘espoir, un Hagen qui donne dans une sorte de subtilité à laquelle on n’est pas habitué tout en gardant une force peu commune.

La surprise (en est-ce une ?) vient de l’extraordinaire Gunther de Markus Eiche. On connaît la qualité de ce chanteur, mais il réussit là à composer un personnage de minable, sans être caricatural. Doué d’une diction exemplaire, d’une rare intelligence dans la manière de dire le texte, d’un jeu qui a su parfaitement épouser le désir du metteur en scène de faire de ce personnage une sorte de clown bête et méchant. La voix est parfaitement projetée et posée, puissante et claire; le personnage est composé à souhait dans sa bêtise et sa faiblesse. C’est un moment prodigieux que de le voir évoluer dans le style du jouisseur idiot, et quel musicien !
Christopher Purves est inhabituel dans ce rôle d’Alberich, on le voit plus dans des Britten (Balstrode). Alberich, jeune et puissant dans Rheingold, mûr et violent dans Siegfried, est vieilli et inquiet dans Götterdämmerung, même s’il reste le dernier à vivre, comme le soulignait Kupfer dans sa légendaire mise en scène de Bayreuth. Purves ne pourrait peut-être pas aussi bien réussir un Alberich de Rheingold, mais dans Götterdämmerung, j’ai rarement, très rarement entendu un Alberich qui distillât le texte d’une manière aussi intelligente et aussi raffinée. Il est expressif, il est tout sauf histrion, tout sauf démonstratif, mais intérieur, mais ombrageux, voire émouvant. Une incarnation à laquelle on ne s’attendait pas, même si le chanteur est de qualité. Un Alberich qui sied à cet Hagen et qui fait de la scène initiale du deuxième acte un des grands moments musicaux et un des grands moments de théâtre (par la seule vertu du texte, d’un texte qui n’a jamais sonné aussi juste et aussi humain) de la soirée. Il est vrai que Petrenko accompagne la scène avec une subtilité et une tension inouïes. L’ensemble m’a frappé, car c’est une scène qui doit être à la fois très intérieure et paradoxalement spectaculaire. Elle l’était grâce à cette conjonction des astres.

Michaela Schuster est une chanteuse valeureuse et engagée, elle a été une Waltraute exceptionnelle, par la diction d’abord, avec un texte mâché, digéré, sculpté, dit avec une expressivité rare, avec un volume immense et contrôlé à la fois, et avec une présence incroyable, donnant à la Brünnhilde de Petra Lang une réplique vibrante, enflammée, douloureuse et faisant de cette scène attendue entre toutes un des sommets de la soirée qui en compta décidément beaucoup.

Anna Gabler a été Gutrune, bête comme une oie, mais ondoyante, mais séduisante, mais amoureuse aussi, et émouvante dans sa manière de ne rien comprendre à ce qui est mis en jeu. Il faut la voir se balancer sur son cheval de bois en forme d’Euro dans sa robe rouge monumentale pour comprendre qui elle est. Mais là où elle devient exceptionnelle, voire mythique, c’est au troisième acte, défaite, déchirante, en larmes (elle avait les yeux mouillés aux saluts), avec une voix bien plus présente qu’en mars dernier, de cette puissance rauque et désespérée qui saisit le spectateur dans la scène finale. Faire de Gutrune un tel personnage, c’est tout simplement immense.
Magnifiques les trois Nornes d’Anna Gabler justement, Okka von der Damerau et Helena Zubanovitch, retenues, profondes, inquiétantes et tragiques et prodigieuses les trois filles du Rhin qui font vivre un moment suspendu, dans une scène si saisissante, au milieu des convives dormant après la fête, ivres morts. Il est vrai qu’Angela Brower, Eri Nakamura et Okka von der Damerau sont des piliers fabuleux de la troupe de Munich : elles réussissent à la fois à donner une vision d’ensemble, chorale, et une caractérisation individuelle. Grand moment, où Lance Ryan leur donne une réplique d’une vérité saississante.
On a déjà bien compris que c’est une soirée exceptionnelle qui a été vécue, que le chœur dirigé par Sören Eckhoff imposant et phénoménal de volume, a rendu encore plus mémorable. L’habileté de la disposition sur toute la hauteur du décor, les masses en jeu, l’urgence de l’interprétation, tout cela couronne l’ensemble du plateau. Oui, Munich est bien la seconde maison de Wagner, voire quelquefois la première.

Car Kirill Petrenko est en fosse, détendu, souriant, attentif à tout, une sorte de Shiva de l’orchestre où chaque regard, chaque mouvement, chaque main, chaque doigt, est au service d’une intention, d’un signe, très rassurant pour les musiciens et les chanteurs qu’il guide avec une précision, une énergie et un sens dramatique exceptionnels. Il l’avait dirigé dans cette même fosse le printemps dernier un peu plus chambriste, à Bayreuth en collant un peu plus à chaque parole, à chaque dialogue, comme faisant du théâtre musical, alors qu’il fait ce soir de la musique de théâtre, c’est à dire qu’il propose une vision plus tendue, plus dramatique, plus spectaculaire, avec une clarté incroyable dans le son de l’orchestre, avec un son cristallin et presque kaléidoscopique, même si quelques scories des cuivres viennent déranger ce magnifique ordonnancement, mais un volume, mais une expansion, mais un relief encore jamais atteints. Cela reste prodigieux, cela reste phénoménal, cela reste unique : la tension qu’il met, la joie visible de diriger, l’engagement rendent l’auditeur comme hypnotisé, comme magnétisé par cette musique qui semble tomber de partout, qui semble envahir tout l’espace, torche vivante presque cosmique.
Les dernières mesures, déchainées et en même temps retenues, qui accompagnent la vision de cette Gutrune esseulée et désespérée de douleur, prennent alors à la gorge, et il faut quelques minutes pour s’en remettre et s’adonner aux applaudissements triomphaux. Triomphe pour tous, délire pour Kirill Petrenko.
Quant à moi, j’attends avec confiance le prochain Götterdämmerung munichois ou le prochain Ring dans cette production car on ne s’en lasse pas. Après un Ange de Feu exceptionnel la veille, ce Götterdämmerung couronne un week end qui confirme le théâtre munichois comme le leader incontesté du monde lyrique européen, voire mondial. Que les autres en prennent de la graine.[wpsr_facebook]
[i]
Janvier 2013 (http://wanderer.blog.lemonde.fr/?p=5005)
Mars 2015 (http://wanderer.blog.lemonde.fr/?p=10363)