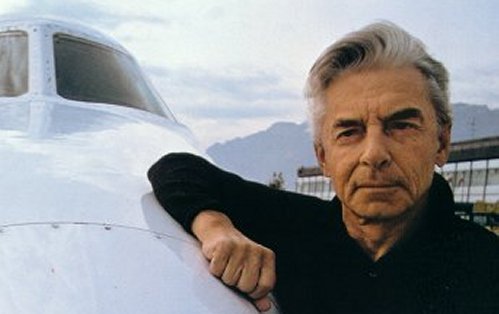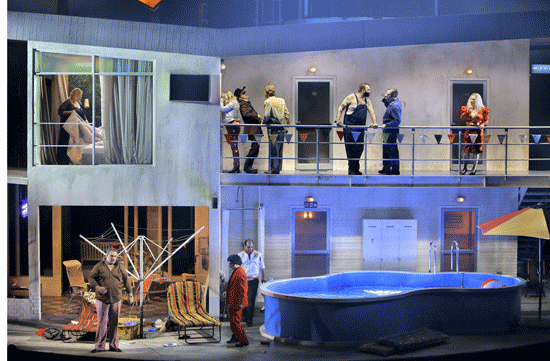
Une Catastorf…voilà comment certains ont qualifié le travail de Frank Castorf sur ce Ring. Une fois de plus, la polémique a fait rage, comme on devait s’y attendre en voyant Frank Castorf monter sur la colline verte. Les deux enfants terribles du théâtre allemand, Hans Neuenfels (73 ans) et Frank Castorf (63 ans), au crépuscule de leur carrière, ont réussi à faire frémir le public, comme de vieux messieurs indignes. Mais si le Lohengrin de l’un est en train de devenir un classique, le Ring de l’autre fait encore frémir, d’autant, comme il fallait s’y attendre, que Castorf, jamais avare de déclarations tonitruantes et de provocations, a accusé l’administration du Festival d’y faire régner une ambiance digne de la DDR, et il s’y connaît !
Mais peu importe.
Peu importent les polémiques auxquelles Bayreuth depuis ses débuts est habitué. De décadence annoncée en décadence annoncée, nous devrions en être au 36ème dessous. Mais le scandale du jour (et ce fut vrai avec Wieland, avec Chéreau et avec d’autres) devient souvent le triomphe de demain.
Castorf a donc fait scandale.
Et pourtant, ce Rheingold est un travail théâtral exemplaire, virtuose même. Au delà des choix idéologiques ou des partis pris, nul ne peut nier qu’il s’agit d’un travail techniquement bluffant, gestion des groupes, en vidéo et en « chair et os » (puisque le spectacle est simultanément sur scène et en vidéo : ce qui ne se voit pas en scène est représenté en direct en vidéo), jeu des acteurs-chanteurs d’une stupéfiante justesse, gestion des espaces, distribués très habilement dans le décor construit sur la tournette. En effet, le décor, extraordinaire de réalisme imagé d’Alexander Denić, tourne sur lui-même présentant toutes les faces d’un Motel du Texas, piscine, terrasses, chambres, bar-station service Texaco, réalisme imagé parce que ce réalisme-là est la somme d’un certain type d’images d’une Amérique vue à travers les films noirs de série B, voire Z, à travers les Comics (abus de couleurs criardes, de figures de femmes pulpeuses comme on ne peut en voir qu’au cinéma, dans les livres d’images pour ados boutonneux ou les romans photo), un hyperréalisme qui propose un concentré de clichés américains (y compris la route 66, qui ne passe pas au Texas d’ailleurs), avec son cortège de bagarres, de bar détruits par des sauvages (les géants) ou même de Ketchup : Frank Castorf nous démontre ce que nous savions déjà (depuis Chéreau), à savoir que cette histoire n’est qu’une histoire de médiocres, petits malfrats avides d’une parcelle d’or ou de puissance régnant sur un corps de prostituées. Wotan n’est qu’un petit maquereau et Alberich le chef d ‘une troupe déglinguée faite de femmes perdues ou de gays en déshérence nocturne. D’ailleurs, là où flotterait la bannière du Texas, Mime, dès qu’Alberich est vaincu, hisse le drapeau arc en ciel en signe de libération, qui flottera ostensiblement au vent lorsque les notes de la marche triomphale vers le Walhalla commenceront à sonner. On a l’arc en ciel qu’on peut.
Cette performance de toute la compagnie, c’est d’abord une performance de troupe de théâtre, un voyage de comédiens-chanteurs pour lesquelles parler de performance vocale serait ou superflu, ou inutile, ou à côté de la plaque (tournante en l’occurrence). En effet, tout est subordonné au jeu théâtral, à commencer par la diction, marquée par un débit plus accéléré comme dans les séries américaines, une sorte de diction aplatie, très fluide, mais très claire, une diction de conversation qui surprend d’abord, puis convainc totalement.
À cette manière de dire le texte correspond en écho une direction musicale elle aussi d’une fluidité rare, d’une clarté inouïe, et accompagnant chaque mot comme si elle le répétait en son. L’attention de Kirill Petrenko au plateau, nous l’avions déjà constatée plusieurs fois à Munich ou à Lyon, mais il y a ici un engagement musical aux côtés du travail scénique qu’il faut remarquer, en ces temps de polémiques contre Frank Castorf. La finesse du rendu sonore, les mille petits détails qu’on avait oubliés ou auxquels on n’avait jamais fait cas, tel solo de tel instrument, tel rendu particulièrement grinçant ou ironique dans une mise en scène où l’ironie est un concept central (appuyée dans les programmes de salle de plus en plus indigents de Bayreuth – par des citations de Vladimir Jankelevitch). Tout contribue à éclairer un propos global.
Détailler la performance de tel ou tel chanteur dans un tel contexte est inutile (même si on s’y essaiera), car c’est vraiment d’ensemble qu’il s’agit. Dans cette mise en scène, Rheingold ne saurait être un concerto pour Wotan et troupe connexe comme on le voit souvent, Wotan est “un parmi d ‘autres” identifiable par son costume rose fuchsia mais qui n’a pas de rôle prépondérant. Alberich et les géants font partie du paysage, un paysage noyé sous les détails polymorphes d’un décor étonnant, vieilles affiches de films (Tarzan..), lecture par le barman (excellent rôle muet de Patric Seibert, assistant de Castorf) de Sigurd, un comic allemand des années 50 (Sigurd…évidemment le bien nommé), barbecue autour duquel se sont réunies les filles du Rhin, au bord d’une piscine cheap dans laquelle flotte l’or et des paillettes dont elles s’enduisent tour à tour. Un barbecue avec ketchup et moutarde, dont s’enduira Alberich renonçant à l’amour au milieu de ces pulpeuses dames l’excitant à plaisir (merci Chéreau), et au milieu d’une bataille de lancer de ketchup: il s’autodétruit; enduit de moutarde, il est lui-même un remède contre l’amour, il a à peine besoin d’y renoncer…. C’est délirant. Du délire, certes, mais une remise à plat de cette histoire de vol, qui devient non un vol mythologique, mais un larcin, comme si l’or-métal n’était plus l’objet du désir, dans un monde où l’Or Noir l’a supplanté (nous sommes dans un Motel station-service Texaco). Alors, tout est dérision, dans un monde pareil, une dérision évidemment soulignée par les silhouettes des personnages : par exemple, l’apparition d’Erda en vison blanc, lamé et cigarette restera l’un de ces moments exceptionnels, qui lutine son vieil amour Wotan sous les yeux courroucés de Fricka qui n’a de cesse de la chasser, Freia en combinaison latex, qui se laisse recouvrir de lingots et qui finit par couvrir sa tête du Tarnhelm, le Tarnhelm et l’Anneau dans le tiroir caisse du barman, là où l’on met dans ce type de bar le revolver indispensable. Et ce twist au ralenti, entamé par les déjantés du coin, quand les premières notes de l’entrée triomphale des Dieux au Walhalla se mettent à sonner. Bref, tout est détourné, mais tout prend sens en même temps. D’un petit larcin au fin fond du Texas, va se déclencher une histoire planétaire, d’une histoire de petits malfrats, géants, dieux, nains, tous pourris, tous pareils, tous sans intérêt sinon celui d’une bande dessinée vite lue vite avalée. Le Ring, qui est une manière de création du monde, naît de bagarres de petits minables et donc dans la création point immédiatement la ruine…
Évidemment, il y a dans cette translation scénique des parties plus difficiles à rendre : le Nibelheim se réduit à une roulotte argentée des années 50, on n’y descend pas, et Alberich ne règne pas avec son anneau sur une armée d’esclaves. Alberich et Mime sont immédiatement faits prisonniers, attachés à un poteau de la station service, et puis vite libérés comme s’ils étaient d’emblée soumis au diktat de Wotan, une bande a vaincu l’autre.

Une étonnante placidité règne dans cette scène, la remontée du Nibelheim se fait assis sur une chaise longue, Alberich avec son canard, Wotan, Loge face au public. Ils ne font rien…La transformation en dragon, ou en grenouille, sont deux vidéos banales. On sent qu’ici les solutions scéniques ont été plus difficiles, mais en même temps la scène se passe, dans la même ambiance, comme si passer des dieux au Nibelheim ne changeait rien. Tous les mêmes.
Quant au Walhalla, c’est « vu à la TV », le palais de Randolf Hearst (est-ce un hasard si c’est lui qui invente le comic strip ?), et c’est en fait plus un Walhalla dans les têtes qu’un Walhalla réel. Et quand Donner frappera à la fin de son marteau laisant apparaître le Walhalla, c’est l’enseigne au néon « Golden Motel » qui s’allumera.
Ce travail acrobatique installe la nature du prologue, séparé de l’histoire qui va commencer dans la Walkyrie: une narration dans la narration, mais une narration caricature, réduite à objet de lecture pour adolescents, d’histoire-cliché où la bande dessinée, mais aussi le cinéma sont interpelés

(Froh est une copie de Michael Douglas dans ses pires films) où cow-boys, maquereaux, barman , prostituées et femmes faciles se croisent : Wotan apparaît couché dans un lit entre Fricka et Freia et elles se l’arrachent, les filles du Rhin dépendent aussi de lui, elle lui téléphonent pour lui raconter le vol de l’or etc…. Les relations de pouvoir existent, le rôle central et moteur de Wotan apparaît, au détour d’un tableau, d’un geste, d’un mouvement autour de lui, mais pour Castorf, c’est clair, il n’y en a pas un pour racheter l’autre et donc tous pourris.
Alors certes, il faut avoir les yeux partout, et essayer de ne pas perdre le fil musical. Pour le spectateur, c’est acrobatique : car ce qui se passe sur scène n’est qu’une partie du jeu, les vidéos en dévoilant l’autre partie, la partie cachée des ellipses du récit. Quand les personnages disparaissent, on les voit sur l’écran, les arrières plans deviennent premier plan, les images expliquent, illustrent confirment, inventent : c’est prodigieux de drôlerie, d’inventivité, de vivacité, de vie. Ce travail sue l’intelligence et l’invention et va jusqu’au bout des intuitions introduites par d’autres, comme Chéreau ou Kupfer, va jusqu’au bout d’une logique qui fait des ces dieux, ces nains, et ces géants (qui cassent tout comme les éléphants dans le magasin de porcelaine) les facettes d’une même humanité dérisoire. Une provocation ? non ! Simplement un reflet à peine déformant de notre humanité minable, sans noblesse, sans autre moteur que le désir multiforme.

Dans ce petit monde, Loge est vu (en costume rouge) comme le Levantin, l’oriental tel qu’on le rêve, barbichette, cheveux frisés noirs de geai, celui qui va vous vendre des tapis dans un bazar, agitant sans cesse son briquet (eh oui, le feu..), celui qui négocie, qui marchande, dont on a besoin et qu’on rejette en même temps (Loge n’a pas le droit aux pommes de Freia, il doit toujours se débrouiller par lui-même pour s’en sortir). Mais à la fin, le tableau risque de finir en apocalypse : tandis que les Dieux sont sur une terrasse, prostrés par le Walhalla (Wotan Fricka et Donner d ‘un côté, et perchés en hauteur Froh et Freia), le barman vient de verser sur le sol de l’essence des pompes, Loge est devant la station service, il allume son briquet, pour faire tout exploser : mais au dernier moment, il renonce tandis que dernière image, les filles du Rhin sur l’écran nagent au fond de l’eau en contemplant la caméra d’un regard halluciné.
Évidemment, ce qui se tient sur scène est tenu d’une manière très serrée musicalement. Kirill Petrenko suit chaque parole et on l’imagine de la fosse avec sa précision coutumière, mais il ne faut pas attendre de sa direction des effets tonitruants, c’est une direction d’une tenue prodigieuse, d’une modestie étonnante au service d’une entreprise globale. C’est un parti pris de musique d’accompagnement, d’exécution de toute la partition, mais rien que la partition, sans effets, une musique explicative comme le seraient sur scène certaines vidéos. Tel instrument qui apparaît surprenant, ici hautbois, là une attaque de violons, ailleurs des contrebasses (sublimes). Il faut revenir sur ce prélude, au crescendo imperceptible, d’une fluidité rare, et en même temps d’une clarté telle qu’on a l’impression (voulue par Wagner) de la naissance du son, venu des profondeurs (ah ! cette fosse…). C’est une direction musicale au service de l’entreprise, et non démonstrative ou autocélébrative: il ne s’agit pas de dire « vous allez voir ce que vous allez voir, c’est mon Wagner à moi ! », mais de s’insérer dans une globalité, de prendre sa place, toute sa place, pour donner le rythme musical qui correspond à ce rythme scénique. En prenant en compte le credo wagnérien qui s’applique dans cette salle, à savoir la profonde solidarité fosse-plateau, le son jamais ne s’impose, mais contribue à un ensemble. Une direction contributive. C’est tout simplement prodigieux, les journaux ont écrit phénoménal : du bonheur à l’état pur.
Alors dans un travail de ce type, il est difficile de rendre compte des voix comme dans un opéra traditionnel, voire un Rheingold ordinaire (s’il y en a…). Pour sûr, ceux qui ont entendu la retransmission radio ont perçu çà et là des trous, des faiblesses. Mais pour ceux qui sont dans la salle, l’impression est autre, elle est celle d’une construction commune, où chacun avec ses défauts et ses qualités, apporte une brique.
Le Donner de Markus Eiche est remarquable et dans son jeu (cow boy tout de noir vêtu), diction impeccable, belle projection. On connaît les qualités éminentes de ce chanteur qu’il démontre une fois de plus. Froh est Lothar Odinius, autre chanteur de haute qualité d’élégance et de projection, comme les spectateurs de l’opéra de Lyon le savent, avec une belle sûreté dans la voix, et Loge est Norbert Ernst, régulièrement invité à Bayreuth, élégance, phrasé, ironie mordante dans l’expression, jeu prodigieux de vérité et de distance, un des ténors de caractère qui à l’opéra de Vienne où il est en troupe continue la tradition des Heinz Zednik.
Du côté des dames, la Fricka de Claudia Mahnke est un beau personnage, mais la voix est plus banale, sans grand relief, elle s’en tire avec honneur, mais sans brio. La Freia de Elisabet Strid est plus présente vocalement, mais reste aussi en retrait sonore, même si elle campe un personnage exceptionnel de vérité.

La plus impressionnante, c’est l’Erda de Nadine Weissmann: une voix profonde, bien projetée, une silhouette fascinante qui s’impose immédiatement et qui par sa seule présence impose silence et tension.

Quant aux filles du Rhin elles sont remarquables et dans leur jeu et dans leur chant, malgré quelques stridences de Woglinde (Mirella Hagen), mais des trois la plus impressionnante par son intelligence physique et surtout sa voix profonde, imposante, au merveilleux phrasé, la Flosshilde d’Okka von der Dammerau, en troupe à Munich (elle y était une magnifique Charlotte des Soldaten).
L’Alberich de Oleg Bryjak qui reprend le rôle cette année, est présent, dans son personnage de gros pervers de la première scène. Mais la voix reste pour mon goût trop claire et n’arrive pas à l’imposer, un Alberich léger, un brave mauvais garçon assez ridicule avec son goût immodéré pour la moutarde dont il s’enduit abondamment, et lui qui va renoncer à l’amour a fait d’un canard en plastique pour enfants une sorte de doudou qu’il reprend à chaque crise : une voix qui correspond sans doute au rôle dans cette mise en scène, mais sans le poids habituel conféré à un Alberich. Ce qui n’est pas le cas de Mime (Burkhard Ulrich), qui est moins appuyé que les Mime habituels moins ténor de caractère, à la voix nasale et plaintive qui remplit les scènes. Burkhard Ulrich, dans son costume tout doré cherche par tous les moyens à chiper quelque chose à son frère, et notamment des copeaux d’or, et chante comme un personnage ordinaire, sans forcer, sans grimacer, et d’une manière non dépourvue d’élégance lui aussi comme les autres.
Les géants en ouvriers furibards, qui cassent tout sur leur passage (pauvre bar ! pauvre barman !), sont bien en place vocalement, sans être impressionnants, Sorin Coliban en Fafner sans doute est-il des deux le mieux en place, aves la voix la mieux projetée, tandis que le Fasolt de Wilhelm Schwinghammer en Fasolt gagnerait à plus de présence, de puissance et d’assise vocale pour tout dire.
Quant à Wotan, c’est Wolfgang Koch, qui a pris le rôle par là où souvent on ne le prend pas, non pas en chef vocal incontesté avec une large voix sonore, mais par le dialogue, par la conversation en musique, un dialogue où dominent un sens du mot, une intelligence expressive, une distance et une élégance du phrasé qu’on entend rarement dans Wotan à ce point de perfection. Comme l’orchestre de Petrenko, la voix de Wotan refuse l’effet et l’autopromotion, elle préfère sans cesse revenir au sens, à la couleur, au dire, à la parole. C’est un Wotan qui chante comme dans Mozart, phrasé, sensibilité, poids des mots. Grands moments que ses interventions.
Voilà un Rheingold pétillant, effervescent, quelquefois délirant, qu’on suit avec difficulté peut-être (il faut avoir les yeux partout, et les oreilles rivées au plateau), un Rheingold qui distancie l’histoire sans trop la prendre au sérieux, comme dans les Comics, où le pétrole texan est toujours présent mais jamais central et où les personnages pris dans une agitation permanente, laissent glisser et passer tout ce qui sera déterminant plus tard. Voilà un Rheingold chanté correctement, mais dirigé d’une manière exceptionnelle, qui a stupéfié et émerveillé le public à un point rarement entendu dans la salle. Voilà un Rheingold mis en scène avec une rigueur et une précision incroyables, de ce travail scénique se détermine une direction musicale complètement en phase et en même temps vive, inventive, diverse, colorée, et un esprit de troupe, cohérente et engagée, au service de ce merveilleux dessin animé . Beau travail. Grand art. De l’Or.
_________________________
RHEINGOLD II le 10 août :
Et la magie vous reprend…
J’avais vu deux Ring de Chéreau successifs, j’avais aussi vu des répétitions générales, puis les spectacles. C’étaient des péchés de jeunesse.
Comme Rossini, j’accomplis mes péchés de vieillesse et me voilà dans mon deuxième Ring à Bayreuth, à peine 10 jours après la fin du premier. Follie, dirait Violetta, mais je suis entouré de gens raisonnables qui font des aller-retour Salzbourg ou Prague pendant les jours libres, et au fond, une fois en Franconie, une fois perdus dans cette ville de Festival improbable, une fois en vacances et loin des soucis, tout est permis.
Les Festivals ont cela de particulier que vous ne pensez qu’à la représentation du soir et ne fait événement que le fait d’avoir croisé un membre de la communauté des wagnériens avec un béret Wagner, ou d’avoir vu déposer un os à moelle fleuri ou une rose blanche sur la tombe de Russ (le chien de Wagner, endormi à côté de ses maîtres). Bien entendu, je n’invente rien…
Alors, folie pour folie, ayant eu la chance de pouvoir voir deux Rings, et le premier m’ayant tout de même fortement secoué, me voilà reparti pour l’aventure.
Et Rheingold a été comme la première fois, une magnifique surprise, oui encore une surprise, pleine de vie, d’une fluidité rare, avec une troupe remarquablement engagée. J’ai trouvé l’orchestre peut-être encore plus fin, encore plus précis que la première fois (mais ce n’est peut-être qu’une impression), avec cette fois-ci des moments suspendus où l’émotion a pris le pas sur l’analyse : image magnifique que celle de Loge remontant de Nibelheim, dans une image rougeoyante du matin, allumant une cigarette avec un fil sonore ténu à l’orchestre qui donnait à cette image banale en soi une poésie indicible.
La virtuosité de la mise en scène reste évidente, avec des moments prodigieux de vie (les tentatives de fuite de Freia, cherchant une solution, au téléphone, fouillant nerveusement dans la valise pour chercher son passeport, se dissimulant sous les couettes, tout cela dans un rythme endiablé), d’autres d’ironie : les géants, brutes épaisses, avec Fafner à l’étrange barbe presque goudronneuse et Fasolt plus humain, qui essaient de tout casser dans le malheureux bar mais qui ne sont pas au total bien méchants, des géants qui ressembleraient à des mauvais garçons de journal de Mickey, des Rapetou.
L’installation très claire du parallèle Wotan/Alberich, qui sont tous deux propriétaires d’une station service, mais l’un avec Mercedes décapotable, l’autre avec roulotte miteuse installe du même coup un rapport de domination inversé, car Wotan est dominant d’emblée, sans or et sans anneau. Car l’or est conservé, l’or fait le costume de Mime, mais l’or n’est plus un enjeu; l’enjeu, c’est seulement Tarnhelm et Anneau conservés dans la caisse du bar…
Autre élément qui me fait encore gamberger : dans ce monde, Wotan reste celui dont on reconnaît la puissance, Alberich ne résistant pratiquement pas, comme si ils étaient déjà complices et qu’ils allaient mener ensemble la suite de l’histoire. Il reste que le passage au Nibelheim est pour moi un peu cryptique dans sa réalisation, c’est bien moins clair que le reste, mais cela permet de se réserver pour de futures visions.
Une idée vraiment séduisante est la libération de Mime qui dès que son frère est prisonnier veut vivre sa vie, qui s’enferme dans la roulotte et évidemment, annonce Siegfried. Les idées fusent, et il faut les attraper au vol, combien d’éléments m’avaient échappé à la première vision !
Du point de vue vocal, les hommes (et notamment les Dieux) me paraissent plus au point que les voix féminines, notamment Fricka (plus intéressante dans la Walkyrie) et Freia. Freia a une voix courte et sans grâce, alors que le rôle gagnerait à être plus valorisé du point de vue vocal, il ne faut jamais oublier que derrière une Freia, il y a au loin une Sieglinde.
Alberich est vocalement assez peu convaincant, ce qui est gênant vu l’importance du rôle ; il reste que nous sommes face à un Alberich faible et sans relief, et donc la voix peut correspondre au dessein de la mise en scène. Disons que c’est un heureux hasard
Enfin, musicalement, il y a un choix extraordinairement clair d’accompagner la scène, au sens d’un accompagnement musical cinématographique. La musique vit au rythme des pulsions de la scène. Grâce à Petrenko, on est de plain pied dans la Gesamtkunstwerk car sa direction est inséparable de ce qu’on voit…et ce doit être d’autant plus étrange lorsqu’on entend cela en radio. Sans doute cette direction peut-elle apparaître insuffisamment spectaculaire ou démonstrative, mais en précision, en fluidité, en discours, en clarté, elle ne peut que convaincre, j’en ai eu encore la confirmation, après la deuxième écoute, c’est toujours inattendu, passionnant, vivant : voilà une direction profonde, fouillée, cherchant à donner du sens et pas seulement du son (suivez mon regard…).
Kirill Petrenko a encore été accueilli par un délire indescriptible aux saluts, et ce n’est que justice : cette direction est miraculeuse.
C’est donc reparti, avec le sourire, avec la joie chevillée au cœur.
[wpsr_facebook]