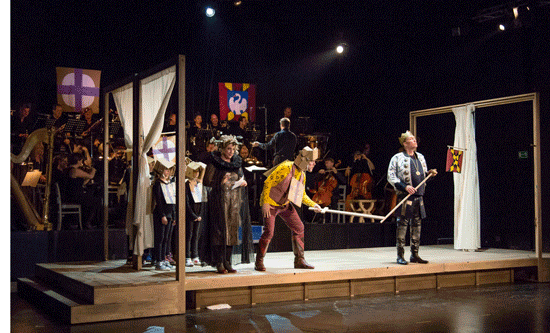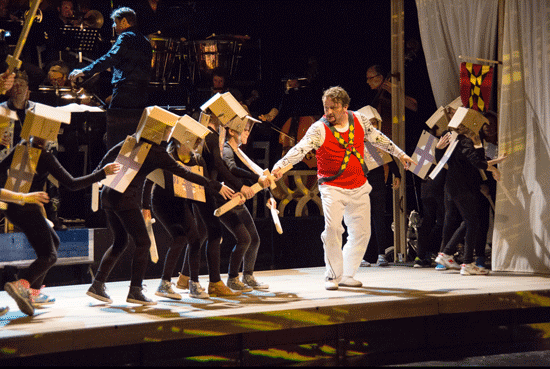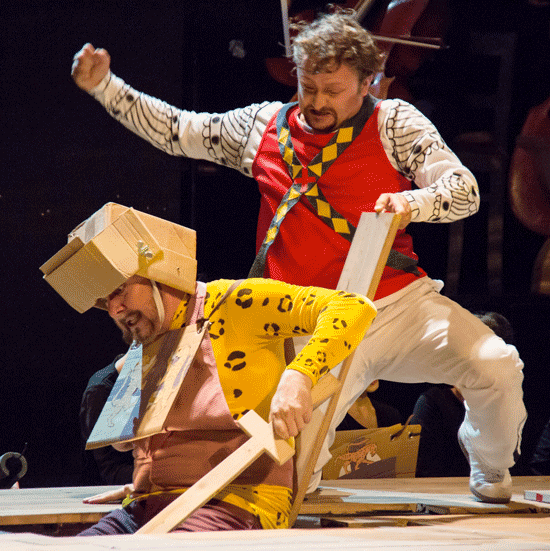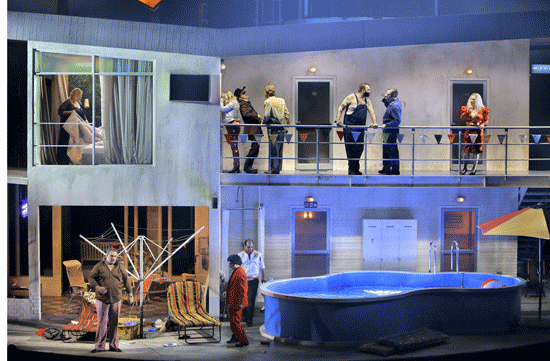L’Opéra de Vienne est d’abord une institution, avec ses habitudes et sa tradition. Il y a un vrai choix artistique de Dominique Meyer, qui a clairement opté non pour des coups médiatiques, mais pour la solidité, pour un meilleur équilibre entre le quotidien du répertoire et les nouvelles productions, privilégiant la musique, les distributions solides, privilégiant une qualité moyenne améliorée plutôt que six ou sept coups au milieu de soirées plus médiocres, ce qui était le reproche qu’on pouvait faire à l’Opéra de Vienne il y a quelques années. Les nouvelles productions sont pensées en fonction de leur future durée, et non en fonction du moment. Il y a des productions qui, une fois présentées et reprises deux ou trois fois, semblent déjà démodées. Dans un théâtre où certaines remontent à 1958 (Tosca 514 représentations), 1963 (La Bohème, 414 représentations), 1968 (Rosenkavalier, 360 représentations), la durée de vie d’une production est évidemment une donnée plus sensible qu’à Paris ou à la Scala. À la Scala par exemple, à part La Bohème de Zeffirelli, – la même qu’à Vienne, et créée par le même Karajan- une production n’a guère plus qu’une dizaine d’années de vie, avec quelques reprises. À Paris, Le Nozze di Figaro de Strehler ont cette fonction muséale, bien que les décors aient été refaits pour l’entrée à Bastille, n’étant pas les décors originaux de 1973, le Faust de Lavelli (1975) avait cette fonction jusqu’au moment où Gérard Mortier a eu la mauvaise idée de se débarrasser des décors…… Mais Paris ou la Scala ont une programmation diversifiée, où la nouveauté joue un rôle plus structurel qu’à Vienne, à cause du système stagione, grand consommateur de productions nouvelles. Dans des théâtres moins importants (par exemple, le Teatro Real de Madrid ou le Comunale de Florence) les reprises sont moindres, et la nouvelle production s’affiche 6 ou 7 fois et disparaît la plupart du temps dans les oubliettes de l’histoire.
Une production ancienne n’est pas seulement un facteur d’économie, elle inscrit le théâtre dans une histoire, dans une tradition, dans une continuité, c’est évidemment le cas, on le verra, du Rosenkavalier que j’ai revu le même week end.
Ainsi donc, une nouvelle production doit allier à la fois modernité pour que le public du jour puisse l’apprécier et l’accepter, mais aussi une modernité suffisamment relative pour qu’elle puisse durer et ne pas lasser un public 10 ans plus tard. « Moderne, oui, mais pas que » du moderne oui, mais du durable.
Je pense que les grandes mises en scènes résistent au temps : l’exemple du Faust de Lavelli, qui a duré une trentaine d’années, alors qu’il fut accueilli sous les huées violentes du public parisien d’alors – qui ressemble étrangement d’ailleurs par sa science de la vocifération à un certain public parisien d’aujourd’hui, on a dû le mettre dans du formol pour le ressortir à chaque fois…- , l’exemple de La Bohème de Zeffirelli, dont le deuxième acte 50 ans après provoque toujours les applaudissements à scène ouverte, comme le Rosenkavalier d’Otto Schenk. Au théâtre l’exemple de l’Arturo Ui de Heiner Müller toujours aussi fascinant, ou de l’Arlecchino servitore di due Padroni de Strehler en sont d’autres preuves
Dominique Meyer veille à la consolidation du répertoire et affiche une politique de production sereine assez loin des paillettes, une politique rassurante qui assure un public régulier. Avec Manuel Legris, il a redonné au ballet un lustre qu’il avait perdu, il a redonné à des productions de répertoire emblématiques (comme le Rosenkavalier) une nouvelle jeunesse, et plusieurs reprises ont marqué (Ring avec Thielemann, Rosenkavalier avec Harteros) , ou même de nouvelles productions comme La Fanciulla del West avec Stemme et Kaufmann, ou probablement cette saison l’Elektra avec Stemme où tous les Stemmolâtres vont courir à Vienne, dans une mise en scène de Uwe Eric Laufenberg, un solide professionnel qui n’effarouchera sans doute personne..
Cette Khovantchina est donc la deuxième des nouvelles productions de la saison (après Idomeneo en octobre). Et c’est la deuxième production de cette œuvre à Vienne.
Présenté à Vienne lors d’une tournée en 1964 de l’Opéra de Belgrade, Khovantchina est entré au répertoire de l’Opéra de Vienne sous le règne de Claus Helmut Drese et Claudio Abbado en 1989, dans une belle production d’Alfred Kirchner dont il reste et CD et vidéo, mais dont la qualité n’atteint pas les grandes mises en scène de Boris qu’on a pu voir dirigées par Abbado, des Boris inoubliables (Lioubimov à Milan, Tarkovski à Vienne, Wernicke à Salzbourg). Abbado d’ailleurs n’a dirigé Khovantchina qu’à Vienne : à la Scala, Khovantchina apparaît dans les années 60, en italien (direction Gavazzeni) mais est représentée souvent lorsque le Bolchoï est accueilli à Milan, et la production de Khovantchina de Iouri Lioubimov en 1981 est dirigée par Rouslan Raïtchev . Mais le goût d’Abbado pour Moussorgski est connu. Il avait organisé à Milan en 1981 un Festival Moussorgski (Boris – Abbado- , Khovantchina- Raïtchev-, et la Foire de Sorochinsky dirigée par Riccardo Chailly) et un très gros congrès . Alors sa Khovantchina à Vienne fut et reste inoubliable. Dans ma mémoire et mon cœur, Abbado reste une référence dans cette œuvre et dans Moussorgski en général. Il tire de cette musique quelque chose qui a à voir avec la tristesse, la mélancolie, la souffrance, il y privilégie non le spectaculaire, mais l’intériorisation, la légèreté, le raffinement, il y fait entendre des sons rugueux (il se réfère toujours aux versions originales ou proches de l’original) , mais insérés dans un discours où le rugueux se confronte à l’élégant, comme souvent il le fait chez Mahler, ou comme souvent Mahler le fait, n’hésitant pas à accoler grotesque et ironie, mais toujours avec l’épanchement sublime de l’âme souffrante.
Le Moussorgski d’Abbado pleure, étreint, émeut, un Moussorgski non pas idiomatique au sens où il serait enchâssé dans son « être russe », mais un Moussorgski universel, le musicien qui fascinait Debussy dont la partition de Boris trônait sur le piano, une musique qui bouleverse et à laquelle on ne cesse de revenir non parce qu’elle est russe, mais parce qu’elle est grande. Il n’est pas de semaine où je ne réécoute le début de son Boris, ou le prélude ou le final de sa Khovantchina.
J’ai peu vu Khovantchina, ce n’est pas une œuvre fréquente : quatre productions. Ma première fois fut à Athènes, en plein air et en plein été à l’Odéon d’Hérode Atticus, lors d’une tournée de l’Opéra de Sofia au temps de sa splendeur, avec au pupitre Atanas Margaritov, excellent chef, et l’extraordinaire Nicolai Ghiuselev dans Dossifei . On utilisait alors l’édition de Rimsky Korsakov. Il existe un très bon disque de l’opéra de Sofia, avec les mêmes protagonistes.
Ensuite, j’ai entendu Abbado en 1989, et ce fut la révélation.
Et j’ai entendu Valery Gergiev à la Scala, en 1998, immense déception tant scénique (vieille production du Marinskij) que musicale : comme je ne pouvais y croire, j’y suis retourné une seconde fois… et ce furent deux soirées monstrueuses d’ennui.
Enfin cette production de Lev Dodine, dirigée par Semyon Bychkov. La production de Kirchner n’ayant été représentée que 22 fois (de 1989 à 1993, avec Claudio Abbado puis Ulf Schirmer) on eût pu penser à un(e) Wiederaufnahme (à une reprise retravaillée), mais sans doute a-t-on préféré donner plus de relief en proposant une nouvelle production.

Lev Dodine est un metteur en scène qui a compté dans les années 1990. Il apparaissait comme l’un des chefs de file des metteurs en scène de l’école russe, une sorte de Tcherniakov de l’époque. Il explosa dans le monde entier en 1990 avec Gaudeamus, une pièce sur l’armée aux temps de l’URSS, d’après Bataillon de construction de Sergueï Kaledine, faite avec les élèves de l’Institut théâtral de Leningrad. Je ne saurais trop encourager les spectateurs parisiens à courir à la MC93 du 22 au 25 mai prochains puisque Dodine reprend ce spectacle mythique avec de jeunes comédiens. Abbado lui a confié Elektra au Festival de Pâques de Salzbourg en 1995.
Depuis les années 2000, Dodine à l’opéra n’a pas laissé de productions vraiment marquantes, et la production présente de Khovantchina n’a pas été plus favorablement accueillie par la presse.
Et pourtant, même si ce n’est pas une production exceptionnelle, elle n’est pas aussi médiocre que ce que la presse allemande ou autrichienne a bien voulu dire. On lui a reproché pêle-mêle l’absence totale de jeu entre les personnages, un refus du théâtre et pour tout dire, un ennui lancinant et répétitif .
C’est que Dodine a choisi volontairement de traiter cette fresque historique non comme une histoire, mais comme une passion, un oratorio qui arriverait de scène en scène à l’holocauste final.
Ceux qui ont connu l’Opéra de Paris dans les années 70 (Et Dominique Meyer le premier !) se souviendront sans doute d’Oedipus Rex de Stravinski dans la production de Jorge Lavelli (avec Maria Casarès dans le récitant), avec ce chœur disposé dans des nacelles, verticalement, pendant que le drame se déroulait sur le plateau avec un minimum de moyens.
Dodine reprend plus ou moins le même principe : une structure de bois (un peu comme des croix entremêlées) verticale avec les protagonistes et les chœurs disposés verticalement, qui dans des sortes de tribunes, qui sur des nacelles apparaissant et disparaissant des dessous (décor d’Alexander Borovski).
Presque jamais aucun chanteur sur le plateau, mais dans des sortes de nacelles d’échafaudage à l’espace réduit, dialoguant entre eux de nacelle à nacelle, ou à deux ou trois (jamais plus) dans la même nacelle. Les chanteurs le plus souvent bien plantés de face, comme s’ils faisaient en permanence un discours au peuple (le public en l’occurrence).
Il en résulte un rythme non théâtral, mais musical, une sorte de litanie permanente que le dispositif dans sa verticalité accompagne, avec en arrière plan une arrière scène souvent éclairée de rouge, puisque le spectacle est tiraillé entre le Rouge et le Noir. Effectivement, on peut considérer que voir les personnages apparaître et disparaître sans cesse, sans aucun autre effet de théâtre, a quelque chose de frustrant, répétitif et ennuyeux.
Pourtant j’ai trouvé que ce spectacle était assis sur des références, enracinées dans l’histoire du spectacle vivant et dans l’art russe.
En réduisant l’espace dévolu à chaque scène, en plaçant clairement le chœur en arrière, comme un spectateur et un commentateur, en isolant les protagonistes, il se réfère à l’art de l’icône, et à l’art de l’icône russe, qui isole les scènes dans des sortes de vignettes, avec les scènes de foule où la foule est collée comme entre ciel et terre, dans une absence de perspective. Il y a quelque chose qui rappelle cela dans ce travail. S’est-il souvenu du travail de Lioubimov sur Boris à la Scala en 1979, dont la référence, cette fois-ci explicite, était l’icône russe ? Je ne peux l’affirmer, mais cette verticalité, cette manière de disposer les foules, et la manière d’isoler les protagonistes non dans un rapport théâtral, mais presque pictural, m’a renvoyé à ces univers.
Effectivement, il y a peu ou pas d’interaction entre les personnages, mais c’est justement ce que veut Dodine, il veut des personnages de face, face au peuple, face au public, isolés comme des emblèmes, il veut un minimum de jeu, constituer des tableaux presque fixes faits de gris, noir et rouge, rouge du feu, rouge du sang. Même les fameuses danses persanes n’ont rien d’une chorégraphie orientale, mais d’un exercice minimal où les femmes se bousculent dans l’espace réduit d’une nacelle où le maître (Ivan Khovanski) est à peine visible dans l’amoncèlement, puis avec une chorégraphie vaguement copulatoire d’un goût discutable. Le meurtre lui même est loin d’avoir le réalisme qu’on pourrait attendre. En fait Dodine essaie de travailler sur une sorte d’abstraction et d’éloignement.
Cependant, le seul personnage qui semble l’intéresser de manière concrète c’est Marfa. Habituellement, Marfa est toujours vue comme une femme hiératique voilée du noir des vieux croyants. Ici au contraire, le personnage est plus complexe (comme d’ailleurs dans le livret), elle est à la fois entrée chez les vieux croyants, mais encore amoureuse d’Andreï Khovantski, et dans un rapport étrange à Dossifei, le chef des vieux croyants, où comme dans une secte, le maître a sa maîtresse préférée.

Dossifei torse nu et Marfa en combinaison au début du 4ème acte laissent peu de doute sur la nature de leurs rapports.
Ce qui intéresse visiblement Dodine, c’est la complexité du personnage de Marfa, à la fois soumise au maître, amoureuse de son ancien amant, et d’une indéniable sensualité là où on la représente toujours comme celle qui a renoncé au monde.
Ainsi donc, dans cette volonté d’abstraire la fresque historique, Dodine insère un seul destin individuel, un peu différent des autres, en une Marfa fortement érotisée, qui transforme les rapports avec les personnages et le regard du public et les rend moins lisibles, mais plus subtils. Il est aidé en cela par l’engagement d’Elena Maximova, qui donne beaucoup de relief au rôle. Parallèlement, il efface presque complètement Andreï Khovantski, en faisant un personnage très secondaire, et ne donnant de vrai relief qu’à Ivan Khovantski (Ferruccio Furlanetto), Dossifei (Ain Anger), Marfa (Elena Maximova) et dans une certaine mesure à Golitsin (excellent Herbert Lippert).
Ainsi donc cette mise en scène peu anecdotique et très concentrée laisse peu de loisir à l’œil de se distraire. On se demande d’ailleurs pourquoi baisser le rideau aussi souvent, puisqu’apparemment il n’y a pas de changements de décor, sinon pour bien séparer les tableaux, comme autant de moments, de stations de la Passion qui est racontée, une sorte de marche au supplice. Cela laisse d’autant plus d’espace à la musique.
Peut-être eût-il fallu à cette conception assez « essentielle » une vision musicale moins « épique » que celle de Semyon Bychkov. Sa direction très énergique, au tempo souvent assez rapide (prélude), laisse peu de place à l’intériorisation ou à la mélancolie, ou même à la méditation. L’orchestre est magnifiquement dirigé, avec un son plein, charnu, massif et en même temps une très grande présence de certains pupitres (les bois) et donc un très grand relief. Mais il manque à cette approche une couleur suffisamment crépusculaire pour mon goût. J’aime dans Khovantchina cette idée si chère à Moussorgski de la fin d’un monde, d’une époque, de la Russie médiévale. Cette Khovantchina qui raconte l’histoire de l’avènement d’une certaine modernité représentée par Pierre Le Grand, le grand absent toujours présent dans l’œuvre, et la disparition de la féodalité et d’une vision rigoriste et sans concession de l’orthodoxie (« l’orthodoxie ou la mort », que les plus rigoureux des orthodoxes encore aujourd’hui affirment),

ne connaît pas de moments de répit, de repli sur soi, elle avance inexorablement vers la fin tragique, cet holocauste très proche de l’hérésie cathare (qui rappelle le bûcher de Montségur), qui est d’ailleurs le moment le plus réussi musicalement. Une scène finale grandiose, terrible, où l’orchestre sonne merveilleusement et où le chœur est impressionnant (magnifique d’ailleurs de bout en bout, dirigé par Thomas Lang, auquel s’est ajouté le merveilleux Chœur Philharmonique slovaque de Jozef Chabroň et le Chœur d’enfants de l’Opéra de Vienne dirigé par Johannes Mertl) : le spectateur en est justement écrasé.
Je trouve pour tout dire que la direction de Bychkov, tout en étant parfaitement au point, parfaitement en place, tant du côté des volumes que des rythmes, manque un peu de couleur sauf au 2ème acte, très réussi. J’eus souhaité une vision musicale plus mystique. Elle est en cela l’opposé d’une conception à la Abbado, qui avait utilisé à la fois la version Chostakovitch, le final plus léger de Stravinski et les quelques moments de la version originale qui restent pour rendre les diverses colorations d’une ambiance . Ici, Bychkov n’utilise que la version Chostakovitch, qu’on estime la plus proche de la couleur voulue par Moussorgski, mais il ne rend pas pour mon goût totalement l’épaisseur de la partition.

Du côté du chant, la distribution ne connaît pas de failles majeures : Ferruccio Furnaletto reste impressionnant en Ivan Khovantski, même si la voix a connu des difficultés qui ont nécessité une annonce à la fin de l’opéra : la diction, le phrasé, la couleur, tout est remarquable et la présence aussi rappellent que Furlanetto a été un beau Boris.

Christopher Ventris est un Andrei Khovantski notable, même si le rôle est plus pâle, mais la présence vocale reste appréciable. Excellent Herbert Lippert dans Golizin, lumineux, à la diction claire, à la voix bien projetée. Moins convaincant pour mon goût le Schaklovity de Andrzej Dobber, au timbre moins séduisant (il ne fait pas oublier Kotscherga dans ce rôle).

Signalons aussi l’écrivain public de Norbert Ernst, toujours impeccable, diction limpide, phrasé modèle, projection magnifique de cette voix claire spécialiste des rôles de composition et notons parmi les rôles de complément le très joli Kuska de Marian Talaba, une image marquante de la soirée.
Mais c’est Ain Anger qui impressionne le plus dans Dossifei. La voix est puissante, immense même.

Tout en restant sombre, elle est particulièrement sonore. Le timbre n’a pas la séduction pour mon goût de certaines basses profondes russes (comme Ghiuzelev, dont il était question plus haut), mais le chanteur a la puissance et l’étendue, la présence imposante, qui en fait sans aucun doute la grande vedette de la soirée. Un Dossifei plus jeune, plus vigoureux, plus énergique, qui n’a rien des vieillards chenus un pied dans la tombe qu’on a l’habitude de voir dans ce rôle. Il est ce meneur de secte, tel qu’on en voit quelquefois dans l’actualité, à la fois énergique et séduisant qui traîne les âmes, les cœurs et les corps derrière soi.
Du côté féminin, jolies Emma de Caroline Wenborne et Susanna de Lydia Rathkolb, mais ce sont des parties très secondaires, émergeant à un seul moment de l’opéra, le rôle féminin essentiel (Marfa) étant tenu par Elena Maximova,

qui s’est substituée à Elisabeth Kulman, cette dernière voulant prendre un peu de champ, et c’est un peu dommage.
Elena Maximova, on l’a dit, brille par son incontestable présence scénique et sa belle féminité. La voix de mezzo est très correcte, mais un peu plate, manquant de couleur et de personnalité et un tantinet de profondeur et n’a en aucun cas la présence hallucinante d’une Miltcheva (avec Sofia), d’une Lipovšek et d’une Semtchuk (les deux avec Abbado).
Au total, une bonne représentation, qui fait honneur à l’œuvre, mais qui ne bousculera pas mon Panthéon moussorgskien. Elle mérite néanmoins d’être vue, parce qu’elle est bien distribuée et bien dirigée, et que Khovantchina n’est pas si fréquent sur les routes du mélomane.[wpsr_facebook]