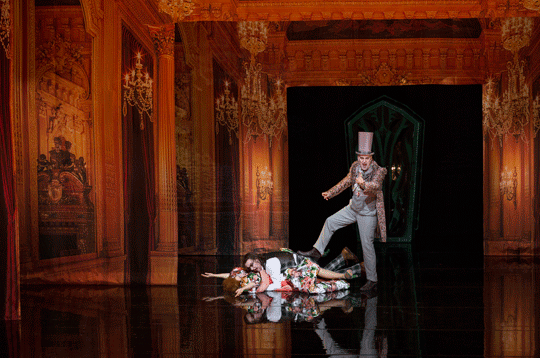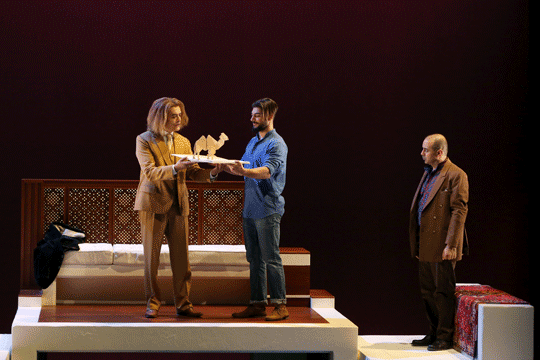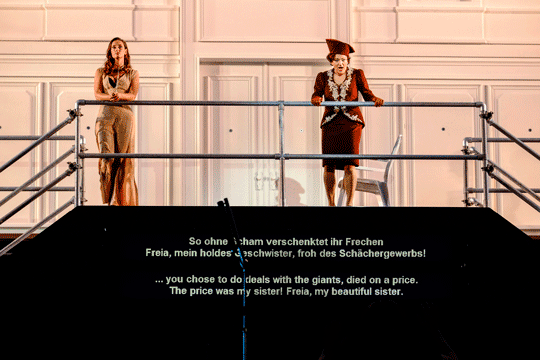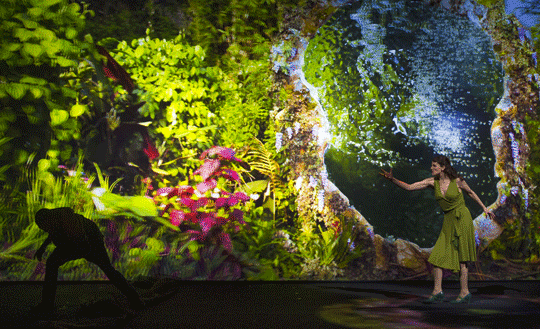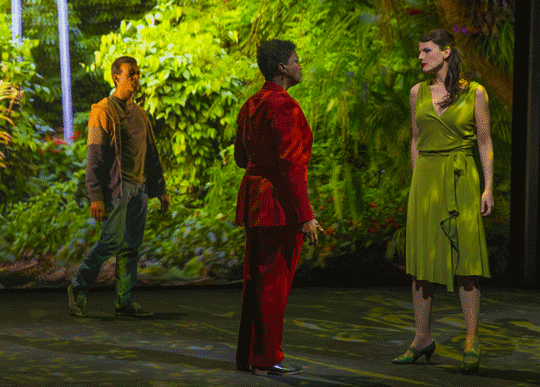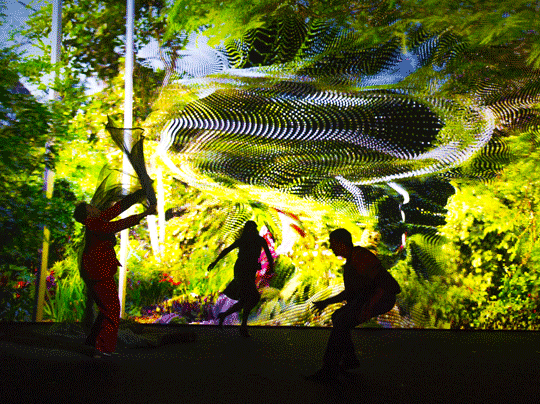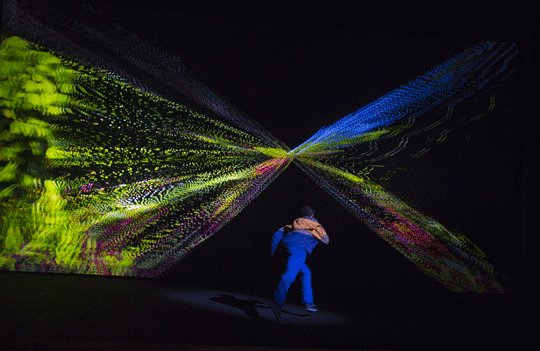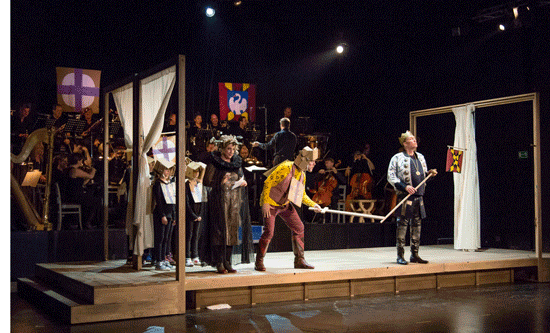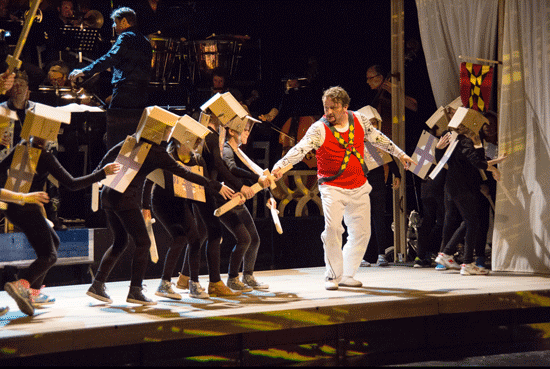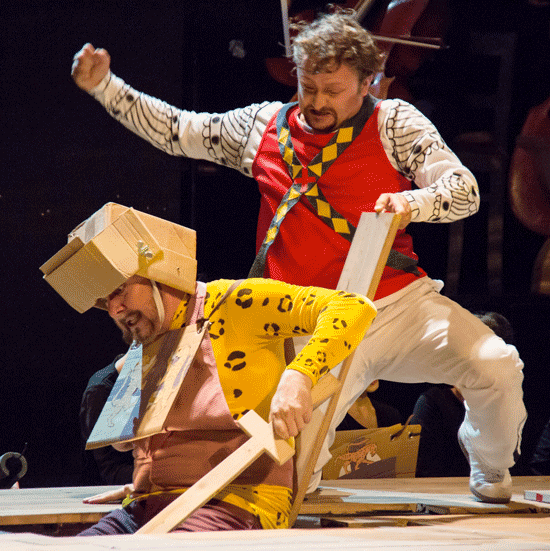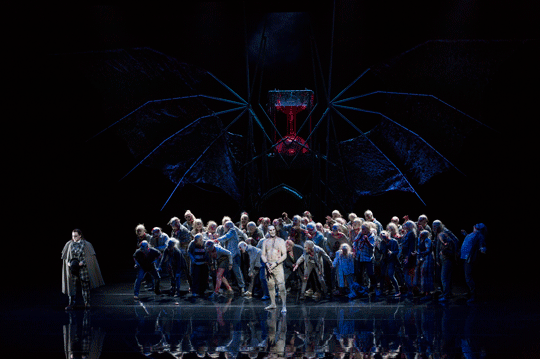
© GTG/Magali Dougados
Der Vampyr,
Opéra romantique en deux actes de Heinrich August Marschner, livret de Wilhelm August Wohlbrück
Créé au Theater der Stadt, Leipzig, le 29 mars 1828
Mise en scène : Antú Romero Nunes (reprise par Tamara Heimbrock)
Dramaturge : Ulrich Lenz
Décors : Matthias Koch
Costumes : Annabelle Witt
Lumières : Simon Trottet
Musique additionnelle : Johannes Hoffman
Avec :
Tómas Tómasson (Lord Ruthven), Chad Shelton (Sir Edgard Aubry), Laura Claycomb (Malwina), Maria Fiselier (Emmy), Jens Larsen (Sir Humphrey Davenaut), Ivan Turšic (George Dibdin).
Choeur du Grand Théâtre de Génève. Chef de chœur : Alan Woodbridge
Orchestre de la Suisse Romande. Direction musicale : Ira Levin
_____________________________________________________________
Une initiative vraiment intelligente et stimulante : proposer l’un des succès de l’époque romantique d’un auteur, Heinrich Marschner dont certains grands (Wagner) se sont inspirés. Les représentations ou les enregistrements de Marschner se comptent sur les doigts d’une main et pourtant, c’est une musique qui a traversé l’époque : la musique haletante de Die Feen n’est pas sans rappeler le rythme continu et jamais essoufflé de Der Vampyr qui vient de triompher à l’Opéra des Nations, siège provisoire du Grand Théâtre de Genève. Les dimensions de la scène imposent de chercher des productions qui puissent d’adapter et empêchent les très grosses machines que permettait le Grand Théâtre.
Allié pour l’occasion à la Komische Oper de Berlin, le Grand Théâtre de Genève propose Der Vampyr dans la production de Antú Romero Nunes, le jeune metteur en scène allemand qui a travaillé souvent sur les livrets d’opéra. Il s’est fait connaître notamment par un travail sur Don Giovanni et a produit à Hambourg un spectacle singulier sur le Ring de Wagner, en s’appuyant exclusivement sur le livret qu’il a un peu trituré, à dire vrai. Pour ce Vampyr, il a complètement mis à plat un livret d’environ 3h, en le réduisant à 1h15 de musique.
On doit s’interroger sur l’opportunité de cette chirurgie. Car ce qu’on se permet sur Marschner, aujourd’hui largement inconnu, se le permettrait-on sur Wagner ou sur Verdi ? Dans la curiosité générale pour l’œuvre, on a souvent peu fait cas de l’avertissement clair du Grand Théâtre, il ne s’agit pas de l’opéra de Marschner mais d’un spectacle de théâtre musical sur Marschner : c’est Der Vampyr, d’après Marschner. Si le Grand Théâtre de Genève a pris ses précautions, et respecte le contrat avec le spectateur, la validité de l’opération pose question.
Certes, Antú Romero Nunes est familier de la chirurgie sur les livrets et c’est un metteur en scène souvent adepte du « texte/prétexte », même si son Guillaume Tell à Munich en 2015 reste très sage et très respectueux. Mais de la même manière, un opéra inconnu reproposé sur les scènes mériterait à mon avis une présentation intégrale, peut-être plus difficile parce qu’il faut trouver les chanteurs qui puissent apprendre un opéra peu affiché sur les scènes et donc avec un rapport investissement /retour sur investissement problématique. Il est évidemment plus facile de convaincre des artistes de n’apprendre qu’un ou deux airs d’une version charcutée.
C’est un débat préalable. L’élargissement actuel des répertoires, qui est le corollaire de programmations trop conformes et d’un public moins stimulé par la nième Bohème ou la nième Traviata, qui çà et là commence à déserter les salles, exige une politique en la matière : ici on coupe les ballets (dans tous les opéras français à commencer par Faust), là des pans entiers du livret (rappelons-nous Rienzi réduit à un peu plus de deux heures à la Deutsche Oper de Berlin dans une production pourtant passionnante). C’est un problème de programmation et de politique culturelle. Ou bien l’on fait une opération culturelle de redécouverte d’une œuvre et on la présente dans sa structure d’origine, ou l’on explore d’autres voies.

© GTG/Magali Dougados
La Komische Oper de Berlin et le Grand Théâtre de Genève ont choisi une voie moyenne, s’appuyant à la fois sur la redécouverte de l’œuvre et la singularité du spectacle de Antú Romero Nunes. Nunes s’intéressant à la question du vampire et à la représentation de l’horreur (au sens des films dits d’« horreur ») et non à la question plus subtile du romantisme, de l’inquiétude, de la nature et des êtres limites et de la fragilité des jeunes filles rêveuses (Malwina est bien proche de Senta, fascinée par un être hybride et prête à se jeter dans les flots).
L’intérêt plus spécifique de Genève est aussi dû à ce que l’œuvre, au moins le texte de John Polidori, « The Vampyre », dont elle s’inspire, soit née dans les soirées de mauvais temps à la villa Diodati, à Cologny, au bord du Léman, où séjournaient Byron et les Shelley : la vision moderne du vampire et l’histoire de Frankenstein sont donc nés près de Genève comme le rappelle opportunément le programme de salle. Dracula vaut bien une messe noire…
Ainsi donc ce spectacle naît de plusieurs signes croisés, la volonté de présenter une œuvre singulière et peu connue, la volonté aussi de s’inscrire dans une identité locale, et celle probable de proposer un « arrangement » suffisamment étoffé pour que le public ait une idée claire de l’original de Marschner, et suffisamment référencé dans notre « modernité » pour que le spectacle ait un rythme et une allure non pas « archéologiques », mais celle d’un spectacle musical divertissant qui ait prise sur tous les publics. Pari réussi : le spectacle a fait un triomphe.

© GTG/Magali Dougados
Antú Romero Nunes a donc travaillé sur la représentation de l’horreur au théâtre, sur les effets sur le public, sur les références artistiques et notamment cinématographiques. D’une certaine manière et pour faire court : il fait un « film d’horreur théâtral » : les premières minutes après l’ouverture, sous lumière stromboscopique, font voir un vampire qui vient dans la salle enlever une frêle jeune fille hurlante au premier rang, pour la dépecer (cœur et intestins y passent) après avoir bu son sang. C’est vif, rapide, bien fait et dégoulinant. Suivent un chœur fait de zombies, référence à la Nuit des morts vivants, et des dépeçages en série : les membres volent, les entrailles explosent, et les personnages traversent ce bal singulier avec la tension voulue par l’ambiance.
À l’arrangement scénique correspond l’arrangement musical puisqu’à la musique de Marschner on a ajouté une musique contemporaine de Johannes Hofmann qui reproduit certaines musiques de films d’horreur : charcuter et truffer sont les deux mamelles de cette production. Il faut d’ailleurs reconnaître que l’articulation entre la musique originale et les inserts contemporains est très bien faite.
Au-delà des observations sur la justification de l’opération, d’une part, au-delà de la fidélité à l’œuvre, d’autre part, le spectacle fonctionne, les spectateurs rient, il est bien fait, rythmé, excessif en diable (si je peux me permettre l’expression) et les chanteurs sont parfaitement insérés dans la mise en scène. Mais il fonctionne comme un objet presque indépendant, une expérience sur l’horreur représentée, et sur les effets sur le public : si le film d’horreur avec sa relation au réalisme peut faire peur, le théâtre fait basculer l’ensemble dans la caricature, même surprenante, le sang pisse, les entrailles volent, et personne n’y croit (heureusement) mais s’amuse bien. Dans ce style les 80 minutes finissent par être répétitives.

© GTG/Magali Dougados
Dans la logique de l’histoire qui est histoire de séduction, Lord Ruthven tel qu’il est hypnotise peut-être mais ne séduit pas, c’est la relation au monstre qui est en jeu (il a des mains d’animal crochues par exemple) : la relation au séducteur Don juanesque est une des références possibles (même tonalité musicale d’ailleurs). Le Dracula de Christopher Lee avait quelque chose d’aristocratique et de séduisant, le vampire de Tómas Tómasson habillé par Annabelle Witt est un personnage de dessin animé ou de bande dessinée.
Le décor (Matthias Koch) fait de toiles peintes (les appartements de Sir Davenaut par exemple ou de projections, correspond au style des opéras du début du XIXème, et la chauve-souris initiale qui enserre un sablier qui à la place du sable fait couler le sang (un sanglier ? pardonnez, mais j’ai osé…) fait de loin penser à la représentation de la reine de la nuit (en araignée) dans la mise en scène de Kosky de Zauberflöte.
La production est faite de décors légers qui conviennent bien à l’Opéra des nations, et qui en ont sans doute facilité le transport de Berlin. Seule originalité (si l’on peut dire) du dispositif scénique, un promenoir derrière la fosse d’orchestre qui permet un voisinage plus fort des spectateurs et du plateau, et un jeu amusant avec le chef d’orchestre chassé de son podium. Une production efficace, et probablement assez économique, avec de beaux effets multiples des éclairages (de Simon Trottet).

© GTG/Magali Dougados
En ce qui concerne le plateau, il affiche comme à Berlin Tómas Tómasson qui passe ainsi du débonnaire Hans Sachs (à la Komische Oper) au terrible Lord Ruthven. Toujours doué d’une diction remarquable, il affiche une voix à la sécheresse marquée qui a quelque difficulté avec la tension requise par le rôle, toujours violent. Les aigus passent mais quelquefois à la limite, et le timbre est relativement ingrat, ce qui peut fonctionner pour ce rôle. Il reste que le personnage est vraiment incarné, que le jeu est très juste, avec quelquefois cette légère touche aristocratique et une alternance de violence sauvage et de retenue (quand il est avec Davenaut et qu’il cherche à « épouser » Malwina.
L’histoire réduite se concentre sur deux des trois jeunes filles à séduire en 24h pour avoir l’autorisation de rester sur terre à hanter les vivants, la première est expédiée ad patres en quelques minutes, c’est celle qui est enlevée au public, la deuxième, Emmy, est aussi enlevée à l’amour des siens – et du jeune George Dibdin (Ivan Turšic) – après quelques péripéties, mais c’est Malwina qui sera la troisième, et qui sera sauvée. Ainsi donc la recomposition du metteur en scène implique-t-elle une gradation qui finalement correspond aussi à l’original.
Face à un lord Ruthven qui est un peu un ogre, le jeune George Dibdin (Georg est d’ailleurs le prénom choisi par Wagner pour Erik dans sa première version du Fliegende Holländer) confié à Ivan Turšic de la troupe de la Komische Oper (vu dans David des Meistersinger), avec sa voix claire et un joli timbre, il défend le rôle (très secondaire) non sans présence.
Face à Lord Ruthwen, le véritable ancêtre de l’Erik du Fliegende Holländer wagnérien, est Sir Edgar Aubry, déchiré entre sa loyauté envers Lord Ruthven, qu’il a suivi et dont il a découvert la véritable nature, et son amour pour Malwina. Confié au ténor américain Chad Shelton, le rôle a notamment un air assez tendu et difficile (les ténors de l’époque avaient toujours fort à faire) : la voix est claire, la diction impeccable et la préparation parfaite comme souvent avec les artistes d’outre atlantique, c’est un vrai ténor lyrique, mais avec du souffle et une belle projection, l’un des gros succès de la soirée.

© GTG/Magali Dougados
Enfin Jens Larsen, voix efficace de basse profonde, qui lui aussi appartient à la troupe de la Komische Oper de Berlin, est Sir Humphrey Davenaut, le père qui sacrifie sa fille en croyant la caser, une basse qui renvoie en version Dracula à un Don Magnifico rossinien (La Cenerentola remonte à 1817) qui serait alors un Don Horrifico. La situation en tous cas est la même.

© GTG/Magali Dougados
Du côté féminin, Laura Claycomb est Malwina : elle éprouve quelque difficulté à entrer dans le personnage, et si les notes sont faites, l’interprétation reste en retrait, sans véritable engagement et la prestation ne réussit pas à être vraiment convaincante parce qu’inexpressive dans un rôle qui se prête pourtant à travailler la diversité des sentiments. Cela reste un peu monocolore.

© GTG/Magali Dougados
En revanche la jeune Maria Fiselier, très récente recrue de la troupe de la Komische Oper, est une Emmy Perth convaincante, émouvante, avec une voix très bien placée et vibrante. L’expression du sentiment, la poésie, la fraicheur : tout y est et c’est elle qui emporte visiblement le cœur du public : une vraie découverte.
Le chœur du grand théâtre, bien préparé par Alan Woodbridge, et bien inséré dans la mise en scène, est lui aussi particulièrement convaincant, dans le rôle de groupe de morts vivants voulu par la mise en scène.
Ce devait être le russe Dmitri Jurowski dans la fosse et ce fut l’américain Ira Levin qui a fait une carrière entre l’Amérique du Sud (notamment au Colon de Buenos Aires) et divers théâtres allemands. Il a su parfaitement rendre la tension de cette musique et son halètement, son rythme continu et effréné, sa pulsation dramatique. L’orchestre lui répond de manière impeccable et l’on aurait aimé en entendre plus de l’œuvre avec ces couleurs-là et ce sens-là de la dynamique. Cette musique telle qu’elle a été concentrée n’a pas un moment d’apaisement, et ne laisse pas « tranquille ». Ce continuum de tension qui ressemble à une sorte de course à l’abîme fait évidemment penser à Weber, une source d’inspiration notable (on pense à Freischütz), mais aussi à certains moments des opéras de Schubert : il y a une sorte de couleur commune à ces opéras que Wagner va savoir utiliser notamment dans Die Feen, dont le halètement permanent et le rythme rappellent la musique de Marschner.
Voilà donc une redécouverte, en forme d’apéritif sanguinolent. On aimerait désormais qu’un théâtre ose la totalité de l’œuvre et reporte à la lumière ce succès notable du XIXème romantique. En tous cas, cet « assaggio » de Marschner a remporté les suffrages du public, qui a fait à cette production un très bel accueil. L’appel du sang ?[wpsr_facebook]