
DAS RUHRGOLD
Fondée en 2002, la Ruhrtriennale a été marquée par son premier directeur, Gérard Mortier. La manifestation qui clôt l’été des Festivals est consacrée à tout ce qui dans l’art et le spectacle vivant peut être contemporain, dans le sens d’une recherche esthétique expérimentale, enracinée dans un territoire, la Ruhr, qui a décidé de faire de la culture un des axes forts de sa politique, sinon l’axe essentiel, notamment en réhabilitant part de son patrimoine industriel en friche depuis l’abandon des mines qui furent pendant le XIXème siècle et le XXème siècle le symbole de l’industrie allemande. Un territoire saigné pendant la 2ème guerre mondiale, et qui laissa à la fin des années 80 un paysage marqué par les crassiers, les usines géantes, les cokeries, un paysage lunaire que des politiciens intelligents (il y en a) ont décidé par un gigantesque programme de réhabilitation (Internationale Bauausstellung Emscher Park de 1989 à 1999) de dédier à la culture : Musées, espaces d’expositions, salles de spectacles sont nées, faisant d’un territoire qu’on pensait définitivement dédié au métal, au charbon et à la poussière, un objet de visites touristiques, un lieu de manifestations culturelles extraordinaires, et une véritable exposition architecturale. Rien qu’une ville comme Essen (600.000 habitants) contient à la fois un théâtre inauguré en 1988 (conçu d’après le projet d’Alvar Aalto né en 1959), et plus récemment ouverts, un musée d’art magnifique (le Folkwang Museum) confié à l’architecte David Chipperfield, et l’un des plus beaux musées d’histoire d’Europe, le Ruhrmuseum, confié quant à lui à Rem Koolhaas, installé au cœur des espaces industriels, au fameux Zollverein.
Mais ce qui est extraordinaire et inédit (et Lille s’en souviendra en 2004 quand elle sera capitale de la Culture), c’est que cet investissement a fait en sorte d’associer la population et de proposer au territoire décimé par la fin du charbon de nouveaux motifs de fierté. La Ruhrtriennale qui de trois ans en trois ans, propose à un manager culturel ou à un artiste de concevoir une programmation prend place dans ce mouvement général: elle attire désormais des spectateurs venus des Pays Bas assez proches, de France, de Belgique mais surtout de la région. Car dans le programme Emscher Park, c’est bien d’abord la conscience et l’estime de soi de la population qui étaient visées.
La culture n’a jamais été absente de la Ruhr, elle était financée par les capitaines d’industrie, et ce depuis le début du XXème siècle, pour l’édification paternaliste des masses : le meilleur exemple en est le Folkwang Museum. Déjà aussi en 1976 Pina Bausch fonde le Tanztheater Wuppertal, qui fut (et reste) l’un des foyers de référence de la danse contemporaine européenne, d’une certaine manière de traiter le corps et le théâtre.
Ainsi, la Jahrhunderthalle Bochum où était présenté ce Rheingold, est un espace industriel d’exposition construit en 1902 et de 8900m2 de surface et réhabilité par un « pronaos » moderne vitré en 2003 par l’architecte Karl Heinz Petzinka.

C’est un hall immense, magnifique, lumineux, qui peut abriter plusieurs espaces de spectacle, pour des concerts rock, du théâtre, du cinéma, et de l’opéra, et dans lequel sont présentées les productions phare : on y a vu Die Zauberflöte (La Fura dels Baus), qu’on a vu à Paris, mais dont on comprend quel effet l’énorme dispositif de la troupe catalane pouvait faire dans cet immense vaisseau, Die Soldaten (David Pountney), Moses und Aron (Willi Decker), dans des productions impressionnantes et originales prenant appui sur la magie de cet espace fascinant. Chaque production est affichée 3 ans, le temps du manager qui l’a suscitée. Après Gérard Mortier, Jürgen Flimm, Willi Decker, Heiner Goebbels, c’est depuis cette année le metteur en scène Johan Simons, ex-directeur depuis 2010 des Kammerspiele de Munich, qui assume jusqu’en 2017 la direction artistique de la Ruhrtriennale : c’est lui qui fit à Paris Simon Boccanegra en 2006 et 2007 et Fidelio en 2008. Il a décidé de dédier sa programmation aux travailleurs mais aussi aux chômeurs de la région (« an die Arbeitenden und an die Arbeitslosen »). Il met en scène cette production de Das Rheingold, production qui n’est a priori pas liée à une future production du Ring, mais qui à elle seule, renferme les ingrédients de toute l’histoire du cycle wagnérien, y compris sa conclusion et qui pose la question du travail et de la production.
Car pourquoi Rheingold ? La réponse est assez simple : dans une Ruhr dédiée au charbon, la descente à Nibelheim était permanente dans le quotidien des habitants de la région. Le monde grouillant des mineurs avait quelque chose de celui des nains enfouis sous la terre à chercher ou forger l’or. Et de Castorf en Simons, l’or pour la Ruhr, ce n’était pas l’or noir, mais le charbon, qui a donné à la fois l’identité de cette région et son l’énergie primale : lorsque Alberich renonce à l’amour, il brandit non de l’or, mais un énorme morceau de charbon.

Rheingold pose la question des maîtres et des travailleurs-esclaves, la question du politique et de ses mensonges, la question du début et celle de la fin : Erda en possède les clefs, et sans aucun hasard, c’est elle, assise dans son coin au premier plan, qui observe et écoute sans mot dire les développement d’une action promise dès le départ à sa perte.
Le pouvoir et sa perte, l’or, sa puissance et sa menace, le début et la fin de toute chose, du soleil auroral au ciel crépusculaire, Rheingold peut ne pas être qu’un prologue, car Rheingold porte déjà en soi la chute des Dieux.
Dans cet immense espace, Johan Simons et sa décoratrice Bettina Pommer ont conçu un dispositif multispatial, avec au premier plan un monde renversé en ruine, le plafond d’un palais avec son lustre dressé, les moulures, mais aussi les gravas, et l’eau qui l’envahit, et qui reflète le toit de la Halle, un monde qu’on piétine, sur lequel tous les personnages vont marcher, le monde d’en-bas, sur lequel émerge le trou qui conduit sous la scène au monde encore plus bas, Nibelheim.
En hauteur en revanche, perchée et fixée par des échafaudages, une immense façade aveugle qu’on comprend être le Walhalla, portes et fenêtres closes précédée d’une petite plateforme. Entre les deux, fait de bois, de cuivres rutilants, et de métaux divers, le monde de l’orchestre, un monde d’hommes et d’instruments, qui est, au début du moins, mais pourquoi pas pendant toute la représentation avec ses apaisements et ses colères, le Rhin, devant lequel les filles du Rhin (les magnifiques Anna Patalong, Dorottya Láng, Jurgita Adamonyté) s’installent sur trois chaises comme des solistes lors d’une représentation concertante. Le flot du Rhin sera musical ou ne sera pas.
L’orchestre à l’intérieur duquel circulent les chanteurs et qui est en même temps surface de jeu a un statut évidemment inhabituel, inclus dans la dramaturgie, comme si les musiciens étaient part de ce monde du travail et de l’esclavage, obligés de jouer : le chef n’arrive-t-il pas entre deux personnages patibulaires comme prisonnier pour être installé sur le podium. Derrière lui on verra une enclume sur laquelle on frappera lors de la descente à Nibelheim…et certains musiciens tantôt se lèvent, tantôt circulent, comme si l’orchestre était Rhin, comme si l’Orchestre était foule, comme s’il était esclave des autres : des chanteurs, du metteur en scène, du chef, du public…
Dans cette ambiance étrange, la représentation qui commence à 15h a lieu en plein jour, et les éclairages soulignent les formes sans les isoler, mais les insérant d’une manière encore plus directe dans l’espace de la Jahrhunderthalle: et alors le texte prend une cohérence et une réalité inattendues : on ne cesse de remarquer les allusions à la présence du soleil, un soleil qui ce jour de septembre aveugle le spectateur tant il est éclatant. On va ainsi suivre le parcours solaire jusqu’au moment où il initie son coucher et alors, miracle, Wotan nous dit :
« Abendlich strahlt
Der Sonne Auge », évocation du soleil couchant.

Ainsi opère la magie du théâtre avec son cortège d’émotions, parce que le spectateur voit ce que dit le texte et parce que l’espace d’un instant, personnage et spectateurs vivent à l’unisson.
Ce Rheingold est une expérience particulière, liée au lieu, liée à l’entreprise, liée à l’ambiance. Tout commence par l’entrée dans l’enfilade immense qui sert d’antichambre gigantesque à la salle de spectacle proprement dite où l’on entend en fond un accord musical électronique, qui ne cessera que lorsque la musique de Wagner prendra le relai, comme une sorte de litanie qui prépare le spectateur et qui se mêle au bruit murmurant de la foule qui s’installe, comme un autre fleuve (la musique électronique ajoutée est du finlandais Mika Vainio).
L’unicité du lieu, l’absence de quatrième mur tant l’espace est unifié, tant la proximité des spectateurs des premiers rangs est grande avec le plateau, tant la lumière est la même, en cet après-midi, éclatante, imposante, aveuglante pour tous, comme si brillait un anneau d’or qui nous écrasait en nous aveuglant, empêchant même quelquefois de voir le spectacle.
Après avoir vu Castorf à Bayreuth, évidemment tout nous paraît déjà vu, et je ne suis pas certain que Johan Simons n’y ait pas repris quelques motifs : le serveur (Stefan Hunstein) qui d’ailleurs fait la conférence préparatoire une heure avant le spectacle comme si Hunstein était le Patric Seibert de service … L’intervention de Donner avec un pistolet contre les géants qui prennent Freia est aussi un geste castorfien. Citations sans doute, et non plagiat car le propos de Simons n’a rien à voir avec celui de Castorf, tout en racontant une histoire parallèle. Le théâtre de Simons se veut « participatif », celui de Castorf est brechtien, c’est participation contre distanciation ! Simons part de ce que son public est venu pour voir non n’importe quel Rheingold, mais le voir à la Ruhrtriennale, le voir à la Jahrhunderthalle, et donc un Rheingold qui est une proposition particulière liée au lieu, lié à la manifestation, lié à ce public particulier qu’on fait entrer dans l’espace de jeu : il y a des spectateurs assis latéralement le long de l’orchestre : figurants ? Spectateurs ? ils nous font penser en tout cas au Tannhäuser de Baumgarten à Bayreuth, qui avait eu la même idée. Public et artistes se « mélangent » un peu, s’approprient l’espace de jeu. D’où d’ailleurs un regard forcément différent sur les aspects musicaux. Ce n’est pas n’importe quel public, en ce sens, c’est comme je l’écrivais il y a peu, son public.

La mise en scène de Johan Simons, pose l’histoire du Ring dans l’histoire de la lutte des classes, avec des Dieux en hauteur qui sont sur le seuil (fermé) du Walhalla, une reproduction à peine stylisée d’une des façades de Villa Hügel, le château des Krupp à Essen et en bas, le jeu des autres, qu’ils soient géants ou nains, ou filles du Rhin et Erda. Une Erda à part, une sorte de grand mère aux fines lunettes noires d’aveugle, vêtue d’une blouse grise de grand mère prête à faire les confitures. Jane Henschel, merveilleuse artiste toujours prête à entrer dans des aventures théâtrales est saisissante dans sa composition. Elle surgit dès le début (enfin, surgir est un verbe bien excessif pour une entrée timide et hésitante, d’un pas difficile et prudent, dans l’eau stagnante à la recherche d’une place discrète où s’asseoir) elle ne disparaît que lorsque Loge et Wotan sont à Nibelheim et ne réapparaît que lorsqu’ils en sortent. Elle est là, chœur muet, aveugle et visionnaire. Et elle attend son heure.

Entre le Walhalla-Hügel et le sol, plafond renversé jonché de ses moulages de plâtre et recouvert d’une eau stagnante, comme si le monde était sens dessus-dessous et que vu du Walhalla, on voyait le sol comme un plafond, est étendu l’orchestre, espace transitionnel, presque fluvial, le Rhin qu’on doit systématiquement traverser pour arriver aux héros du bas, et, pourquoi pas, un Rhin miroir qui renverrait aux Dieux l’image d’un Walhalla déjà en ruine, le Walhalla d’avant d’un Ring vécu comme cyclique. D’ailleurs, sur l’eau flotte une robe dorée de petite fille, trace d’une aventure précédente qui pose question, et dont le spectateur découvre la réponse en voyant Freia revêtue de cette petite robe lorsqu’on mesure la quantité d’or nécessaire au deal Wotan/Géants. Nous sommes dans l’histoire cyclique des gens d’en haut et de ceux d’en bas.
La fin est dans le début : c’est bien le message qui est envoyé au spectateur ; message d’ailleurs confirmé par la couverture du programme Götter + Fall avec la polysémie du mot Fall, mais aussi son sens premier de chute. La montée au Walhalla est ici vue comme chute. Voilà le premier message : les dieux Krupp tomberont. Et du même coup Rheingold annonce non une chute pessimiste à la Schopenhauer, mais une révolution.
Le second propos de la mise en scène de Johan Simons est de bien marquer les différences de classe entre les Dieux, grande famille bourgeoise, d’abord vêtue d’effets de voyage (merci Chéreau…) élégants, beiges, (costumes de Teresa Vergho ) puis dans la seconde partie avec le retour de Nibelheim vêtus de smokings, que Wotan et Loge endossent à vue d’ailleurs, aidés par le majordome de l’occasion (Hunstein) ou de vêtements de cocktails ou de soirée.
Et puis il y a les autres, les sans-grades (sans dents ?), ouvriers ou mineurs, c’est à dire les fratries Alberich/Mime et Fasolt/Fafner. La grande famille des Dieux-Krupp et les microfamilles du peuple, qui dialoguent rarement sur le même niveau, mais souvent de haut en bas ou de bas en haut, distribués sur les différents niveaux, coursives, balustres, sol.

C’est au sol que se déroule la fascinante scène initiale des filles du Rhin s’amusant avec un Alberich phénoménal ravagé de désir, et qui finit par se vautrer avec des poupées de son encouragé par les fille du Rhin dans une gymnastique sexuelle ahurissante. C’est du sol qu’Erda lance son avertissement qui annonce le crépuscule des Dieux (et donc la fin des Krupp).

C’est aussi en bas que se déroule logiquement la scène du Nibelheim, vue comme noyautage du monde ouvrier par Wotan et Loge déguisés en ouvriers, en mineurs et donc cherchant à créer la zizanie et le désordre chez l’ennemi. Par ailleurs, il n’y a aucun « effet » magique ou de lumière dans ce travail purement théâtral : la transformation en grenouille ou en dragon est mimée par Alberich et sa capture est une capture purement humaine. Il s’agit des pièges que les hommes entre eux se tendent.

C’est enfin en bas que les Dieux se recroquevillent abandonnés par une Freia prisonnière, ils essaient de manger les pommes, mais elles sont pourries, et jetées à terre comme un tas d’excréments ou du vomi qui gît au milieu du plafond en ruine et de l’eau stagnante, signe d’une puissance déjà perdue.
Le troisième élément, c’est une « Personenführung » très précise, qui travaille sur les relations avec les personnages, petits gestes (Fricka), attitudes presque esquissées, y compris les moindres expressions. Un travail d’acteur très engagé, qui montre d’ailleurs l’évolution définitive de l’opéra quand il est conduit avec rigueur au niveau théâtral. Le jeu nécessite un véritable engagement des chanteurs, avec une force de conviction décuplée parce qu’au chant, exercice physique s’il en est, s’ajoute le jeu, qui en renforce la puissance.
Enfin, ce qui caractérise les relations des fratries, c’est la violence aussi bien entre les deux frères du Nibelheim qu’entre les deux géants. La violence des deux nains est impressionnante (l’un des deux chanteurs s’est légèrement tordu une cheville pendant l’opéra) et leur engagement est vraiment exceptionnel.

En même temps, pendant la scène finale, les corps des nains d’un côté et de l’autre ceux des géants sont enchevêtrés au pied du premier rang des spectateurs. Mime et Alberich dorment tendrement entrelacés, presque enfantins, et Fafner vivant essaie d’éveiller doucement Fasolt dans ses bras, comme pour tester s’il est vraiment mort et se rend compte brutalement du désastre. Son regard perdu dans le lointain, sa manière de caresser le cadavre du frère, discrètement, sont des attitudes saisissantes, voire bouleversantes. Ils resteront ainsi jusqu’à la fin, visibles de tous, pendant que les Dieux s’essaieront à ouvrir le Walhalla dans une scène de triomphe dérisoire..
Car la scène finale est conçue à l’inverse que ce qu’avait fait Chéreau : Wotan y essayait de tirer péniblement le cortège des Dieux vers le Walhalla : ici, Wotan qui a compris Erda se refuse à monter au Walhalla, écrasé de désespoir pendant que les Dieux s’essaient à ouvrir un Walhalla désespérément clos, la musique sonne d’autant plus creuse ou ironique qu’elle est vaine, le tout orchestré par un Loge en frac de chef d’orchestre.
Mais le moment le plus spectaculaire est évidemment l’intermède de la descente à Nibelheim, où Wagner fait entendre les bruits des marteaux sur les enclumes, les bruits des nains esclaves attachés à la production. Ces bruits sont ici démultipliés, les percussions envahissent l’espace sonore, l’orchestre sur-sonne et on va chercher dans le public des spectateurs à qui l’on donne un marteau pour frapper sur des bouts de rails, comme si la Jahrhunderthalle résonnait encore des bruits de l’esclavage industriel : c’est assourdissant, impressionnant et surtout étonnant : les spectateurs essaient de frapper en rythme, hésitent, s’arrêtent reprennent, regardent le chef ou les musiciens. Rien n’est distancié ici et tout le monde participe de l ‘élaboration du spectacle, dans un vacarme qui ne fait pas oublier la musique, mais qui va jusqu’au bout de l’option du son expérimental de l’instrument-outil que Wagner avait ouverte et qu’il reprendra aussi dans Siegfried. C’est ainsi que la descente à Nibelheim allonge particulièrement l’œuvre (de quasiment une demi-heure) dans un vacarme fascinant dans lequel on finit par se vautrer, alors que résonne un texte d’Elfriede Jelinek hurlé par le majordome (dans le programme de salle) : Brünnhilde an Papa Wotan : Also, Papa hat sich diese Burg bauen lassen…[Alors, papa s’est fait construire ce château..].
On ne peut pas trouver dans ce travail l’originalité qu’on trouve dans d’autres mises en scène, parce que le Ring comme métaphore de la lutte des classes, ou les Dieux comme métaphore des capitaines d’industrie aux débuts de l’industrialisation était déjà dans Chéreau et a fait le tour des mises en scène du Regietheater depuis 40 ans. Ce n’est pas le propos qui ici étonne, mais l’adaptation de la situation au lieu, à la région, la complicité qui est cherchée avec le public, l’entreprise globale, liée aussi à l’ensemble de la programmation dont le motto est « Seid umschlungen » (soyez enserrés, embrassés) qui encourage à la solidarité, au sentiment d’appartenance.

De telles options influent évidemment sur la musique, et sur la manière dont Teodor Currentzis à la tête de son orchestre MusicAeterna de la lointaine Perm, élargi à d’autres musiciens pour l’occasion, conduit la « fosse ».
Dans un tel lieu, dans un tel contexte, la musique fait aussi spectacle, et Currentzis excelle à faire spectacle : cuivres rutilants debout, puis ensemble de l’orchestre, tenues de notes d’une longueur inusitée, insistance inhabituelle sur les percussions, tout est désormais possible. Il reste que l’orchestre est parfaitement tenu, qu’il n’y pas seulement des effets de manche, il n’y a pas seulement du théâtre ou de la musique-théâtre, mais beaucoup de moments d’une très grande tension qui sont dus simplement à la musique de Wagner interprétée avec relief et précision. Évidemment, nous sommes dans une option épique, à l’opposé de l’accompagnement note à note de la conversation que faisait Petrenko un mois plus tôt à Bayreuth (auquel d’ailleurs certains spectateurs ou certains auditeurs n’ont rien compris), nous sommes dans un espace presque infini où l’orchestre doit se faire entendre, se faire voir, faire spectacle et faire relief, où il est part de la scène et du dispositif, où il est fleuve humain et sonore : Currentzis en tire bien les conséquences (et cela ne doit pas trop lui déplaire), et remporte une immense succès d’un public debout qui ne quitte pas la salle.
Sans être une distribution de vedettes internationales du wagnérisme, l’ensemble des chanteurs réunis a donné une magnifique preuve d’excellence et d’engagement. Dans une salle ainsi aménagée, la sonorisation est indispensable : il serait impossible de travailler sans. Mais c’est une sonorisation d’une grande discrétion et d’une très grande efficacité, le résultat en est qu’elle n’est jamais envahissante, et qu’on a l’impression de voix naturelles, avec les craintes légitimes que des dispositifs aussi performants font peser sur de futures sonorisations clandestines de hauts lieux de l’opéra.

Il y a là de toute manière une équipe cohérente et engagée, qui fait merveille, une équipe qui est d’abord dans le jeu, c’est à dire dans la couleur et l’expression : Peter Bronder à ce titre est un Loge qui n’a rien d’histrionique, une sorte de crapule raffinée, et donc intelligente, qui sculpte les paroles pour donner à ce texte une couleur incroyablement variée, sans jamais faire du jeu un double des paroles. Il est le plus vieux du plateau, et dirons nous, le plus mûr, le plus matois, avec ce presque rien de distance qui lui fait toujours être à la fois dedans et dehors, magnifique présence, et une voix qui sans être puissante est particulièrement bien projetée. Il est le « chef d’orchestre » de l’histoire, distancié mais pas trop, présent et ailleurs, dans une élasticité qui sied bien au personnage.
Face à lui, avec lui, le Wotan assez juvénile de Mika Kares, basse finlandaise (c’est presque un pléonasme tant les finlandais ont donné à cette tessiture) à la voix bien posée et projetée de manière efficace, à la diction remarquable. La présence de ce Wotan s’affirme de moment en moment, pour finir en personnage torturé, ravagé par la compréhension du monde que lui a donnée Erda. C’est un Wotan plus traditionnel évidemment que celui de Wolfgang Koch, qui dit le texte de manière sans doute moins variée, mais qui pose le personnage, avec sa père de lunettes à demi obscurcie ; une très belle prestation, qui pose un Wotan non conscient de sa perte qui va quand même y aller, comme chez Guy Cassiers, mais un Wotan qui finit écrasé.
Il faut saluer l’extraordinaire performance de Leigh Melrose en Alberich, un Alberich jeune, vigoureux, violent, puissant, étourdissant qui remplit la scène et la salle par une voix claire, magnifiquement projetée et un texte dit avec une conviction rare, un Alberich sans cesse in medias res, qui contraste avec la distance affichée chez Castorf par un Albert Dohmen plutôt presque aristocratique, un Alberich wotanisé. Ici l’Alberich de Leigh Melrose se pose comme opposé directement à Wotan, l’autre absolu.
Même engagement chez le Mime d’ Elmar Gilbertsson, ténor moins « caractériste » que les Mime habituels, une sorte de double de son frère en version vocalement moins imposante, mais non moins intense.

Les géants Frank van Hove (Fasolt) et Peter Lobert (Fafner) sans être exceptionnels, sont particulièrement efficaces et très émouvants dans la dernière partie. Donner (Andrew Poster-Williams) et Froh (Rolf Romei) complètent efficacement la distribution masculine.
Du côté féminin, on apprécie la Fricka bien plantée de Maria Riccarda Wesseling, avec son mezzo charnu, et son personnage de bourgeoise caricaturale en tailleur et chapeau, une Fricka vocalement très présente, qui pose un personnage à la fois plein de relief et dérisoire, tandis que la Freia d’Agneta Eichenholz, qu’on a vue dans pas mal de productions récentes sur les scènes européennes, est volontairement pâle, réduite au statut d’instrument qu’on va se passer de main (des Dieux) en main (des géants), elle est en retrait, mais la voix est bien timbrée, bien claire, même si ce n’est pas la future Sieglinde qu’on espère toujours dans ce rôle.
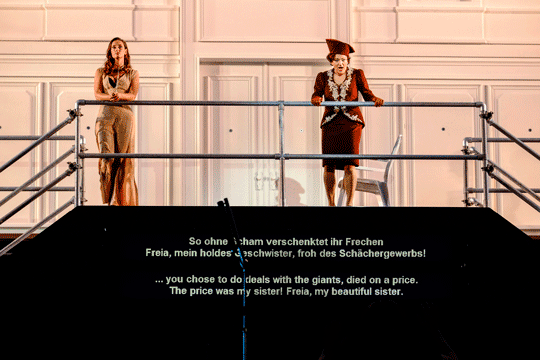
Les filles du Rhin (Anna Patalong, Dorottya Láng, Jurgita Adamonyté) je l’ai déjà souligné, sont vraiment magnifiques, leurs voix s’unissent parfaitement, leur jeu est prodigieux de vérité, au plus près du spectateur, très vibrant et vivant, avec un chant très émouvant à la fin (Rheingold…). Les filles du Rhin qui ouvrent et ferment l’opéra doivent vraiment être musicalement impeccable parce qu’elle donnent la couleur et l’énergie à l’ensemble.

Je garde pour la bonne bouche Jane Henschel, une chanteuse magnifique d’intensité, qu’on ne cesse de redécouvrir. Mortier l’aimait tout particulièrement (souvenons nous de sa Kabanicha dans Katia Kabanova – Production de Marthaler- où elle fut défintive) poarce qu’elle est un personnage, un vrai mezzo de caractère apte à interpréter toutes les méchantes du répertoire, avec une voix toujours magnifiquement projetée, avec une diction parfaite, avec une intelligence des personnages incroyablement sensitive. Elle est une Erda impressionnante, seule au milieu de l’eau stagnante, annonçant la chute à ces Dieux qui viennent d’emporter une victoire à la Pyrrhus. C’est un des moments les plus forts et les plus émouvants de la soirée. Une Erda pour l‘éternité.
Et un Rheingold très spécifique, passionnant, non par le propos qu’il diffuse, assez rebattu, mais par la manière dont il s’adapte à la région, à son histoire, à sa géographie, à sa population, à ses lieux : un Rheingold pour la Ruhr, un Ruhrgold plus que Rheingold. Production forte, si forte qu’elle se suffit à elle même, et si forte qu’il ne faudrait surtout pas l’exporter, mais faire le voyage de la Ruhr pour la découvrir comme un symbole de cette région encore si marquée par le chômage et qui renaît par la culture.[wpsr_facebook]


 Photo Marthe Lemelle
Photo Marthe Lemelle
 Photo Marthe Lemelle
Photo Marthe Lemelle