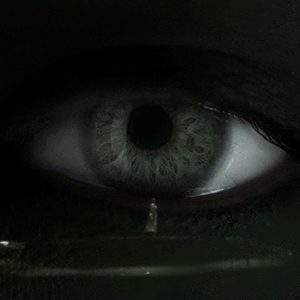Non, tout ne marche pas en Allemagne. L’aéroport de Berlin-Brandeburg devait ouvrir en juin dernier, il ne sera opérationnel qu’en 2015, et encore, sa capacité est insuffisante dès l’ouverture: tant mieux, on continuera d’utiliser Tegel, bien plus pratique. La Staatsoper unter den Linden en travaux depuis deux ans, n’ouvrira probablement pas non plus dans les délais prévus et donc voilà encore ce théâtre contraint d’utiliser les espaces plus étroits du Schiller Theater, à une volée du rival la Deutsche Oper, en face sur la même avenue. A ce jour les deux théâtres ont publié leurs saisons respectives, mais pas le troisième larron, la Komische Oper. Trois opéras à Berlin, trois histoires, trois traditions différentes, trois publics aussi et donc un casse tête pour le politique désireux de rationaliser la situation, budgétaire notamment. Je m’en vais donc essayer de vous présenter les deux saisons, de ces deux théâtres qui sont des théâtres de répertoire, avec leur troupe et donc leur couleur.
La Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110
Héritier de la tradition lyrique historique de Berlin, la Staatsoper, à deux pas du palais impérial, était la Hofoper (Opéra de Cour) de l’Etat prussien, avec l’orchestre d’Etat, la Staatskapelle, il fut dirigé par les plus grands Richard Strauss, Leo Blech, Erich Kleiber, Clemens Krauss, Herbert von Karajan (1941-1945…) ; ce fut après la deuxième guerre mondiale et une longue reconstruction (1945-1955) l’opéra d’Etat de Berlin Est, avec son public plus populaire, vitrine de l’art lyrique en Allemagne de l’Est, que Daniel Barenboim reprit en 1992 peu après qu’il a été écarté du Philharmonique de Berlin au profit de Claudio Abbado. Royaume de Daniel Barenboim et de l’intendant Jürgen Flimm, resté peu de temps à Salzbourg et qui en dit des horreurs (commentant dans les journaux le fait qu’en ce moment Alexander Pereira ferraille avec son conseil d’administration et se trouve au bord du départ: Salzbourg use et abuse des intendants depuis le départ de Mortier), il est installé à l’étroit dans la salle du Schiller Theater qui contient moins de 1000 spectateurs.
La programmation de la Staatsoper est dans l’ensemble plus recherchée et plus raffinée que celle de sa voisine d’en face, la Deutsche Oper; d’une part Jürgen Flimm est homme de théâtre et à ce titre veille à ce que les productions soient faites par des metteurs en scène inventifs, l’an prochain par exemple, Tcherniakov, Philipp Stölzl, Sasha Waltz, Andrea Breth sont des acteurs de la scène d’aujourd’hui et représentent une certaine modernité. Du côté musical, Daniel Barenboim est un directeur musical très ouvert, très présent (trop disent ses détracteurs) qui va diriger trois des nouvelles productions (La Fiancée du tsar, Trovatore, Tannhäuser), mais aussi Don Giovanni, Simon Boccanegra, Wozzeck dans le répertoire, soit 6 productions au total, ce qui est très respectable, mais il a appelé aussi Zubin Mehta (deux productions, Salomé et Aida), Sir Simon Rattle (Katja Kabanova), Daniel Harding (Fliegende Holländer), Marc Minkowski (Il trionfo del Tempo e del Disinganno), René Jacobs (Rappresentazione di Anima e Corpo) ce qui promet de belles soirées.
Vu l’exigüité de la salle, elle peut accueillir plus facilement des opéras baroques, du théâtre musical, et la salle de l’atelier (Werkstatt) des opéras pour enfants ou des petites formes. Ainsi donc la saison est plutôt séduisante, diverse et marque une vraie variété alliant répertoire, raretés, recherche; quant au reste du répertoire, il fait appel aux chefs maison, à la troupe locale, à des chefs très solides spécialistes de répertoire baroque ou classique (Christopher Moulds) ou italien (Massimo Zanetti).
Ainsi donc bonne partie de l’automne sera faite de nouvelles productions, après un Ballo in Maschera de répertoire (Production Jossi Wieler/Sergio Morabito, avec Norma Fantini (Amelia), Kamen Chanev (Riccardo), Marina Prudenskaia (Ulrica), Valentina Nafornita (Oscar), le tout dirigé parr Massimo Zanetti (septembre), dès le 3 octobre, et pour 6 représentations jusqu’au 1er novembre, la première nouvelle production, Zarskaja newesta (La Fiancée du Tsar) de Nicolai Rimski-Korsakov dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov et dirigée par Daniel Barenboim avec une très belle distribution, Anatolij Kotscherga, Olga Peretyatko, Johannes Martin Kränzle, Pavel Černoch, Anita Rachvelishvili. Daniel Barenboim en profitera pour diriger un Wozzeck de répertoire mis en scène par Andrea Breth, avec Roman Trekel dans Wozzeck, Waltraud Meier (Marie), Graham Clark (Kapitän), Pavol Hunka (Doktor) et Štefan Margita dans le Tambourmajor: il faut le dire, c’est une splendide distribution (4 représentations du 4 au 12 octobre). Daniel Barenboim dirigera en octobre une reprise de Don Giovanni dans la production salzbourgeoise passionnante de Claus Guth (où Don Giovanni blessé à mort par le Commandeur dès le début vit à fond ses dernières heures et règle tous ses comptes); comme à Salzbourg, c’est Christopher Maltman qui chante Don Giovanni, aux côtés de la Anna de Christine Schäfer et la Elvira de Dorothea Röschmann, du Leporello de Adrian Sâmpetrean (vu récemment dans le Macbeth milanais) de l’Ottavio de Rolando Villazon, de la Zerlina d’Anna Prohaska et du Masetto de Adam Plachetka (qui sera en revanche Don Giovanni à Vienne et à la Deutsche Oper); là aussi, une jolie réunion de bons chanteurs! (6 représentations du 18 octobre au 3 novembre).
Daniel Barenboim sera encore au pupitre pour un hommage de Sasha Waltz au Sacre du printemps de Stravinski, la création de Sacre un montage entre le Sacre du Printemps, la “scène d’amour” du Roméo et Juliette de Berlioz et L’après-midi d’un faune de Debussy pour deux représentations les 26 octobre et 2 novembre.
La programmation de novembre est faite de représentations de répertoire, La Traviata fameuse de Peter Mussbach, direction Domingo Hindoyan, avec Anna Samuil dans Violetta pour 3 représentations en novembre, 2 en février et 2 en mars, Die Zauberflöte (Production August Everding) direction du jeune Wolfram-Maria Märtig, avec Anna Prohaska en Pamina et Stephan Rügamer en Tamino et La Finta Giardiniera (Die Pforten der Liebe) de Mozart dans une nouvelle version du livret signée Hans Neuenfels, qui a aussi signé la mise en scène à l’automne 2012, dirigé par Christopher Moulds avec Stephan Rügamer et Anna Siminska.
Le 29 novembre 2013, la première très attendue du Trovatore de Verdi pour 7 représentations (jusqu’au 22 décembre) dans la production de Philipp Stölzl (à qui l’on doit le Rienzi et le Parsifal de la Deutsche Oper, ainsi que le Fliegende Holländer actuellement en scène à la Staatsoper), dirigé par Daniel Barenboim avec Anna Netrebko (Leonora), Alexksandr Antonenko (Manrico), une voix un peu lourde pour le rôle à mon avis, Marina Prudenskaja dans Azucena et…Placido Domingo dans Il conte di Luna. Réservons notre vol…
Car en décembre, outre ce Trovatore, quelques Zauberflöte et Finta Giardiniera, ainsi que La Bohème (pour5 représentations jusqu’au 19 janvier (Anna Samuil dans Mimi et Josep Caballé-Domenech au pupitre) on pourra aussi voir Der Fliegende Holländer, dans la production de Philipp Stölzl (c’est son mois!) dirigé par Daniel Harding, avec Michael Volle dans le Hollandais, Emma Vetter (Senta) et Stephan Rügamer (Erik) (à partir du 12 décembre pour 4 représentations jusqu’au 29). Philipp Stölzl sera encore à la fête à la Staatsoper pour la production de fin d’année, une reprise de Orphée aux Enfers (Orpheus in der Unterwelt) d’Offenbach, dirigée par Günther Albers pour 4 représentations jusqu’au 12 janvier.
En janvier justement des représentations de répertoire de Bohème, de Zauberflöte, de Barbiere di Siviglia, pour en arriver le 25 janvier à la première représentation de Katja Kabanova, de Leoš Janáček, nouvelle production d’Andrea Breth, dirigée par Sir Simon Rattle pour 6 représentations jusqu’au 16 février, avec une magnifique distribution réunissant entre autres Deborah Polaski (Marfa) et Eva Maria Westbroek (Katja), Pavel Černoch (Boris), Stephan Rügamer (Tichon), Roman Trekel (Kuligin). En février on pourra coupler cette Katja Kabanova de luxe par une reprise de choix, celle de Salomé, car la production de Harry Kupfer sera dirigée par rien moins que Zubin Mehta, pendant un bon mois à la Staatsoper de Berlin et pour pour 4 représentations du 2 au 13 février, avec Camilla Nylund (Salomé) et Albert Dohmen (Jochanaan), mais aussi l’excellent Gerhard Siegel (Herodes) et Birgit Remmert dans Herodias; un “mois Mehta”, ai-je dit, parce le 15 février, il dirigera une série de 3 représentations (jusqu’au 23 février) de Aida, dans la mise en scène de Pet Halmen avec le quatuor Ludmila Monastyrska (Aida), Nadia Krasteva(Amneris), Franco Vassallo (Amonasro), Fabio Sartori (Radamès): on pouvait rêver meilleur cast, mais pour Zubin Mehta dans un grand Verdi on ne fera pas la fine bouche.
En fin de mois, une Tosca qu’on peut éviter (Mise en scène Carl Riha, direction Stefano Ranzani avec Maria José Siri, Thiago Arancam et Egils Silins). Traviata, Zauberflöte pour un mois de mars sans grand intérêt, sauf pour 6 représentations (16 mars-6 avril) des Nozze di Figaro dirigées par Christopher Moulds avec une jolie distribution qui vaut une soirée si l’on est à Berlin: Roman Trekel (Il conte), Dorothea Röschmann (La Contessa), Vito Priante (Figaro), Anna Prohaska (Susanna) et Rachel Frenkel (Cherubino, comme à Vienne).
Avril, c’est le festival annuel du 12 au 20 avec deux “must”:
– une nouvelle production de Tannhäuser, dirigée par Daniel Barenboim, dans une mise en scène chorégraphiée de Sasha Waltz (c’est incontestablement attirant) avec quelle distribution ! René Pape (Landgrave), Peter Seiffert (Tannhäuser), Peter Mattei (!!) (Wolfram), Marina Prudenskaja (Venus), Marina Poplavskaja (Elisabeth). (4 représentations du 12 au 27 avril)
– une reprise de Simon Boccanegra (mise en scène – mauvaise- de Federico Tiezzi) avec Placido Domingo (Simon) et Anja Harteros (Amelia), Dmitry Belosselskiy (Fiesco), Fabio Sartori (Gabriele) les 13 et 17 avril.
Et peu après, à partir du 22 avril et jusqu’au 26 avril (3 soirs), une rareté, le Vin Herbé de Frank Martin, direction de Frank Ollu, et mise en scène de Katie Mitchell, avec entre autres Matthias Klink et Anna Prohaska, qui est une reprise d’un spectacle qui aura sa première à la fin du mois de mai 2013.
La première moitié du mois de mai 2014 sera baroque. Tout d’abord, une reprise de Rappresentatione di Anima et di Corpo de Emilio de’ Cavalieri, oeuvre fondatrice de l’opéra, dirigé par René Jacobs avec l’Akademie für Alte Musik Berlin, dans la mise en scène de Achim Freyer, avec notamment Marie-Claude Chappuis pour 4 représentations du 4 au 11 mai, puis de Dido and Aeneas, de Purcell (réédition de Attilio Cremonesi) dans une mise en scène et chorégraphie de Sasha Waltz, un magnifique spectacle dirigé par Christopher Moulds, reprise d’un spectacle de 2005 (je crois), avec l’Akademie für Alte Musik de Berlin.
On pourra voir (en passant) à partir du 18 mai une reprise de la production déjà ancienne de Philipp Himmelmann (2004) de Don Carlo de Verdi (version en 4 actes) pour 5 soirées du 18 au 30 mai, dirigée par Massimo Zanetti, avec René Pape dans Filippo II, Fabio Sartori dans Don Carlo et Alfredo Daza dans Posa, ainsi que Anna Samuil dans Elisabetta et Marina Prudenskaja dans Eboli et encore les 24 mai et 1er juin Tosca (avec Béatrice Uria-Monzon et Jorge de Leon cette fois).
Le mois de juin verra pour la dernière reprise de l’année (pour trois représentations les 7,9,11 juin) , encore un spectacle baroque: Il trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel, avec Marc Minkowski au pupitre des Musiciens du Louvre – Grenoble et dans la mise en scène de Jürgen Flimm avec notamment Charles Workman, Sylvia Schwartz, et Delphine Galou et enfin la dernière nouvelle production de l’année, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny de Kurt Weill dans une mise en scène de Vincent Boussard, décors de Vincent Lemaire et costumes de Christian Lacroix avec Wayne Marshall au pupitre de la Staatskapelle Berlin pour 6 représentations du 6 au 25 juin, avec le très bon Michael König dans le rôle de Jim Mahoney .
Toute la seconde moitié de juin est dédiée au festival Infektion! Festival für neues Musiktheater qui présentera
– le Lohengrin (1982) de Salvatore Sciarrino dans l’Atelier (Werkstatt) pour 5 représentations du 14 au 21 juin, mise en scène Ingo Kerkhof
– dans la grande salle de la Staatsoper la création d’un spectacle composé d’un opéra de Morton Feldman Neither (sur un texte de Samuel Beckett) et de Footfalls de Samuel Beckett, sur les lieux mêmes où Feldman et Beckett se rencontrèrent, la mise en scène est de Katie Mitchell (qui a mis en scène Written on Skin de George Benjamin à Aix) qui combinera les deux œuvres, la Staatskapelle de Berlin sera dirigée par François-Xavier Roth et la soliste sera Laura Aikin pour 4 représentations du 22 au 29 juin.
– Aschemond oder The Fairy Queen, un opéra de Helmut Oehring sur une interprétation de musiques de Henry Purcell dans une mise en scène de Claus Guth avec une distribution très stimulante, Marina Prudenskaja, Bejun Mehta, Andrew Staples, Roman Trekel et sous la direction de Michael Boder pour la Staatskapelle Berlin et de Benjamin Bayl pour l’Akademie für Alte Musik (23, 26, 28 juin)
– Enfin, une reprise de Lezioni di tenebra de Lucia Ronchetti créé le 30 janvier au Werkstatt d’après Giasone de Francesco Cavalli sous la direction de Max Renne (27 et 29 juin).
On peut constater à la fois la variété de l’offre de la Staatsoper qui va de l’opéra standard à au théâtre musical le plus contemporain, la qualité des chefs invités et celle des metteurs en scène ainsi que la bonne tenue des distributions. Le système est un mélange de système de répertoire et de stagione: la scène du Schiller Theater ne permet pas de toute manière une alternance complète. En tous cas de septembre à février, les mélomanes devraient trouver leur compte, sans oublier le Festival en avril et aussi le Festival de Théâtre musical en juin qui offre deux spectacles à voir de Katie Mitchell et Claus Guth. De quoi remplir bien des soirées berlinoises, à des prix raisonnables vu que la plupart du temps les places vont de 20-28 € à 66-84 € !
Deutsche Oper am Rhein, Bismarckstraße 35
Le cube de béton construit au début les années 60 (1961), salle à vision frontale de 1900 spectateurs environ fait suite à une histoire qui remonte au début du siècle. Face à l’opéra d’Etat (Staatsoper) , c’est un “opéra de quartier” lié au quartier très riche de Charlottenburg (la commune la plus riche de Prusse à l’époque) qui naît, appelé Deutsches Opernhaus, puis Städtische Oper (Opéra municipal) en 1925. Goebbels l’a appelé de nouveau Deutsches Opernhaus. Carl Ebert, l’intendant de l’époque, a quitté l’Allemagne pour éviter à avoir à se compromettre avec le régime: il retrouvera son poste en 1945. La salle de 1912, remodelée en 1935, fut détruite par un bombardement en 1943. La conception de la salle de 1961 est clairement celle d’une salle de répertoire, plutôt ouverte (vision frontale) qui fut l’Opéra de Berlin Ouest lorsque le mur sépara Berlin et que la Staatsoper fut celui de Berlin Est. Deux symboles donc et toujours la même rivalité (sous les nazis, Goebbels tenait la Deutsches Opernhaus et Göring la Staatsoper), qui continue au-delà de la “Wende”, après la chute du mur, tant les profils des deux théâtres sont différents (un peu comme Garnier et Bastille si les théâtres avaient deux administrations séparées). La Deutsche Oper est donc un véritable opéra de répertoire, avec des productions durables, très marqué encore par les années où Götz Friedrich fut son intendant, de 1981 à sa mort, en 2000.
Ses directeurs musicaux furent, entre autres, Bruno Walter, Ferenc Fricsay, Lorin Maazel, Gerd Albrecht, Christian Thielemann. Depuis 2009, le directeur musical est l’américain Donald Runnicles.
Six nouvelles productions en 2013-2014, et deux productions en version de concert, et 26 productions au répertoire, cela signifie une grosse trentaine de titres différents, sans compter les six productions dans la “Tischlerei” (l’ancienne menuiserie) salle de création dédiée aux expérimentations ouverte en novembre 2012. En 2013-2014, on jouera Berlioz (2) Bizet (1), Britten(1), Donizetti(3), Humperdinck(1), Janacek(1), Leoncavallo(1), Mascagni(1), Massenet(1), Mozart(4), Ponchielli(1), Puccini(2), Rossini(1), Verdi(7), Wagner(6, dont deux séries du Ring).
Une saison qui s’ouvre le 22 août par une création (unique soirée) dans le foyer de l’opéra, un opéra “accessible”(Begehbare Oper) sur des musiques de Maurizio Kagel et Christian Steinhäuser dans une mise en scène de Sven Sören Beye.
Mais c’est bien le Ring, dans la mise en scène désormais culte de Götz Friedrich qui va encore faire événement cette année: programmé deux fois dans deux distributions différentes, en septembre sous la direction de Sir Simon Rattle (qui se partage entre Deutsche Oper et Staatsoper!) et en janvier sous la direction de Donald Runnicles. C’est septembre qu’il faut choisir au vu de la distribution: Wotan, Juha Uusitalo (sept), Mark Delavan (janv); Alberich: Eric Owens; Loge: Burkhard Ulrich; Fricka: Doris Soffel (sept), Daniela Sindram (janv), Siegmund: Simon O’Neill (sept) Peter Seiffert (janv); Brünnhilde (Walküre): Evelyn Hertlizius (sept), Linda Watson (janv), (Siegfried) Susan Bullock,(Götterdämmerung) Evelyn Hertlizius (sept), Susan Bullock (janv) ; Sieglinde: Eva-Maria Westbroek(sept), Heidi Melton (janv); Siegfried: Lance Ryan; Wanderer: Juha Uusitalo (sept), Terje Stensvold (janv); Mime: Burkhard Ulrich; Hagen: Hans Peter König; Waltraute: Anne Sofie von Otter; Gutrune: Heidi Melton; Günther: Markus Brück.
Anna Smirnova sera comme à Vienne Abigaille dans une nouvelle production de Nabucco dirigée par le jeune Andrea Battistoni, moins doué que l’autre jeune italien, Daniele Rustioni à mon avis (qui vient d’obtenir l’Opera Award du meilleur jeune chef) mise en scène de Keith Warner, avec Johan Reuter dans Nabucco (à partir du 8 septembre, en octobre et en décembre). La saison propose un autre Verdi, Falstaff, dirigé par Donald Runnicles, mise en scène de Christof Loy (hum), avec Markus Brück (Falstaff), Michael Nagy (Ford) , Joel Prieto (Fenton) et Barbara Haveman dans Alice Ford (7 représentations de novembre à janvier). Donald Runnicles dirigera aussi La Damnation de Faust de Berlioz, mise en scène de Christian Spuck, sur deux séries de représentations ( 4 en février-mars et 4 fin mai début juin) avec des choix de distributions cornéliens: en février Klaus Florian Vogt, Clementine Margaine, Samuel Youn, et en mai Matthew Polenzani, Elina Garanca, Ildebrando d’Arcangelo. On passera rapidement sur une nouvelle production d’Irina Brook de L’Elisir d’amore de Donizetti, dirigée par le très pâle Roberto Rizzi Brignoli avec Nicola Alaimo tout de même dans Dulcamara (5 soirs en avril mai) pour s’intéresser vivement à Billy Budd de Britten, pour 5 représentations en mai juin, dans une mise en scène de David Alden et dirigé par Donald Runnicles, avec John Chest en Billy Budd et Burkhard Ulrich en Edward Fairfax Vere. la saison se termine par quatre représentations concertantes, deux (4 & 7 juin) de Maria Stuarda de Donizetti (Paolo Arrivabeni, Joyce di Donato/Carmen Giannatasio), pour madame Di Donato, et deux (16 & 19 juin) de Werther de Massenet (Donald Runnicles, Ekaterina Gubanova/Vittorio Grigolo): Grigolo en Werther…c’est le mauvais rêve de l’éléphant dans le magasin de porcelaines.
Du côté des reprises de répertoire, comptez sur des Bohème (7 fois en décembre) et des Tosca (6 fois en décembre, janvier, mai), des Nozze di Figaro (3 fois en février-mars), des Don Giovanni (6 fois de mars à juin) avec Adam Plachetka la trouvaille viennoise, et Sonja Yontcheva, 10 Zauberflöte (mise en scène Günter Krämer) d’octobre à mai, un Barbiere di Siviglia pour 6 représentations d’octobre à février (dirigé par Guillermo Garcia Calvo).
Les Verdi sont plus intéressants et se concentrent en automne (année du centenaire oblige) cinq titres sont proposés en plus de Nabucco et Falstaff dans la période:
– Don Carlo (version en 4 actes) en octobre et surtout novembre, direction Donald Runnicles et mise en scène Marco Arturo Marelli, avec Hans Peter König, Paata Burchuladzé, Russel Thomas, Dalibor Jenis, Violeta Urmana et Anja Harteros/Barbara Frittoli (pour une soirée en novembre).
– Macbeth (4 représentations en octobre et novembre), direction Paolo Arrivabeni, et mise en scène Robert Carsen, avec en Macbeth Thomas Johannes Mayer (octobre) et Simon Keenlyside (novembre), en Lady Macbeth Marianne Cornetti(octobre) et Ludmyla Monastyrska (novembre).
– Otello (3 représentations en novembre), dirigé par Donald Runnicles, dans une mise en scène de Andreas Kriegenburg, avec José Cura (Otello), Barbara Frittoli (Desdemona) et Thomas Johannes Mayer en Jago: malgré Kriegenburg, on peut passer.
– Rigoletto (6 représentations en novembre, décembre et avril), mise en scène de Jan Bosse, direction Roberto Rizzi Brignoli, nouvelle production très contestée de la saison actuelle, avec Lucy Crowe (nov-déc)/Elena Tsallagova(avril), Andrzej Dobber(nov-déc)/Markus Brück(avril) et Ivan Magri(nov-déc)/David Lomeli(avril)
– La Traviata (8 représentations entre octobre et avril) dans la mise en scène de Götz Friedrich, dirigée par Gérard Korsten et Ivan Repusic (avril) avec quatre Violetta (Dinara Alieva, Ailyn Perez, Alexandra Kurzak, Marina Rebeka), quatre Alfredo (Gyorgy Vasiliev, Stephen Costello, Yosep Kang, Dmytro Popov), quatre Germont (Etienne Dupuis, Simon Keenlyside – 1 fois-, Leo Nucci -1 fois- et Markus Brück en février et avril).
Du côté de Wagner, à part le Ring, la Deutsche Oper affiche des spectacles solides dans des distributions soignées:
– Parsifal, à Pâques comme il se doit (5,18, 21 avril) dans la mise en scène assez réussie de Philipp Stölzl (nouvelle production de cette saison) , dirigé par Axel Kober, qui dirigera cette année Tannhäuser à Bayreuth avec Hans-Peter König (Gurnemanz), Stefan Vinke (Parsifal), Bo Skovhus (Amfortas) Bastiaan Everink (Klingsor) et Evelyn Herlitzius (Kundry)
– Tristan und Isolde, en mai pour 3 représentations, dirigé par Donald Runnicles dans la mise en scène de Graham Vink, avec Nina Stemme et Stephen Gould, entourés de Albert Pesendorfer et Liang Li (Marke), Samuel Youn (Kurwenal) et Tanja Ariane Baumgartner (Brangäne). Pour le couple vedette, on ne peut manquer Nina Stemme dans Isolde.
Mais dans la liste des opéras de répertoire, émergent quelques moments qui devraient stimuler le plaisir du mélomane ou du fan.
– Les Troyens (3 représentations en mars-avril): production de David Pountney, dirigée par Paul Daniel, avec Roberto Alagna (Enée), Ildiko Komlosi (Cassandre) et Béatrice Uria-Monzon (Didon), distribution intéressante et œuvre évidemment passionnante qu’on n’a pas vue depuis longtemps à Paris, ce foyer, paraît-il, du grand répertoire français.
– Jenufa (3 représentations en février): production de Christof Loy diriége par Donald Runnicles, avec Hanna Schwarz, Will Hartmann, Jennifer Larmore et Michaela Kaune; là aussi, un ensemble digne d’intérêt
– Cavalleria rusticana/Pagliacci (4 représentations en mars) : on pourrait ranger cette production dans les soirées habituelles de répertoire, mais voilà, Santuzza sera Waltraud Meier dans Cavalleria et cela change tout et dans Pagliacci, Canio sera Stephen Gould et Nedda Carmen Giannatasio. C’est aussi le jeune Cornelius Meister, grand espoir de la direction en Allemagne qui sera au pupitre et la mise en scène est de David Pountney
– La Gioconda (4 représentations en janvier-février), entrée au répertoire de Paris en ce moment, déjà au répertoire de Berlin depuis longtemps, La Gioconda mérite d’être vue au moins une fois même dans une vieille mise en scène de Filippo Sanjust, dirigée par l’excellent Jesus Lopez Cobos, avec Hui He, Marianne Cornetti, Marcelo Alvarez, Lado Ataneli. Une distribution solide, qui peut sauver l’honneur d’une œuvre un peu surannée.
Telles sont les perspectives des deux salles berlinoises: deux couleurs différentes certes, deux manière de gérer l’opéra certes, mais bien des similitudes: toutes deux sont ouvertes au Regietheater et à l’innovation sur scène, on y retrouve les mêmes (Philipp Stölzl par exemple) ou quelquefois les mêmes titres en trop grand nombre (Don Carlo, Don Giovanni, La Traviata, Il Barbiere di Siviglia, Tosca, Bohème…) ce qui est regrettable et montre les effets pervers de la concurrence sur les grands standards. La Deutsche Oper travaille plus sur son répertoire (on le voit sur l’accumulation des Verdi et Wagner), la Staatsoper travaille plus sur “la” représentation dans une logique qui se rapproche du système stagione : en sera-t-il de même lorsqu’elle aura regagné Unter den Linden? Il faudra un jour qu’une décision soit prise pour que les deux institutions ne labourent pas le même champ.
Même si tout ne vaut pas le vol vers Berlin pour le mélomane français, il reste que pour le spectateur local, il y a de quoi aller voir de l’opéra chaque semaine, sinon chaque soir, et de l’opéra, dans des productions souvent intéressantes: au moins ce n’est pas ennuyeux…Heureux berlinois. [wpsr_facebook]