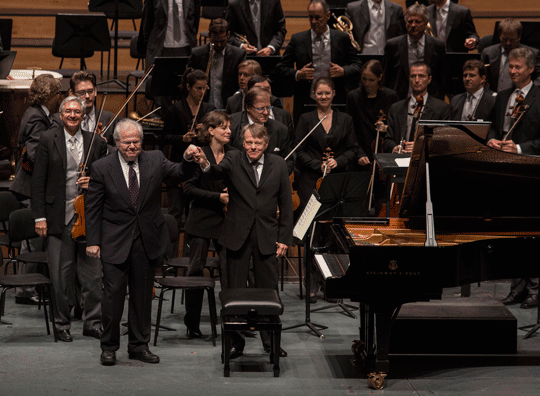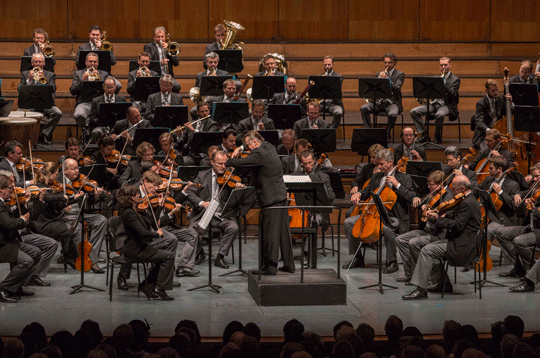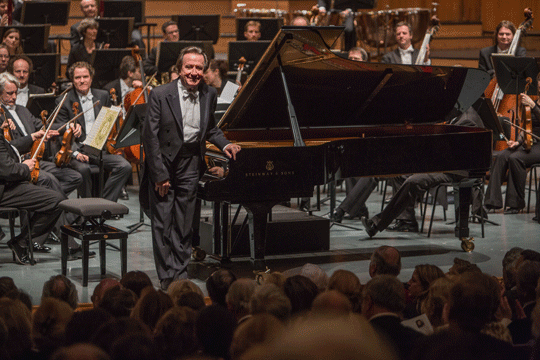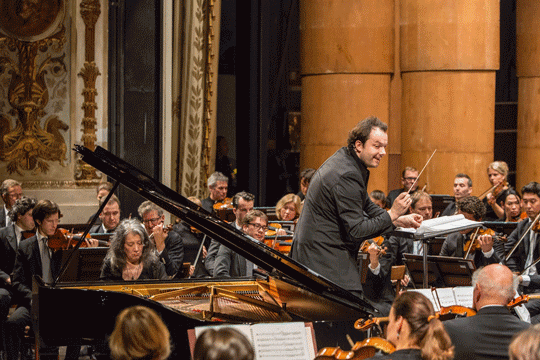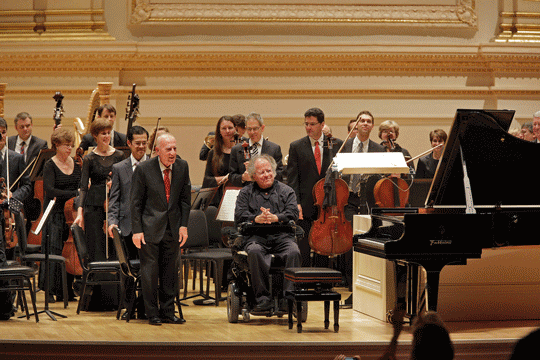Igor Levit est considéré comme l’un des plus importants pianistes de sa génération. Il a écrit ce texte suite à des menaces de mort reçues en novembre dernier visant un de ses concerts. Il peut être lu sur le site du journal berlinois TAGESSPIEGEL qui l’a publié dans son édition du dimanche 29 décembre 2019 sous l’URL: https://www.tagesspiegel.de/meinung/pianist-igor-levit-erhielt-morddrohungen-habe-ich-angst-ja-aber-nicht-um-mich/25372372.html
C’est un texte puissant, sensible, intelligent. Il est d’actualité en Allemagne sans doute, mais partout ailleurs en Europe où la tentation populiste (pudique terme qui masque la peste brune) commence à irriguer de nombreux pays ces dernières années et excite les haines.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de le traduire pour permettre à des lecteurs et lectrices non germanophones d’y avoir accès directement. Levit y appelle un chat un chat, et c’est réconfortant qu’un artiste de sa trempe prenne la parole. On en entend bien peu en France qui ont ce courage-là.
C’est le cadeau de fin d’année du Blog du Wanderer. Meilleurs voeux, notamment musicaux et beethoveniens en cette année du 250ème anniversaire du compositeur, un des grands défenseurs des valeurs de l’humain, comme Levit le rappelle ci-dessous.

Avant, c’était la vigilance, la recherche de quelque chose de neuf, de l’inconnu, la colère, l’inquiétude, l’attention. Après s’ajoute quelque chose à l’ensemble qui me semblait lointain auparavant : la peur.
Pas pour moi, mais pour ce pays. Mon pays. Notre pays.
Quiconque me connaît, en direct ou par le numérique, sait qu’à chaque fois que je me présente, je place trois termes au-dessus de tout : Citoyen. Européen. Pianiste. Mais dans l’intervalle, j’ai commencé à me demander si ça suffisait pour toucher au cœur. Parce que quelque chose que je pensais qu’il n’était pas nécessaire de nommer explicitement, parce que je le considérais comme allant de soi, a été laissé de côté dans cette auto-description : l’être humain.
Humain, citoyen, européen, pianiste.
Il ne suffit pas de se décrire en termes de fonction, de profession, d’appartenance culturelle et institutionnelle et de se situer politiquement, socialement et civiquement. Cette liste n’est pas exhaustive. Il y a quelque chose de plus élémentaire dans la profondeur de l’être humain : l’être, l’âme, les sensations, les émotions, une boussole morale.
En insistant sur l’évidence ? Oui, parce que ce n’est plus si évident.
L’autre jour, un journaliste m’a demandé dans une interview si Israël était mon pays, parce que j’étais juif. La question n’était probablement qu’irréfléchie et superficielle. Mais ça m’a atteint comme un coup sur le moment. J’ai réagi, parce que ça m’a frappé : « Tu es différent. Tu n’es pas l’un des nôtres. Toi et nous – il y a quelque chose entre les deux. D’une certaine façon, tu n’appartiens pas exactement à notre communauté ».
D’autres sont sans équivoque. Pas de manière superficielle, pas de manière irréfléchie, pas de manière cristalline et en annonçant vouloir fermer ma gueule de “sale juif” devant le public pendant que je suis assis sur scène. Devrais-je m’inquiéter ? Est-ce que j’ai peur ? Oui, mais pas pour moi.
Walter Lübcke, président du district de Kassel, a été abattu parce que le meurtrier avait été agacé par une remarque de Lübcke, faite il y a des années, sur la manière dont les réfugiés étaient traités. Martina Angermann, maire d’Arnsdorf, démissionne de son poste épuisée après d’innombrables et interminables attaques haineuses sur Internet. Andreas Hollstein, maire d’Altena en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est victime d’une attaque au couteau – par haine pour sa politique de réfugiés. Les trois victimes de la haine et de l’hostilité. Cela ne vient pas de nulle part.
Même les auteurs de violences verbales sont des criminels
Après qu’un Erythréen vivant en Suisse eut poussé un enfant (qui est mort) sur la voie ferrée à la gare centrale de Francfort-sur-le-Main, la députée de l’AfD Verena Hartmann a écrit : « Madame Merkel, que voulez-vous nous faire d’autre ? … je maudis le jour de votre naissance ». Et le chef du groupe parlementaire AfD au Bundestag, Alexander Gauland, a déclaré en 2018 : « Hitler et les nazis ne sont que fiente de moineau dans notre histoire millénaire. – Fiente de moineau ? Avec les dommages collatéraux de la Shoah, le programme d’euthanasie et les 50 millions de victimes de la Seconde Guerre mondiale ?
On pourrait remplir une page entière de journal avec l’énumération des violences, des dénigrements et de l’agitation dans notre pays.
Le langage et la violence.
Certains ne font mal qu’avec des mots. Mais supprimez le “ne…qu’…”. Les propos violents sont un crime. Ils existent dans l’anonymat de l’Internet, mais ils siègent également au Bundestag allemand et dans les parlements des Länder. Ils ont du temps d’antenne à la télévision et de l’espace dans les journaux – il n’est pas rare que les bavures soient d’autant plus violentes. Les gens sont harcelés avec des mots et on leur tire dessus.
D’abord la langue, puis l’action.
Et avec les chambres d’écho du net, les applaudissements fusent. La haine populiste cible tout ce qui ne lui convient pas. Des individus, des membres de la société civile, des populations entières : réfugiés, étrangers, musulmans, juifs, femmes, gauchistes, homosexuels, transsexuels, environnementalistes. En effet, de plus en plus de couches de la population sont stigmatisées.
Le poison des campagnes de dénigrement se répand lentement et insidieusement
On offense, on harcèle, et sur les lignes de touche on fait expressément état de « compréhension ». Insultes, imprécations, discrimination, discréditation, histoires de fake news, haine, menaces de mort, règlements de comptes, banalisation, relativisation et négation de l’histoire – toute la brutalisation drastique du langage et des relations entre les gens se répand de plus en plus : est-ce le climat relationnel, est-ce la terre que nous voulons? Bien sûr, la grande majorité du pays dirait : Non !
Mais : « Goutte à goutte, l’eau creuse la pierre ! » Le poison du harcèlement venu des populistes et de l’extrême droite se répand lentement et insidieusement. Lorsque les agressions et les attentats reviennent régulièrement dans l’actualité, le risque est de nous habituer au scandale et à l’inhumanité au lieu d’être alarmés et sensibilisés : nous acceptons une nouvelle normalité avec des hiérarchies de victimes et de criminels.
Ici, les crimes commis par les migrants sont jugés plus sévèrement que ceux commis par les allemands. Et la politique envers les réfugiés et la peur des étrangers sont citées comme des raisons de l’augmentation drastique de la violence antisémite et raciste. Pour parler clair, ce sont les extrémistes de droite qui attaquent les synagogues, mais en fait c’est la faute de Merkel et des réfugiés. Allons-nous laisser cela se produire, allons-nous tomber dans le panneau ? A qui laissons-nous interpréter notre temps ?
« An artist’s duty is to reflect the times » : « C’est le devoir de l’artiste de refléter l’époque », a déclaré Nina Simone, la grande artiste américaine et militante des droits civils. Les artistes et les intellectuels décrivent le monde tel qu’il est, ils décrivent émotionnellement le monde tel qu’il est : mettre en image ce qui est, le faire entendre, le mettre en mots, l’exprimer.
La musique décrit émotionnellement le monde tel qu’il est
« Faire le bien là où on peut, aimer la liberté par-dessus tout, ne jamais nier la vérité – même pas sur le trône ». C’est un envoi du journal de Ludwig van Beethoven de 1793 et d’un des nombreux exemples de sa puissance d’expression et de son amour inébranlable de la liberté. Enchanté par le monde, il ne s’est pas enfermé dans sa chambre de compositeur. Il se tenait au milieu de la société – ferme et prêt à en découdre.
La musique décrit le monde par les émotions, aujourd’hui comme hier.
La musique, c’est tellement de choses : c’est beaucoup plus que des points noirs sur cinq lignes. La musique n’est pas simplement l’héritage d’un compositeur. Elle décrit l’infini, elle est immatérielle, elle touche et raconte les états d’âme, elle peut nous rappeler, à nous les humains, qui nous pouvons être, pourquoi nous sommes et qui nous sommes. Comment nous aimons, comment nous avons peur, comment nous espérons, comment nous nous battons, comment nous nous abandonnons, comment nous nous relevons. elle raconte l’amour, la colère, le chagrin, l’épuisement, le fait d’être ensemble et l’un contre l’autre – elle décrit ce qu’on ressent dans la vie.
Que je joue l’Appassionata de Beethoven de manière contemplative ou intérieurement agitée, c’est le jour ou la nuit. Le lendemain de la première menace de mort de ma vie, l‘Appassionata était toute autre que les autres jours. Les Variations Goldberg de Bach après l’attaque de Halle ont sonné pour moi tout autrement que n’importe quel autre jour. La musique et les musiciens reflètent la vie.
Chacun de nous est libre d’avoir ses propres pensées et sentiments. Dieu merci. Comme interprète, comme lecteur et comme auditeur. Mais être libre, ce n’est pas une invitation à l’arbitraire et surtout ce n’est pas une invitation à l’arbitraire libre de toute responsabilité.
Au contraire : être libre signifie être responsable. La liberté pour et pas seulement de quelque chose. Être libre nécessite l’utilisation de ses sens. Entendre, voir, ressentir, sentir. La musique nous fait ressentir ce genre de liberté.
Mais la musique n’est pas un substitut, ne peut pas être un substitut. Pas un substitut de la vérité, ou de la politique, pas un substitut des relations entre les gens et pas de l’humanité. La musique n’est pas un ersatz qui empêcherait d’appeler racisme le racisme, ou empêcher d’appeler haine des femmes la haine des femmes. La musique ne peut être l’ersatz d’un citoyen alerte, critique, aimant, vivant et actif. Appeler un chat un chat quand l’urgence l’exige. C’est le devoir de chacun d’entre nous.
Nous devons nommer clairement les réalités
L’antisémitisme, le racisme, l’antiféminisme – le mépris de l’humanité : ils ont tous leur place dans notre pays – malheureusement ! C’est un fait. Ils l’ont toujours eu. Et aujourd’hui, ils prennent de plus en plus de place. Nous devons juste commencer à parler de la façon dont nous y répondons. Nous devons grandir politiquement et socialement. Non pas pour égrener des platitudes, non pas pour émettre des vœux pieux, mais pour nommer clairement les réalités, aussi difficiles soient-elles.
Être choqué encore et encore, se plaindre des actes individuels, quand il y a des morts, quand une maison est en feu, quand des gens sont battus, c’est ce que nous sommes formés à faire. Ensuite, nous ne faisons généralement rien d’autre que de resservir les mêmes stéréotypes encore et encore.
Ce n’est plus suffisant !
Nous devons accepter ces faits : Il ne s’agit pas de “cas”, de “cas isolés”. Il s’agit de victimes, encore et encore et encore. Et il s’agit de criminels et d’un système ! Il s’agit d’antisémitisme et de racisme systématiques, d’extrémisme de droite, de terreur et de violence populiste.
N’agissez que selon la maxime par laquelle vous pouvez en même temps vouloir qu’elle devienne une loi générale, dit l’impératif catégorique de Kant. C’est un principe éthique. La vraie vie est différente.
Mais notre réalité sociale n’est pas seulement différente, elle s’éloigne de plus en plus de cet idéal. La direction n’est plus la bonne : toujours plus de division, toujours plus d’hostilité, toujours plus d’exclusion, au lieu de cohésion, d’intégration et de respect.
C’est pourquoi il s’agit d’une question de décence et d’engagement. Engagement contre une société de plus en plus brutale, contre les poisons lents et contre l’émoussement des réactions. Ou bien mieux, pour la dignité humaine, pour l’humanité, pour la morale.
Car ce qui est peut-être plus associé au mot yiddish « Mentsh » qu’au mot allemand « Mensch»- c’est l’homme bon. Une personne intègre et honorable, un véritable modèle, quelqu’un dont vous suivez l’exemple. Il s’agit de la force de caractère, de la dignité et du sens de ce qui est bien et de ce qui est mal, de la responsabilité et de l’honnêteté.
Cette conception de l’humanité et de la dignité n’est pas d’ordre juridique ou constitutionnel. C’est une question de morale qui bien entendu ne contredit pas la norme d’ancrage de la Constitution ni les principes juridiques correspondants, écrits ou non, en vigueur n’importe où.
La dignité de l’être humain est touchée et attaquée
La dignité de l’homme est inviolable. L’article 1 de la Constitution stipule c’est le devoir de l’Etat que de la respecter et la protéger. Une revendication et un idéal né des horreurs de l’Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. Mais le décalage par rapport à notre réalité est flagrant. Il y a un écart entre la norme constitutionnelle et la réalité de la vie. La dignité de l’être humain, des êtres humains, est touchée et attaquée. En Allemagne – constamment, chaque jour, quelque part.
L’antisémitisme et le racisme sont des faits. Où est l’obligation de toute autorité étatique de respecter et de protéger la dignité humaine ? Pire encore : les pouvoirs publics sont aveugles de l’œil droit depuis très, très longtemps, et malgré tous les avertissements et les catastrophes – NSU [i] etc. – depuis beaucoup trop longtemps.
Protéger la dignité humaine lorsqu’elle est attaquée : c’est un sujet typique qui provoque le détournement du regard, surtout dans certains organes de l’État. Au lieu de la protéger, on a dit que la migration était la mère de tous les problèmes. Beaucoup, beaucoup trop, détournent simplement le regard lorsqu’il s’agit de protéger la dignité humaine.
Les autorités manquent de personnel et sont débordées
Les autorités qui enquêtent sur l’extrémisme de droite et les violations de la liberté d’expression sur Internet manquent toujours de personnel et sont débordées. L’insulte n’est pas considérée comme un crime particulièrement grave et n’est donc pas une priorité pour les autorités chargées de l’application de la loi. Le constat d’infractions virtuelles sur Internet n’est pas une infraction pénale. Comment l’État entend-il s’acquitter efficacement de son obligation constitutionnelle de protéger la dignité humaine ? Ne faut-il pas en conclure qu’il y a un énorme déséquilibre et un besoin considérable d’action ?
Certains acteurs publics, politiciens, leaders d’opinion et responsables de notre pays semblent ne pas avoir encore compris que l’heure a sonné. Nous sommes en plein changement de normes au sein de notre démocratie, qui ne sera plus la même si nous laissons l’antisémitisme, le racisme et l’antiféminisme continuer à gagner du terrain, si la meute numérique, dirigée par ses gangsters intellectuels, est capable de cibler les gens comme des proies faciles, si des battues sont d’abord lancées sur Twitter et Facebook puis dans nos rues, et si les tempêtes de merde virtuelle sont suivies de la destruction réelle des vies. D’abord la langue, puis l’action. D’abord l’Internet, puis la rue. D’abord la fiction, puis le vrai meurtre. Ce n’est pas de la théorie. C’est la réalité en Allemagne à la fin des années 2010. Maintenant, nous allons vers les années 2020. Avec des feux d’artifice et de bonnes intentions. Un regard sur le passé, sur 100 ans, devrait également en faire partie et est plus qu’un simple rappel. « Les cerveaux sont embrumés, assombris », écrit dans son journal le social-démocrate Friedrich Kellner pendant la tyrannie nationale-socialiste. Aujourd’hui, voir une fois de plus dans notre pays des êtres systématiquement exclus, attaqués, blessés intérieurement et extérieurement ? Ce n’est pas possible. L’indignation ne doit pas s’épuiser dans des rituels et se limiter à la rhétorique de l’inquiétude dans les discussions de salon et les déclarations aux médias.
[i] NSU : Parti National Socialiste souterrain, auteur de plusieurs attaques de banques, de crimes racistes d’assassinats entre 1999 et 2011