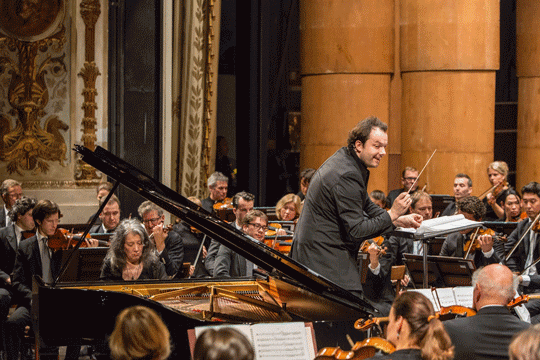Cet article est une adaptation-traduction de l’article paru le 20 août dernier dans Platea Magazine (Madrid) http://www.plateamagazine.com/criticas/1213-daniel-bareboim-martha-argerich-y-la-west-eastern-divan-en-el-festival-de-lucerna
C’est désormais un passage obligé. Chaque été, lors de la première semaine du festival, Daniel Barenboïm et son West Eastern Divan Orchestra donnent deux concerts entre les deux programmes du Lucerne Festival Orchestra, en cette première semaine généralement si riche. C’est cette année d’autant plus obligé que Daniel Barenboïm fête sa 50e année de présence à Lucerne (tout comme Bernard Haitink) puisqu’il a donné son premier concert le 25 août 1966, à la tête de l’English Chamber Orchestra. Il reviendra à Lucerne avec la Staatskapelle de Berlin le 10 septembre prochain pour un concert Mozart-Bruckner.
Les programmes des deux concerts étaient très différents : revenant à ses premières amours, le programme du 14 août était composé des trois dernières symphonies de Mozart (les n° 39, 40, 41) ; Barenboïm ces dernières années a moins dirigé Mozart dont il fut l’un des grands interprètes (notamment au piano, mais aussi à l’opéra) entre les années 60 et 70. Il est intéressant d’entendre son Mozart symphonique aujourd’hui. Le second programme, outre une pièce de Jörg Widmann, comprenait le concerto n°1 de Liszt (Martha Argerich au piano) et une seconde partie composée d’extraits de Wagner.
C’est donc un peu tout l’art de Barenboïm en modèle réduit qui nous était donné d’entendre ces deux soirs. Ayant entendu un peu de jours de distance Haitink, Jansons et Barenboïm, il est évidemment intéressant de voir ces trois personnalités si différentes sur le podium.
Trois musiciens exceptionnels et des trois, deux d’une discrétion légendaire et le troisième bien plus médiatique et exposé .
Daniel Barenboim paraissait un peu fatigué et amaigri, surtout grippé en ce 14 août, mais cela n’a pas empêché de montrer dans ces Mozart l’habituelle énergie. Des trois symphonies, la n°39 a été peut-être le moins réussie, ou la moins en place techniquement, avec des cordes un peu rugueuses et un rythme moins énergique. En revanche la n°40, avec son dialogue cordes-bois (et notamment de très belles clarinettes) l’a été beaucoup plus avec une touche de poésie et d’intériorité bienvenues. Les bois de toute manière ont été remarquables tout au long du concert. Évidemment, la n°41, « Jupiter » a emporté l’adhésion et l’enthousiasme du public, avec un deuxième mouvement tout à fait bouleversant, et des bois à se damner, notamment dans leur dialogue avec les cordes. C’est un Mozart qu’on a évidemment moins entendu ces derniers temps, un Mozart qui tire vers la symphonie romantique plus que vers l’espace baroque. Il y a là une énergie, une dynamique, une tension qui entraîne et emporte l’adhésion. Il y a dans cette vision quelque chose de théâtral au bon sens du terme, quelque chose de généreux aussi, jamais superficiel, qui fait partager l’émotion.
Le deuxième concert avait un programme encore plus attirant puisqu’à Daniel Barenboim s’ajoutait Martha Argerich. Tous deux souffrant probablement d’un refroidissement. La musique ne s’en est pas aperçue.
Le programme se composait de trois parties, « Con brio » de Jörg Widmann , une pièce de 2008 , le concerto pour piano n°1 de Liszt , et une seconde partie entièrement dédiée à Wagner , avec des extraits de Tannhäuser ,de Götterdämmerung et de Meistersinger von Nürnberg .
La première pièce était « Con brio » de Jörg Widmann, ouverture pour orchestre créée en 2008 sur une commande de l’orchestre du Bayerischer Rundfunk.
Mariss Jansons à l’occasion d’une intégrale Beethoven avait demandé à plusieurs compositeurs une pièce inspirée par Beethoven. C’est ainsi que Jörg Widmann a créé « Con brio », inspiré des septième et huitième symphonies, les plus alertes, les plus énergiques peut-être, celle où la sève coule sans doute avec le plus d’évidence. Widmann a composé un morceau très énergique et aussi raffiné en utilisant les instruments à la limite de l’audible, mais en même temps avec de belles couleurs et des citations habilement insérées, jouant sur les limites de la tonalité mais aussi sur la tradition, dans un jeu particulièrement passionnant.

Un début excitant, d’autant plus que le concerto de Liszt doit lui aussi beaucoup à Beethoven . La première à Weimar en 1855 avait été dirigée par Hector Berlioz, un autre admirateur éperdu de Beethoven avec le compositeur au piano. L’orchestre, fort, plein de relief, est parfois surprenant (utilisation du triangle dans le troisième mouvement qui intervient de manière affirmée entre orchestre et piano, qui était et reste une curiosité). Le final martial est scandé par un rythme très marqué par Barenboim: mais l’orchestre dans ce concerto sert de cadre spectaculaire à un piano ébouriffant confié à une Martha Argerich un peu fatiguée et un peu grippée, mais toujours magique dès qu’elle touche le clavier, pour le legato incroyable de naturel, pour la douceur du toucher et la fabuleuse précision du son. La virtuosité est ahurissante, qui s’allie à une simplicité apparente du jeu et à une extrême attention à l’orchestre: le dialogue avec la clarinette est un moment suspendu de ceux qui sont inoubliables. Tout sous ses mains semble facile et ne joue jamais sur l’effet : aucun effet sinon celui époustouflant du génie.

« Magique » Argerich offre en bis un duo à quatre mains avec Barenboim (Schubert) où la partie acrobatique est confiée à un Barenboim au raffinement, à l’élégance et à la fluidité inouïes. Une première partie qui laisse le public stupéfait et impressionné par tant de joie de faire de la musique et par un résultat pour le moins fabuleux .
On a supposé que la deuxième partie de l’ensemble était plus traditionnelle, tant le répertoire wagnérien est désormais attaché au nom de Barenboim. C’était sans compter sur l’enthousiasme de l’orchestre à jouer Wagner, qui semble le compositeur favori, pour lequel chaque musicien donne tout aussi bien dans les parties les plus grandioses que celles plus intimes. Les cuivres, sans scorie aucune, évidemment très sollicités, les bois fabuleux (Hautbois! Clarinette!) Et des cordes chaudes, rondes, moins raides que la veille dans Mozart (notamment la symphonie n ° 39, cf ci-dessus). Après une ouverture de Tannhäuser si dynamique, si fluide, si majestueuse en même temps, et si convaincante qu’elle déclenche l’enthousiasme immédiat de l’audience, Barenboim a enchainé avec deux morceaux de Götterdämmerung, avec en premier lieu la scène de Siegfried et Brünnhilde suivie du voyage de Siegfried sur le Rhin. Depuis le premier accord, Barenboim dessine un climat, une ambiance, un paysage qui installe le drame, le mystère, et en même temps nous plonge dans l’histoire: Barenboim ne fait pas du son pour le son, mais pour le drame: son Wagner entre immédiatement «in medias res» et quand il conclut la pièce par l’accord final qui ferme le monologue de Hagen, il réussit sans chanteurs, sans décor, sans théâtre, à nous montrer un paysage intérieur qui nous plonge dans l’histoire.

Puis il conclut avec la marche funèbre accompagnant la mort de Siegfried, tendue, spectaculaire comme un choc et en même temps retenue, intérieure, presque une méditation sur la mort. Un moment inoubliable.
Le programme se termine sur l’ouverture de Die Meistersinger von Nürnberg, chaleureuse, souriante, d’une précision de joaillier : on y peut tout entendre, tous les niveaux, tous les instruments, avec des moments retenus volontairement et d’autres plus expansifs. Barenboim n’est jamais démonstratif, jamais complaisant : son Wagner est naturel, fluide, et en même temps plein de relief; il met l’accent sur la couleur, qui, après le drame de Götterdämmerung ne nous propulse pas dans la comédie, mais dans l’humanité souriante, dans l’humanisme wagnérien et sa transcendante douceur
Magie.
Magie d’autant plus forte que le premier bis propose le prélude du troisième acte de Meistersinger : à la joie profonde succède la mélancolie, qui n’est pas la tristesse : l’interprétation est d’un tel raffinement, d’une telle justesse, d’une telle profondeur qu’on voit certains musiciens essuyer une larme. Comment pourrait-il en être autrement : nous sommes entrés dans les méandres d’un monde intérieur, d’un esprit saisi de doute, qui est exaltation de la sensibilité, qui est poésie pure. Les fleurs du beau.
Ensuite, pour satisfaire l’accueil frénétique du public, il conclut le concert alla grande avec le prélude de l’acte III de Lohengrin, triomphant, dynamique, joyeux, interprétation d’une incroyable jeunesse.
Un jeune chef de 73 ans nous a amenés au seuil de la jeunesse éternelle.[wpsr_facebook]