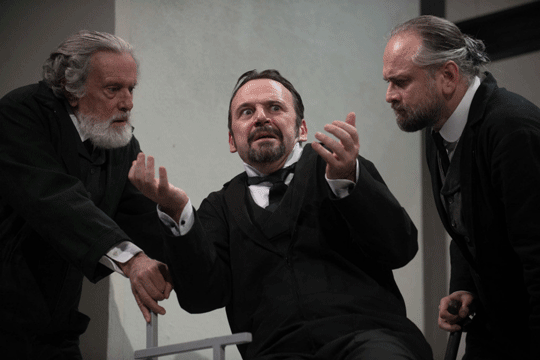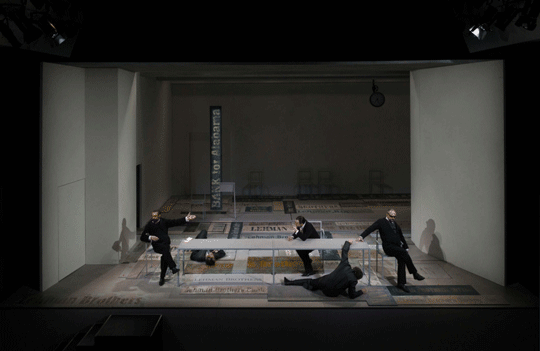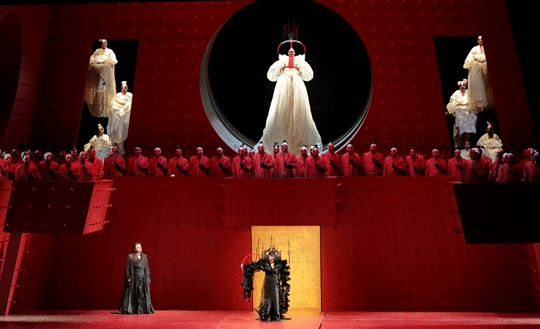Cette production de Lulu, alliant Dmitri Tcherniakov et Kirill Petrenko, était très attendue. Se demander si elle a tenu ses promesses, c’est déjà répondre…alors mieux vaut ne pas se le demander et se laisser porter vers l’ailleurs que cette production propose…
Au lendemain du spectacle, il trotte en tête. Beaucoup de spectateurs autour de moi sont sortis tendus. La dernière image et la fin «en suspension » saisit de surprise le public. Il est vrai que Lulu n’est pas si fréquent sur les scènes, même si ces dernières années on l’a vu en Europe dans plusieurs grandes salles, comme la Scala (mise en scène Peter Stein, en coproduction avec Lyon) ou à Bruxelles (dans le prodigieux travail de Warlikowski), voire à Oslo (dans la mise en scène circassienne de Stefan Herheim). L’œuvre est difficile musicalement et théâtralement. Depuis 1979, création de la version en trois actes par Pierre Boulez dans la production de Patrice Chéreau, il est clair que l’œuvre a conquis les scènes, alors que les productions restaient rares auparavant.
Il est d’ailleurs intéressant de voir comment Lulu est devenu, comme par exemple Die Frau ohne Schatten, un des must de notre temps lyrique, alors qu’il n’en a pas toujours été ainsi loin de là.
Lulu est un témoignage extraordinaire de la vitalité et de la liberté de création qui a marqué le début du XXème siècle. Si l’œuvre de Berg remonte à 1935, l’original théâtral de Frank Wedekind est de 1913, l’œuvre se présente comme une tragédie en 5 actes réunissant L’esprit de la terre (« Erdgeist ») et La Boite de Pandore (« Die Büchste von Pandora »), une « Monstretragödie » : la tragédie, comme on le sait, aime les monstres, de Phèdre à Médée, et Lulu s’en veut un avatar de ces héroïnes tragiques qui font les légendes et nos rêves ou nos cauchemars
Avec le volontaire double sens érotique de l’expression « La Boite de Pandore », l’allusion à un vagin « puits sans fond » qui ne demande qu’à être rempli sans jamais être rassasié, le sexe est ce qui fonde l’histoire de Lulu. Wedekind s’est intéressé très tôt à la sexualité, notamment dans sa première œuvre, l’éveil du Printemps, (1891) sur la sexualité adolescente.
L’autre composante de Lulu, à laquelle on pense moins, est la composante clownesque, ou circassienne, dont on a dans l’œuvre de Berg une trace au premier acte dans la présentation de la « ménagerie », qui rappelle non sans étonner le prologue de I Pagliacci, ou chez des personnages comme l’athlète. Wedekind a travaillé pour un cirque, le cirque Herzog, et a fréquenté le milieu parisien lié au Grand Guignol et à la Pantomime, héritée de l’univers de la Foire au XVIIIème, dont Lulu est tirée puisque le sujet est celui d’une Pantomime de Félicien Champsaur, « Lulu, roman clownesque » (1888).
Lulu « bête de foire » se rapprocherait alors d’œuvres littéraires ou cinématographiques qui ont pour thème l’univers forain. Lulu d’ailleurs a très tôt inspiré le cinéma (1929, Lulu de Papst) qui a marqué pour toujours le physique du personnage (la mythique Louise Brooks).
Mais là où l’on pense « univers des années 30 », c’est bien plutôt celui du « décadentisme » fin de siècle dans laquelle cette histoire prend ses racines.
Aussi faut-il lire et la mise en scène de Tcherniakov, et l’approche de Petrenko à ce prisme-là. Lulu, ou la tragédie décadente d’une bête de foire.

Je ne suis pas loin de penser que le décor (unique) conçu par Dmitri Tcherniakov lui-même soit une allusion claire à cette attraction de foire qu’on appelle le palais des mirages ou le palais des glaces, sorte de labyrinthe de verre dans lequel on se perd, et où l’on voit à l’infini les reflets des gens qui s’y perdent et des chemins (im)possibles pour en sortir. Et la ménagerie, c’est justement cette humanité perdue dans le labyrinthe, dont le sexe est la seule issue, un sexe ciment du couple vécu dans la violence, la possession, la bestialité et jamais la tendresse.

Dmitri Tcherniakov, travaille volontiers sur les destins, les figures, les individus ; on l’a vu dans son Macbeth, on l’a vu aussi dans sa Traviata, voire dans son Parsifal où il isole trois destins centraux (Amfortas, Parsifal, Kundry) .Il a résolument décidé de travailler Lulu en dehors de tout contexte historique ou temporel, au contraire de ce que faisait Peter Stein ou même Patrice Chéreau : il concentre le propos sur la manière dont Lulu met les hommes à genoux et à nu, et sur la bête dont on va observer les mœurs et le parcours, Lulu, dont les noms changent pendant la pièce, elle est Eva, elle est Mignon, elle est Nelly, elle est une « namenlose » (comme Kundry) une figure, une idée (l’idée de la femme, comme l’évoque son portrait, non pas un vrai portrait monumental comme on le voit la plupart du temps, mais une silhouette peinte sur le plexiglas qu’on efface facilement, dans laquelle les uns ou les autres (à commencer par le peintre et à finir par Geschwitz) sont vus en transparence et qui va rester tout au long présente de manière obsessionnelle. Car Lulu n’existe pas, elle est ce que les autres projettent en elle, elle est les autres, et n’est que trace, que silhouette, que trait effaçable.

Toute l’action va se concentrer sur un espace scénique réduit, conséquence de la présence envahissante du « palais des glaces » qui sert d’arrière plan pendant les scènes, et revient au premier plan pendant les intermèdes, où les autres, la ménagerie présentée au départ (des couples d’une banalité très étudiée), vont tour à tour s’aimer, danser, se heurter, se battre aussi, se détruire pour finir au troisième acte presque fossilisés, en sous-vêtements, hommes et femmes à terre ou debout, des vivants-morts au milieu desquels Lulu cherche ses clients.
Il ne faut pas chercher dans ce travail un quelconque spectaculaire ou des moments qui seraient esthétiquement séduisants, pas de clair de lune bouleversant ou d’escalier monumental comme chez Chéreau, mais un espace vide, et transparent ces cloisons de plexiglas, et des reflets, reflets des gens, reflets de l’orchestre, reflets du chef, reflets de la salle travaillés selon les éclairages, qui seuls, changent. Le monde comme un reflet, et non plus comme une réalité, le monde sans épaisseur, réduit à des images vacillantes.

Au premier plan, sur un espace réduit : le jeu, les personnages, les conflits, le sexe et la violence. Avec une Lulu qui va être pendant l’essentiel de l’opéra de blanc vêtue (costumes volontairement neutres d’Elena Zaytseva, qui mettent par contraste en valeur ce que porte Lulu) : blanc de pureté ? Certes non, mais de ce blanc dont on voit souvent les vedettes du cirque qui attirent la lumière ; elle finit d’ailleurs (comme Kundry) en combinaison légère et tout le costume du troisième acte oscille entre le mythe (avec sa toque, au lever de rideau de l’acte III, elle m’a fait penser à Marlene Dietrich) et le cirque (la même toque pourrait faire partie d’un costume de cirque). Mais quelle que soit la situation, que Lulu soit en majesté ou qu’elle soit en déréliction, ceux qui en ont fait le centre de leur cercle et de leur univers continuent de la suivre.

Tcherniakov a d’ailleurs composé une magnifique image de cette dépendance, de cette addiction de tous ceux qui ne peuvent s’en passer regroupés autour d’elle et cherchant à la toucher, comme en un tableau religieux.
Tcherniakov a insisté sur les rapports entre les différents personnages, empreints de violence et de tension, la mort du peintre, égorgé et christique derrière le portrait en transparence de Lulu qu’il a lui même peint en est un exemple, mais bien entendu aussi la mort de Schön, qui survient presque par hasard, mais qui est amenée par la dégradation des rapports entre Schön et Lulu après leur mariage.
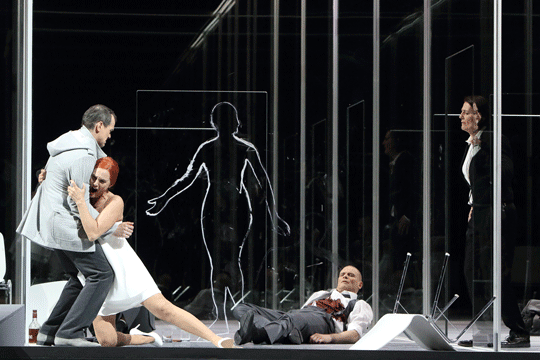
Schön passe du statut de père/souteneur, de sugardaddy à celui de mari : le couple tue la relation, faite désormais de soubresauts de violence et de sexe, et d’une féroce jalousie qui voit surgir de partout des amants potentiels, avec des scènes de vaudeville, comme lorsque le Gymnasiast sort de sa cachette sous les chaises, ou de tragédie, comme lorsque Schön découvre son fils Alwa avec Lulu, qu’il l’entraîne en arrière scène et qu’il le frappe violemment (les cloisons de plexiglas permettent de tout voir) . Le travail sur l’évolution de cette relation, sur le personnage de Schön, même, magnifiquement incarné par Bo Skovhus, à qui ce type de rôle convient particulièrement, est d’une très grande crudité et en même temps d’une très grande précision.
Le personnage de Geschwitz est aussi très étudié, une Geschwitz jeune, ce n’est pas si habituel, à la voix triomphante et claire (une Daniela Sindram exceptionnelle), à la fois acceptée et rejetée, errante et présente.
Chaque personnage est caractérisé de manière éminente, précise, si le Medizinalrat est vite éliminé, le peintre est merveilleusement dessiné, assoiffé d’amour, assoiffé de Lulu, mais aussi bien l’Athlète, un personnage vieilli, aux muscles défraichis (excellent Martin Winkler), que l’étrange Schigolch (donné cette fois à un chanteur mur mais pas âgé comme souvent – à la Scala c’était Franz Mazura), sorte de vagabond, de voyageur qui surgit avec ses lunettes de voiture sur le front (Pavlo Hunka): tous composent une véritable ménagerie, c’est à dire des typologies presque animalières qui apparaissent et disparaissent dans ce palais de verre qui semble quelquefois une cage d’où ces animaux dénaturés ne sortent pas.
Il semble d’ailleurs que si le deuxième acte m’est apparu musicalement le plus impressionnant, c’est le troisième acte qui du point de vue scénique est peut-être le plus convaincant.
La scène initiale, le salon parisien, semble être une sorte de fantasme de Lulu, au premier plan assise, pendant que les autres personnages au second plan en rang d’oignon conversent ou du moins lancent leurs répliques, comme si Lulu se souvenait, ou qu’elle rêvait. En tous cas elle est absente, elle est ailleurs, elle a dépassé ce moment, elle est déjà au-delà : du coup, tout ce qui pourrait être anecdotique, romanesque ou même vaudevillesque comme le changement de costume, ou les réactions des personnages à l’annonce que les actions de la société de la Jungfrau se sont écroulées, voire les menaces mêmes du marquis (excellent Wolfgang Ablinger-Sperrhacke), tout cela semble laisser Lulu indifférente.

Tout ce beau monde, pendant l’intermède musical qui suit entre les deux scènes, se déshabille pour composer une humanité (?) figée, seul décor des bas fonds de Londres, au milieu de laquelle Lulu va chercher ses clients.
Ses compagnons, Schigolch, Alwa, Geschwitz errent pendant que Lulu cherche ses clients, comme des sortes de fantômes, encore une fois d’animaux assoiffés. Tcherniakov fait défiler les clients, et la violence s’accroît (le premier fuit, le second, le nègre, tue Alwa) sans que la scène change de nature ou qu’il se passe vraiment quelque chose. La meurtre d’Alwa par exemple semble être un moment ordinaire…tout passe et Tcherniakov réussit parfaitement à marquer le refus de l’événementiel comme si tout valait tout, ou plutôt que toute valeur avait délaissé ce monde.
La rencontre avec Jack l’Eventreur cependant n’est pas traitée selon l’habitude. Ici, Lulu trouve le poignard dans la poche de son client, le regarde et se tue, un peu comme Tristan avec Melot. Elle reconquiert ainsi sa mort, plutôt que d’accepter celle anonyme des prostituées de Whitechapel. Elle reconquiert en même temps, dans la déchéance la plus totale, sa grandeur d ‘héroïne tragique et son propre destin. Celle qui au contraire tombe, c’est Geschwitz, qui a tout donné, argent, liberté, amour, qui n’a rien reçu sinon le coup de poignard de Jack l’Eventreur et qui en une ultime image aussi déchirante que vaine, s’approprie le corps sans vie de Lulu dans une étreinte ultime, pendant que les dernières notes s’égrènent, presque en suspension, interrompues par le silence et le noir final qui surprennent visiblement le public.
Voilà un travail surprenant, dispositif unique, espace réduit, motifs récurrents : il n’y a plus rien des ambiances différentes, l’atelier du peintre, le salon de Lulu, la maison de Schön, le salon parisien, les bas fonds de Londres. Plus de lieux sinon un seul qui est le lieu tragique, cet espace permanent rempli par quelques chaises, disposées autant que de besoin, et dans lequel tout se passe. Tcherniakov a opté pour la concentration, il a opté aussi pour le théâtre, en s’appuyant visiblement sur les sources théâtrales. Il bâtit plus une pièce de théâtre musicale une tragédie avec musique qu’un opéra. La précision du jeu, les trouvailles dans les relations entre les personnages, la caractérisation de chacun, tout montre un vrai travail sur le texte, très attentif, millimétré et en même temps inattendu.
J’ai lu plusieurs fois que ce travail était raté, fait à la va vite, voire bâclé. On peut ne pas partager cette option au total assez minimaliste (à l’opposé d’un Py à Genève par exemple) mais tellement forte, tellement concentrée, tellement tendue et préférer d’autres travaux de Tcherniakov, mais qu’on ne dise pas qu’il a bâclé son travail.
Un metteur en scène digne de ce nom – comme l’est Tcherniakov, ne peut bâcler une Lulu, même s’il peut la rater. Mais ce n’est pas le cas : au lieu de faire une fresque une parabole mythique, il a travaillé là au millimètre, en respectant le livret sans jamais s’en écarter. C’est loin de tout ce qu’on a pu voir jusque là, et surtout ce n’est pas forcément à la mode. Ça gène forcément le consommateur…
Avec ce travail très hiératique en somme, sans complaisance et sans lustre, avec cette vision sèche, noire, désespérante pour l’humanité ambiante, Kirill Petrenko lui aussi surprend. On retrouve bien sûr ses qualités habituelles de précision et de netteté. On entend tout, chaque moment est accompagné, contrôlé, dominé. Et d’abord le volume, très contenu, très maîtrisé, qui fait de bien des moments un opéra de chambre. Il y a quelque chose du concerto à la mémoire d’un Ange dans cette manière d’aborder le son et de l’ adoucir à l’extrême. Malgré ce concerto à la mémoire de Lulu, plus intimiste, plus contenu, Petrenko ne renonce pas à souligner l’extraordinaire variété des couleurs de cette musique. Il choisit les intermèdes musicaux, plus spectaculaires (y compris scéniquement) pour mettre en valeur l’orchestre et les aspects les plus symphoniques, mais aussi les sources et les échos de cette musique, qu’il souligne en dirigeant à dessein ici comme Strauss, là comme Wagner. Jamais on avait entendu Lulu sonner comme les grands anciens ou les grands modèles, il y a des moments où les violons tremblent et vacillent comme dans certains instants straussiens, il y a des moments où cela sonne comme dans Salomé, il y en a d’autres où l’on se dit que Wagner est là, tutélaire. Et cette diversité d’ambiances, elle se conjugue avec les moments plus habituels chez Berg, plus “seconde école de Vienne”, comme si défilaient en une symphonie de couleurs diverses, de reflets scintillants, cinquante ans de musique et d’ombres portées.
Car ce qui m’a frappé dans cette direction, c’est qu’elle est très diverse, très miroitante de couleurs, de différences de volumes, d’accents, d’insistance sur certaines phrases, de refus du lyrisme là où l’on s’y attend, d’une froideur glaçante par moments, d’un lyrisme époustouflant inattendu à d’autres : Kirill Petrenko a su rendre justice à l’ensemble d’une partition incroyablement riche (certains soutiennent, et peut-être n’ont-ils pas tort que Lulu est supérieur à Wozzeck), d’une très grande complexité, et c’est cette diversité et cette complexité qu’on entend ici, comme rarement on les a entendues.
Bien entendu, Petrenko triomphe, comment pourrait-il en être autrement, mais il triomphe parce qu’il a su par la tension insufflée à la musique correspondre à la tension scénique, il a su rendre ce qu’il y a de grand, ce qu’il y a de pittoresque, ce qu’il y a de petit et médiocre sur scène, en faisant de l’orchestre à la fois un protagoniste et un accompagnateur, il a su donner une incroyable variété à sa lecture, qui est tout sauf monolithique ou unidirectionnelle. Il est suivi par un orchestre comme souvent impeccable, aucune scorie ce soir avec des cordes incroyables de précision, des bois presque électriques, et un ensemble parfaitement au point mais aussi et cela s’entend, parfaitement habité, qui dessine un paysage, une ambiance, un univers. C’est grandiose, et en même temps comme toujours avec Petrenko d’une unité étonnante avec ce que l’on voit : ce qu’on voit sur scène, on l’entend en fosse. L’oeil écoute et l’oreille voit.
Mais Petrenko est un vrai directeur d’opéra et il accompagne avec une attention presque tatillonne chaque chanteur et un plateau complètement soumis à la fosse : il dispose de chanteurs acteurs exceptionnels qui se donnent en scène d’une manière définitive, et doit, pour leur permettre de jouer en toute liberté, d’être d’une attention totale pour qu’ils se sentent en pleine sécurité.

Il n’y a pas grand chose à redire sur le plateau réuni, fait comme souvent à Munich de nombreux membres de l’excellente troupe : Christian Rieger (Medizinalrat, Bankier, Professor) Heike Grötzinger, Christof Stephinger, ou Rachael Wilson, belle figure du Gymnasiast ou du Groom : on retrouve même dans les petits rôles Cornelia Wulkopf, qui fut de la troupe de Munich, mais surtout du Ring de Chéreau depuis 1977.
Rainer Trost dans le peintre (et le nègre) rappelle qu’il fut un temps l’un des ténors mozartiens les plus en vus, l’un des espoirs du chant mozartien. La voix est claire, l’émission parfaite, la diction exemplaire; l’Alwa de Matthias Klink, très sollicité scéniquement, n’a pas tout à fait la même suavité vocale, mais une sorte de force qu’on n’a pas l’habitude d’entendre. Je me souviens d’Alwa plus « caractérisés », ténors de caractère à la Kenneth Riegel : l’Alwa de Klink est plus naturel, plus présent aussi et très engagé dans le jeu. C’est vraiment une belle performance.

J’ai déjà évoqué Bo Skovhus, avec sa voix irrégulière, quelquefois triomphante, et des aigus tenus, avec un certain éclat même, et des trous, des moments où cette voix disparaît. Mais au-delà de la technique, il y a une interprétation. Skhovus sait habiter ses rôles et il n’est jamais aussi bon que dans les personnages tiraillés, contradictoires, étranges. La performance est à la hauteur, il incarne un Schön nerveux, affectueux quelquefois, un Schön plus engagé que certains interprètes qui soignent plutôt le parallèle avec Jack au troisième acte, que Tcherniakov refuse (alors que Chéreau le marquait). Franz Mazura avec Chéreau a marqué le rôle, distant, froid, élégant, tout de violence rentrée. Skhovus ici est plutôt extraverti, plutôt démonstratif, et surtout très humain.
J’ai entendu rarement Daniela Sindram, et elle m’avait marqué dans le Rienzi de Bayreuth en 2013, où elle chantait Adriano. Elle est une Geschwitz jeune, passionnée et désespérée. Là aussi s’impose la comparaison avec une Yvonne Minton, chez Chéreau, une Geschwitz plus mûre, plus intérieure (on verra ce que fait dans Geschwitz Jennifer Larmore, magnifique choix, dans la Lulu d’Amsterdam en juin): je me souviens, j’ai encore dans l’oreille sa dernière réplique, sorte de lamento désespéré « Ich bin dir nah, bleib dir nah, in Ewigkeit »: comme Minton disait « Ewigkeit », jamais aucune Geschwitz que j’ai pu voir depuis ne l’a dit. Pas plus Daniela Sindram. Mais elle a d’autres qualités, de jeunesse, d’engagement, avec une voix fraiche et triomphante et des aigus incroyables de puissance. Geschwitz n’est pas un rôle de travesti et ne peut être joué comme un travesti, même si elle s’habille en homme, c’est un rôle de femme qui doit garder quelque chose de la féminité. C’est pourquoi je préfère que les metteurs en scène habillent Geschwitz en femme, et non en homme comme c’est le cas ici ; je trouve que cela complexifie l’interprétation et distancie un peu trop. C’est en tous cas un rôle passionnant, et sûrement le plus douloureux de l’opéra. Peut-être Sindram, qui du point de vue vocal est excellente, gagnerait à faire mûrir le rôle en elle, même si son dernier geste est sublime d’émotion et de justesse.
J’avais écouté Marlis Petersen au début de la saison en Susanna avec Levine à New York, elle y était délicieuse, et surtout elle laissait voir l’ambiguïté du personnage sa fraicheur et sa rouerie. Dans Lulu, c’est encore mieux. C’est un rôle qu’elle sculpte et qu’elle habite. Ce n’est pas la première fois qu’elle le chante, mais on sent le travail qu’elle a mené avec Tcherniakov, par l’engagement et la conviction qu’elle y met. Comme Kampe dans Kundry (on aura compris par mes lourdes allusions que je trace des ponts entre les visions de ces deux rôles par Tcherniakov…), elle se jette à corps perdu dans le rôle, tout à tour élégante, distante, terrible, livrée à toutes les addictions, et notamment sexuelles, bestiale aussi. Magnifique bête de cirque, jusqu’au bout, elle délivre une interprétation de très haut niveau, étonnante à bien des points de vue.

La qualité des moments parlés et la justesse du ton montrent qu’elle fait du théâtre, qu’elle dit son texte comme au théâtre. Il y a là une vérité, des accents, des couleurs, des partis pris qui frappent. Vocalement, c’est un peu plus irrégulier, mais le rôle est terrible, à cheval entre le soprano colorature (Dessay y a pensé, sans jamais avoir le courage ou l’audace de s’y jeter) et le soprano lyrique. Marlis Petersen est un colorature, elle en a le répertoire, mais la voix a plus de corps que chez certains colorature : elle peut chanter Donna Anna, toutes ne le peuvent pas. Il faut avoir une voix suffisamment corsée pour dominer l’orchestre, même si Petrenko retient le son. Marlis Petersen a les qualités et elle tient ses aigus d’une manière étonnante, même si certains notamment au troisième acte semblent être à la limite et même si les réserves semblent quelquefois épuisées : mais ce n’est jamais crié, c’est toujours chanté, avec un vrai contrôle du chant. Marlis Petersen, originaire de Souabe, a découvert l’opéra à Pforzheim : un lieu comparable en France est improbable, mais c’est la vertu de la province allemande d’avoir des théâtres dans les villes improbables. En France, dans les villes comparables, on étrangle les théâtres comme à Chambéry, parce qu’apporter la culture à la population, c’est, n’est-ce pas, inconcevable, que dis-je, pornographique !

Or donc, revenons à Marlis Petersen pour affirmer qu’elle dépasse de loin les Lulu actuelles, même si Patricia Petibon est aussi une Lulu qui compte aujourd’hui. Et même physiquement, grande, bien plantée, avec une vraie silhouette, elle change de l’image de petit oiseau fragile qu’on a pu avoir quelquefois (que Stratas, la géniale Stratas avait su développer, ou même Christine Schäfer, autre magnifique interprète du rôle). Cette Lulu là comptera et ce n’est pas un hasard si le public munichois rappelle sans fin et Kirill Petrenko et Marlis Petersen, ce sont les piliers de la soirée.
Une soirée qui m’a séduit musicalement et marqué scéniquement, plus que je ne le pensais en sortant du théâtre: c’est le signe que quelque chose fonctionne et que ce qu’on y voit marque de manière presque subliminale. Dmitri Tcherniakov a résolument opté pour un travail plus épuré et à la fois plus « théâtral », très fouillé et intelligent et très différent de ce que j’ai pu voir ces dernières années (Py, Herheim, Stein) , avec moins de profusion, moins de spectaculaire, moins de contexte, mais peut-être plus de profondeur, plus de cruauté, plus de lacération. C’est vraiment une très grande réussite dans la conduite des acteurs, qui par sa rigueur mène à l’émotion et il est étonnant que deux mois après avoir travaillé sur Parsifal et de quelle manière, il nous emmène à la fois ailleurs, dans un style radicalement autre, tout en faisant sentir quelles lointaines parentés il trouve entre les deux personnages féminins sur lesquels il a travaillé et avec quelle maestria : Kundry et Lulu…
Rendez-vous sur Staatsoper.tv (le streaming du Bayerische Staatsoper : https://www.staatsoper.de/tv.html) le 6 juin prochain, mais aussi prochainement sur ARTE.
[wpsr_facebook]