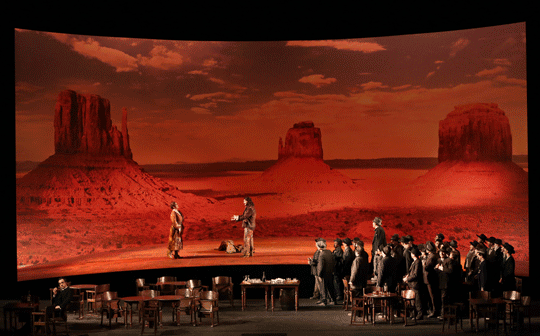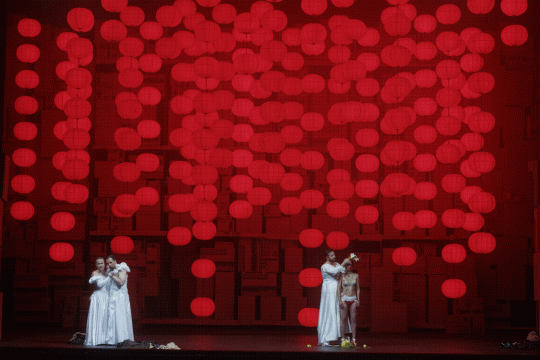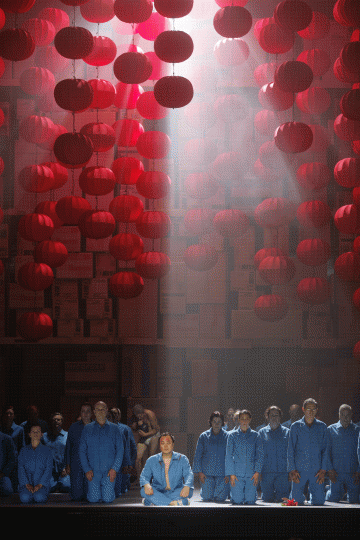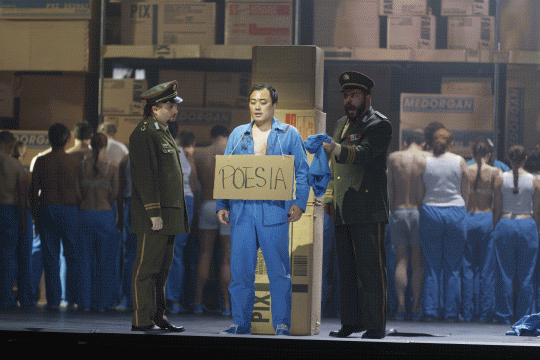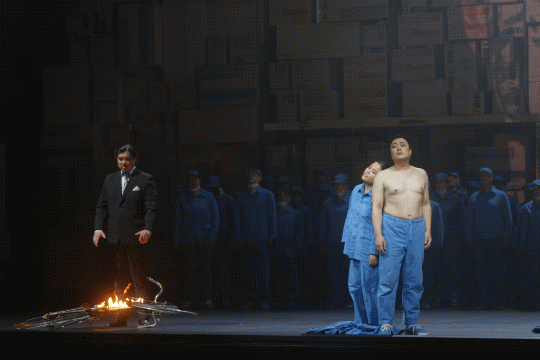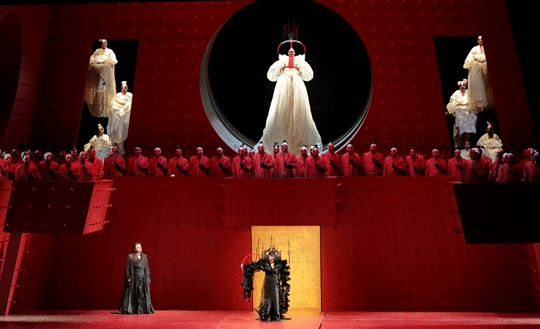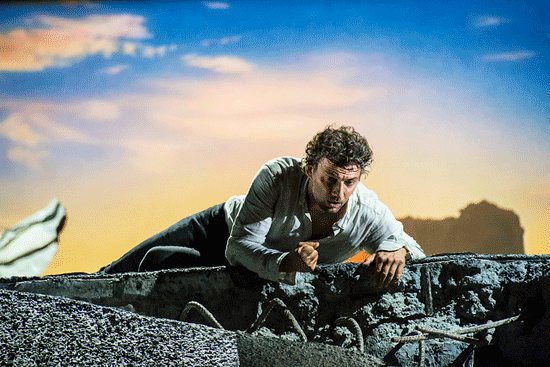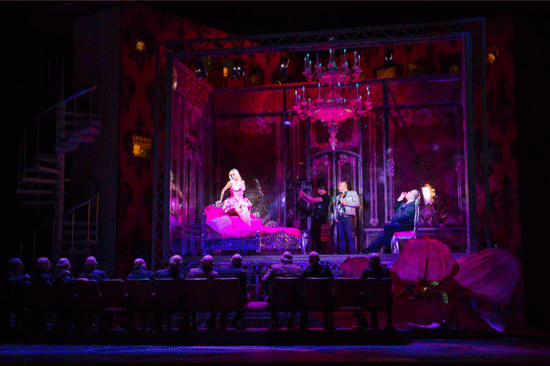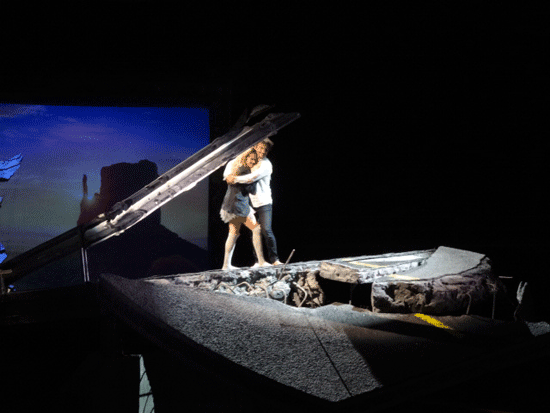Toutes affaires cessantes, j’interromps l’écriture de deux autres articles pour rendre compte encore à chaud de ce qui a été vécu hier soir à Munich. Cette Tosca , reprise d’une production de 2009 de Luc Bondy créée au MET et coproduite par la Scala et Munich où elle fut représentée en 2010 a fait son temps, et les multiples coproductions si elles sont efficaces économiquement, donnent l’impression de voir partout le même spectacle. Bondy avait fait un travail classique, plutôt élégant, dans des décors de Richard Peduzzi qui rappellent un peu le style de son Elektra (avec Chéreau) ou de son Tristan (toujours avec Chéreau), un travail quand même un peu passe partout, innovation pour le MET (où il fut hué) et plutôt passepartout pour les autres théâtres. Le premier acte, plutôt que Sant’Andrea della Valle semble se passer dans une salle des marchés de Trajan ou de la Domus Aurea, un espace impérial repris par le christianisme pour en faire une église. Je renvoie à mon article sur la Tosca du 20 septembre 2014 à Munich, avec Harteros.
Un monde essentiel, sans décorations, géométrique et sombre, un monde glacial. Ce qui reste de la mise en scène reprise par Johannes von Matushka, ce sont quelques beaux mouvements, un acte II très bien conduit et construit, des éclairages intéressants de Michael Bauer, juste de quoi assurer pendant quelques années encore des reprises propres.
Mais personne ce soir ne venait pour la production de Luc Bondy, car pour cette ouverture du Festival de Munich 2016, Bachler avait concocté une reprise de choc, en appelant la fleur des chanteurs munichois et son directeur musical Kirill Petrenko, faisant son entrée alla grande dans un Festival où il n’a jamais dirigé depuis son entrée en fonction (Bayreuth oblige les années précédentes). Si Bachler voulait afficher la santé insolente de sa maison, il a pleinement réussi son coup. Pas une Tosca dans le monde n’arrive à la cheville de ce que nous avons entendu hier. Il faut remonter sans doute aux grandes années de la Scala (entendez, les années 50/60) pour retrouver pareille réussite. Pour ma part, pour qui Tosca n’est pas l’œuvre de Puccini que je préfère, et j’ai encore en oreille celle de Paris en 1984 (Conlon, Behrens, Pavarotti, Bacquier, dans une production de Jean-Claude Auvray sans grand intérêt créée en 1982 avec Ozawa). Mais on en a vu tant et tant qu’il est difficile d’en extraire une série marquante. Tosca fait partie de ces œuvres, comme La Bohème, qui remplissent les théâtres, pour lesquelles on affiche une vedette et quelques bons chanteurs sans forcément avoir le chef idoine, mais qu’importe puisqu’on ne vient pas pour le chef…
Lorsque distribution et chef affichés promettent un moment d’exception, alors il faut accourir. Et c’est bien le cas de cette Tosca munichoise reprise pour trois représentations, avec les stars maison Anja Harteros et Jonas Kaufmann, et Kirill Petrenko qui ne l’avait pas dirigé depuis 2013 (où il avait remplacé le chef prévu malade), ainsi qu’un Scarpia d’exception le gallois Bryn Terfel.
Ce fut plus qu’une grande représentation, ce fut un miracle qui montre ce que peut-être Puccini, ce que peut-être l’opéra italien quand il est défendu, incarné dans l’urgence de ses brûlures. Rien à dire ni redire, sinon l’admiration éperdue pour le travail et pour l’engagement des chanteurs et de l’ensemble des protagonistes.
Jonas Kaufmann, à peine remis de son Lied von der Erde 48h auparavant à Paris fait taire tous les chichiteux et tous ceux qui prédisent la fin prochaine de sa carrière. Déjà ses Meistersinger avaient montré l’état éclatant de sa voix et son intelligence scénique. Les bruits de son récent Mario viennois (avec Angela Gheorghiu) avaient traversé les frontières. A Munich cependant il n’a pas bissé E lucevan le stelle, d’ailleurs Kirill Petrenko n’en laisse pas le choix, enchainant avec la suite sans respiration, et empêchant les applaudissements.
Des rôles italiens de Kaufmann, desquels je ne suis pas toujours convaincu, Mario Cavaradossi est sans doute celui, depuis des années, où il réussit le mieux. Son timbre sombre, son sens dramatique conviennent bien à ce rôle. De plus, en l’espèce, la production de Bondy a été créée avec lui, il en connaît les éléments et a travaillé avec Bondy, ce qui lui donne cette aisance alerte et ce naturel, particulièrement au premier acte dans les premières scènes avec Tosca. Il a été confondant, dès les premières mesures, dès Recondita armonia à la fois sculpté, modulé, éclatant de santé, avec un jeu sur les paroles, sur les sons, sur les mezze voci calculées, qui en fait, malgré l’éclat attendu, un chant intérieur…son Vittoria du deuxième acte est extraordinaire de puissance et de sûreté, avec un jeu et des échanges avec Tosca d’une vivacité et d’une tension notables, quant à E lucevan le stelle au début du troisième acte, aidé par un Petrenko au sommet qui prépare à l’orchestre la méditation, brûlante de passion (o dolci baci languide carezze..) et complètement intériorisée, rappel de la relation érotique forte entre Tosca et lui, mais scandant en même temps la fin du bonheur. Il faut donc y lire à la fois la passion et le désir, mais aussi la mélancolie, la nostalgie du temps passé, être ravagé de l’intérieur et presque pacifié…tout et son contraire. D’ailleurs Puccini prépare l’affaire musicalement par un prélude avec cette voix de berger (un merveilleux garçon du Tölzer Knabenchor) accompagné par des cloches à vaches (ou à brebis) qui sonnent discrètement dont on sait où Puccini a puisé son inspiration…Etrange début très bucolique, très apaisé, dans une œuvre où domine l’urgence et où Petrenko joue sur les contrastes avec une fluidité époustouflante, enchaînant le bucolique avec le dramatique sans jamais jouer sur le pathétique ; unique car ainsi l’approche méditative de Kaufmann se justifie. Voilà avec quelle intelligence on travaille, même avec un temps de répétitions minimal dans ce théâtre de répertoire qui préparait en même temps une première attendue de La Juive.
Il faut alors entendre le solo de violon et le jeu des cordes précédant le monologue, léger et tendu tout à la fois, avec la reprise aux bois du thème de l’air, presque murmuré, avec un jeu sur les inflexions vocales tourneboulant, chaque parole étant dite sur un mode différent, et un crescendo du volume sans jamais forcer, sans jamais donner dans le pathétique, dans l’insistant, dans le démonstratif, c’est l’intelligence du chant à l’état pur, celle de la voix qui ne se met jamais en représentation, mais qui sert un dessein dramatique. Prodigieux. C’est aussi du tressage voix orchestre, de l’incroyable jeu des instruments et de la voix que naît l’impression miraculeuse produite par cet air. Et ce qui frappe enfin, c’est le passage à la musique plus claire, plus positive, qui correspond à l’arrivée de Tosca, sans un silence, dans un continuum, qui semble naturel et qui multiplie la diversité des couleurs. Et de cet enchaînement naît évidemment l’urgence de la rencontre qui est rencontre érotique, avec un duo éblouissant d’intelligence du texte et du chant, et d’une musique qui fait apaisement et légèreté, pour exploser dans les dernières minutes dans un maelström sonore (les percussions !), en une alternance apaisement-urgence et drame qui démultiplie la force dramatique.
Bryn Terfel était Scarpia, un Scarpia qui a remporté un phénoménal succès, même si la voix m’est apparue quelquefois en-deçà de ce que nous savons de lui, et quelquefois couverte par un orchestre particulièrement virulent au premier acte : un premier acte qui se termine par un Te Deum remerciant Dieu de la victoire contre Napoléon à Marengo, premier message fallacieux qui déchaine le désir de vengeance de Scarpia. Au deuxième acte, il compose un personnage vulgaire et assoiffé de désir, peu « éduqué », une sorte de brute (comme le Méphisto qu’il fit naguère à Paris dans La Damnation de Faust), et l’effet scénique est garanti, face à une Tosca d’une violence désespérée. Terfel a une présence et un charisme impressionnants, et son deuxième acte est mémorable. La voix, même si elle a perdu un peu de son bronze si caractéristique, reste présente, puissante, expressive. Peu de chanteurs savent dire un texte et le rendre clair et expressif comme lui, et c’est un vrai plaisir que de l’entendre dire la langue italienne avec cette vérité. Toutefois, et c’est une affaire de goût car sa prestation scénique était exceptionnelle, j’ai une préférence pour les Scarpia de style « grand seigneur ». Certes, Bondy souligne à plaisir le côté « satyre immonde » de Scarpia (l’expression est de Sardou, je crois), le côté « être de désir », comme le dit d’ailleurs le texte du livret au deuxième acte : bramo. La cosa bramata perseguo, me ne sazio e via la getto (« je désire. La chose désirée je la poursuis, je m’en rassasie, et puis je la jette ») , sorte de credo à la Jago qui ouvre le deuxième acte. Ce côté désir sauvage, Terfel le rend parfaitement. Mais mes souvenirs me conduisent à des Scarpia comme Thomas Hampson en septembre 2014 , ou Sherill Milnes, formidable de froideur glacée, ou surtout Gabriel Bacquier, l’un des plus grands Scarpia des années 60/80, élégant et racé, mais glacé, mais terrible. Il y a chez Terfel comme une fragilité masquée. Terfel, c’est peut-être Tartuffe déchainé, et Bacquier ou Milnes, c’était l’Onuphre de La Bruyère, celui qui n’est jamais pris au piège.

Enfin Anja Harteros. On lit tout est son contraire sur Anja Harteros. Pour ma part, à chaque fois que je l’ai vue en scène (assez souvent quand même malgré ses célèbres annulations), dans Tosca, Traviata, Desdemona, Amelia, Leonora, Eva, Elsa, Marschallin, Arabella notamment, elle ne m’a jamais déçu, même si elle n’a pas toujours déclenché l’enthousiasme délirant de sa présente Tosca. J’avais déjà vu sa Tosca face à Thomas Hampson sur cette même scène et donc dans cette mise en scène et j’y renvoie le lecteur , mais j’avais à l’époque écrit qu’elle criait certains aigus au premier acte…Rien de tout cela aujourd’hui, la prestation est impressionnante, car elle rend totalement le personnage, excessif aussi bien dans la colère que dans la douceur, passant de l’un à l’autre avec une sensibilité exacerbée : Tosca n’est pas un personnage équilibré, c’est une tigresse, c’est une chatte, c’est une sensuelle, c’est une dévote, et dans chacune de ses facettes, elle est extrême : il n’y rien d’équilibré ni de placide. Quand la Tebaldi avait abordé le rôle, on lui avait reproché sa placidité. Il faut de la folie, de l’exagération, du tutta forza et du tutta dolcezza. En ce sens, l’orchestre puccinien dans Tosca est métaphorique de son personnage éponyme et doit rendre ce déséquilibre. Les forte dans Tosca (indiqués tutta forza pour les accords initiaux) n’ont rien à voir avec ceux de Turandot ou de Bohème, ils doivent refléter ce monde binaire de Tosca, toute force et engagement, ou toute douceur et sensualité. Et Harteros est ce personnage, haletant, alternant aigus triomphants et tenus, et moments de retenue et de douceur, bouleversante au second acte, qui a fait dire à certains (dont des connaissances italiennes qui l’avaient vue dans leur jeunesse) « c’est Callas »…On se gardera des évocations, même s’il est clair que la cantatrice allemande (d’origine grecque) joue habilement de sa lointaine ressemblance, avec des attitudes quelquefois calquées sur certaines photos. Il reste que la voix est d’une éclatante santé, que la diction et le phrasé italiens sont impeccables. Rarement une Tosca a montré une telle intensité, une telle vérité, une telle aisance ces dernières années, sans aucun geste surjoué, avec un naturel confondant et une adéquation geste, texte, musique à tomber.
Son vissi d’arte, avec ses notes tenues sur le souffle, avec sa respiration au service de l’expression, avec sa manière de tenir les notes en modulant, est vraiment pétrifiant. Et pour une fois, la mise en scène aide, avec ce début, étendue sur le canapé, comme le dit la didascalie du livret Affranta dal dolore, si lascia cadere sul canapé (brisée par la douleur, elle se laisse tomber sur le sofa) et non à genoux comme la tradition l’a établi (on appelait dans ma jeunesse le vissi d’arte « la prière de la Tosca »). Ce que fait Harteros est pour moi unique, car elle allie de manière exceptionnelle la science du chant, la vérité de l’expression, et la présence scénique. C’est la Tosca du moment : je ne vois qui pourrait lui discuter le primat.
Au service de ces trois stars incontestées, la troupe de la Bayerische Staatsoper montre encore ses qualités, chaque petit rôle est tenu avec style, on retiendra notamment Goran Juric dans Angelotti, le sacristain de Cristoph Stephinger et le Spoletta de Kevin Conners et le beau chœur bien préparé par Stellario Fagone.
Mais c’est évidemment à l’orchestre qu’on s’intéresse non seulement parce que le Bayerisches Staatsoper est l’un des orchestres de fosse les meilleurs qui soient, mais aussi parce que Kirill Petrenko est rarement entendu dans le répertoire italien. Il avait dirigé en 2013 quelques représentations de Tosca, et en février 2015 une Lucia di Lammermoor restée dans les mémoires, sans coupures, où il avait montré ce qu’était diriger un Donizetti débarrassé des toiles d’araignées de la tradition.

Il épouse là Puccini. Un Puccini non inhabituel, mais plus acéré allant au bout de la logique du texte. Tosca remonte à 1900, un siècle après l’histoire qui est racontée (1800, Marengo). De cette victoire de Bonaparte, d’abord annoncée comme une défaite qui suscite le Te Deum du premier acte naît une ambiance tendue, qui montre que l’œuvre évoque un moment sur le fil du rasoir où tout va basculer, et où les âmes se révèlent, face à ce qu’ils croient être la vérité. D’où la tension, d’où les excès, d’où l’explosion finale de Scarpia. Nous sommes dans un moment d’écartèlement idéologique, traduit par des paroxysmes musicaux : Puccini écrit pour les premiers accords « tutta forza », insistant pour que le son dans Tosca soit paroxystique, très fort et très violent, et très adouci et lyrique en même temps . Et tous les personnages sont pris dans ce dilemme, entre la tyrannie des sentiments, désir, passion, érotisme. Car Tosca est d’abord l’opéra des désirs et des passions violentes, chez les trois personnages principaux, dans une déclinaison paroxystique au premier acte pour Tosca (qui a Mario « dans la peau »), au deuxième acte pour Scarpia, et au troisième acte pour Mario qui évoque clairement Tosca comme dans un rêve érotique. Mario n’est pas un héros de la liberté, il aide Angelotti par affinité politique et par amitié mais en aucun cas par volonté d’héroïsme. Cavaradossi est d’abord “désirant” Tosca, mais aussi l’Attavanti qu’il peint en Maddalena. Il aime la femme clairement et sans perversion, en ce sens il est le positif de ce qu’est Scarpia en négatif, qui n’est que perversions. Si on ne perçoit pas cette construction très particulière à Tosca, tout en écarts et en contrastes du fortissimo all’adagio, une construction en rupture de constructions, en anacoluthes, mais aussi en passages insensibles de l’un à l’autre, on ne peut lire de manière satisfaisante l’interprétation de Petrenko. Au contraire de Bohème, l’autre grand triomphe de Puccini, Tosca n’a pas cette mélodie qui emporte tout, c’est une œuvre tendue, à l’instar d’une Elektra de Strauss. Tosca doit être paroxystiquement contrastée ou n’est pas. Petrenko embrasse cette option, et installe cette couleur. On ne reviendra pas sur l’incroyable clarté de la lecture et les révélation de certains moments (début de l’acte III) sur l’exaltation des violoncelles, sur la sûreté et la poésie des bois, sur la lenteur calculée de certains moments, sur le détail de chaque phrase, bien isolée et du volume extrême d’autres, comme au premier acte (dont certains se sont plaints car il prend le risque de couvrir Terfel dans son monologue final). Petrenko est trop connaisseur des lois de l’opéra (certains feignent de croire qu’il ne connaît pas ce répertoire : il a été GMD à Meiningen et à la Komische Oper, où il a dirigé toutes sortes de répertoires, comme tout bon GMD de théâtre de répertoire qui se respecte). D’autres, ceux qui entendent sans écouter pensent (beati pauperes spiritu) que c’est vulgaire, ou trop fort, mais Puccini dans Tosca est tout sauf élégant et rond : il n’est jamais vulgaire, mais il est brutal : la création de Tosca surprit le public romain qui ne lui fit pas un triomphe, loin de là, étonné par une musique qui dérangeait. Puccini orchestre le dérangement sans être évidemment jamais vulgaire, mais en écrivant un drame paroxystique où l’histoire n’est que le prétexte à des analyses psychologiques de l’excès dont les trois personnages sont à la fois fauteurs et victimes. La musique rend sans cesse ces orages. Si la musique n’est pas excessive, dans le volume, dans les appuis, mais aussi dans les moments les plus lyriques et les plus doux, elle rate son coup. Il y a des moments qui font trembler les murs, d’autres qui font monter au ciel – quelquefois au septième-, et le tout dans une unité profonde des sensibilités.
D’ailleurs toutes les situations sont excessives : le deuxième acte, avec un Scarpia qui fait augmenter les tortures pour faire céder Tosca, est évidemment excessif, le troisième avec l’érotisme des retrouvailles et les va et viens musicaux des derniers moments, avec une Tosca qui se jette dans le vide des murs du Château Saint Ange le bien nommé, et même ce premier acte qui se termine avec un Te Deum monté à la hâte pour célébrer une victoire qui d’avère être une défaite est l’écrin d’un monologue de Scarpia, l’ange noir, d’après Jago son modèle qui lui aussi lançait chez Verdi (treize ans avant) un credo, forme d’une religiosité du Nadir, un credo noir de messe noire pour pervers assumé. C’est bien ce que fait ici Scarpia, et ce Te Deum sonne étrangement contrasté lui aussi entre actions de grâce et évocation parallèle des turpitudes futures, comme si c’était le Te Deum même qui les insufflait.
Et Petrenko conduit ce bal-là, avec une énergie fougueuse, n’hésitant pas à rompre les équilibres, mais n’hésitant pas non plus à inscrire certains moments dans un temps suspendu. Comme il accompagne le Vissi d’arte, comment il laisse au chanteur la respiration musicale, en grand chef d’opéra pour qui prime la musique! Dans sa manière de conduire le chanteur à l’opéra, il rappelle un Abbado, qui laissait à la voix tous les moyens de s’expanser : il accompagne le chanteur avec un sens de l’à-propos et une sensibilité étonnantes. On voit ses gestes multiples et ses indications d’une rare précision, notamment les attaques, mais on ne voit pas comme il laisse le chanteur respirer son air. Il est « confortable » avec les chanteurs, cela se sent, et cela s’entend. En même temps, et c’est là le prodige, dans son approche de Tosca, même dans les moments les plus doux et les plus lyriques, il reste tendu, dans un opéra où tout ce qui est apaisé n’est que prélude à tensions plus rudes encore (si vis pacem, para bellum); il fait respirer chaque moment, tout en n’oubliant jamais les tensions, dans une continuité et une absence de ruptures qui ne laisse pas d’étonner ici encore ; parce que dans un opéra où les ruptures de volume et d’intensité sont fréquentes, il réussit à les faire entendre en restant fluide, en soignant la continuité, sans aucun silence (voir l’extraordinaire début du troisième acte où il n’y a aucun silence, aucune rupture sonore mais un continuum ou les couleurs les volumes changent insensiblement sans jamais heurter). Et cette direction de Kirill Petrenko exalte toute la complexité et les raffinements de la partition, dans les excès de douceur, dans les excès de violence, dans le maillage et le tissu d’une orchestration détaillée, dont il révèle plein de secrets, et les principes de composition. C’est bien pourquoi Puccini est complexe, parce qu’il peut sans cesse être lu à contresens.
Au terme du voyage, une fois de plus se révèle l’exceptionnelle période vécue par la Bayerische Staatsoper. Dans quel théâtre peut-on connaître de telles représentations ? de tel triomphes ? J’en vibre encore.
Hier soir étaient réunis les Phares :
Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,
Sont un écho redit par mille labyrinthes ;
C’est pour les cœurs mortels un divin opium ! .
Charles Baudelaire, Les Phares (Les Fleurs du Mal, Spleen et Idéal)
[wpsr_facebook]