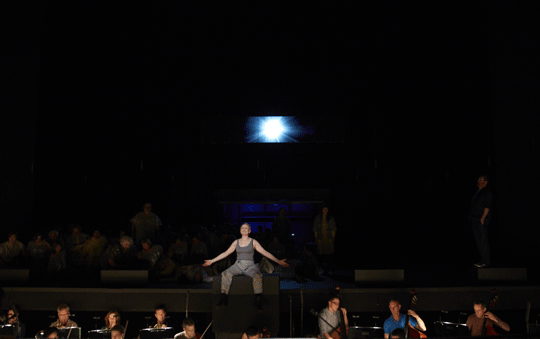Direction musicale: Patrick Lange, Mise en scène et Dramaturgie: Jossi Wieler, Sergio Morabito, Décor: Bert Neumann, Costumes: Nina von Mechow, Lumière: Lothar Baumgarte, Chœur: Johannes Knecht
Don Fernando: Ronan Collett, Don Pizarro: Michael Ebbecke, Florestan: Eric Cutler, Leonore: Rebecca von Lipinski, Rocco: Roland Bracht, Marzelline: Josefin Feiler, Jaquino: Daniel Kluge, Erster Gefangener: Young Chan Kim, Zweiter Gefangener: Sebastian Peter, avec: Staatsopernchor Stuttgart, Staatsorchester Stuttgart
Venu pour le Faust exceptionnel de Frank Castorf (voir le site Wanderer), j’ai profité de ma présence à Stuttgart pour assister la veille au Fidelio dit « de répertoire », qui était la production de début de saison dernière. L’intérêt était double, d’une part il était intéressant de mettre en perspective l’approche de Kupfer à Berlin vue quelques jours auparavant et celle du binôme Wieler-Morabito à Stuttgart, d’autre part, j’aime assister à des représentations de répertoire, parce qu’elles en disent souvent plus sur l’état d’une maison d’opéra qu’une nouvelle production.
La production de ce Fidelio va se concentrer sur la question du texte et des dialogues, complets, et sur la question de la trace là où Claus Guth à Salzbourg les a tous effacés, signe qu’il y a là un véritable enjeu.
Toute l’action se déroule devant une espèce de bunker dont on ne réussit pas à déterminer la fonction et qui se dévoilera à la fin. L’ambiance dessinée par Bert Neumann, le mythique décorateur berlinois de Frank Castorf qu’il a accompagné à la Volksbühne depuis 1989, pour son dernier décor (il est décédé l’été 2015 à 54 ans), est à la fois aseptisée et redoutable, un hall d’entreprise de logistique éclairé à cru (par Lothar Baumgartne, fidèle de Neumann et Castorf), où le travail des personnages consiste à réceptionner des paquets d’un tapis roulant, les ouvrir, les contrôler puis les renvoyer sur un autre tapis roulant. Des personnages dont on finit par comprendre qu’ils sont tous prisonniers, tous habillés de la même manière en quatre déclinaisons, évoluent sous une vingtaine de microphones qui captent tous leurs dialogues: c’est un monde de prison, comme si l’univers était lui-même une immense salle de contrôle où chacun épie l’autre ; les prisonniers vêtus (costumes de Nina von Mechow) comme les personnages principaux se déplacent comme de petits soldats au pas, et à l’aveugle : le monde-même est une prison, sous le regard, figuré par un écran où paraissent les mots même des airs, non comme surtitrage (leur format est bien plus large), mais comme s’il fallait absolument garder le mot comme trace fatale et qu’aucun, ni des dialogues, ni des airs ne devait échapper .
Ce décor, un hangar logistique du « Stasiland » (un monde connu et subi par Bert Neumann originaire de la DDR) que Jossi Wieler et Sergio Morabito, loin de l’humanisme beethovénien, nous présentent, est une sorte de monde d’après, ou, mieux, un monde d’aujourd’hui, ce monde du totalitarisme soft, de ce « monstre doux », le mostro mite décrit par Raffaele Simone dans un livre célèbre paru il y a quelques années.
Comme Kupfer à Berlin, Wieler et Morabito n’y croient plus.
Inquiétant regard où le monde est lu comme une immense prison, ou comme un univers à la Orwell où Big Brother règne, ou bien, pire encore, un univers de téléréalité où la vie au quotidien est objet de regard, parce que tout doit être vu, et de spectacle, parce qu’on doit en jouir. Ainsi au milieu de cet univers faussement industriel, qui gère l’industrie de l’espionnage des uns vers les autres, de tous vers tous, une balancelle orange, qui marque l’univers petit bourgeois qui s’est construit dans cette horreur-là : on a l’humanité qu’on peut.
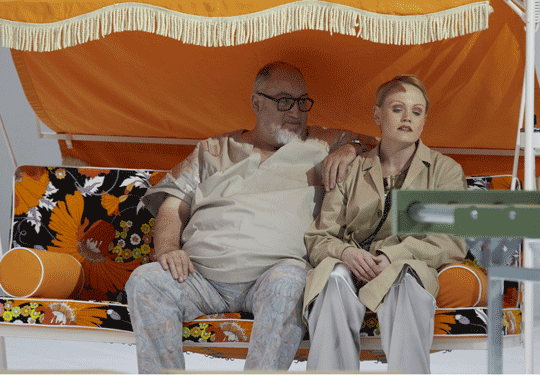
Il y a en effet évidemment une sorte de contraste entre l’horreur du propos, le regard, l’impossibilité d’être soi, la saleté mentale que tout cela suppose et le décor très clean, la modernité proprette presque télévisuelle (d’où ma référence à la téléréalité). En effet, le Pizzaro est une sorte non pas de « Stasimann » mais semble presque sorti d’un film de Fellini (on est dans la férocité d’un Ginger e Fred), un producteur prêt à tout.
Mais que fait donc le prisonnier Florentin isolé dans un tel monde ?

La solution vient, comme un deus ex machina à la fin. Le ministre, Don Fernando, libère l’ensemble des prisonniers avec Florestan au premier plan en faisant ouvrir par Leonore le fameux bunker, qui s’ouvre comme une porte de garage et laisse apparaître un monde de papiers et d’archives qui sont en train d’être broyées, qu’aussi bien Leonore que Marzelline et Jaquino vont regarder, consulter, comme si leurs actions avaient été là consignées, épiées, classées peut-être par Florestan lui-même au passé alors trouble, ou bien c’est le produits des dénonciations dont a été victime Florestan. On pense à Tartuffe, au discours de l’exempt (« Nous vivons sous un Prince ennemi de la fraude) et à la dénonciation de l’Orgon du moment (Florestan) par le Tartuffe du moment (Pizzaro ?), et à la volonté du Prince d’effacer les mots. C’est tout le discours sur le rapport au passé, sur les totalitarismes, sur la situation des sympathisants de la révolution au début du XIXème dans l’Empire d’Autriche à la veille du congrès de Vienne qui se révèle: en 1804, quand Beethoven écrit sa première version de Fidelio, le monde des libéraux européens voyait en Napoléon le garant de l’humanisme et de la liberté, et l’opéra libérateur avait un sens d’espérance. En 1814, quand tout est à peu près consommé, que Napoléon n’a défendu ni la liberté ni l’humanisme, mais a installé un autre totalitarisme, et que les vieilles monarchies sont en train de reconquérir le terrain perdu, le monde est autre et Fidelio (1814) ne peut qu’être un chant désespéré. C’est cette histoire complexe, ce renversement de sens, ce monde d’hier et d ‘aujourd’hui où les conquêtes qu’on croyait définitives s’avèrent fragiles que racontent Wieler et Morabito.

Les relations entre les personnages restent cependant ce qu’elles sont dans l’œuvre de Beethoven, même si la mise en scène et la dramaturgie leur donnent l’ambiguïté dont il a été question plus haut, et en font un monde où la frontière entre bons et méchants n’est plus si nette : chez Beethoven, c’est le cas de Rocco. Wieler et Morabito nous suggèrent que Florestan et Pizzaro sont eux-mêmes ambigus, que le monde-même est ambigu et que la liberté n’est pas un donné, ni même un promis. Le chant final plein d’espérance est teinté d’amertume, il n’est qu’à regarder le visage de Leonore, défait par la découverte du « bunker », la trace construite des ambiguïtés, des secrets gardés et accumulés, des passés troubles. On comprend alors pourquoi au lever de rideau Marzelline lave avec scrupule et attention le sol : on pense aux servantes de l’Elektra de Chéreau occupées à laver toutes les traces indélébiles du sang du meurtre d’Agamemnon, on pense à Lady Macbeth et à son obsession des taches de sang, on pense à ce passé qu’on essaie d’effacer et qui ne disparaît jamais, qui se révèle toujours à un moment ou un autre, ce peut-être pour l’Allemagne le passé nazi, ou le passé Stasi, en France le passé Vichy. Il y a toujours quelque chose à cacher, et qui finit toujours par se révéler.
Voilà un travail complexe, qui exige du spectateur une attention, une réflexion et une analyse approfondies, et qui ne laisse pas indemne. Mais à une semaine de distance, le Fidelio de Kupfer et celui de Wieler-Morabito, par des moyens très différents, disent quelque chose de voisin sur la désespérance du monde, comme si nous entrions dans un tunnel.
Musicalement, la représentation est d’une très grande tenue : les forces de l’Opéra de Stuttgart que ce soit le chœur (dirigé par Johannes Knecht) avec ses deux solistes valeureux Young Chan Kim et Sebastian Peter ou l’orchestre, montrent que nous sommes dans une grande maison: pas de scories, mais de l’énergie, de la précision, une vraie implication qui seront confirmées par le Faust du lendemain. Spectacle créé par le directeur musical Sylvain Cambreling, cette reprise de Fidelio est dirigée par Patrick Lange, un chef encore jeune qui fut pendant une brève période directeur musical de la Komische Oper de Berlin, très attentif, très précis, un de ces chefs qui donnent confiance aux orchestres par leur sérieux et leur souci d’une approche sans bavures. Sa direction est énergique, plutôt classique au sens où elle ne marque pas une volonté excessive de personnalisation ou d’interprétation, mais un respect de l’écriture et un vrai souci de l’équilibre avec le plateau, sans jamais couvrir et soutenant en permanence les chanteurs. Patrick Lange, que j’estime, est en ce sens un grand chef de répertoire (et ce n’est pas pour moi péjoratif), une garantie pour un théâtre (comme a pu l’être un Fabio Luisi dans la première partie de sa carrière), il lui manque peut-être ce grain de fantaisie et de liberté qui le propulserait à un niveau supérieur.

Du côté du plateau, essentiellement composé d’artistes de l’ensemble de Stuttgart, une remarquable homogénéité, c’est quasiment la distribution de la première qui a donc travaillé longuement avec les metteurs en scène : frais et très incarnés le Jaquino de Daniel Kluge et la Marzelline de Josefin Feiler, joli contrôle de voix mozartiennes, jamais excessives, et très présentes néanmoins.
Le Pizzaro de Michael Ebbecke est d’abord un personnage, d’une certaine vulgarité télévisuelle, échevelé, vêtu comme un faux jeune, sans scrupule, chanté avec netteté et force, voix bien projetée (ou jetée ?) qui est bien plus ambigu que dans d’autres lectures. Wieler et Morabito n’en font pas un personnage noir, ils lui laissent en quelque sorte sa chance.
Le Rocco de Roland Bracht, même avec une voix un peu fatiguée, est profondément juste, humain, ambigu lui aussi mais il chante d’une manière si chaleureuse, avec ses faiblesses et son air débonnaire, qu’on pardonne tout au personnage, et tout au chanteur. Une véritable incarnation.
Le ministre de Ronan Collett est un peu pâle vocalement, mais c’est aussi la conséquence d’une mise en scène qui l’efface, devant le chœur et les personnages qui se dépêtrent dans le bunker. Une absence de relief du vrai pouvoir qui accentue l’ambiguïté de cette fin sans gloire laissant seule Leonore avec une pâle lumière lunaire qui n’a rien du soleil éclatant qui habituellement se lève sur les âmes .

Les deux héros, Rebecca von Lipinski (Leonore) et Eric Cutler (qui succède à Michael König, le Florestan de la première) ont tous deux une voix qui n’a pas tout à fait le format habituel des deux rôles. Rebecca von Lipinski était aussi Leonore dans le Fidelio récent donné à la Philharmonie (voir Wanderer). La voix est aux limites, le format est plus celui d’un lyrique qu’un lirico très spinto exigé par le rôle, et la fin est quelquefois un peu difficile. Elle incarne pourtant magnifiquement le personnage, et compense par sa présence et une jolie technique les fragilités réelles de la voix : l’incarnation est meilleure que la prestation, mais dans Fidelio, l’incarnation est essentielle et elle est totalement engagée dans la mise en scène et sa complexité. Elle rend cette Leonore émouvante notamment à la fin où, malgré la libération de son Florestan, elle semble frappée, et finit isolée dans le noir.
Eric Cutler est un ténor de belle facture, belle technique, style, attention au texte, contrôle. Lui aussi n’a pas tout à fait le format de Florestan, il semble épuiser ses réserves, mais son Florestan reste crédible, notamment dans l’air redoutable d’entrée du deuxième acte. Il fait partie de ces chanteurs dont la technique et le style permettent d’aborder des rôles légèrement surdimensionnés sans jamais tomber dans les pièges. La voix est évidemment tendue, mais l’incarnation est là aussi, impressionnante notamment quand face à Rocco à qui il demande à boire, et la clarté de la voix, la justesse de l’expression sont ici des atouts. Il est à l’extrême du spectre du rôle. Florestan comme d’autres rôles du répertoire de la période, qu’on va retrouver dans Weber ou même dans le Grand Opéra, demande de la force, de la puissance et aussi du style, de l’élégance, une capacité à maîtriser et dominer la voix : Cutler a les qualités de raffinement qui permettent de compenser une puissance qu’il n’a pas tout à fait, et c’est pourquoi il est un Florestan crédible.
Au total, un Fidelio d’un grand intérêt, par son pessimisme même, par son ambiguïté : j’ai souligné souvent combien l’œuvre était difficile à monter, avec sa dramaturgie bancale et cette notable différence entre première et deuxième partie. En posant le dialogue comme musique, ainsi qu’ils l’affirment dans le programme de salle, les metteurs en scènes ont réhabilité théâtralement une pièce à la dramaturgie souvent sacrifiée. Je ne suis pas toujours convaincu par le travail de Wieler et Morabito, car je le trouve souvent d’un dépouillement paradoxalement complexe et exigeant. L’impression au sortir de ce Fidelio était mi-figue, mi-raisin, musicalement oui et scéniquement moui. Quatre semaines de maturation, la réflexion et l’analyse qui en résultent ont fait leur œuvre, ce sera oui, et pour les deux. [wpsr_facebook]