
La question de l’inachèvement de Turandot pose de manière plus profonde celle de la résolution du conte de Gozzi, et de l’histoire, qui est celle de l’humanisation de l’héroïne. Devenue femme amoureuse, ayant perdu sa distance et sa frigidité, par la vision de l’amour de Liù, celle ci n’est pas une Isolde, mais bien plutôt une Brünnhilde, découvrant en Siegmund et Sieglinde la force de l’amour et du même coup abdiquant virginité et immortalité pour vivre l’amour humain. Il y a dans le parcours de Turandot quelque chose de très semblable. Mais Puccini n’a pas fini l’œuvre, et ne l’a pas bouclée musicalement, et ni Alfano et ni Berio ne sont totalement convaincants, on le verra. L’enjeu de ce final, c’est bien la transformation de Turandot de roc en fragilité, même si cette fragilitė se perçoit déjà dans la scène des énigmes quand les réponses successives de Calaf bousculent et hystérisent la princesse, élément lisible aussi dans la musique qui accompagne la manière dont Turandot pose les questions.
Tel qu’il existe aujourd’hui l’opéra met en scène une princesse lointaine et monstrueuse, à la psychologie fruste, un prince égocentrique prêt à tout sacrifier pour la conquérir et qui sacrifie donc et père et esclave, c’est à dire ce qui lui reste de sa famille et de ses origines probablement arabes vu son nom sans doute venu du mot Calife. Mais Calaf est inflexible pour mieux faire tomber la princesse, et lui faire enfin connaître ce qu’est la force de l’humain…les seuls personnages ayant au départ une humanité sont ceux qui sont sacrifiés Timur et surtout Liù. Ce n’est pas un hasard si la plupart des distributions à la Scala depuis les années 70 affichent les Liù les plus légendaires, Tebaldi, Freni. Face à des Turandot qui alternent entre légendes (Nilsson) et grosses voix du moment (Mastilovic).
Pour Turandot en effet, on a pu afficher Birgit Nilsson, référence incontestée de l’après guerre, et Caballė, tout aussi incroyable…aujourd’hui on oublie que Caballé fut Sieglinde ou Salomé et on ne retient que la référence en matière de bel canto, mais la voix de la Caballé avait cette ductilité capable d’épouser les rôles les plus divers. Et elle était Turandot, je peux en témoigner puisque je l’ai vue dans ce rôle, à Paris, lors de la reprise de la production de Margherita Wallman en 1981 (sous la direction d‘Ozawa), j’ai vu aussi Eva Marton (et Maazel) Ghena Dimitrova (et encore Maazel) , et Nina Stemme est la dernière d’une longue série de grandes voix. Mais je garde une agréable surprise devant une Turandot inattendue à Gênes il y a quelques années , interprétée par Raffaela Angeletti qui m’avait frappé par sa fragilité intrinsèque, qui donnait au rôle une autre nature.
Mais la tradition veut qu’on donne le rôle à une maîtresse des décibels, pour les incroyables hauteurs de in questa reggia.
Pour Calaf c’est un peu différent, il n’a certes qu’un grand air fameux, nessun dorma, dont la référence reste Luciano Pavarotti, mais que tous les grands ténors ont eu à leur répertoire Carreras, Domingo, Lucchetti, Alagna et sous peu probablement Kaufmann. Le rôle est tendu notamment au premier acte pour dominer le flux orchestral.
Le choix d’Aleksandr Antonenko est ici le choix d’une voix, plus qu’un interprète, mais c’est une voix de référence.

Alexandre Tsymbaliuk qui est un Boris apprécié, en Timur, c’est presque sous dimensionné, Timur restant un rôle secondaire, mais cela donne d’autant plus de poids au personnage, le couple Timur/Liù s’opposant alors au couple Turandot/Calaf.
Quant à Liù, le choix de Maria Agresta, jeune star du chant italien, continue la grande tradition scaligère des Liù de référence .
La musique de Turandot est assez singulière dans la production puccinienne . Il ne faut pas oublier qu’elle est contemporaine de Wozzeck, comme il ne faut jamais oublier quand on écoute Puccini ses relations réciproques d’estime avec Schönberg et son intérêt déclaré pour le Pierrot Lunaire. D’ailleurs, la manière de classer Puccini dans le vérisme est une erreur fréquente de ceux qui n’écoutent pas, même les premiers succès, à commencer par Manon Lescaut. Ce n’est pas un hasard si c’est le seul opéra de Puccini qu’Abbado aurait voulu diriger. C’est d’ailleurs la même problématique pour Zandonai dont la Francesca da Rimini n’a pas le son d’une œuvre vériste, mais bien plus proche par ses accents d’un Fauré ou d’un Debussy…
Pour les compositeurs d’opéra des premières années du XXème siècle, la découverte de la seconde école de Vienne est un élément clé, en positif comme en négatif, mais tous se positionnent. Puccini reste une référence pour beaucoup de compositeurs de l’époque (ceux que les nazis vont classer comme dégénérés, mais aussi Janacek ). Il faut lire Turandot comme une œuvre du XXème siècle, utilisant de la musique contemporaine et plongée dans les débats musicaux du moment, y compris le wagnérisme revu du début du XXème (il y a dans Turandot quelques traces) et pas un reliquat de musique du XIXème. En ce sens, le final de Berio peut avoir du sens. Je me souviens d’Ingo Metzmacher me disant qu’il voudrait être invité en Italie à diriger Puccini, parce qu’il le ferait comme on dirige Schönberg…
Cette musique surprenante, à l’orchestration complexe, avec ses dissonances, son agressivité orchestrale, avec ses fausses chinoiseries, même si Puccini était soucieux d’authenticité, avec le rôle trės marqué des percussions, qui pour le coup renvoient à ce premier XXème Stravinski bien sûr, mais aussi Bartok, mais aussi à la musique américaine que Puccini familier de New York connaissait bien, il y a des moments qui sonnent comme Gerschwin et qui annoncent Bernstein. Enfin l’écriture même du rôle de Turandot abandonne la mélodie du chant italien, la manière de porter la voix aux extrêmes, éloigne bien sûr Turandot de l’humain, mais la rapproche vocalement d’autres héroïnes, plus germaniques : Puccini s’intéressait à Strauss…
Il y a donc une modernité de Turandot c’est à dire une manière de considérer l’œuvre non par rapport au passé, mais par rapport à l’avenir qu’il faut toujours avoir en tête lorsqu’on l’écoute.
L’œuvre originelle de Carlo Gozzi (1762) qui trouve ses origines dans une publication du début du XVIIIème siècle rassemblant des contes persans (et non chinois) eut déjà une certaine fortune. Gozzi qui a voulu rénover ou continuer à faire vivre la tradition de la Commedia dell’Arte ou de la pièce fantasmagorique en s’appuyant sur les modes du temps, comme la mode chinoise, fort à la mode en Europe au XVIIIème, cherche à proposer une sorte de théâtre rêvé et exotique.Cela va être si apprécié en Europe et notamment en Allemagne que Schiller va s’emparer de la pièce et la traduire en 1802, et la présenter avec Goethe à Weimar, foyer créateur et créatif de l’histoire du théâtre en Allemagne. Weber lui même va en faire des musiques de scène.
Plus près de Puccini et avant lui, en 1917, Ferruccio Busoni va présenter sur la même histoire une Turandot, en langue allemande, mais plus proche des intentions de Gozzi, qui n’a rien de l’épopée puccinienne, mais qui reste intimiste, comme l’œuvre originale créée dans le petit théâtre vénitien de San Samuele.
La plupart du temps, les mises en scène se contentent de proposer une version spectaculaire faite de chinoiseries, une sorte de représentation des rêves chinois du public, c’est le cas à la Scala de Margherita Wallman (qui fit aussi la Turandot parisienne de 1968, dont je vis la reprise en 1981), de Franco Zeffirelli, qui a régné longtemps, il y a eu ensuite le japonais Keïta Asari, et enfin Giorgio Barberio-Corsetti en 2010. Vérone s’est fait la spécialité de grandes machines chinoisées, pour en arriver à Zhang Yimou, qui a proposé au moment des JO une superproduction à Pékin .
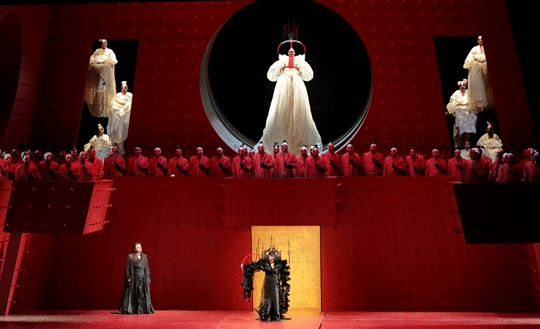
On doit reconnaître que cette fois, Nikolaus Lehnhoff, qui reprend une mise en scène faite à Amsterdam en 2010, essaie d’échapper à ce pittoresque de dessin animé. Pas de centaines de figurants en scène, la Chine est plus esquissée que dessinée, l’espace lui même, fermé par de hauts murs cloutés, rouges comme les murs de la cité interdite, image de prison, est à trois niveaux, celui de l’empereur, près du ciel, en blanc, celui des dignitaires en rouge sur un balcon, et celui du peuple enfoncé dans le plateau au premier acte. Tout change au deuxième acte où l’espace de jeu se vide pour laisser les deux protagonistes Calaf et Turandot seuls, les dignitaires regardant du balcon les “épreuves” conçues ainsi comme une joute que l’on regarde, et d’où le peuple est exclu une sorte de jeu de cirque à deux personnages, comme le montre la photo ci-dessus. Turandot ayant quitté son podium pour se lancer dans l’arène, qu’elle ne quittera pas d’ailleurs jusqu’à la fin de l’opéra. Et du blanc pur immaculé inaccessible du premier acte, elle s’habille de noir prophétique de sa chute dans l’humain qui sera symbolisé par le geste de Calaf qui lui arrache manteau et coiffe.

Le jeu des costumes n’est pas indigne d’intérêt. Blanc (le deuil en Chine) pour l’empereur et sa famille au II, blanc pour Turandot au I, gris clair pour Liù et Timur, et noir pour tous les autres, le peuple, relégué au rôle d’ombres noires, munies de chapeaux aux yeux maquillés de noir comme dans certains tableaux expressionnistes. Quant à Turandot, toujours vêtue de manière presque proche d’un personnage de bande dessinée, elle tient en main un demi-cerceau rouge, destiné à empêcher tout humain – essentiellement mâle- d’approcher. Elle s’en servira comme une sorte de bouclier face à Calaf.
Les trois ministres Ping, Pang, Pong habituellement vêtus de costumes de mandarins de fantaisie sont ici vêtus comme trois clowns, et dans l’ensemble la conception des costumes d’Andrea Schmidt-Futterer renvoie à une ambiance marquée par Brecht (dans ces années, il commence sa carrière au Deutsches Theater de Max Reinhardt): maquillages clownesques, visions un peu expressionnistes des peintures a la Otto Dix ou Max Beckmann, en bref, une ambiance « Berliner Ensemble » et Lehnhoff et son décorateur Raimund Bauer ont essayé de donner à cette Turandot une couleur vaguement « Art déco » ou « Liberty » aussi, en tous cas une valence plus proche des années 20 ou 30 qu’une Chine revisitée.
Les personnages restent à distance, se touchent peu, plus comme emblèmes que comme personnages. Turandot et Calaf, pris au départ dans un ballet réglé (par exemple la scène des énigmes) redeviennent « personnages » à la fin parce que tout simplement ils se touchent alors que Timur et Liù sont les seuls vrais « humains » par les gestes, attitudes, habits, dans ce monde d’automates ; le cadavre de Liù reste en scène pendant le duo final, comme témoignage de l’humain, témoignage de l’amour et donc cause du retournement final.
Une mise en scène moins passe-partout qu’il n’y paraît , qui convient au public de la Scala fait en ce moment de touristes de l’EXPO , on parle beaucoup japonais et russe dans la salle, et de publics d’abonnés que le seul mot de “mise en scène” fait frémir. Voilà un travail qui ne va choquer personne, assez beau à voir pour déclencher y compris pendant le spectacle des photos prises de mobiles restés évidemment allumés (…à la Scala, les spectateurs qui du haut regardent la platea – le parterre – voient des dizaines de petites lucioles qui sont les mobiles allumés, c’est le seul théâtre où ce soit si caricatural). C’est un travail suffisamment intelligent pour permettre de gratter un peu derrière les images et de constater que les intentions sont loin d’êtres routinières.
A ce travail résolument XXème siècle correspond une approche XXème siècle de Riccardo Chailly, qui fait là son esordio (ses débuts) comme directeur musical de La Scala, où il n’a pas dirigé depuis une petite dizaine d’années. Chailly voit Turandot comme une œuvre du XXème siècle, contemporaine de tous les mouvements musicaux et intellectuels qui marquent les trente premières années du siècle. C’est bien ce qui marque dans ce travail. Chailly dirige Turandot comme la voisine de Berg, de Webern, de Varèse (lui qui dirige Amériques comme personne), mais aussi de Stravinski . C’est presque une Turandot « république de Weimar » qui nous est donnée à entendre, une Turandot vibrante de modernité: lecture analytique à l’extrême, sons secs, précis, peu de legato, sauf lorsque la musique se réfère à la musique américaine, un ensemble à la fois monumental, et glacial. Point n’est besoin d’ailleurs d’en affirmer la modernité, l’audition du 1er acte suffit pour nous en convaincre. Dans cette option très symphonique, où l’orchestre répond de manière splendide (il y a eu de longues répétitions), on va en oublier…le plateau.
En effet, si l’orchestre est superbe, si l’approche rend parfaitement cohérent le choix du final de Berio, l’ensemble est beaucoup trop fort (au moins pour les places de parterre) et couvre comme un mur de son débordant tout ce qui se passe sur le plateau, obligeant les chanteurs pour pouvoir êtres entendus à tendre leur voix à l’extrême, et même, ce qui est assez étonnant, on entend mal le chœur, un comble s’agissant de la Scala et de cette œuvre où au début surtout, il est déterminant. Certes, le choix de Chailly est de proposer (est-ce possible ?) une Turandot moins épique vocalement, plus sombre et presque plus intimiste (absence de figurants, absence de spectaculaire), mais en même temps cherchant à rendre une image de poème symphonique, voire de de légende dramatique, où voix et orchestre se mêlent, sauf qu’ici l’orchestre domine voire écrase tout, inonde tout comme un tsunami sonore sur son passage, portant presque seul la monumentalité de l’opéra. Ce déchaînement d’éléments est tellement marqué que je me suis demandé si le décor, très fermé, ne créait pas un effet de réverbération et de retour sonore excessif, mais normalement, il y a des assistants en salle capables de signaler les excès…
Les choses s’équilibrent au deuxième acte, mais dans l’ensemble, l’orchestre met en difficulté non pas Nina Stemme, qui en a vu d’autres, mais l’équilibre du plateau qui souffre, et c’est dommage ; car l’approche de Chailly est très défendable et surtout les détails qui émergent de la fosse, la manière de faire sonner des bois et les cuivres, la manière d’exiger des sons, nets, sans bavures, mettant en relief les éléments inspirés des contemporains, les jeux sur l’atonalité, tout cela donne une couleur vraiment XXème siècle à l’ensemble et replace Turandot là où l’œuvre doit être, chronologiquement à côté de Wozzeck, en cohérence parfaite avec la production de l’époque.
Alors, le choix du final de Berio prend son sens. Bien sûr, il y a le travail d’Alfano, fortement influencé sinon dicté par Arturo Toscanini, dont la toute première version n’a pas encore été proposée sur les scènes, mais en terminant l’œuvre par une sorte de chant triomphant, il est en contradiction avec ce que voulait Puccini, et notamment à cause du final wagnérien à la Tristan qu’il désirait. De plus l’orchestration d’Alfano est moins passionnante, la partition perd immédiatement en épaisseur et en diversité. La mélodie puccinienne y est peut-être présente, mais sûrement pas le tissu orchestral toujours complexe (y compris dans La Bohème d’ailleurs , si souvent aplatie) chez Puccini. Bien sûr, Berio compose à la fois tenant compte de ce que le XXème siècle a proposé en matière de création musicale et d’innovation, mais aussi en tant que compositeur d’opéras dans la grande tradition italienne et enfin en cherchant dans les parties recréées à évoquer un univers musical qui intéressait Puccini, ainsi glisse-t-il des citations de Gurrelieder, ou quelques mesure de la 7ème de Mahler. Dans ce final, il y a des moments qui regardent très nettement vers le contemporain, des éléments dissonants (comme chez Puccini) et Berio utilise plus d’esquisses de Puccini qu’Alfano et il écrit notamment ce final en adagio auquel Puccini aspirait. Et qui est si cohérent avec l’évolution psychologique des personnages qui ont chacun laissé l’épique pour une expression plus lyrique. Il serait excessif de dire que ce final éblouit. Disons que s’il ne fait pas regretter Alfano, il ne passionne pas mais il surprend et certains moments sont vraiment passionnants. Notamment les dernières mesures .
Riccardo Chailly a donc eu raison à la fois de proposer le final de Berio, pour la première fois et surtout de proposer une vision de l’ensemble qui joue la cohérence et la modernité. Il l’a d’ailleurs déclaré plusieurs fois avant la première, et notamment devant les étudiants de l’université. Ce sont les conditions de réalisation, le travail sur le volume les déséquilibres fosse et plateau qui posent problème, mais pas les choix interprétatifs. Enfin, le public très traditionaliste de la Scala, fossilisé notamment les soirs d’abonnement a semblé accepter la chose avec son indifférence coutumière vu l’accueil tiède reçu dans l’ensemble ; quant au reste du public, touristique russophone ou nipponophone, plus intéressé par les selfies, les bavardages incessants et les photos de scène au milieu du spectacle, ne se pose pas la question de Berio ou Alfano qui ne l’a pas effleuré une seconde.
Cette production était idéalement calibrée pour cette diversité des publics, classique mais pas trop, plutôt bien distribuée, bien dirigée, et avec en plus un prétexte musicologique qui attirait les animaux de mon espèce. La suite de la programmation, qui enfile les standards comme des perles de culture (ou d’inculture ?), Lucia, Cavalleria/Pagliacci, Carmen, Tosca, Otello (de Rossini) est encore bien plus touristique et attrape-mouches.
Comme je l’ai souligné, le magnifique chœur de la Scala perd un peu de son relief au lever de rideau, face au tsunami sonore de l’orchestre, d’autant que les choristes sont un peu « enterrés » et chantent à demi-enfoncés, la prestation est comme souvent, excellente, mais il faut quelquefois tendre l’oreille pour véritablement le distinguer avec bonheur.
Alors évidemment, le chant peut être victime d’une telle option. Le ténor (Aleksandr Antonenko) pousse au maximum (heureusement, il a la réserve voulue) dans Calaf, mais son chant est tellement inexpressif que pousser la note est la seule chose dont on peut le gratifier. C’est un Calaf sans couleur ni tension, avec une tenue en scène sans relief. J’ai entendu dans Calaf des voix très variées, de Pavarotti à Bonisolli, de Carreras à Giacomini, chacun avec des moyens très différents, mais tous s’efforçant de donner vie et vibration. Antonenko, qui est un chanteur fréquent dans les rôles à décibels, reste absent, distancié sans le vouloir, peu impliqué par l’action et peu impliqué dans le personnage : regard vide, déplacements lourdauds, gestes creux ou passe-partout. Au fond, il donne sans le vouloir sans doute à Calaf cette absence d’humanité et d’authentique présence qui est aussi la volonté du metteur en scène.
Ce n’est pas le cas de Timur, chanté par Alexander Tsymbalyuk, qui n’a pas la voix du vieillard fatigué, mais celle de la basse vigoureuse qu’il est (c’est un Boris de grande classe). Il est très émouvant, par la couleur, par l’intériorisation, par l’intelligence du propos et par la diction, on ne fait pas toujours attention à Timur habituellement, mais ici, distribué à une grande basse de notre temps, le personnage prend un relief inattendu, d’autant qu’avec la Liu’ de Maria Agresta, ils forment un couple de personnages cohérents, prenants, émouvants
Maria Agresta est en train de devenir le soprano lyrique qu’il faut avoir vu…On l’a vue dans Nedda le mois précédent à Salzbourg. Elle chante le bel canto, Verdi, le vérisme…attention à l’overdose…le monde du chant italien est le grand spécialiste du usa et getta, on prend un soprano jeune, prometteur, on l’use en quelques années et on passe à un autre…cela fait 20 ans que ça dure avec le résultat désastreux sur le paysage italien actuel.

Maria Agresta a une belle voix de soprano lyrique, mais pas si grande, avec quelques acidités parfois. Elle est très émouvante dans Liù, plus par les accents qu’elle y met que par un timbre assez banal. C’est sans conteste une artiste, qui sait utiliser ses atouts (présence, diction, interprétation), mais on a toujours l’impression d’une voix sans vraies réserves, toujours sur le fil du rasoir notamment dans les aigus. Quand je pense aux Liù entendues par le passé, elle ne les dépasse pas, même si elles ont des noms oubliés Yoko Watanabé, Lucia Mazzaria, ou moins oubliés comme Katia Ricciarelli, a fortiori si l’on regarde le disque, de Leontyne Price à Mirella Freni, de Teresa Stich Randall à Elisabeth Schwartzkopf. Elle a l’émotion, le sens du pathos, la technique aussi, émouvante, elle sait l’être, bouleversante, pas encore. Il faut avoir le timbre chaud de la Freni et sa sécurité vocale, sa rondeur, sa vibration interne pour bouleverser le public. Il reste que c’est Maria Agresta qui remporte le concours de l’applaudimètre, pourtant ce soir tiède et indifférent.
Turandot, c’est Nina Stemme. Dans le paysage des Turandot du jour, assez clairsemé et géographiquement dispersé entre scandinaves, russes et allemandes, Nina Stemme se devait d’aborder le rôle. Quand on est suédoise, il y a un rang à tenir pour succéder à l’incontestable référence depuis 50 ans, Birgit Nilsson. J’entends çà et là que Nina Stemme a des accents nilssoniens…ce qui est totalement faux ; le timbre de Nilsson était froid, ses aigus coupants, avec une réserve infinie. Qui l’a entendue en salle garde en mémoire cet incroyable volume (L’orchestre de Chailly eût paru un orchestre de chambre, face à ce volume), cette sûreté, et aussi un certain engagement qui faisait qu’elle était tout sauf un bout de bois en scène. Nina Stemme est un soprano dramatique, c’est évident, mais le timbre n’a pas cette froideur, il a bien plus de rondeur, et la réserve à l’aigu, notable, est moindre de celle de sa compatriote. Là où Nilsson était inhumaine et semblait presque infaillible, Stemme est au contraire humaine et presque faillible. Et pour la Turandot voulue par Nikolaus Lehnhoff, c’est très juste. Loin d’être la Turandot perchée en hauteur et inaccessible du premier acte et de toutes les mises en scène de l’acte II qu’on voit dans les théâtres, nous avons une Turandot qui descend dans l’arène , et qui darde ses aigus du proscenium (heureusement d’ailleurs sinon l’orchestre l’aurait aussi balayée…). Dans le combat avec Calaf qui est réglé par le metteur en scène dans la scène des énigmes, Stemme est vraiment magnifique, vocalement et scéniquement.
Cependant, la question de Turandot, c’est que le rôle n’est pas bien passionnant. Le premier acte est muet, le second acte est tout entier dédié à In questa reggia qui n’est pas un air aux raffinements psychologiques évidents, et à la scène des énigmes, plus subtile qu’il n’y paraît à l’orchestre et dans le déroulement psychologique, mais où l’hystérie de l’héroïne est mise en évidence.
Au troisième acte, Turandot pourrait être un rôle plus travaillé, dans sa recherche désespérée du nom du Prince inconnu (Il principe ignoto), pour le condamner ou pour se condamner. L’enjeu devrait être marqué dans le jeu du personnage, et aussi lors de la mort de Liu’, déclencheur du basculement.

Ainsi lorsqu’elle annonce au peuple qu’elle a le nom du Prince et qu’il est « amore », un très grand metteur en scène, qui sait faire travailler l’individu et en faire sortir quelque émotion, pourrait faire un travail de contraste entre la Turandot du II et celle du III. Ce n’est jamais fait, dans aucune mise en scène et pas plus dans celle-ci. Turandot passée de glaçon à femme amoureuse reste à peu près la même, rien ni dans le geste, ni dans le ton, ni dans les accents, ne nous indique ce changement…Sans doute Nina Stemme n’arrive-t-elle pas à le rendre par ses ressources personnelles d’interprète, sans doute la mise en scène reste-t-elle au seuil de ce qui pourrait être un moment d’émotion, mais surtout ce n’est pas Puccini qui écrit la musique, et cela se sent. Ce maître de la gestion millimétrée du pathétique et de la mélodie qui tire les larmes eût-il sans doute déployé là quelques traits de génie qui auraient aidé et chanteuse et metteur en scène à basculer. Tout cela reste extérieur et pour tout dire lointain. Ainsi Nina Stemme est-elle une belle Turandot sans que le rôle ajoutât quoi que ce soit à sa gloire. À ce point de la carrière, elle devait l’aborder pour couvrir le spectre de tous les rôles de soprano dramatique de référence, et après ?
Même si cela peut surprendre (en bonne rhétorique on va du moins au plus important), je voudrais terminer mon tour d’horizon des chanteurs par les trois ministres Ping Pang Pong. On va me dire « mais ce sont des rôles secondaires !», quel intérêt ? d’autant que beaucoup de musiciens (dont Berio) trouvent leur présence envahissante.

Il en va des trois ministres de Turandot comme d’Oscar dans Ballo in maschera, ce sont des rôles secondaires qui portent l’identité même de l’œuvre. Et je dirais son identité historique, sa filiation avec le comique, avec la Commedia dell’Arte, avec l’hétérogénéité particulière de ce conte. Rien de plus terrible que cette histoire qui met en scène de manière sanguinaire Eros et Thanatos. Et pour moi rien de plus fort que ces trois ministres qui expriment leur lassitude, toute humaine, ou qui participent cyniquement du massacre, avec une mécanique musicale toute horlogère : comment Puccini joue-t-il des contrastes ? Ping Pang Pong, c’est la vraie trouvaille de l’œuvre, et de plus si difficile musicalement. Il faut trois voix bien marquées par leur différence, mais pourtant qui « s’emboitent », soulignées par des costumes toujours ou souvent semblables par la coupe mais différents par la couleur (ici par le dessin géométrique du costume) et qui soient en même temps unies par un collectif à la précision millimétrée. Part d’un tout, la voix est triple et presque singulière, une chacune, une pour tous et tous pour une.
Dans cette précision redoutable demandée, j’ai entendu de belles voies singulières, celles de Angelo Veccia (Ping), Roberto Covatta (Pang) et Blagoj Nacoski (Pong) mais un tout aussi singulier manque de précision dans les attaques des ensembles, et pour tout dire des voix qui ne fusionnaient pas, de cette fusion magique qui fait la nature même du trio, qui doit être chantant et dansant et rythmé, c’est à la fois pour moi un motif de surprise et de déception ; vu la direction de Chailly, très millimétrée, on aurait pu s’attendre à un « trio-machine », la machine a eu quelque ratés, mais le principal ne résulte pas du chant, mais de l’union des timbres, pas convaincante, et là, il me semble y avoir un défaut de distribution..
Que conclure de cette Turandot inaugurale, car cette année à la Scala il y a eu l’inauguration de saison (Barenboim, Fidelio), chant du cygne, l’inauguration de la saison EXPO, (Chailly, Turandot), sorte d’aurore aux-doigts-de-rose.
C’est d’abord un spectacle à intention, dans le choix musicologique, dans le soin apporté à la direction musicale, à l’esprit général de la production de Nikolaus Lehnhoff qui a embrassé le souci de Riccardo Chailly (ils y réfléchissaient depuis longtemps et avec Berio lui-même, décédé en 2003) c’est ensuite un spectacle grand public, qui correspond à ce que les italiens appellent le marchio Scala, car l’image qu’il laisse est déterminante pour le théâtre. C’est enfin un spectacle un peu inabouti, à qui il manque sans conteste un vrai Calaf, mais aussi peut-être il manque aussi une véritable homogénéité dans la distribution qui fait les grands spectacles et sans doute quelque chose comme une adhésion qui fait les grandes soirées.
Mais je suis sans doute insupportablement difficile, même si les grandes œuvres ouvrent toujours des abîmes. Ce fut une vraie bonne soirée.[wpsr_facebook]

