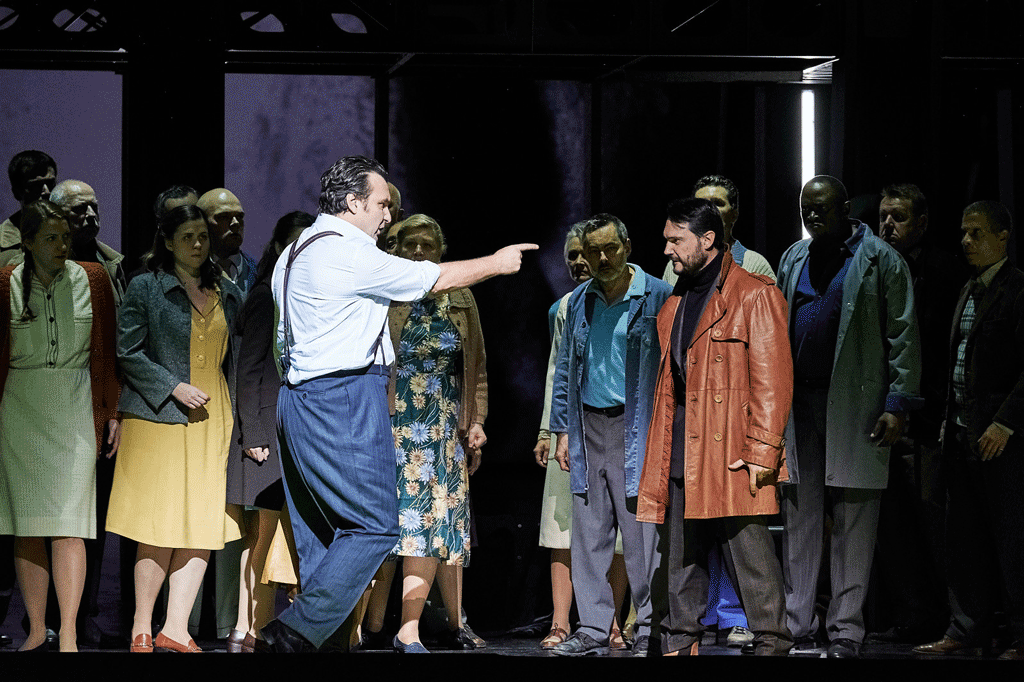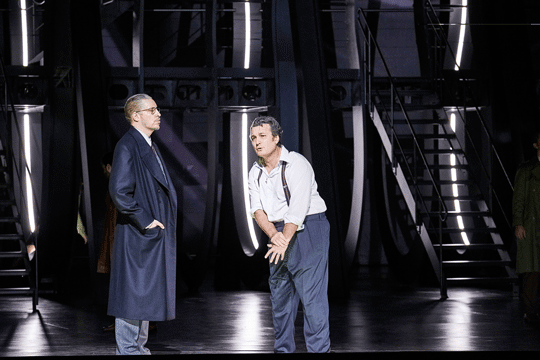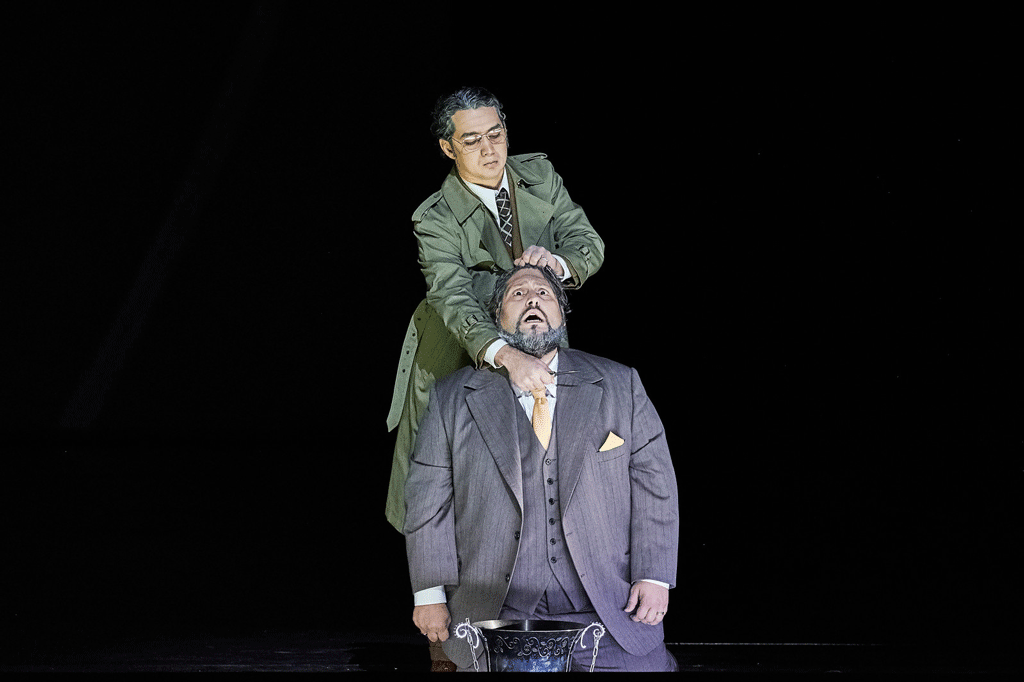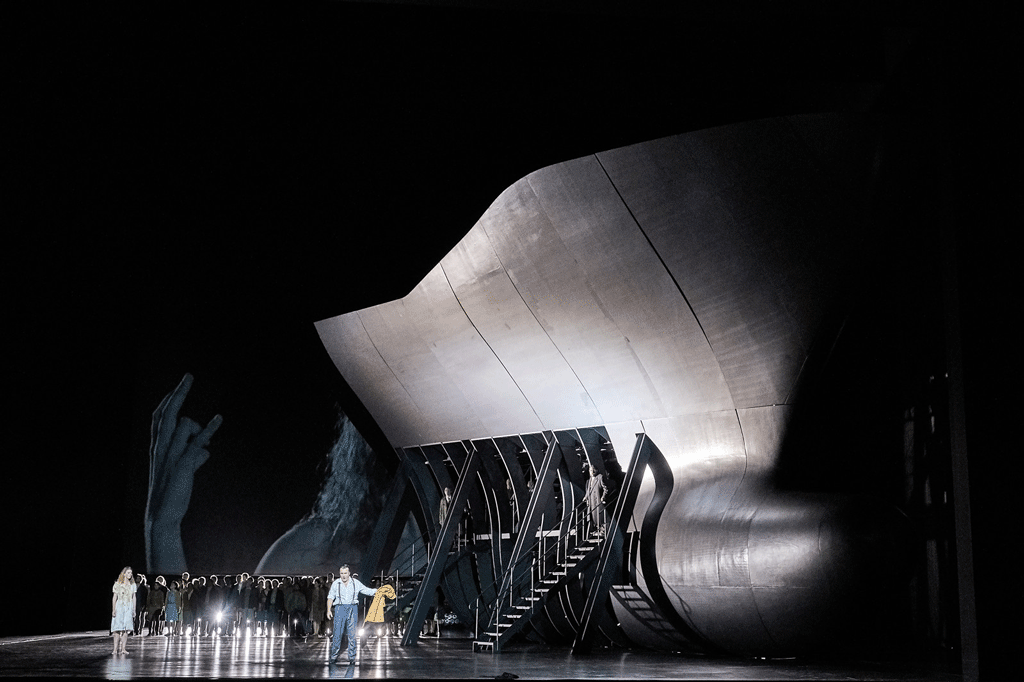Enfin !
Enfin une saison de la Scala qui fait (musicalement) envie, enfin des chefs d’envergure, et 14 productions d’œuvres diverses, qui reflètent le répertoire maison et des titres importants d’autres répertoires. C’est la saison la plus intéressante de la Scala depuis des années.
Dominique Meyer est arrivé en 2020, il lui a fallu trois ans, délai habituel, pour construire une première saison au profil vraiment digne de ce théâtre et de son histoire. Bien sûr les choix de metteurs en scène sont un peu plan-plan, mais on connaît le refus de Dominique Meyer devant des mises en scènes un peu contemporaines ou sortant de la poussière, mais tout de même, arrive à la Scala Christof Loy pour Werther, certes pas un révolutionnaire, mais un metteur en scène vraiment intéressant. De l’autre côté, confier le Ring à David Mc Vicar, ça fait plutôt sourire, un peu has been, et sans aucun intérêt, mais l’intérêt de ce Ring est ailleurs évidemment, avec Thielemann aux commandes, Volle comme Wotan et une somptueuse distribution.
On verra le détail des productions, mais d’emblée saluons deux opérations marquantes, d’abord, deux œuvres jouées pour la première fois dans leur version originale française, Médée et Guillaume Tell et ensuite, le coup de maître de la saison, avoir pour Rosenkavalier réussi à attirer Kirill Petrenko pour sa première sortie à l’opéra en dehors de Baden-Baden depuis qu’il a pris en main les Berliner ! C’est un vrai cadeau et surtout un symbole. Chapeau Meyer !
On connaît le tropisme italien de Kirill Petrenko, régulièrement fidèle à l’Orchestre RAI de Turin et à L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il arrive pour la première fois à la Scala, dans une production qui a fait ses preuves à Salzbourg (avec Welser-Möst) et à la Scala (avec Mehta) et avec deux protagonistes du cast d’origine. C’est un événement incontestable.
Bref, plein d’arguments pour faire des voyages à Milan. Une perspective dont on se réjouit.
SAISON LYRIQUE
Les productions :
Neuf compositeurs italiens, deux allemands, un autrichien et un français composent une saison « typique » de la Scala, qui porte largement le répertoire italien dans sa variété (du baroque au XXe) dans une saison certes diversifiée mais qui reste assez classique en affichant essentiellement des grands standards du répertoire, sans grande prise de risque, mais l’époque ne s’y prête pas à l’opéra comme on le constate un peu partout. On remarque tout de même Il Cappello di Paglia d’Italia de Nino Rota, qu’on n’a pas vu depuis longtemps, ou La rondine, un Puccini plus rare absent de Milan depuis 1994 et surtout L’Orontea de Cesti, un de ces titres à découvrir du baroque italien. Pour le reste, des titres rassurants, des distributions somptueuses, des chefs de niveau ou de très grand niveau. Ne nous plaignons pas et prenons notre plaisir. Au total 10 nouvelles productions et 4 reprises.
Cherubini : 1 production
- Médée (NP)
Cesti : 1 production
- L’Orontea (NP)
Donizetti : 1 production
- Don Pasquale (Reprise)
Mascagni/Leoncavallo : 1 production
- Cavalleria rusticana/Pagliacci (Reprise)
Massenet : 1 production
- Werther (NP)
Mozart : 1 production
- Die Entführung aus dem Serail (Reprise)
Puccini : 2 productions
- Turandot (NP)
- La rondine (NP)
Rossini : 1 production
- Guillaume Tell (NP)
Rota : 1 production
- Il Cappello di paglia di Firenze (NP)
R.Strauss : 1 production
- Der Rosenkavalier (Reprise)
Verdi : 2 productions
- Don Carlo (NP)
- Simon Boccanegra (NP)Wagner : 1 production
- Das Rheingold (NP)
Regard sur la saison
Décembre 2023 – janvier 2024
Giuseppe Verdi
Don Carlo
8 repr. du 7 déc. au 2 janvier (+avant-première jeunes le 4 déc.)
Dir : Riccardo Chailly/MeS : Lluis Pasqual
Avec René Pape, Francesco Meli, Luca Salsi, Ain Anger, Jongmin Park, Anna Netrebko (jusqu’au 22 déc. inclus)/Maria José Siri (30 déc/2 janv), Elina Garança (jusqu’au 22 déc. inclus)/Ekaterina Semenchuk (30 déc/2 janv) etc…
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Version de 1884 en quatre actes
Nouvelle production
Après Naples en 2022 qui a ouvert avec la version en cinq actes, La Scala ouvre avec la version « de Milan » de 1884. C’est respecter la fausse règle d’un opéra écrit pour le lieu parce qu’on connaît les tribulations des versions de l’œuvre. N’y revenons pas. Mais rappelons quand même qu’Abbado après avoir ouvert la saison 1968-69 par la version en quatre actes a ouvert 1977-78 par la version complète en cinq actes avec des musiques jusque-là inconnues, et qu’on est revenu ensuite à la version en quatre actes scaligèrement idiomatique avec Riccardo Muti, lors de la production malheureuse de Franco Zeffirelli, et avec Daniele Gatti dans celle aussi malheureuse de Stéphane Braunschweig
Signalons aussi que la version originale en Français n’a pas encore été présentée à la Scala… Dans une saison où deux des grandes œuvres du répertoire (Médée- Guillaume Tell) sont pour la première fois présentées à la Scala dans leur version originale, peut-être aurait-on pu faire l’effort pour un Don Carlos au lieu d’un Don Carlo, mais sans doute Madame Netrebko n’avait-elle pas vraiment envie d’apprendre le rôle en Français…
Alors forcément, on regrette le choix un peu cheap de la version en quatre actes.
Pour le reste, personne ne contestera la distribution, que les rôles masculins assureront sur toutes les dates, alors que les deux dernières seront assurées par la solide Maria José Siri et par Ekaterina Semenchuk dans Eboli où elle n’a pas convaincu à Florence. Mais qui oserait commenter le duo Netrebko/Garanča qui rappelle une lointaine Anna Bolena viennoise.
Personne ne contestera Riccardo Chailly en fosse, le directeur musical doit défendre le compositeur maison et pour la mise en scène, Dominique Meyer a choisi Lluis Pasqual, qu’on vit beaucoup à Milan dans les années 1980 (il était lié à Giorgio Strehler) et qui a eu une carrière européenne flatteuse. On verra ce qu’il en reste, mais ce ne peut être pire que Stéphane Braunschweig (2008) ou Franco Zeffirelli (1992), avec lesquels on a bien souffert.
On y courra, il faut y courir, malgré les quatre actes.
Janvier 2024
Luigi Cherubini, Médée
6 repr. du 14 au 28 janvier – Dir : Michele Gamba / MeS : Damiano Michieletto
Avec Sonya Yoncheva, Stanislas de Barbeyrac, Nahuel di Pierro, Ambroisine Bré, Martina Russomano
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Nouvelle production
À l’instar de Don Carlos version originale, Médée de Cherubini n’a jamais été présenté à la Scala, qui aussi bien en 1953 avec Leonard Bernstein qu’en 1951 avec Thomas Schippers avait offert le rôle-titre à Maria Callas dans sa traduction italienne très tardive (1909). L’œuvre qui remonte à 1797, est créée originellement comme opéra-comique au Théâtre Feydeau le grand théâtre qui accueillit sous la Révolution les opéras comiques et notamment la Lodoïska du même Cherubini en 1791.
L’opération est donc bienvenue, et découvrir ce chef d’œuvre dans sa langue originale est appréciable, dans une saison marquée par le centenaire de la naissance de Maria Callas en 1923, qui a notamment chanté le rôle, mais l’a aussi interprété au cinéma dans le film de Pier Paolo Pasolini (1969).
Sous la direction de Michele Gamba qui a triomphé à la Scala dans Rigoletto la saison dernière et dans une mise en scène de Damiano Michieletto, la production promet d’être fort intéressante, avec une distribution de grande qualité, à commencer par Stanislas de Barbeyrac en Jason, bien entouré de chanteurs valeureux.
Las, le seul « hic », c’est le rôle-titre, confié à Sonya Yoncheva, sans doute parce qu’elle l’a chanté à Berlin, qu’elle est un nom relativement bankable sur le marché et qu’une Médée (en Français) ne se trouve pas aujourd’hui sous les sabots d’un cheval. À Berlin, elle était particulièrement décevante, ne possédant rien des qualités scéniques et vocales de ce rôle de monstre sacré. Qui a entendu au disque Callas, et vu sur scène Shirley Verrett dans la version Pizzi à Florence ou à Paris dans les années 1980 sait parfaitement que Yoncheva enfile comme souvent un costume bien trop large pour elle. Mais l’œuvre est si rare qu’on ne la manque pas, surtout dans ce théâtre-là.
Février 2024
Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra
7 repr. du 1er au 24 février – Dir : Lorenzo Viotti / MeS : Daniele Abbado
Avec Luca Salsi, Ain Anger, Roberto de Candia, Andrea Pellegrini, Eleinira Buratto (A)/Anita Hartig (N), Charles Castronovo (A)/Matteo Lippi (B)
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Nouvelle production
Même à distance de dizaines d’années, le souvenir de la production Strehler-Abbado avec sa distribution légendaire, reste vivace et les propositions qui ont suivi n’ont jamais convaincu, à la scène comme dans la fosse. Cette production emportée à Vienne dans les bagages de Claudio Abbado fut détruite à l’initiative du team Holender/Wächter dès le départ du chef…
C’est son fils, Daniele Abbado, qui est appelé pour la mise en scène, et son travail ne pourra qu’être meilleur que la production précédente de Federico Tiezzi qui n’a pas vraiment laissé un bon souvenir.
En fosse, Lorenzo Viotti, assez populaire à la Scala tissera de nouveaux fils, mais il n’a pas une fréquentation connue de Verdi.
Dans la distribution, Eleonora Buratto, la meilleure chanteuse italienne pour Verdi sera Amelia en alternance pour les deux dernières avec Anita Hartig, plus habituée à Bohème. Le couple Boccanegra/Fiesco sera Luca Salsi/Ain Anger. Pour ces rôles tellement particuliers, je ne suis pas convaincu de ces choix. Salsi a une grande voix, a été un bon Macbeth et il est considéré comme le meilleur baryton italien aujourd’hui. Il faut peut-être pour Boccanegra une figure au chant plus nuancé. Et Ain Anger de son côté est une grande voix, mais pas très expressive… Reste Charles Castronovo qui sera un bon Gabriele Adorno (le rôle n’est pas si ardu) en alternance avec le plus jeune Matteo Lippi (pour les deux dernières), les deuxièmes distributions servent souvent à lancer de nouvelles voix.
Un ensemble qui malgré Eleonora Buratto, n’arrive pas à convaincre. Mais je suis une vieille chose élevée au lait Strehler-Abbado à Paris, à la Scala et Vienne… Ah si on avait pu reconstituer la production Strehler qui à la vidéo au moins ne vieillit pas…
Février-mars 2024
Wolfgang Amadeus Mozart
Die Entführung aus dem Serail
6 repr. du 24 février au 10 mars – (Dir : Thomas Guggeis/MeS :Giorgio Strehler)
Avec Jessica Pratt, Jasmin Delfs, Daniel Behle, Michael Laurenz, Peter Rose, Sven Eric Bechtolf
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Reprise
Voilà en revanche une reprise qui devrait faire courir. La production légendaire de Giorgio Strehler, venue de Salzbourg passée par Florence et arrivée à la Scala en 1972 n’a pas depuis quitté les programmes. L’œuvre aujourd’hui sent le soufre (on l’a vu à Aix avec la production Kušej) et certains théâtres hésitent même à la programmer ou en changent le livret (à Genève ou Lyon par exemple), entre traitement de la Turquie (Osmin), de l’Islam, et aussi de la femme.
Mais en 1972, on n’y voyait que nostalgie, poésie, mélancolie, sourire et c’est ce qu’offre la production de l’immense metteur en scène qu’était Strehler. En Konstanze, Jessica Pratt, qu’on voit de plus en plus sur les scènes italiennes à ce stade de sa carrière en dehors de son répertoire rossinien ou belcantiste, pour la pyrotechnie de Martern aller Arten. Face à elle en Blonde, une nouvelle venue, tout droit sortie du Studio de l’Opéra de Munich, Jasmine Delfs et dans l’ensemble une distribution parmi les meilleures qu’on puisse trouver (Daniel Behle/Michael Laurenz/Peter Rose) et un clin d’œil de Dominique Meyer à ses « racines » viennoises en appelant Sven-Eric Bechtolf, le metteur en scène (Ring viennois) qui est aussi acteur, en Pacha Selim.
Dans la fosse, un nouveau venu à Milan, Thomas Guggeis, le jeune chef talentueux qui fut l’assistant de Barenboim à Berlin et qui prend ses fonctions de directeur musical à l’opéra de Francfort. Il représente la nouvelle génération germanique qu’il faut suivre.
Voilà une reprise qui a tout pour plaire. Il faut y courir.
Mars-avril 2024
Gioachino Rossini, Guillaume Tell
6 repr. du 20 mars au 10 avril – Dir : Michele Mariotti /MeS : Chiara Muti
Avec Michele Pertusi, Dmitry Korchak, Nahuel di Pierro, Evgeny Stavinsky, Luca Tittoto, Marina Rebeka, Martina Russomanno, Géraldine Chauvet.
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Nouvelle production
Comme pour Médée, c’est la première fois que la Scala propose la version originale de Guillaume Tell, c’est une excellente idée et on ne va pas s’en plaindre. On ne se plaindra pas non plus de la présence en fosse de Michele Mariotti, grand rossinien devant l’Éternel, ni d’une distribution de haut niveau, avec Pertusi, inégalable Tell tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change, Nahuel di Pierro, Luca Tittoto qui sont de beaux chanteurs. Le choix de Dmitry Korchak laisse plus perplexe pour Arnold, alors qu’un John Osborn est encore dans le circuit et aujourd’hui peut-être plus convaincant. Marina Rebeka en Mathilde est un choix solide pour les médias et l’affiche, mais c’est une voix sans véritable prise sur les cœurs et sans grand intérêt musical qui me laisse très indifférent.
Comme Daniele Abbado-fils-de pour Boccanegra, Chiara Muti-fille-de pour Guillaume Tell que son auguste père a dirigé avec succès (en version italienne sur cette même scène il y a un peu plus de trois décennies dans une production spectaculaire de Luca Ronconi). Je ne pense pas que la vérité du théâtre sortira de cette mise en scène, au-delà du gentillet, au vu des spectacles précédents qu’elle a déjà proposés. Mais on ne manque pas un Guillaume Tell…
Avril 2024
Giacomo Puccini, La rondine
6 repr. du 4 au 20 avril – Dir : Riccardo Chailly – MeS : Irina Brook
Avec Mariangela Sicilia, Rosalia Cid, Matteo Lippi, Giovanni Sala, Pietro Spagnoli
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Nouvelle production
L’hirondelle (en italien la rondine) fera donc le Printemps. Riccardo Chailly poursuit son exploration du répertoire puccinien en proposant La rondine, un titre aussi fameux que peu représenté, en tous cas moins que d’autres, alors que l’œuvre a été créée dans les grandes années du compositeur (en 1917, à Montecarlo). Le livret de Giuseppe Adami s’inspire du livret original prévu pour une première à Vienne qui n’eut pas lieu à cause de la première guerre mondiale. Avec Riccardo Chailly en fosse, on peut supposer que cette musique peu connue ( à part l’air Chi il bel sogno di Doretta) retrouvera son lustre et toutes ses couleurs. La distribution est composée de chanteurs plutôt jeunes, la nouvelle génération en marche, avec Mariangela Sicilia, l’un des sopranos les plus prometteurs d’Italie en Magda, et à l’autre bout, le très expérimenté Pietro Spagnoli, en Rambaldo, le vieux protecteur de Magda qu’elle choisit à la fin au lieu d’une vie d’amour avec Ruggero (Matteo Lippi). Mise en scène d’Irina Brook, c’est à dire élégance et discrétion. Il faut résolument y aller, tant l’œuvre est rare.
Avril-mai 2024
Pietro Mascagni/Ruggero Leoncavallo
Cavalleria rusticana/I Pagliacci
9 repr. du 16 avril au 5 mai – Dir : Giampaolo Bisanti – MeS : Mario Martone
Avec :
- (Cavalleria) Elina Garanča (Ekaterina Semenchuk les 30 avril, 2 et 5 mai), Elena Zilio, Brian Jagde, Amartuvshin Enkhbat.
- (I Pagliacci) Irina Lungu, Fabio Sartori, Amartuvshin Enkhbat, Mattia Olivieri, Jinxu Xiahou
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Reprise
9 représentations, c’est une reprise tiroir-caisse (les prix en conséquence…) essentiellement organisée autour de la figure d’Elina Garanča en Santuzza, qui devrait être impressionnante. On y retrouve en Mamma Lucia la légende Elena Zilio, Amartuvshin Enkhbat en puissant Alfio et avec le Turiddu sans charisme mais sonore de Brian Jagde.
Fête vocale également autour de Fabio Sartori en Alfio de Pagliacci, bien entouré par Mattia Olivieri et Amartuvshin Enkhbat.
Aucun souci pour la fréquentation du public avec de tels noms et dans la mise en scène solide de Mario Martone. En fosse Giampaolo Bisanti, passable, suffisant pour une reprise de répertoire où ce n’est pas le chef qui fera événement.
Mai-juin 2024
Gaetano Donizetti, Don Pasquale
6 repr. du 11 mai au 4 juin – Dir : Evelino Pido’/MeS : Davide Livermore
Avec Andrea Carroll, Ambrogio Maestri, Lawrence Brownlee, Mattia Olivieri
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Reprise
Una saison sans Davide Livermore n’est pas une vraie saison à la Scala (ni ailleurs en Italie d’ailleurs) dans une mise en scène qui n’est pas l’une de ses plus mauvaises. La création avait été assurée par Chailly, c’est Evelino Pido’ qui assure la reprise… sic transit. Une distribution très solide, (Maestri, Brownlee, Olivieri) avec en Norina une nouvelle venue, l’américaine Andrea Carroll qui a été en troupe à Vienne aux temps de Dominique Meyer
Juin-juillet 2024
Jules Massenet, Werther
6 repr. du 10 juin au 2 juillet – Dir : Alain Altinoglu – MeS : Christof Loy
Avec Benjamin Bernheim, Victoria Karkacheva, Francesca Pia Vitale, Jean-Sébastien Bou, Armando Noguera, Rodolphe Briand etc..
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Nouvelle production
Coproduction avec Théâtre des Champs Élysées, Paris
Nouvelle production avec en fosse Alain Altinoglu qui garantit un Massenet idiomatique et coloré et dans une mise en scène de Christof Loy, un metteur en scène qu’on n’attendrait pas à la Scala en ce moment, mais qui sans être un révolutionnaire, est un vrai metteur en scène de théâtre, solide, avec des idées souvent intelligentes. Une Charlotte russe, Victoria Karkacheva, qu’on a vue notamment à Lyon et Munich (où elle est en troupe), voix solide, expressive, et belle actrice engagée. En face, Benjamin Bernheim le ténor le plus en vue pour ce répertoire, bien meilleur chanteur qu’acteur, mais quel timbre ! Jean-Sébastien Bou sera Albert. Tout cela pour dire que les ingrédients sont réunis pour un très beau Werther, une œuvre très aimée à Milan.
Giacomo Puccini, Turandot
7 repr. du 25 juin au 15 juillet – Dir : Daniel Harding / MeS : Davide Livermore
Avec Anna Netrebko, Yusif Eyvazov/Roberto Alagna (9, 12, 15 juil.), Rosa Feola, Raül Giménez, Vitalij Kowaljow etc…
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Nouvelle production
On est rassuré, Davide Livermore se voit confier une nouvelle production, Turandot, dont on imagine que cet apôtre de la superficialité insignifiante en mettra plein les yeux. C’est une nouvelle production peut-être évitable dans la mesure où la dernière, de Nikolaus Lehnhoff (décédé peu après) remonte à 2015 seulement. En fosse Daniel Harding, ce qui est toujours intéressant. Mais c’est bien sûr la distribution qui attire l’attention avec Anna Netrebko en Turandot, le mari Yusif Eyvazov en Calaf, et la délicieuse Rosa Feola en Liù. Mais l’autre événement, ce sont les trois dernières représentations assurées par Roberto Alagna en Calaf, qui revient à la Scala après des années d’absence suite à une Aida fatale plus que céleste. Inutile de souligner qu’un petit week-end estival à Milan s’impose aux fans, à combiner avec Werther si possible.
Septembre 2024
Nino Rota, Il Cappello di paglia di Firenze
5 repr. du 4 au 18 septembre – Dir : Donato Renzetti / MeS : Mario Acampa
Avec les solistes de l’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala
Nouvelle production
Un peu comme à Munich avec la production du Studio, la production de l’Accademia est toujours intéressante dans la mesure où l’on peut espérer repérer des voix nouvelles et des futures belles carrières, et que le théâtre ne lésine pas sur les moyens mis en œuvre, avec en fosse un chef aussi sûr et éprouvé que Donato Renzetti, tout en offrant à un jeune metteur en scène, Mario Acampa, déjà animateur et metteur en scène à la Scala des projets pour les enfants, l’occasion de travailler avec des chanteurs en formation toujours plus disponibles,. L’œuvre de Nino Rota, tirée de Labiche, est une farce souriante qui par sa fraîcheur s’adapte parfaitement à un travail avec de jeunes chanteurs, et permet d’effectuer la rentrée lyrique de manière sereine et optimiste, d’autant qu’elle manque dans les programmes depuis 1998.
Septembre-Octobre 2024
Antonio Cesti, L’Orontea
5 repr. di 26 sept. au 5 oct – Dir : Giovanni Antonini/MeS : Robert Carsen
Avec Stéphanie d’Oustrac, Mirco Palazzi, Hugh Cutting, Francesca Pia Vitale, Carlo Vistoli, Luca Tittoto, Sara Blanch, Marianna Pizzolato.
Orchestre du Teatro alla Scala
Nouvelle production
Né à Arezzo et mort à Florence, Antonio Cesti (1623-1669) n’a pas passé pourtant sa vie en Toscane, mais a commencé une carrière de moine franciscain, bientôt bousculée par son engagement musical comme chanteur et compositeur (il sera d’ailleurs relevé de ses vœux), notamment comme maître de Chapelle à Innsbruck puis à Vienne. L’Orontea de 1656 a d’ailleurs été composée pour Innsbruck.
Après La Calisto (Cavalli) e Li Zite n’galera (Vinci), la Scala explore sous Meyer de nouveau un répertoire moins connu, même si l’opéra de Cesti avait été proposé en 1961 à la Piccola Scala, idéale pour ce type d’œuvre, et malheureusement engloutie dans les restaurations de l’an 2000.
Avec Giovanni Antonini en fosse, on a la garantie d’un travail approfondi et efficace et Robert Carsen, très aimé en Italie, réussit souvent mieux qu’ailleurs dans les œuvres baroques. La distribution est particulièrement solide, autour de Stéphanie d’Oustrac on relève des noms d’artistes qui ont émergé très favorablement ces dernières années (Sara Blanch, Carlo Vistoli, Luca Tittoto, Marianna Pizzolato).
Si vous aimez découvrir des œuvres peu connues…
Octobre 2024
Richard Strauss, Der Rosenkavalier
6 repr. du 12 au 26 octobre 2024 – Dir : Kirill Petrenko/MeS : Harry Kupfer
Avec Krassimira Stoyanova, Kate Lindsey, Günther Groissböck, Sabine Devieilhe, Tanja Ariane Baumgartner, Gerhard Siegel, Johannes Martin Kränzle, Caroline Wenborne
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Nouvelle production
Coproduction avec les Salzburger Festspiele
La belle production du regretté Harry Kupfer, qui remonte déjà à 2014 sera l’écrin somptueux d’une reprise qui a le parfum des grandes premières, même si la distribution allie celle de l’origine soit Krassimira Stoyanova et Günther Groissböck, et de nouvelles venues Sabine Devieilhe (qu’on attend avec impatience en Sophie) et Kate Lindsey en Octavian. Ils seront entourés pour l’occasion de rien moins que Johannes Martin Kränzle en Faninal, Gerhard Siegel et Tanja Ariane Baumgartner en Valzacchi et Annina, et un « vrai » chanteur italien, Piero Pretti.
Mais en l’occurrence, même avec cette belle distribution, toutes les oreilles seront tendues vers la fosse, où pour la première fois officiera Kirill Petrenko, dans un de ses opéras fétiches où il fit tomber de tous les balcons le public munichois…
Inutile de souligner qu’il faut dès maintenant programmer une virée milanaise.
Octobre-novembre 2024
Richard Wagner, Das Rheingold (Der Ring des Nibelungen)
6 repr. du 28 oct. au 10 nov. – Dir : Christian Thielemann/MeS : David Mc.Vicar
Avec Michael Volle, Andrè Schuen, Norbert Ernst, Johannes Martin Kränzle, Wolfgang Ablinger Sperrhacke, Jongmin Park, Ain Anger, Okka von der Damerau, Olga Bezsmertna, Christa Mayer etc…
Orchestre du Teatro alla Scala
Nouvelle production
En trente ans, c’est le troisième Ring programmé par la Scala, dans une maison où a officié dès 1951 l’immense Furtwängler dont il reste des traces audio notables. Dix ans après Barenboim/Cassiers, voici revenu le temps du classicisme, avec
un Christian Thielemann qui revient dans une fosse italienne (il fut dans sa jeunesse très fréquent en Italie, et très apprécié) après des décennies et qui cette saison a promené sa vision si ciselée musicalement entre Dresde et Berlin, qui reste fascinante même si on peut lui préférer d’autres approches plus dramatiques – mais ne chipotons pas- et qui arrivera à Milan pour sa première apparition dans la fosse du Piermarini. Du classique à prévoir aussi dans l’approche de David McVicar sans doute moins dérangeante que Cassiers et naturellement de tous les Ring nés ces dernières années de Bayreuth à Berlin ou qui s’apprêtent à naître à Bruxelles (Castellucci) et Munich (Kratzer).
La distribution n’offre aucune espèce de discussion, on y trouve la crème du chant wagnérien – même si j’ai un petit doute sur Olga Bezsmertna en Freia, mais entre Michael Volle en Wotan, Johannes Martin Kränzle en Alberich et tous les autres dont Okka von der Damerau en Fricka, il y a de quoi satisfaire le plus difficile des wagnériens.
Allez, prenez un abonnement d’automne sur Trenitalia pour filer à Milan plusieurs fois entre septembre et novembre.
La saison lyrique reflète l’évolution de ce théâtre qui est en train d’achever sa mue, retrouvant une fréquentation qui tourne autour de 90%, travaillant sur la cité par des initiatives assez nombreuses : n’oublions pas que le public de la Scala, comme disait Lissner, habite dans un rayon de 4 km autour du théâtre et qu’avant d’être un phare international de l’opéra, c’est un théâtre local, que j’aime à l’appeler affectueusement le plus grand théâtre de province du monde.
On y développe donc les aspects numériques (nouveau site à peine ouvert), développement de la plateforme de Streaming La Scala.tv et achèvement des travaux commencés en 2001 avec la création de nouveaux espaces de répétitions (Ballet et orchestre) et de bureaux sur la Via Verdi (à droite quand on regarde la façade), avec tout de même les regrets éternels constitués par la perte de la Piccola Scala, dont la fonction n’a pas été remplacée et qui reste à mon avis une erreur fondamentale du projet de restauration.
Le théâtre va mieux et se relève des crises consécutives au Covid 19 et au départ chaotique d’Alexander Pereira. Qui s’en plaindrait ? Surtout pas celui qui écrit et qui a fait de ce théâtre son quotidien d’amour lorsqu’il vivait à Milan.
Alors la programmation lyrique est bien étayée aussi par celle du ballet, désormais dirigé par Manuel Legris que Dominique Meyer a emporté dans ses valises en venant de Vienne, et celle, très riche, des concerts divers qui sont dans l’histoire de la Scala, on le sait moins, un des axes porteurs de la maison, notamment depuis le passage de Claudio Abbado à la direction musicale qui était très attentif à ce qu’on appelait alors la saison symphonique (qui remplissait l’automne, en attendant l’ouverture de saison du 7 décembre).
LE BALLET
(contribution de Jean-Marc Navarro)
S’il est encore un peu tôt pour conceptualiser l’approche de programmation de Manuel Legris, la cure administrée à la Compagnie depuis son entrée en fonction il y a deux ans et demi se structure autour d’un mantra simple : “le plus de longs ballets classiques tu danseras”. La saison 2024 en est une illustration éloquente, qui sera lancée 10 jours après la Saint-Ambroise par une nouvelle production de Coppélia reconstruite, excusez du peu, par Alexei Ratmansky, à qui on doit tant de versions “historiquement informées” de ballets du XIXème siècle. Peu de choses ont filtré sur ce qui attend le balletomane et les sources qu’utilisera l’érudit pétersbourgeois, mais cela donne d’ores et déjà l’eau à la bouche.
La production parisienne de La Bayadère, que Manuel Legris avait fait venir à La Scala en 2021, sera ensuite reprise, avant que la part belle soit laissée à deux hits narratifs. Occasion tout d’abord de fêter les 50 ans de la création de L’histoire de Manon de MacMillan. Puis dans La dame aux camélias, est déjà annoncé l’extraterrestre Roberto Bolle qui à 49 ans assurera le très périlleux rôle d’Armand (!). Il apparaîtra également dans la reprise de la très ambitieuse commande qui avait été faite en 2021 à Fabio Vacchi en support d’un ballet “full-length” de Mauro Bigonzetti, Madina. De même que pour La Bayadère, voilà une belle idée que de reprendre des œuvres nouvellement entrées au répertoire pour les inscrire dans les esprits et dans les corps.
Une soirée de créations contemporaines est prévue autour de Garrett Smith, Leon/Lighfoot et Simone Valastro. Du contemporain peu hardcore et peu conceptuel dont on attend avec impatience la création de Valastro, qui a déjà commis des œuvres étourdissantes, dont Stratégie de l’hippocampe, sa première chorégraphie, pour l’Opéra de Paris à l’époque. Second triptyque programmé, exigeant : une soirée autour de classiques absolus de George Balanchine (Thème et variations) et Jerome Robbins (Dances at a gathering, The Concert).
L’École de danse du Teatro alla Scala aura droit à une soirée tandis que Legris, qui avait mis en place à Vienne ses Galas Noureev annuels, perpétue sa tradition avec un Gala Fracci désormais inscrit dans le paysage des saisons de danse milanaises.
Plein de belles choses, intelligemment agencées, de nature à permettre à la Compagnie de continuer de progresser.
Les festivaliers juilletistes pourront se faire une première idée des fruits de la “ligne Legris” en allant à Orange le 15 juillet, le programme s’annonçant à son image : mélange de l’académique (acte II du Lac des cygnes), de contemporain classico-sage (Verdi Suite de Legris soi-même), de la création avec Philippe Kratz.
CONCERTS et RÉCITALS
La saison symphonique
Aujourd’hui, et depuis bien des années, l’automne (septembre-novembre) jadis dédié à la saison symphonique est la fin de la saison lyrique tandis que la saison symphonique est distribuée sur toute l’année, entre concerts de l’orchestre de la Scala, de la Filarmonica de la Scala (fondée en 1982 par Claudio Abbado), des concerts associés à des événements spéciaux (appelés concerts extraordinaires, des invitations d’orchestres étrangers et des récitals). En outre s’est développée une saison de chambre, avec de nombreux concerts des musiciens de l’orchestre en formation de chambre, qui enrichit le paysage à un horaire inhabituel (le dimanche à 11h) continuant à faire de la Scala le centre musical névralgique d’une ville de Milan qui n’a pas en dehors de la Scala d’orchestre de prestige puissant comme l’Orchestra Sinfonica nazionale della RAI (pour Turin) ou l’Accademia di Santa Cecilia (pour Rome), même s’il y a des institutions symphoniques et des sociétés musicales historiques qui animent et complètent la vie musicale de la ville.
Sept programmes de concerts « ordinaires » irriguent la saison, avec au pupitre de l’Orchestre della Scala ou de la Filarmonica, outre Riccardo Chailly (trois programmes), Ingo Metzmacher, Daniel Harding, Daniele Gatti (qui reviendra diriger en 2025 un opéra…), Lorenzo Viotti.
Par ailleurs, Riccardo Chailly à qui l’on reproche de ne pas diriger beaucoup d’opéra est très présent au niveau du symphonique, aussi bien pour les concerts « ordinaires » qu’extraordinaires. Il faut noter la diversité des programmes, l’intérêt des solistes et quelques concerts exceptionnels comme les Gurre-Lieder, sans doute programmés à cause de la présence à Milan pour le Ring de la fine fleur du chant allemand, un concert auquel on pourra difficilement résister. Mais aussi bien la Symphonie n°9 de Mahler dirigée par le grand mahlérien qu’est Daniele Gatti qu’un Requiem de Mozart confié à la baguette de Daniel Harding avec une distribution jeune sont des arguments à ne pas négliger non plus.
Novembre 2023
9, 11 et 14 novembre
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Direction : Riccardo Chailly
Schubert : Symphonie n°4 en ut min. D 417 “Tragique”
Verdi : Quattro pezzi sacri
Chef de chœur : Alberto Malazzi
Janvier 2024
22, 24, 25 janvier
Filarmonica della Scala
Direction : Ingo Metzmacher
Luigi Nono : Como una ola de fuerza y luz
pour soprano, piano, orchestre et bande magnétique
Dimitri Chostakovitch : Symphonie n°4 en ut min. op. 43
Pierre Laurent Aimard, piano
Serena Saenz, soprano
Paolo Zavagna, régie sonore
Février 2024
19, 22, 23 février
Filarmonica della Scala
Direction : Lorenzo Viotti
Nikolai Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol op.34
Maurice Ravel : Concerto en sol
Serguei Rachmaninov : Danses symphoniques op.45
David Fray, piano
Avril 2024
22, 24, 27 avril
Filarmonica della Scala
Direction : Daniele Gatti
Gustav Mahler : Symphonie n°9 en ré majeur
Mai 2024
27, 29, 30 mai
Filarmonica della Scala
Direction : Riccardo Chailly
Arnold Schönberg : Verklärte Nacht, pour orch. à cordes
Anton Webern : Passacaille op.1
Alban Berg : Trois fragments de Wozzeck op.7, pour soprano et orchestre
Marlis Petersen, soprano
Juin-juillet 2024
29 juin, 3, 5, juillet
Direction : Daniel Harding
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Chef du chœur : Alberto Malazzi
Wolfgang Amadeus Mozart : Requiem en ré min. K.626
Rosa Feola, soprano
Cecilia Molinari, mezzosopeno
Giovanni Sala, ténor
Adam Platchetka, basse
Septembre 2024
13, 16, 17 septembre
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Direction : Riccardo Chailly
Chef du chœur : Alberto Malazzi
Chor des Bayerischen Rundfunks
Chef de chœur : Peter Dijkstra
Arnold Schönberg, Gurre-Lieder, pour solistes, chœur et orchestre
Waldemar : Andreas Schager
Tove : Camilla Nylund
Waldtaube : Okka von der Damerau
Bauer/Sprecher : Michael Volle
Klaus/Narr : Norbert Ernst
Concerts extraordinaires
Les concerts extraordinaires marquent un moment singulier ou célèbrent des anniversaires, et il y en a trois cette saison (Neuvième de Beethoven, Requiem de Verdi, Mort de Puccini). Ils donnent par exemple l’occasion de réunir Jonas Kaufmann et Anna Netrebko pour un ensemble d’extraits pucciniens rares, d’entendre une Alcina en version de concert et surtout The Fairy Queen en version semi-scénique chorégraphiée par Mourad Merzouki, avec Les Arts Florissants et William Christie. Pour le reste, entre une Neuvième de Beethoven et un Requiem de Verdi, le milanais a de quoi remplir son carnet de concerts, d’autant que la saison symphonique offre aussi le Requiem de Mozart et les Gurre-Lieder…
1er décembre 2023
Jansen/Maiski/Argerich
Musiques de Chostakovitch et Tchaïkovski
Janine Jansen, violon
Misha Maiski, violoncelle
Martha Argerich, piano
23 décembre 2023
Concert de Noël
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Dir : Daniel Harding
L.v.Beethoven : Fantaisie en ut mineur op.80 pour piano, solistes, chœur et orchestre
Johannes Brahms : Symphonie n°2 en ré majeur op.36
Chef de chœur : Alberto Malazzi
8 février 2024
Les Musiciens du Louvre
Dir : Marc Minkowski
Georg Friedrich Haendel, Alcina, en version concertante
Alcina : Magdalena Kožená
Morgana : Erin Morley
Bradamante : Elizabeth Deshong
Ruggero : Anna Bonitatibus
Oronte : Valerio Contaldo
Melisso : Alex Rosen
29 avril 2024
Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala
Dir : Marco Armiliato
Airs français de Donizetti, Meyerbeer, Rossini, Massenet, Gounod
Lisette Oropesa, soprano
Benjamin Bernheim, ténor
7 mai 2024
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Dir : Riccardo Chailly
Pour le bicentenaire de la première exécution
L.v.Beethoven : Symphonie n°9 pour solistes, chœur et orchestre
Olga Bezsmertna, soprano, Wiebke Lehmkuhl, mezzosoprano
Benjamin Bruns, ténor, Markus Werba, baryton
Chef de chœur : Alberto Malazzi
23 mai 2024
Chiesa di San Marco
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Dir : Riccardo Chailly
Pour le 150e anniversaire de la première exécution, el 22 mai 1874 à la Chiesa di San Marco
Giuseppe Verdi : Messa da requiem pour solistes, chœur et orchestre
Marina Rebeka, soprano, Vasilisa Berzhanskaia, mezzosoprano
Freddie De Tommaso, ténor, Alexander Vinogradov, basse
Chef de chœur : Alberto Malazzi
30 juin 2024
Les Arts Florissants
Dir : William Christie
Henry Purcell : The Fairy Queen, version semi-scénique
Chorégraphie et mise en espace : Mourad Merzouki
29 novembre 2024
Orchestre et chœur du Teatro alla Scala
Chœur d’enfants du Teatro alla Scala
Dir : Riccardo Chailly
Chef de chœur : Alberto Malazzi
Chef du chœur d’enfants : Bruno Casoni
Pour le centenaire de la mort de Giacomo Puccini
Anna Netrebko, soprano
Jonas Kaufmann, ténor
Programme
- de Le villi
“La tregenda” intermezzo symphonique - Requiem
pour chœur mixte, alto et orgue - Crisantemi
Version pour orchestre à cordes - de Madama Butterfly
Acte II, Introduction
pour chœur et orchestre - de Edgar
Acte III, Prélude
Requiem aeternam
pour chœur, orchestre et chœur d’enfants - Preludio Sinfonico
- de Manon Lescaut
Intermezzo
Acte IV
Concerts d’orchestres invités
Quatre prestigieuses phalanges de passage à Milan, dont on retiendra notamment le retour de Riccardo Muti à la tête du Chicago Symphony Orchestra dans un programme incluant même Philip Glass, et la présence d’ Esa-Pekka Salonen, très aimé à Milan, dans un programme Sibelius-Bartók. Une Passion selon saint Mathieu par Herreveghe et le Collegium vocale de Gand, et le Royal Concertgebouw dans un programme plus classique (Mozart Bruckner) dirigé par Myung-Whun Chung.
21 janvier 2024
Royal Concertgebouw Orchestra
Dir : Myung-Whun Chung
W.A.Mozart, concerto n°17 en sol majeur K 453 pour piano et orchestre
Emanuel Ax, piano
Anton Bruckner, Symphonie n°7 en mi majeur
27 janvier 2024
Chicago Symphony Orchestra
Dir : Riccardo Muti
Philip Glass, The Triumph of the Octagon
Igor Stravinski, Suite de L’Oiseau de feu (1919)
Richard Strauss, Aus Italien, fantaisie symphonique en sol majeur op.16
25 mars 2024
Collegium Vocale Gent
Dir : Philippe Herreveghe
Bach, Matthäus-Passion BWV 244
9 novembre 2024
Philharmonia Orchestra
Dir : Esa-Pekka Salonen
Jean Sibelius, Symphonie n°1 en mi min. op.39
Béla Bartók, Concerto pour orchestre
Récitals
Du côté des récitals, c’est le répertoire d’opéra qui est privilégié avec Flórez, Feola, Alagna pour son grand retour, plus diversifié avec Garanča et Oropesa, et la promesse d’une grande soirée de Lieder avec Christian Gerhaher dans un programme Brahms. On doit souligner qu’à un moment où cette forme n’est plus guère prisée en France (il fut un temps où de grandes stars donnaient des récitals à Garnier, mais cet heureux temps n’est plus), la Scala maintient la tradition, et la consolide, profitant quelquefois du passage des chanteurs à l’occasion d’une production.
18 décembre 2023
Juan Diego Flórez, ténor
Vincenzo Scalera, piano
Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi
5 février 2024
Christian Gerhaher, baryton
Gerold Huber, piano
Brahms
11 mars 2024
Elina Garanča, mezzosoprano
Malcom Martineau, piano
Brahms, Berlioz, Saint-Saëns, Gounod, Tchaïkovski, Rachmaninov, Chapí
24 mars 2024
Rosa Feola, soprano
Fabio Centanni, piano
Gluck, Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi
19 mai 2024
Lisette Oropesa, soprano
Beatrice Benzi, piano
Mercadante, Bellini, Donizetti, Schubert, Rodrigo, Nin, De Falla, Sorozábal, Barbieri
24 juin 2024
Roberto Alagna, ténor
Jeff Cohen, piano
Wagner, Massenet, Verdi, Leoncavallo, Moniuszko, Tchaïkovski, Pergolesi, Saint-Saëns
Grands pianistes à la Scala
La tradition, là encore, du grand récital de piano à la Scala (il y a aussi la salle alternative du Conservatoire Verdi qui en offre quelquefois). C’est à la Scala qu’à la grande époque Maurizio Pollini rencontrait régulièrement son public dont on espère que sa santé lui permettra d’assurer le concert prévu, c’est à la Scala que j’entendis pour une seule et unique fois Vladimir Horowitz. Les noms réunis allient les grandes stars (Trifonov, Pollini, Grimaud) et la nouvelle génération en phase de starification comme la magnifique Beatrice Rana et Alexandre Kantorow qui brûle les planches et les claviers.
31 janvier 2024
Daniil Trifonov
3 juin 2024
Hélène Grimaud
13 octobre 2024
Beatrice Rana
20 octobre 2024
Maurizio Pollini
19 novembre 2024
Alexandre Kantorow
Musique de chambre
Au grand Foyer « Arturo Toscanini » du Teatro alla Scala les dimanches à 11h
J’ai voulu m’attarder sur cette série de concerts déjà programmés la saison actuelle et qui me semblent déterminants à plusieurs niveaux.
- D’abord, c’est évident, ces concerts mettent en valeur les membres de l’orchestre et du chœur et leur permettent de se confronter à des répertoires divers, tant la variété des programmes est marquée
- L’horaire, le dimanche à 11 h, casse un peu les rituels d’un théâtre qui en a beaucoup et surtout la réponse très forte du public montre que l’offre a répondu à une demande.
- Elle permet aussi à un prix très raisonnable (24€) d’accéder à la Scala pour un public peut-être moins habitué, et pour des concerts de grande qualité. C’est aussi un moyen d’élargir le public.
- C’est ce type de manifestation qui permet de tisser des rapports avec la cité, avec le public potentiel, des rapports de fidélité (il y a onze concerts…) qui pourront amener les publics moins habitués aux concerts symphoniques (prix maximum 110€) ou aux récitals de chant (Prix maximum 60€) puis à l’opéra, plus sélectif (prix maximum s’échelonnant entre 250 et 300 € la place d’orchestre selon les titres).
10 décembre 2023
Quatuor à cordes du Teatro alla Scala
Beethoven
Francesco Manara, violon
Daniele Pascoletti, violon
Simonide Bracconi, alto
Massimo Polidori, violoncelle
21 janvier 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Brahms/Schumann
Francesco De Angelis, violon
Sandro Laffranchini, violoncelle
Roberto Paruzzo, piano
23 février 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Ravel / Fauré / Respighi
Indro Borreani, violon
Olga Zakharova, violon
Giuseppe Russo Rossi, alto
Julija Samsonova, mezzosoprano
Michele Gamba, piano
10 mars 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Mozart / Brahms
Alexia Tiberghien, violon
Evgenia Staneva, violon
Francesco Lattuada, alto
Carlo Maria Barato, alto
Simone Groppo, violoncelle
24 mars 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Halvorsen / Boccherini / Pergolesi
Enkeleida Sheshaj, violon
Andrea del Moro, violon
Elena Faccani, alto
Beatrice Pomarico, violoncelle
Attilio Corradini, contrebasse
Giorgio Martano, orgue positif
Barbara Rita Lavarian, soprano
Maria Miccoli, mezzosoprano
7 avril 2024
Percussionistes du Teatro alla Scala
Philip Glass
Gianni Massimo Arfacchia, Giuseppe Cacciola, Gerardo Capaldo, Francesco Muraca
Percussions
28 avril 2024
Choristes féminines du chœur du Teatro alla Scala
Brahms / Rheinberger / Andrès / Holst
Direction : Alberto Malazzi
Margherita Chiminelli, Critina Injeong Hwang, Cristina Sfondrini, Nadia Engheben, Srah Park, Silvia Spurzzola
Sopranos
Marzia Castellini, Alessandra Fratelli, Romina Tomasoni
Messosopranos
Eleonora Adigo, Maria Miccoli, Daniela Salvo
Contraltos
Giovanni Emanuele Urso, cor
Giulia Montorsi, cor
Luisa Prandina, harpe
19 mai 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Mozart, Beethoven
Laura Marzadori, violon
Eugenio Silvestri, alto
Martina Lopez, violoncelle
22 septembre 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Poulenc / Verdi / Puccini
Giovanni Emanuele Urso, cor
Marco Toro, trompette
Daniele Morandini, trombone
Nelson Calzi, piano
20 octobre 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Strauss / Zemlinsky / Korngold
Agnese Ferraro, violon
Lucia Zanoni, violon
Duccio Beluffi, alto
Joel Imperial, alto
Gianluca Muzzolon, violoncelle
Beatrice Pomarico, violoncelle
10 novembre 2024
Musiciens de l’orchestre du Teatro alla Scala
Schubert / Brahms / Bottesini
Giuseppe Ettorre, contrebasse
Pierluigi Di Tella, piano
17 novembre 2024
Quatuor à cordes du Teatro alla Scala
Beethoven
Francesco Manara, violon
Daniele Pascoletti, violon
Simonide Bracconi, alto
Massimo Polidori, violoncelle
Pour les enfants
La Scala a toujours eu une vraie tradition de relation au public enfantin et avec les écoles, dont jadis le responsable fut une figure historique du théâtre d’une exceptionnelle longévité.
La programmation pour les enfants s’est désormais très étoffée, avec une offre double,
1) des opéras pour enfants (prix maxi : 48€ mais 1€ pour les moins de 18 ans)
– 27 octobre 2023 : Il piccolo principe (Le petit Prince ) de Pierangelo Valtinoni, (MeS Polly Graham)
– 11 février 2024 : Il piccolo Spazzacamino (Le petit ramoneur) de Benjamin Britten (MeS Lorenza Cantini)
Outre ces deux représentations, d’autres sont organisées pour public captif (écoles etc…)
2) des concerts animés et commentés (prix maxi : 18 € mais 1€ pour les moins de 18 ans) avec une programmation thématisée (par exemple, autour de Vivaldi et d’Arlequin pour le premier concert du 28 janvier 2024), sous la responsabilité de Mario Acampa, aussi chargé de la mise en scène du Cappello di Paglia di Firenze de Nino Rota, spectacle de l’Accademia (Septembre 2024) pendant la saison lyrique.
Cette année, la saison des concerts pour les enfants ouvrira le 20 octobre 2023 par un concert exceptionnel des sœurs Katia et Marielle Labèque (au progr. Saint-Saëns, Carnaval des animaux, Ravel, Ma mère l’Oye) (prix maxi : 48€ mais 1€ pour les moins de 18 ans)
À noter que toutes les représentations ont lieu dans la grande salle de la Scala, la salle de Piermarini, ce qui pour un très jeune public, constitue un souvenir sans doute très fort.
Conclusion
J’ai voulu cette année proposer un panorama à peu près complet de toutes les activités du Teatro alla Scala, dont le statut à Milan est un peu particulier puisqu’il porte à la fois la saison lyrique et de ballet, mais aussi une large part de la programmation symphonique de la cité, dont le reste se divise entre plusieurs institutions moins puissantes.
Les saisons symphoniques sont toujours attirantes et variées, et celle-ci ne fait pas exception, mais la saison lyrique est passée à une vitesse supérieure, non pas tant par les distributions, la plupart du temps soignées, mais par les chefs puisqu’on annonce la présence des deux plus grands chefs opérant en Allemagne, Kirill Petrenko et Christian Thielemann, mais aussi d’Aiain Altinoglu pour la première fois à la Scala, ou Daniel Harding et Lorenzo Viotti, aimé du public milanais, le prometteur Thomas Guggeis, sans oublier Michele Mariotti, directeur musical à Rome, et évidemment Riccardo Chailly qui outre les deux opéras, dirigera un certain nombre de grands concerts.
J’ai suffisamment commenté les saisons précédentes avec amertume pour saluer celle-ci, qui fait très envie musicalement par la variété des œuvres et la qualité des interprètes.
Il reste la question des mises en scène, où l’imagination semble s’être arrêtée au seuil du théâtre.
Certes le public milanais est conservateur – comme est frileuse toute l’Italie face au théâtre et à la mise en scène, oubliant qu’elle a produit Visconti, Strehler, Ronconi ou qu’elle produit encore Castellucci dans le monde entier (moins en Italie), Pippo Delbono et Emma Dante.
Certes Dominique Meyer affiche une attitude résolument rétrograde en la matière, une posture longuement construite, et dommageable dans la mesure où sans appeler tout le Regietheater de la terre ou ce qu’il en reste, quelques noms d’aujourd’hui pourraient donner de la couleur à un paysage terne, au mieux sage et élégant (Irina Brook, Daniele Abbado, Mario Martone – pour une reprise), comme si la mise en scène n’avait rien à dire des œuvres : Mc Vicar dans le Ring « fa ridere i polli » (comme on dit en Italie). Certes enfin, Christof Loy fera Werther, ce qui est intéressant, certes, le regretté Harry Kupfer se rappellera à nous pour Rosenkavalier, tout comme Giorgio Strehler pour Entführung aus dem Serail, mais le public milanais a aussi droit au présent du théâtre.
Chez les metteurs en scène italiens, Francesco Micheli mériterait par exemple d’être appelé, et dans l’ailleurs scénique inconnu des théâtres italiens, un Barrie Kosky – qui est un véritable homme de théâtre à qui l’on doit tant de grandes productions très éloignées du Regietheater – ou même un David Bösch, qui signe le meilleur Elisir d’amore sur une scène d’opéra (à Munich), voire un Simon McBurney seraient aussi possibles sans effaroucher ni décoiffer le public scaligère. Ils feraient sans doute mieux que le Davide Livermore des familles.
Mais la saison prochaine, malgré tout, on tâchera d’aller souvent revoir Milan….








 La Scala repart de Muti (en souvenir de Toscanini) titre par exemple La Repubblica dans ses pages milanaises.
La Scala repart de Muti (en souvenir de Toscanini) titre par exemple La Repubblica dans ses pages milanaises.