Il est clair que ce texte qui est une réflexion sur cet étrange livret s’adresse à ceux qui ont vu le spectacle de Strasbourg, ou connaissent l’œuvre, donc a priori à un petit nombre de lecteurs, même si ce nombre, j’espère, s’élargira à partir du 25 mai prochain sur Arte-concert, qui restera ensuite en ligne.
Dans ce cas, ce texte peut accompagner votre vision.
On ne peut qu’encourager fortement tous les mélomanes curieux à se confronter à cette œuvre. Elle en vaut la peine.
J’ai vu samedi 4 avril Guercœur d’Alberic Magnard à l’Opéra National du Rhin et à l’instar de la plupart des spectateurs et d’une belle unanimité critique, il est clair que c’est une production exemplaire à tous points de vue, fruit de l’intuition d’Alain Perroux, directeur général de l’Opéra du Rhin, qui a ainsi permis la troisième production dans l’histoire d’une œuvre crée en 1931, et seulement reprise en 2019 à Osnabrück en Allemagne.
Guercœur est effectivement réapparu en 2019 au Theater Osnabrück, et cette production (la deuxième dans l’histoire de l’œuvre – Voir le trailer – ) n’a pas fait l’objet d’une attention médiatique débordante et c’est regrettable, mais Osnabrück ne fait pas partie du circuit habituel des références en matière lyrique.
 Plus étonnant, la parution de l’enregistrement de Michel Plasson avec José Van Dam et Hildegard Behrens en 1986 aurait pu décider un directeur d‘opéra (et Plasson lui-même au Capitole de Toulouse) à reproposer le titre sur une scène, mais il n’en fut rien. On se demande pourquoi car le moment était propice.
Plus étonnant, la parution de l’enregistrement de Michel Plasson avec José Van Dam et Hildegard Behrens en 1986 aurait pu décider un directeur d‘opéra (et Plasson lui-même au Capitole de Toulouse) à reproposer le titre sur une scène, mais il n’en fut rien. On se demande pourquoi car le moment était propice.
C’est une raison supplémentaire pour saluer l’Opéra national du Rhin à Strasbourg qui fait découvrir cette œuvre fascinante à une bonne partie de l’Europe de l’Opéra.
Fascinante, cette œuvre l’est assurément parce que difficile à classer, aussi bien musicalement que conceptuellement et que sa lecture peut en être brouillée, de « Poème de l’âme » (La Croix) , œuvre « touchante », comme l’a écrit Christian Merlin dans Le Figaro, un opéra dont la portée philosophique frôle parfois le manifeste (Le Monde), Ein Abstecher auf die Erde (un détour par la Terre) selon le Neue Musikzeitung, Ein Meisterwerk für diese Zeit, écrit Manuel Brug dans Oper-Magazin qui ainsi souligne l’actualité de l’œuvre quand d’autres en soulignent les aspects rêveurs ou utopiques.
Tout cela amène évidemment à s’interroger sur le sens de l’œuvre, mais plus encore sur ce silence de l’institution musicale qui a tenu éloigné des scènes un opéra qui a tous les ingrédients musicaux et vocaux pour être un succès et les ingrédients conceptuels suffisamment riches pour nourrir des rêves de metteurs en scène de tous horizons, des classiques aux plus échevelés des héritiers du Regietheater.
Ainsi essaierons-nous de naviguer dans cette forêt profonde et dense où se mélangent tant d’idées philosophiques débouchant sur l’espoir, ou l’utopie (c’est selon) appuyés sur l’étrange personnage qu’est le compositeur Alberic Magnard, comme si sa propre marginalité, sa mort tragique, la disparition partielle de la partition, sa renaissance donnaient à cette œuvre un parfum presque irréel, comme si le destin de cette œuvre rejoignait celle de son héros, une partition sortie du « rivage des morts » et ressuscitée en 1931, puis repartie chez les morts avec l’espoir d‘une future « autre vie ». Il y a comme superposition entre Guercœur le héros et Guercœur l’œuvre. Sommes-nous arrivés à ce moment lointain où Vérité éclate aux yeux de l’humanité musicale, faisant enfin exploser Guercoeur dans le monde de la musique ?
________________________________________
L’acquiescement intérieur peut provenir de la raison, et cet acquiescement né de la raison est la paix plus élevée qu’il nous soit donné de connaître.
Spinoza
Des éléments « princeps
Il y a comme une logique à voir l’Opéra National du Rhin recréer en France cette œuvre plus ou moins disparue ; en effet plusieurs éléments plaidaient :
- Une ville fortement marquée par les relations avec l’Allemagne, pour une œuvre marquée par le Wagnérisme, mais dont le compositeur est mort sous les coups allemands en 1914.
- Une œuvre dont le héros prône la liberté, l’humanisme, la fin des soumissions, contre les tyrannies, à un moment où c’est l’inverse qui menace bonne part du monde, France comprise.
- Enfin, absolument nécessaire, un théâtre ouvert, au directeur curieux et riche d’idées, qui sait ce que signifie politique artistique.
Capitale d’une Europe de la paix et symbole de la relation apaisée entre la France et l’Allemagne, Strasbourg était une ville désignée pour accueillir cette reprise qui vaut recréation française, car Guercœur est une œuvre si politique qu’on peut par ailleurs se demander si l’absence de reprises à l’Opéra de Paris (Guercœur est représenté à Paris pour onze représentations entre avril 1931 et mars 1932 sans plus jamais réapparaître)
après sa création au seuil d’une décennie politiquement dramatique n’est pas due à la question centrale posée par l’œuvre si urgente en Europe et en France à l’époque. Je me demande même s’il ne faut pas classer Guercœur dans ces œuvres disparues des répertoires à la même époque pour d’autres raisons, comme les œuvres dites « dégénérées », ici à cause d’un livret lourdement politique, mais aussi d’un compositeur qui alliait bien des « tares » ciblées par une extrême droite en réveil dans les années 1930 : dreyfusard de la première heure, féministe, fortement et systématiquement marqué à gauche… Sans être « dégénérée », elle est quasiment mort-née comme les œuvres « dégénérées », et comme les œuvres « dégénérées », elle disparut des préoccupations après la deuxième guerre mondiale où un monde « nouveau », avec d’autres « valeurs » d’autres esthétiques et d’autres influences allait s’ouvrir. En quelque sorte, Magnard comme Korngold, Schulhoff, Krenek et autres Schreker… On serait presque tenté de rapprocher ces destins, tant la musique de Magnard à l’écoute n’est pas si éloignée de celle de ces compositeurs. Il y a comme un lien invisible des musiques maudites entre elles.
Aujourd’hui cependant, on peut supposer que dans la chasse à la nouveauté à laquelle se livrent les opéras européens en mal de répertoire et las de reprendre les mêmes standards, qui a fait une place assez large à ces musiques dans les dernières années (notamment Schreker et Korngold) Guercœur à son tour constitue une pièce de choix : musique somptueuse et charnue, d’un grand classicisme monumental, distribution vocale assez spectaculaire affichant différents type vocaux, avec de vraies différenciations, mais aussi de grandes exigences : les deux rôles principaux, Guercœur et Vérité, ne pouvant être confiés qu’à des voix solides, aguerries, et puissantes : il suffit de penser à la distribution de l’enregistrements EMI de Plasson, avec José Van Dam et Hildegard Behrens, tous les autres personnages devant aussi être fortement caractérisés, avec notamment un éventail de voix féminines de haute qualité. Le troisième élément, un livret singulier, offre aux metteurs en scène une palette de possibles particulièrement ouverte.
De fait, l’Oper Frankfurt programme Guercœur sa saison prochaine dans une mise en scène de David Hermann, et le Theater Dortmund la saison suivante avec Oliver Py comme metteur en scène. L’Allemagne se met en état de marche après Osnabrück, qui suivra Strasbourg en France ?
On attend la France et notamment notre première scène nationale, qui serait bien inspirée de se réveiller après son long sommeil de 92 ans cette année, à moins que l’œuvre ne continuât de sentir le soufre dans un pays un peu bousculé politiquement ces derniers temps, fortement menacé par des forces politiques aux valeurs douteuses, sinon moisies.
Je n’entends pas écrire une critique supplémentaire de la représentation, d’abord parce que Wanderersite.com en a publié une excellente de David Verdier qui fait parfaitement le point sur le spectacle de Strasbourg et ensuite que c’est l’écoute de l’œuvre dans cette impressionnante réalisation musicale et les options de la mise en scène de Christof Loy qui ont fait naître en moi une foule de réflexions très diverses, une sorte de ballade multiple que je voudrais partager ici.
La chance avec une production (presque) princeps, c’est qu’elle permet d’asseoir une référence initiale, une base de lecture d’autant plus solide que le travail de Christof Loy est remarquable. Mais il faut éviter que cette première vision ne devienne une doxa: il faut au contraire au contraire permette de « gamberger » à partir de la nature d’une œuvre qui à mon avis n’a pas fini de nous dire des choses sur nous, sur le monde, sur la musique.
Mais d’abord, rappelons les éléments essentiels du livret.
Trois actes, un premier et un troisième acte qui se répondent (Chacun « Au Ciel ») et un deuxième acte (sur la Terre) divisé en trois tableaux.
Au premier acte, Au Ciel, Guercœur, qui a sauvé son peuple de la tyrannie a été emporté trop jeune, laissant sur terre son épouse aimée Giselle et son ami et disciple Heurtal. Il se morfond dans les Cieux où temps et espace ont disparu et où règnent les figures allégoriques Bonté, Beauté, Souffrance et Vérité. Devant ses plaintes, son insatisfaction et son insistance, Vérité à l’instigation de Souffrance décide de le renvoyer sur terre finir d’accomplir son œuvre et retrouver éventuellement amour et amitié, mais surtout de subir une leçon : il n’aurait pas éprouvé la souffrance sur Terre et il a urgent besoin de la connaître… (Souffrance soutient à la fin de l’acte I : Qu’il soit châtié dans son orgueil ! Il a vécu hors de mon atteinte ! qu’il revive pour me connaître !)

L’acte II s’ouvre donc sur l’arrivée émerveillée (premier tableau « les illusions ») de Guercœur qui retrouve temps, espace et nature. Mais dès le deuxième tableau (« L’Amante ») on découvre Giselle et Heurtal enlacés, ils sont amants, même si Giselle est pétrie de remords d’avoir trahi son serment d’amour éternel sur le lit de mort de Guercœur. Heurtal en plein combat politique, disparaît pour aller le mener, et apparaît Guercœur, dont Giselle ne sait s’il s’agit d’un rêve ou de la réalité, d’un spectre ou d’un fantasme né de ses remords. Elle lui avoue quand même avoir trahi son serment et lui demande son pardon qu’il soit spectre ou réel. Guercœur ravagé par la souffrance le lui accorde. Giselle pourra enfin vivre son amour avec Heurtal sans remords. Elle a « fait son deuil » en quelque sorte.
Le troisième tableau s’intitule « Le peuple ». Et va confronter Guercœur à ceux qu’il avait libérés de la tyrannie. Il trouve Heurtal en face de lui, il le heurte littéralement et l’autre ne voit en lui au mieux qu’un spectre et au pire qu’un usurpateur. Heurtal est en train de conquérir le pouvoir au nom de l’ordre face au désordre. Le peuple est fatigué de la liberté et de l’indépendance qui lui ont été données et qui confinent à l’anarchie, il souhaite un-chef-un-vrai s’occupant de tout en lui garantissant le pain. Un « bon dictateur » en somme. Guercœur s’interpose dans les luttes et devient la cible de tous, comme la cause de tous les maux puisqu’il a offert une liberté que tous accusent de leur misère : alors tous le lynchent et il meurt sous leurs coups, tandis qu’Heurtal est porté au pouvoir.
Le troisième acte, Au Ciel, accueille de nouveau Guercœur qui a connu la souffrance et donc revient au Ciel dans une disposition bien différente, il a renoncé à l’absolutisme des sentiments et des idées, a connu la souffrance et tous les relativismes, il est prêt à accepter la paix du Ciel et la repentance : ses premiers mots sont Pardon, repos, oubli.
Vérité prophétise alors la fin lointaine des temps agités pour la terre où se réaliseront les rêves de Guercœur, la réunion de l’humanité dans sa diversité quelles que soient leurs origines, leurs cultures et leurs langues. Et le dernier mot est Espoir.
Quelques observations initiales
La première observation qui saute évidemment aux yeux de tout wagnérien, c’est une structure de l’œuvre proche du Parsifal de Wagner avec deux actes similaires et statiques(au Ciel) qui entourent un acte d’action (Sur la terre).
Les deux actes « célestes » sont en effet nettement moins marqués par l’action et plus même si le premier acte est « au bord » de l’action, quand le dernier sonne comme une sorte d’oratorio, voire de Requiem pour Guercœur (dont les interventions sont très limitées) c’est un chœur des « déesses » au centre desquelles Vérité parie sur le futur.
Au Ciel, il nous est dit dès la première réplique du chœur que « Le temps n’est plus, L’Espace n’est plus » claire allusion à Zum Raum wird hier die Zeit de Parsifal (« Espace et temps ne font plus qu’un », Acte I)
Comme dans Parsifal, le deuxième acte est « humain », et donc plus théâtral, plus dialogué, plus vif aussi bien dans les premières scènes de l’intimité entre Giselle et Heurtal que celles où Giselle dialogue avec Guercœur, puis plus spectaculaire dans la deuxième partie avec les scènes de foule, de révolte et de lynchage, les scènes typiquement politiques sur lesquelles évidemment il faudra revenir.
Une réplique dans Parsifal est la clef : Amfortas ! Die Wunde où Parsifal perçoit le sens de son action et de sa mission : tout est clair, parce qu’il a éprouvé la compassion (Mit-Leid, c’est-à-dire souffrir avec : Durch Mitleid wissend, c’est la connaissance par la souffrance, la conscience que le partage de la souffrance fait avancer l’homme.
Dans Guercœur, très vite arrive au milieu du discours de Giselle qui lui avoue sa situation la réplique de Guercœur Je souffre ! repris un peu plus tard par Va, ne sache jamais l’horreur de ma torture.
Torture et souffrance. Guercœur apprend ce qu’il ignorait jusque-là, lui aussi apprend par la souffrance. Lui aussi, Durch Mitleid wissend. Car le pardon à Giselle est plus qu’un acte d’amour, c’est un acte de renoncement, de ce renoncement dont il était question dans le premier acte, « renoncement seul charme de la vie, dit l’ombre d’une femme, qui prend en compte la relativité et la fragilité des choses.
Mais la démonstration n’est pas complète, Guercœur pense qu’il va trouver une sorte de compensation à sa souffrance par la joie du peuple le voyant revenu. Il trouve au contraire la mort. D’abord, s’il est reconnu, il est repoussé, rejeté par un peuple qui lui voue un fort ressentiment, et qui le rend responsable de sa misère. Et Heurtal refuse de voir en lui autre chose qu’un spectre ou qu’un sosie-usurpateur, en tous cas un obstacle sur sa route toute tracée du pouvoir.
Heurtal, qui a accompagné Guercœur comme disciple, arrive au pouvoir convaincu que le peuple ne sait pas user de la liberté qu’on lui a donnée et qu’il lui faut un maître : je sais comment on mate le lion populaire, que lui faut-il du pain, des coups. Guercœur surgit dans ce moment que l’on appelle un coup d’État où le mandat de Heurtal consul dépositaire du pouvoir arrive à échéance et où il va provoquer un soulèvement populaire pour l’y maintenir. De consul il deviendra dictateur. Un parcours césariste.
Au milieu des cris des révoltes et des vociférations, Guercœur use des mots de la raison contre la violence et la tyrannie, mais son pouvoir n’est plus. Il est lynché par les deux partis qui se combattaient, unis contre lui, vu comme le responsable de la situation.
Il meurt en disant : « Vérité, pardonne à mon orgueil ».
On trouve ici plusieurs éléments qui vont appeler à réflexion et développements, d’un côté le point de vue de Giselle qui mérite approfondissement, de l’autre, le mécanisme de la vindicte populaire et de son désir d’un homme fort est vu à la fois brièvement et de manière particulièrement acérée et juste par le livret. Tout cela pose des questions fortes, qui touchent à notre humanité mais aussi à notre présent et demande un regard attentif au texte.
La mise en scène de Christof Loy
Mais d’abord, puisqu’elle est notre vision de base, analysons les principes de la mise en scène de Christof Loy.
Christof Loy a entrepris de raconter l’histoire de manière linéaire, horizontale, centrée autour de l’expérience de Guercœur, dans ses rencontres successives au Ciel puis sur la Terre, comme une histoire édifiante, un conte moral dans une esthétique épurée de Johannes Leiacker et des costumes peu contrastés de Ursula Renzenbrink, donnant à l’univers scénique dans son ensemble un caractère assez unifié. Ce qui différencie le Ciel de la Terre est un mur, noir au Ciel qui efface les ombres et les individualités et dilue l’espace et blanc sur la terre qui au contraire accentue les ombres et donc focalise sur les formes des individus mieux identifiés. Mais ce sont semble-t-il les deux côtés d’une même monnaie, que l’installation sur une tournette renforce bien évidemment. C’est le même espace vide que Peter Brook n’aurait pas renié, avec les mêmes rares meubles et accessoires. Il s’agit bien d’épurer au maximum le cadre pour se concentrer sur les êtres, mais aussi donner l’idée d’un monde unique en version noir et blanc.
Le noir, ce sont les Déesses au Ciel, comme porteuses d’un deuil infini, le blanc, c’est Giselle, comme un symbole d’éternelle mariée (à qui ?), d’éternelle pureté, comme si elle était comme saisie dans le regard de Guercœur, immaculée. Heurtal est vêtu plus banalement comme un politique, costume trois pièces, l’uniforme qui fait sérieux et qui encourage à la confiance. Le col blanc cravaté : porté universellement par tous les politiques, gage (ou image ?) de sérieux.
Tout comme la chair, le Ciel est triste. Et malgré les déclarations de l’ombre du poète ou de l’ombre de la femme, on a l’impression d’un monde en attente, même s’il n’y a plus rien à attendre, où Guercœur, vêtu d’un complet « politique » gris est en fait comme dans les contes de fées, un « élément perturbateur » de l’ordre établi, puisqu’il est sans cesse en posture de refus lui, le défunt dont la première parole, le premier cri est vivre !. Le vilain petit canard du Ciel qui va mettre les autres au bord de la crise de nerfs, un « Amédée ou comment s’en débarrasser ».
On s’ennuie peut-être moins sur Terre, mais ça n’est guère plus enjoué. Même la joie affichée par le couple Giselle/Heurtal est ternie par les remords de Giselle, qui dans les bras de Heurtal a trahi son serment à Guercœur. Elle n’est pas heureuse…
Heurtal est amoureux de Giselle, mais possède la passion du pouvoir. Il est l’objet d’une tension politique où il joue son avenir. Il affiche devant Giselle une sérénité factice qui cache une situation politique où les factions se déchirent.
La terre est en somme, elle aussi perturbée.
Loy nous montre deux mondes parallèles traversés par le doute ou les épreuves, et nous susurre que Sur la Terre comme au Ciel, ce n’est pas si différent, voire superposable.
Ainsi dans une situation au total complexe, le personnage de Guercœur, l’élément perturbateur du premier acte, ne serait-il pas, au final (au troisième acte) le sauveur des deux mondes, un super Parsifal en somme : au troisième acte, plus de problème, tout est apaisé et se focalise sur l’Espoir, et son passage sur la terre assez bref, a sauvé Giselle du remords et sauvé son couple (et les enfants à naître…) et sa mort libère définitivement la voie vers le pouvoir dictatorial d’Heurtal… Sur la Terre comme au Ciel… Guercœur à son cœur défendant a tout résolu.
Entre les deux monde, Loy a placé comme un sas, étonnant, inattendu, un tableau de Claude Gellée, dit le Lorrain, Paysage aux figures de Danse (1669) actuellement au Musée de L’Ermitage de Saint Petersbourg, seule tache de couleur dans le spectacle, qui selon Loy, peut évoquer le monde utopique évoqué par Vérité et dont rêve Guercœur. Il poursuit …On peut y contempler une nature généreuse accueillant des êtres humains qui vivent en harmonie entre eux et avec la nature.
Le tableau, structuré en trois parties, un Ciel lumineux, une nature bienveillante et apaisée avec ses éléments divers, arbres, lac ou rivière en arrière-plan dans le lointain très éclairé, quand le premier plan (où sont les hommes) est plus obscur. Que le tableau évoque la Terre et le Ciel, avec les hommes un peu écrasés sous cet ensemble est clairement une référence à la trame, mais ce qu’il évoque pour moi, c’est plus généralement, la place de l’art et de l’artiste entre les deux mondes, comme un passeur, comme si les deux mondes en avaient besoin l’un et l’autre, comme si l’Art était nécessité, voire impératif catégorique. Car l’Art représente aussi bien la Terre, les individus, leurs actions, les guerres, l’histoire, leurs rêves, que le Ciel, il suffit de penser au Jugement Dernier de Michel Ange et plus généralement tout le cycle de la Sixtine
C’est à la Renaissance que l’artiste (à partir de Raphael notamment) a acquis le statut de « créateur », et donc quelque part un statut « divin », car jusque-là le seul créateur était Dieu. L’Art est donc en quelque sorte la seule voie humaine en soi possible pour approcher la nature du divin et un monde « autre », parallèle, utopique ou non. Le décor de Leiacker représente ce tableau comme coincé, plié entre les deux mondes, comme s’il se hissait entre les deux avec difficulté, mais qu’en fait, sa seule présence créait déjà une autre humanité, parce que s’il n’y a pas d’art sans créateur, il n’y a pas d’art sans regard et sur scène une femme corsage blanc-jupe noire – et donc « Ying et Yang », Ciel et Terre – observe le tableau. L’art n’est jamais réductible à une fonction, notamment politique (certains voudraient ou ont voulu l’y contraindre), à un univers, mais il porte en fait le seul point de passage entre des univers. L’expérience artistique est la seule expérience humaine d’un autre univers. Et mettre ce tableau entre les deux mondes de Guercœur, c’est le placer entre nous et nous. C’est pour moi la plus belle idée de Loy, celle qui fait de l’Art en quelque sorte la seule solution, entre Celui qui croyait au ciel, Celui qui n’y croyait pas pour reprendre Aragon.
Par ailleurs, sa mise en scène très épurée est aussi très théâtrale et concentrée sur les personnages, les femmes et les hommes, leurs regards, leurs attitudes, leur mouvements, c’est évidemment clair au deuxième acte, le plus « théâtral », mais aussi au premier acte avec ces personnages vêtus de manière plutôt « propre sur eux », dans un Ciel très « politically correct », qui ont l’air de tourner en rond sans but, donnant exactement l’image de l’ennui que dénonce Guercœur. Ces ombres, gouvernées par des dames en noir sans parfum que sont les déesses n’évoquent en rien l’apaisement éternel. Le Ciel s’ennuie.
Mais ne dit-on pas que l’Enfer est moins ennuyeux que le Paradis ?… On le sait en littérature depuis Dante, dont on cite le plus souvent l’Enfer, comme si à lui seul il représentait la Divine Comédie. Mais c’est ce que nous enseigne aussi d’une autre manière Offenbach dans son Orphée aux Enfers… Ce qui frappe, qui n’est pas clairement dit, mais en même temps ressenti, c’est l’idée d’un Ciel en crise et Loy le montre par le seul mouvement des personnages et par les seuls jeux de regard, et par Guercœur, qui ose dire les choses.
J’ai écrit plus haut que Guercœur est à la fois élément perturbateur mais en même temps résolutif puisqu’à la fin en quelque sorte tout rentre dans l’ordre et tout est apaisé : la démonstration parabolique est faite.
Loy, très justement à mon avis, suit le livret sans ajouter de surinterprétation, on a parlé d’horizontalité, on pourrait parler de linéarité, ce qui laisse le livret être écouté (les chanteurs ont une articulation parfaite, en premier lieu Stéphane Degout, ce qui est, on va le voir, indispensable) et se dérouler, laissant le spectateur découvrir le texte et en même temps découvrir la musique. Il semble ne pas y avoir de place pour une surinterprétation, pas de place pour quelque chose qui aille au-delà, laissant le spectateur et son imaginaire à ses gamberges. Place à la fable, et la fable seule, selon le bon principe d’Aristote.
Que de questions en suspens
Loy par son approche nous laisse justement nous interroger sur le livret, sur cette « prose poétique » qui semble si simple, si directe et en même temps, si l’on rajoute le mot « poétique », nous apparaît comme « enrichie » de cet au-delà dont il était question ci-dessus.
Le Livret est structurellement conçu comme une leçon, une mise à l’épreuve. Et le fait même qu’il soit écrit en prose (certes dite poétique) accentue pour moi cet aspect de conte édifiant que des vers auraient peut-être un peu éloigné de l’auditeur : il y a dans le vers quelque chose d’élaboré, de construit, de discrètement spectaculaire qui éloigne le message et le fait passer par la fabrique d’une esthétique. La prose n’appelle pas ces considérations ; on en reste à Monsieur Jourdain :
- Et comme l’on parle, qu’est-ce que c’est donc que cela ?
- De la prose.
(Molière, Le Bourgeois gentilhomme, II,6)
La prose à l’opéra est un choix d’abord théâtral, de ce théâtre en prose qui à l’époque est celui des comédies dramatiques à la Henry Becque, mais aussi de Maurice Maeterlinck dans Pelléas et Mélisande qui date de 1893, la même année de la publication de la Salomé d’Oscar Wilde (écrite en 1891), qui ne sera jouée qu’en 1896, elle aussi drame en prose soit peu avant le début de la composition de Guercœur. Le choix de la prose est donc un choix d’époque, et à l’opéra, de modernité. Un contemporain comme Edmond Rostand choisit au contraire essentiellement le vers à cette époque, dont il fait spectacle et jeu sur la parole (Cyrano… qui date de 1897) dans un classicisme populaire.
Le choix d’écrire son propre livret chez Magnard est évidemment influencé par Wagner, pour que le texte dans sa prosodie suive la musique, mais au contraire de Wagner il écrit en prose : c’est le choix de l’accessibilité, à la différence d’un Wagner qui a toujours choisi le vers, et souvent dans une langue qu’on a dit torturée et faussement médiévale, sauf dans Meistersinger qui se doit comme comédie d’être directement accessible et « humaine ».
Il y a donc dans ce choix de Magnard un aspect didactique et de rapprochement de « l’humain » qui peut étonner parce que la structure et les personnages renvoient à des genres du passé. Les figures symboliques Bonté, Beauté, Souffrance et Vérité rappellent évidemment les allégories des opéras baroques qui préparent la trame qui va suivre et on pourrait presque structurer l’œuvre en un prologue (Acte I), l’opéra (acte II) et l’épilogue (acte III)…
Mais ce serait faire des Déesses des spectatrices, alors qu’elles sont aussi parties prenantes dans ce Ciel que j’ai décrit plus haut en crise et aussi dans l’acte II où Souffrance suit fidèlement et affectueusement Guercœur. Ce sont donc des personnages, plus que des allégories.
Au premier acte, en effet dans ce Ciel les déesses Bonté, Beauté, Souffrance et Vérité, consentent au retour de Guercœur parmi les hommes non par tolérance ou gentillesse, mais à la fois pour lui donner une leçon, s’en débarrasser pour un temps, mais sans doute l’instrumentaliser.
Guercœur est arrivé au Ciel dans une situation d’insatisfaction, celle du devoir non accompli, celle d’une vie encore à vivre, celle de l’action à conduire. Cette insatisfaction dure depuis deux ans. Mais deux ans au Ciel où Temps et l’Espace sont abolis, cela ne signifie rien. Sur Terre au contraire, c’est bien plus significatif et c’est un des non-dits du livret.
Les Déesses envoient Guercœur revenir sur la Terre parce qu’elles savent exactement ce qui va se passer : le livret est clair, et Vérité annonce exactement la suite : Rentre dans ta prison de joie et de douleur, Redeviens le jouet des faiblesses humaines, du désir, de la haine, de l’orgueil, de la honte (…) Que la mort te ramène libre, libre, libre ! Va Guercoeur, où tu crois retrouver l’amour et la gloire…
Tout est donc clair à la fin du premier acte et la linéarité choisie par Christof Loy correspond à la clarté du livret, qui annonce les épreuves. Les déesses mettent des épreuves sur le chemin de Guercœur… voilà un motif mythologique fréquent, et opératique qu’on retrouve aussi sous diverses formes dans des opéras particulièrement populaires, comme Die Zauberflöte, ou moins comme Cosi fan tutte. Mais, à la différence de bien des récits, on connaît la fin dès le premier acte : Que la mort te ramène libre, libre, libre ! Va Guercoeur, où tu crois retrouver l’amour et la gloire… la seconde mort est inscrite, et l’échec également avec l’emploi de « tu crois »…
Ainsi tout semble filer avec une sorte de logique implacable : Guercœur est renvoyé sur terre pour mourir de ses illusions, se confrontant successivement à ce qu’il croyait être immuable, une construction éternelle de vie, ce que Thucydide (Guerre du Péloponnèse, I, 22) aurait appelé κτῆμα ἐς ἀεί (ktèma es aei, une œuvre impérissable) et qui n’est que changement.
Mais cette linéarité même de l’histoire, ce côté parabolique du livret mort et insatisfaction (au Ciel I), retour sur terre et désillusion, mort et apaisement (au Ciel II) qui souligne la fragilité des choses humaines et des constructions utopiques, est elle-même une illusion. La simplicité apparente du livret et du texte de Magnard mérite décryptage au sens où le texte est certes un modèle de concision et de concentration mais un mot ou une expression laissent entendre un au-delà des choses assez vertigineux.
Juste quelques exemples
Giselle (à Guercœur) : Tu étais le génie et la bonté, il est la jeunesse et l’amour.
Giselle ne parle d’amour qu’à propos de Heurtal. Elle n’en parle pas pour Guercœur ce qui relativise l’idée de « trahison »…
Heurtal (à Giselle) : Baste ! Le peuple souverain s’amuse
Claire allusion à un passage de L’Éducation sentimentale de Flaubert, la prise des Tuileries où Frédéric et Hussonnet observent le peuple envahir les Tuileries alors qu’il n’y a plus d’enjeu, tout détruire et s’amuser :
Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entr’ouverte, l’air hilare et stupide comme un magot. D’autres gravissaient l’estrade pour s’asseoir à sa place. — Quel mythe ! dit Hussonnet. Voilà le peuple souverain !
Flaubert analyse les désillusions de la révolution de 1848, qui aboutira assez vite à l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte et au coup d’État qui le porte à l’Empire. Il est difficile de penser que Magnard n’ait pas cette histoire encore proche en tête, d’autant qu’il connaît bien l’histoire de 1848 et qu’il vient de vivre la crise du Boulangisme.
Enfin dans les scènes de foule, le texte contient un grand nombre d’éléments qui montrent au-delà des vociférations des mécanismes politiques connus et qui donnent à ce texte une actualité cinglante, nous y reviendrons.
Un livret pas si linéaire
C’est pourquoi l’apparente linéarité et clarté du récit cache en réalité de bien plus grandes complexités qui ont trait à notre fonctionnement comme individus, comme collectivité, mais aussi et à travers Guercœur et Heurtal au fonctionnement de deux types de pouvoir aussi problématiques l’un que l’autre, ce qui rend le constat général assez vertigineux, si on considère chaque personnage et chaque position. Et dans ce maelstrom, les déesses, qui sont en quelque sorte les « Valeurs » qu’on invoque tant et tant de nos jours, restent impuissantes au total, se réfugiant dans un futur lointain, si lointain qu’il en perd toute possibilité réalisable ou représentable.
La question posée est moins celle de la découverte par Guercœur que tout a une fin et que les serments peuvent aussi n’être pas tenus, pas forcément d’ailleurs par mauvaise volonté mais qu’il faut nécessairement accepter la relativité du monde. Il s’agit de prendre en compte le monde et l’humanité dans son imperfection, plutôt que de penser monde et humanité comme une construction théorique immuable.
On a parlé de Platon, mais la construction platonicienne est impossible à pratiquer dans le monde sensible. On en revient toujours à Rousseau : « il en coûte peu de prescrire l’impossible quand on se dispense de le pratiquer » leçon de relativité que Rousseau le prescripteur vit d’ailleurs lui-aussi dans sa chair.
Or Guercœur a pratiqué l’impossible dans sa première vie et en cela il est vécu non comme un être parmi les autres mais comme une sorte de figure théorique, différente des autres hommes ; l’altérité idéale en quelque sorte.
Guercœur ou l’hybris
D’abord, une petite incise sur le nom, Guercœur, composé ad-hoc. On pense immédiatement à un univers qui a des liens avec la chevalerie, comme un nom de Bande-dessinée de type « Prince Vaillant ».. Le chevalier, c’est celui qui a une morale, un code, du cœur au sens double de cœur-courage et cœur- sentiment, et qui éventuellement fait la guerre et combat ce qui correspond au profil du personnage, combattant de la liberté et de l’humanisme. Lacan aurait peut-être fait remarquer aussi que guer renvoie aussi bien à guerre que guère, et que dans ce dernier cas, (guère-cœur, guère de cœur) cela n’était pas fort flatteur pour le héros. Mais gageons que Lacan n’était pas né à la fin du XIXe, et que Freud lui-même n’avait pas encore installé la psychanalyse dans le paysage, disons simplement qu’il y a dans ce nom même un aspect héroïque et positif, et un autre qui l’est moins…

Alain Perroux dans son texte du programme de salle rappelle que l’idée de Guercœur germa (l’anecdote n’est pas vérifiée) en Alberic Magnard lorsque son père Francis attira son attention sur un passage de Bossuet tiré de l’Oraison funèbre de Michel le Tellier qui donne clairement le fil de l’idée centrale de l’œuvre : « Ah ! Si quelques générations, que dis-je ? si quelques années après votre mort vous reveniez, hommes oubliés, au milieu du monde, vous vous hâteriez de rentrer dans vos tombeaux pour ne voir pas votre nom terni, votre mémoire abolie, et votre prévoyance trompée dans vos amis, dans vos créatures, et plus encore dans vos héritiers ! ». C’est un topos de la mythologie et de la littérature que le retour d’un mort au milieu des vivants, voire le retour tardif d’un vivant qu’on avait fini par croire mort, par exemple, Thésée, cf Racine, Phèdre II,5 :
On ne voit point deux fois le rivage des morts,
Seigneur : puisque Thésée a vu les sombres bords,
En vain vous espérez qu’un dieu vous le renvoie ;
La pièce de Racine éclaire d’ailleurs ce type de mécanisme. La supposée mort de Thésée, qui faisait peser vivant une ambiance paralysante, libère la parole et l’explosion des sentiments, de Phèdre à Hippolyte, mais aussi d’Hippolyte à Aricie.
Toute l’analyse du personnage est donc conduite par l’idée d’une confrontation avec une humanité oublieuse qui d’une certaine manière porterait la faute. Une idée qu’on retrouve aussi bien entendu dans le récit biblique de la Chute.
Soulignant, comme dit Perroux dans son texte, « le caractère versatile de l’âme mortelle et la dimension éphémère de l’action humaine », le livret de Magnard insisterait sur les illusions de Guercœur (c’est d’ailleurs le titre du premier tableau de l’acte II) et en ferait une parabole de plus dans la grande tradition de la littérature et des mythologies occidentales.
Mais ce serait limiter la portée de l’œuvre, évidemment soutenue par d’autres fondements, Platon, Bossuet, Racine, mais aussi Corneille : Magnard connaissait sans doute Suréna et son Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir prononcé par Eurydice, dont le nom même, rappelle étrangement le mythe d’Orphée. Magnard connaît aussi l’histoire de l’opéra, puisque l’œuvre s’intitule Tragédie en musique rappelant les tragédies lyriques de Lully et Rameau, mais aussi Monteverdi dont L’Incoronazione di Poppea qui s’intitule Dramma per musica, qui commence d’ailleurs par un prologue où des figures allégoriques, Fortuna, Virtù et Amore débattent, même si les figures de Beauté, Bonté, Vérité et Souffrance sont traitées de manière très différente que dans la tradition baroque.
On a beaucoup écrit et réfléchi sur l’expérience de la désillusion, sur la versatilité humaine, et sur le parcours parabolique de Guercœur, mais si le livret de Magnard s’arrêtait à ces considérations, nous resterions en terrain connu et labouré, et n’aurions guère que la musique à vraiment admirer pour sa puissance et sa singularité.
Pourtant, à lire et relire ce livret, on reste frappé à la fois par sa concision et la beauté du texte, et en même temps par les innombrables ouvertures à une réflexion multiple sur la condition du monde, qui n’a rien perdu de son actualité.
Tu étais le génie et la bonté
On ferait une erreur en croyant à une histoire édifiante où Guercœur, génie et bonté (selon les termes de Giselle) serait confronté à son retour sur terre aux infidèles (Giselle, Heurtal et le peuple), coupables de ne pas avoir respecté leurs serments ou suivi ses préceptes.
L’histoire de Guercœur n’est donc pas seulement la découverte de l’étendue des trahisons diverses mais peut-être aussi de découvrir trop tard d’avoir été dans l’erreur dès sa (première) vie.
Être appelé Maître, cela induit des relations particulières : Heurtal est son disciple et Giselle l’appelle aussi maître (Maître, maître, pardonne moi), ce qui induit une relation hiérarchisée d’abord, éventuellement affective ensuite, mais la relation affective avec un maître n’a rien à voir avec l’amitié ou l’amour qu’on a pour son égal. Quand Giselle le veille sur son lit de mort, trois mots le qualifient, héros, tribun, poète et le ressort est ici l’admiration, mais pas l’amour. On ne sent pas d’intimité dans cette relation, et d’ailleurs, le couple est stérile. Par ailleurs plus tard à Heurtal, elle affirme en parlant de Guercœur Grande, sainte Bonté, le plaçant encore et toujours dans un autre ordre au sens pascalien du terme.
De son côté, Heurtal l’appelle aussi Le Maître, (Folle ! Le maître t’a légué sa demeure), mais avec plus de distance (Giselle, pourquoi rappeler le passé) qui est celle de celui qui a remisé le passé et n’est occupé que par le présent.
Guercœur dans sa première vie a suscité l’adhésion, l’admiration, et a peut-être exercé un pouvoir éclairé, mais dans lequel il n’y avait pas de place pour un autre autonome. Ainsi, il a peut-être fait le bien, il a peut-être fait très bien voire plus, mais il est enfermé dans sa propre logique, où l’autre n’a de place que théorique, en ce qu’il ne s’oppose jamais et n’est mu que par l’admiration. C’est dans ce sens que le dicton populaire dit que le « mieux » est quelquefois l’ennemi du « bien ».
C’est une chaîne de dépendances qu’il a installé autour de lui, comme le gourou d’une secte quelconque, comme le « grand homme » inaccessible, infaillible, une figure et non un simple humain. Appeler l’être aimé maître implique une hiérarchie, au mieux acceptée, au mieux partagée, qui fait de soi un dépendant, où la liberté entre peu, une sorte d’esclave consenti si l’on veut en appliquer la dialectique maître-esclave. Ainsi celui qui rend la liberté au peuple crée aussi un réseau de dépendances autour de lui qui l’isole et l’empêche de considérer le réel pour n’en voir que ce qui lui convient
D’où l’absence de souffrance puisque rien ne lui résiste, affectivement, politiquement et apparemment.
C’est pourquoi cette histoire reste pour moi profondément réaliste, parce qu’elle raconte la résistance des réalités contre les rêves.
L’Histoire est remplie de ces mouvements qui de rêves initiaux conduisent aux catastrophes, Robespierre l’incorruptible, quasiment déifié lors de la fête de l’Être suprême, et qui tombe parce qu’il a forcé le réel au nom d’utopies qui ont viré à l’aigre, à la Terreur et à la dictature, et puis la longue histoire des idéologies auxquelles on croit et auxquelles on se donne, et qui s’effritent et s’autodétruisent, ou détruisent le monde autour d’eux. Vouloir le « Bien » (encore faut-il savoir lequel) contre le mur du réel, c’est conduire à la catastrophe ou à l’autodestruction. Et les sociétés alors punissent ceux qui prêchent un Bien dont elles ne veulent pas, ou qui devient gênant pour le fonctionnement des relations établies (voir Socrate).
Sur le plan individuel, Guercœur sur son lit de mort fait promettre à Giselle une fidélité par-delà la mort : au nom de ses propres valeurs, de son propre monde, de son propre amour peut-être, mais il fait évidemment ce qu’on appelle un « chantage affectif ». Imagine-t-on Giselle auprès de l’être qu’elle admire et qui va mourir ne pas se soumettre formellement à ce serment ? Son seul effet est d’apaiser Guercœur, (Une joie éclaira son visage, il mourut doucement, déclare-t-elle) faisant peser sur la jeune femme un engagement terrible post-mortem.
Alors dans cette vie qu’appelle Guercœur au début de l’œuvre, il ne revendique en fait qu’un « Je » agissant sur les autres : le livret est à ce titre encore une fois juste et subtil. À Guercœur qui crie au premier acte : ne regrettez-vous pas le bonheur d’aimer ? Aimer, aimer ! , l’ombre d’une femme répond : Frère, j’eus le bonheur d’aimer et d’être aimée…
L’un dit aimer, l’autre répond, aimer et être aimée. Tout le nœud est là, d’un Guercœur qui pense à l’action, à l’actif, mais jamais au passif : Penser, agir, créer ! Il continue : Je ne puis oublier les heures de triomphe et de tendresse. Guercœur ne peut se représenter autre chose que lui-même en triomphe, entouré d’amour d’amitié et de clameurs joyeuses.
Il est atteint d’un incommensurable orgueil, l’Hybris (ὕϐρις) grec de celui qui est persuadé que le monde tourne autour de lui, enivré par « l’excès de pouvoir et de ce vertige qu’engendre un succès trop continu » (l’expression vient de Wikipedia mais elle s’applique parfaitement au cas qui nous occupe).
Guercœur n’est pas un méchant, ni un nuisible mais un aveugle et un sourd qui n’écoute pas les autres : il n’écoute pas l’ombre du poète qui notamment lui décrit exactement ce qui va lui arriver au deuxième acte et il n’écoute pas Vérité non plus : crois-tu l’amour plus fort que la mort, l’amante et le peuple fidèles au souvenir ? aveuglé par un Je omnipotent : huit fois je ou me dans la réplique qui précède ces questions posées par Vérité.
Face à cet aveuglement qui sera vite dessillé, le livret fait aussi place aux autres, chacun dans sa modalité : Giselle, Heurtal et le peuple y sont chacun dessinés d’une manière spécifique, qui éclaire la lucidité de Magnard, son réalisme et son humanité, le tout construit comme des visites successives de Guercœur, chacune devenant une douleur nouvelle. Là est la parabole presque dantesque de ce livret : il y a dans ces rencontres successives comme un parcours infernal qui enfonce dans la douleur et fait évidemment de la Terre l’Enfer qu’il n’a pas connu jusque-là.

Giselle ou l’humanité
Des trois noms des protagonistes, celui de Giselle semble le plus ordinaire, mais c’est un faux semblant. Il est clair en effet que le choix de ce nom est dicté par l’archétype du ballet romantique, Giselle d’Adolphe Adam, une des grandes références culturelles du spectacle du XIXe, où Giselle meurt en apprenant que celui qu’elle aime, Albrecht, est promis à une princesse. Elle devient une Willi, esprit d’une jeune fille vierge. La reine des Willis condamne Albrecht à danser jusqu’à épuisement et mort, mais il est sauvé par Giselle. Le ballet est un des nombreux symboles de l’amour qui persiste par-delà la mort, et rappelle évidemment le mythe d’Orphée et d’Eurydice en version romantique. La thématique de l’œuvre et le retour à la vie de Guercœur dont le premier geste est de retrouver Giselle ne peut évidemment être un hasard. Mais Giselle de Magnard n’est ni un pur esprit, ni romantique. Son nom même, rappelant l’amour éternel, renforce encore si besoin était la désillusion.
La rencontre avec Giselle est d’une vraie justesse humaine. Giselle répond à Guercœur sans savoir exactement si c’est lui, ou un spectre ou un rêve, mais elle oppose à ce Guercœur être ou fantôme, intrusif et décidé (donne-moi tes lèvres) sa honte, peut-être, mais aussi son refus. C’est la rencontre la première et la plus décisive parce que si Giselle la « dédiée » a « failli » à son serment, il y a fort à parier que les autres (Heurtal et le peuple) n’auront pas mieux fait…
Dans le livret les paroles de Giselle n’ont rien de grandiloquent, rien de tragique, rien même de dramatique, elles disent simplement et sans fard ce qui est, et du même coup, disent l’humanité et la douleur.
Suivons son discours :
Quand la mort vint ternir tes yeux de héros (…). Je croyais te suivre au tombeau. La mort m’épargna…
Guercœur et Giselle ne sont pas Tristan et Yseult, c’est la première donnée, presque définitive, confirmée par l’expression si simple. Hélas ! j’aimais encore la vie.
C’est-à-dire la possibilité d’un futur. Il y a un futur après Guercœur, même si ce futur passe d’abord par l’évocation de sa mémoire : les regrets, les souvenirs communs m’unissaient à Heurtal, ton disciple une réplique qu’un bel alexandrin conclut :
J’ai pleuré près de lui par les beaux soirs d’été.
Si on en faisait l’analyse racinienne, on verrait dans ce « vers » une sorte d’apaisement donné par l’absence de ponctuation, de souvenir d’un bonheur discret construit par l’opposition entre J’ai pleuré et beaux soirs d’été modulé par près de lui qui est début de consolation.
Guercœur ne s’y trompe pas, qui l’interrompt par « Je souffre ! »
Suit ensuite un moment d’une rare poésie, de cette concision qui dit tout du parcours de la jeune femme, et qui rappelle le vers de Baudelaire :
Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne.
Il y a chez Giselle l’expression de la franchise, peut-être terrible mais qui grandit en même temps cette humanité qu’on croyait volatile et qui paradoxalement la rend encore plus digne d’être aimée par Guercœur, augmentant sa souffrance.
Mon désespoir devint tristesse, ma tristesse mélancolie, et j’ai trouvé du charme à ma mélancolie… Même si la mélancolie est une affection psychique grave, plus grave que la tristesse, le mot est utilisé ici dans son sens littéraire, puisque Magnard établit une gradation descendante du désespoir à la mélancolie, une sorte d’état d’âme (Baudelaire dirait « le spleen ») qui se conclut par et j’ai trouvé du charme à ma mélancolie, autre alexandrin conclusif qui fait presque passer la mélancolie au rang de motif littéraire et pourquoi pas ? de séduction, puisqu’aussitôt après Giselle annonce : Maître, j’ai succombé dans ce langage un peu précieux de la carte du Tendre ou de la guerre amoureuse.
Magnard consciemment ou non parcourt avec Giselle face à Heurtal une carte du Tendre qui illustrerait presque Montaigne “Parce que c’était lui ; parce que c’était moi”.
Si Guercœur dans un premier moment refuse d’entendre, n’y voit que le parjure, la trahison de l’amour, et renvoie Giselle à la justice divine, celle-ci utilise l’argument définitif. Elle est heureuse avec Heurtal, certes, mais reste poursuivie par le remords, elle l’a dit dès la scène 1 du deuxième tableau intitulé « L’amante » : Heurtal, je suis heureuse, heureuse, mais parfois des remords me troublent, d’autant plus forts que leur relation a pour cadre l’ancienne demeure de Guercœur. Or, elle laisse entendre qu’elle est enceinte : Prends pitié de la mère !
Signe que désormais elle a construit non seulement son futur, mais une famille, que le couple n’est pas infatuation mais véritable installation dans un cadre qui a été refusé à Guercœur. Giselle mère, c’est ce plus que lui n’a pas eu, signe peut-être de l’imperfection du couple qu’il formait.
Elle expose sa souffrance, qui fait écho à la sienne, il y a souffrance commune (« Mit-Leid ») ; et il pardonne, avec cette pointe de condescendance dont il ne peut se départir en la qualifiant d’enfant. « Enfant, enfant, je te pardonne », une lointaine évocation du christique « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Giselle alors est libérée du poids du remords : Guercœur m’est apparu (…), il me pardonnait notre tendresse. Oh Maintenant je suis à, toi sans regrets, sans remords. Prends-moi toute, Heurtal ! Prends-moi, je t’aime ! elle dispose librement de son corps et surtout de son désir. Plusieurs fois dans le texte, elle fait claire allusion à leurs ébats physiques (Heurtal, doux amant qui m’a réjouie dans mon âme et dans ma chair ! ).
En bref, elle vit.
Ah!
Je veux vivre
Dans ce rêve qui m’enivre;
(Air de Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod)
Dans ce parcours vers la libération décrit par le livret de Magnard, ce n’est pas seulement le pardon de Guercœur qui me semble intéressant, signe de son premier acte de composition avec la réalité, de renoncement, mais c’est aussi une vision de l’humanité qui n’est pas cette humanité ingrate qu’on pourrait voir dans la parabole décrite dans ce récit ou chez Bossuet. En exprimant par des mots simples et précis le parcours de Giselle de la douleur et du désespoir aux retrouvailles avec la joie Heurtal a fait refleurir la joie dans mon âme dit-elle. Il y a ce qu’on appelle aujourd’hui le parcours du deuil, qui conduit celui qui reste du désespoir initial à la vie, et donc à un futur ouvert.
Vivre, c’est décider d’avoir un futur, sans l’être disparu.
Vivre c’est donc forcément refermer le Livre des Morts. Les anciens égyptiens munissaient le mort de tous ses viatiques pour son « autre » vie, en prenant bien soin de refermer la tombe, de la dissimuler, avec entre les vivants et les morts ce long fleuve de vie qu’était le Nil. Cela n’empêche ni le souvenir, ni la mélancolie passagère, ni les signes des passages dans cette vie des disparus, mais la vie n’appartient qu’aux vivants, quoi qu’ils fassent et quoiqu’ils en fassent. C’est le sens de l’expression tant employée aujourd’hui de « faire son deuil », c’est-à-dire acter que le mort est définitivement sur l’autre rive et qu’il ne reviendra pas.
Tout ce qui suit aujourd’hui la mort d’un être aimé, les rites, les héritages, les notaires, les ventes, la dispersion des objets est une manière de fermer le livre pour ne garder (ou pas d’ailleurs) que l’indispensable qui donne sens à votre vie, votre passé, votre histoire. Si dans la réalité (et non dans les contes, les mythes ou les paraboles) un de nos disparus revenait, où le mettre puisque par définition, il n’a plus sa place au monde, il n’a plus d’espace ni de biens. C’est cette parabole là que Magnard très discrètement et très humainement esquisse, et sans aucun jugement moral, puisque Giselle explose de vie dès qu’elle est pardonnée. Il n’accuse pas les vivants d’être oublieux, il acte le nécessaire cycle de vie qui fait que le mort n’a plus rien à faire au monde, qu’on le regrette, qu’on l’honore, qu’on le glorifie ou qu’on le voue aux gémonies. Il persiste dans les mémoires, peut-être, mais il ne peut perturber les vies.
Ce que donne Magnard, c’est d’abord en ce deuxième acte, à travers le personnage de Giselle, une leçon d’humanité, faisant de Giselle ce modèle loin de l’héroïsme, qui a trouvé son loculus où continuer de vivre.
Elle est à l’opposé de la grandiloquence de Guercœur, mais pour la première fois, elle lui donne une leçon : le Maître, pour la première fois, c’est elle. Et que le Maître soit une femme est pour moi assez signifiant aussi de l’esprit de Magnard et de sa subtilité.
Ainsi donc, cette humanité dont parle Bossuet du haut de sa chaire n’est pas à travers Giselle si négative, si insouciante, ou « insoucieuse », elle est ce fardeau qu’on tire et qu’on appelle la vie, et que toute humanité a en partage.
Du côté de Guercœur, la rencontre avec Giselle, la première des rencontres, sanctionne la première souffrance, et impose le pardon, le premier renoncement, qui impose à Guercœur qui pensait « absolu » la relativité des choses.
Le pardon est l’un des « outils » qui rend possible la vie en société, au même titre que les excuses, les négociations, tout ce qui fait composer avec l’autre et avec le monde tel qu’il est C’était le premier pas de Guercœur dans la « vraie » vie, sans doute le plus difficile…
Avec Heurtal et le peuple, nous abordons les rencontres plus « politiques ».

Heurtal
Le nom Heurtal d’emblée ne fait pas rêver, au contraire de « Guercœur » ou de « Giselle » : il évoque le verbe heurter, « entrer brutalement en contact », et au sens abstrait contrarier. De la même famille le verbe anglais to hurt, qui signifie blesser ; immédiatement le champ lexical renvoie au conflit, à la violence, à la blessure physique et morale et le nom sonne presque comme brutal, confié pourtant à une voix de ténor. Il est perçu immédiatement comme négatif, dans un opéra inhabituel où le baryton aime la mezzo, et le ténor la lui a volé… C’est tout le schéma de l’opéra romantique qui est mis à bas.
Heurtal, le Judas de l’affaire…
Le cas de Heurtal est donc différent, parce qu’il touche à la fois le sentiment (l’amitié) et les idées (la politique) et il est aussi différemment traité : il n’y aura pas de vrai dialogue avec Heurtal. Heurtal est d’abord celui qui lui a pris Giselle, et donc celui qui a trahi l’amitié. C’est pourquoi Guercœur élimine Heurtal quand il lance à Giselle : l’amour m’a trahi, la sainte liberté me reste. Le peuple m’est fidèle. Par fidèle, il faut entendre évidemment l’antithèse de Giselle (et de Heurtal) qui ne l’ont pas été.
Ainsi la question de l’amitié ne se pose plus alors que Guercœur lui lance à la première rencontre dans sa maison : Oses-tu frapper ton maître, Heurtal ? Honore toujours l’amitié, l’amour, la liberté ! qui sonne à la fois ironique et menaçant.
Heurtal ne se pose pas la question de la réalité de Guercœur, il a déjà déclaré à Giselle Pourquoi rappeler le passé. Il range l’apparition dans deux catégories possibles, celle de l’imposteur comptant sur sa ressemblance avec le héros mort (et donc agissant seul), celle du fou manœuvré par ses ennemis et dans ce cas il se fie à l’absence de mémoire du peuple.
Heurtal est le disciple à qui Guercœur a laissé le pouvoir. Mais le disciple a aimé le pouvoir, et moins les idées qu’il était censé suivre. Il a abandonné la ligne et a tourné définitivement la page… C’est la déviance vers le mauvais gouvernement.
C’est le goût du pouvoir qui lui fait « faire son deuil », et il a reçu Giselle en « héritage ». Il est pour tous le successeur de Guercœur en toute légitimité, Giselle comprise et donc quand Guercœur lui apparaît, il lui refuse toute réalité, en toute logique. Au contraire de Giselle, il n’a rien promis sur le lit de mort et il a tout reçu : il a joui de l’exercice du pouvoir, ce qui est pour lui la nouveauté… De disciple, il est passé « maître », comme l’appellent ses partisans : C’est le sauveur et c’est le maître !
Il profite du moment présent, à plein. Installé dans le présent, il a fait le deuil des utopies et des rêves : Guercœur m’a transmis ses pouvoirs, mais non ses rêveries. Et dans cette transmission, ce qui compte pour Heurtal, c’est le pouvoir en pur politique tacticien du présent, sans vision.
Il est le pur politique qui vise la tyrannie, pour Giselle qu’il aime, et pour lui. Le couple de tyrans, c’est une figure dans la littérature (Macbeth) et dans l’histoire, même si Giselle ne semble pas vraiment impliquée : elle exprime plutôt des craintes, Écoute ces clameurs sauvages ou bien j’ai peur aussi Heurtal, l’émeute gronde dans la ville et la fureur des foules est aveugle !.
Elle restera en dehors des événements
Ce qui intéresse Magnard, c’est de montrer dans son livret les mécanismes d’ambition qui conduisent l’acte politique. Autant il est clair qu’il élève Giselle a un degré de dignité qui mérite le pardon de Guercœur autant il n’a pour Heurtal aucun scrupule du même ordre.
On retrouve là l’observateur impitoyable des jeux politiques les plus traditionnels avec ses références, César, Napoléon, mais aussi Napoléon III. Heurtal s’exprime en effet d’une manière caricaturale lorsqu’il parle du peuple Je sais comment on mate le lion populaire. Que lui faut-il ? Du pain, des coups.
En deux mots qu’il explicite ensuite, il exprime sa philosophie politique Du pain et des coups. Les peuples acceptent les dictatures si on leur garantit le pain. Cette politique n’a-t-elle pas été celle du PC chinois depuis Deng Xiaoping ? Ou celle de ce qu’on appelle les démocraties dites illibérales, donner des satisfactions matérielles qui puissent être une garantie de pérennité politique. Il y a là la vision claire d’un moteur des dictatures.
Heurtal a rangé les idées de Guercœur dans les utopies : ayant le pouvoir, mais n’ayant pas le charisme du « tribun », il est contraint aux basses œuvres s’il veut maintenir son autorité.
Chacune de ses interventions affine la mécanique décrite d’un coup d’État en cours : mater les révoltes (il emploie le mot), s’appuyer sur un groupe compact de partisans, et promettre des lendemains qui chantent.
Toute la scène de la révolte, que nous regarderons du côté du peuple, se conclut par un discours de Heurtal entrecoupé de vociférations qui suit ce chemin.
- Citoyens…
Heurtal s’adresse au citoyen, qui appartient à la cité et qui vote, il entérine implicitement ainsi l’idée de démocratie introduite par Guercœur (alors qu’il a dit précédemment à Giselle, désormais je crois à l’esclavage)
- Vous m’avez donné la dictature ! je serai digne de votre confiance.
Captatio benevolentiae, les vociférations montrent que ce n’est pas encore tout à fait le cas, mais faire comme si fait effet de réalité. Il continue la fiction d‘une dictature conférée par le peuple… Notre monde d’aujourd’hui est rempli d’exemples, dernier en date, la dernière élection de Vladimir Poutine.
- L’heure est critique
- Notre belle cité sombre dans l’anarchie
Deux affirmations qui visent à justifier son intervention comme sauveur.
- Les riches ont fui
La cité a besoin des riches pour que faire travailler et vivre les pauvres, mais a aussi besoin des capitaux, et les scandales capitalistes de la IIIe république sont encore récents (Panama), qui ont provoqué le boulangisme et risqué de faire vaciller le nouveau régime.
- Les pauvres ont faim
Pas de travail fourni par les riches, et donc l’argent ne circule plus et crée la pauvreté.
- C’est bientôt pour nous ruine et souffrance
Première conséquence, la menace de chaos.
- Et si quelque ennemi franchissait la frontière, nous tomberions à sa merci.
Claire évocation de mécanismes politiques bien connus et de toutes les époques, où le responsable, c’est l’Autre, pour provoquer un mécanisme de repli sur la défense identitaire. Toute allusion à des phénomènes d’une brûlante actualité n’est évidemment pas fortuite.
Consul, j’étais sans armes devant le péril. Dictateur, Je ramènerai l’ordre…
J’avais une fonction de régulateur et d’apaisement héritée de Guercœur, qui me laissait spectateur passif ; dictateur, je serai actif. Manière de souligner qu’il était prisonnier d’une situation qu’il n’avait pas créée.
- Je sais… il est des misérables qui vont prêchant le meurtre, l’incendie, et vivent des malheurs du peuple. Traitres, je ne crains pas vos menaces. Dès ce soir, j’aurai raison de vous
Après l’ennemi possible de l’extérieur, les ennemis de l’intérieur, qui nourrissent le chaos. Nourrir le chaos, c’est être un traître. Et donc les traitres seront punis c’est-à-dire simplement les opposants (appelés dans le livret « ennemis »). Premier devoir des dictateurs, mater les oppositions.
Comme on le voit en quelques phrases, Heurtal déclenche tous les ressorts des mécanismes politiques qui mènent à la dictature, s’appuyant sur le « peuple » on le dirait aujourd’hui « populiste », et tous ces mécanismes sont reconnaissables dans notre bel aujourd’hui… Ce petit texte applique une grille de lecture impitoyable.
Guercœur évidemment saisit tout le sous-texte, les intentions et les mécanismes qui se mettent en place. Mais il est seul, ne représente plus que lui-même, un souvenir, plutôt honni, mais qui fut l’ami de Heurtal qui a hérité de son pouvoir. Voir ce Guercœur se dresser ne peut être qu’imposture. Mieux : les temps ne sont plus au discours sur la liberté, devenue « licence » et « anarchie » et du même coup, Guercœur, vrai ou faux, imposteur ou non, est d’un autre temps et doit être éliminé, il fait forcément partie des traîtres..
Écoutons encore Heurtal quand Guercœur hurle « arrête, arrête, arrête »
- Cet homme est fou
- N’écoutez pas le malheureux a perdu la raison
Premier moment, faire passer Guercœur, seul contre tous, qui n’a que la force de la parole, et d’une parole dont on ne connaît pas l’origine (est-ce Guercœur ou son sosie…) pour un fou, un malheureux, un inoffensif alors qu’il désigne Heurtal comme La honte.
- Qu’on en finisse avec cet idiot
La didascalie dit « perdant son sang-froid » qui peut laisser entendre qu’Heurtal a reconnu le tribun et croit d’une manière ou d’une autre à cette présence. Une seule solution alors, sonner l’hallali : « qu’on en finisse ».
- L’imposteur, Amis, à moi !
Heurtal, dit la didascalie, « descend précipitamment de la tribune », en d’autres termes, il prend peur, et appelle à l’aide pour le mettre hors d’état de nuire. C’est l’appel à la violence.
Il avait déjà tué le père politiquement, il le tue ou le fait tuer effectivement. Guercœur est éliminé de l’horizon.
Le peuple

C’est peut-être le moment le plus étonnant du livret, qui constitue le troisième tableau du deuxième acte, « le peuple ». Correspondant à la troisième désillusion de Guercœur, après l’amour et l’amitié. Moment étonnant, non dépourvu de ce qu’on a appelé une certaine « naïveté » où les réactions du « peuple » sont méthodiquement exposées et concentrées, résumant les éléments essentiels de la crise qui porte Heurtal au pouvoir.
Le texte est concentré en trois scènes assez courtes, et les didascalies sont longues, décrivant scrupuleusement le décor, une place publique, une sorte d’agora, celle de l’hôtel de ville à l’intérieur duquel se déroulent des débats qu’on entend sans les voir. Trois groupes, les femmes (scène I), les partisans de Heurtal et ses ennemis. (scène II) et la victoire de Heurtal (Scène III), constituant un mouvement continu en crescendo, discussions, violences verbales et insultes, puis violences physique et sang, contre lequel Guercœur ne pourra rien, isolé et bientôt lynché.
La concentration en peu de temps de tous les arguments ne tourne pas pourtant à la simplification, car le livret de Magnard surprend une fois de plus par sa précision et sa pertinence dans la manière dont il présente la situation.
C’est sans discussion le moment le plus politique, et aussi le plus grinçant parce qu’il souligne à la fois l’échec de Guercœur, incapable de se faire entendre, mais arrive à donner un éventail d’attitudes et d’opinions qui éclairent la situation, emblème de bien des situations de crise.
Les femmes ont une scène assez longue et une expression particulièrement développée où elles demandent du pain, discret rappel de la marche des 5 et 6 octobre 1789 à Versailles où les femmes réclamèrent du pain et ramenèrent le roi à Paris Elles sont sur la place publique où l’on entend les débats houleux venus de l’intérieur de l’hôtel de ville. En apercevant Guercœur, sans s’interroger sur la nature de cette présence elles l’accusent de leur avoir donné la liberté, qui ne donne pas le pain… Elles le maudissent…
Les grands principes ne donnent pas à manger, et la loi économique prime sur tous les principes. Qu’est-ce que la liberté dans la misère ? Il y a là tout un débat qui s’ouvre ou qui pourrait s’ouvrir sur Guercœur mort trop tôt pour aller jusqu’au bout de son projet, mais en même temps sur la disparition du héros, du tribun qui fédérait et qui laisse le peuple orphelin et sans guide. C’est l’histoire biblique du Veau d’Or…
La liberté ne peut se donner telle quelle, la démocratie est un effort de tous et non un système où tous attendraient de toute manière que la solution vienne d’en haut. La liberté sans organisation sociale afférente devient licence ou danger. C’est bien tout cela qui est en arrière-plan.
Peu à peu le débat de l’hôtel de ville fait émerger la volonté de nommer Heurtal dictateur et les femmes reprennent leur discours, en une argumentation qui peut sembler simpliste, voire un peu ridicule dans leur appel à l’autorité du Tyran (Un mâle, un mâle ! sonne aujourd’hui presque hors sol) : l’autorité est forcément mâle, et va sortir les hommes des cabarets et les remettre au travail.
C’est la traduction de ce que nous venons d’évoquer : il n’y a ni démocratie ni liberté sans organisation sociale ni production. La liberté est la clé d’un système (le libéralisme, dans sa définition originelle), qui s’accompagne de constructions sociales et fonctionnelles diverses. C’est bien cela qui est derrière la demande des femmes, avec la conviction (erronée pour Magnard, évidemment) que seul un pouvoir tyrannique peut garantir une organisation sociale, et non un pouvoir régulé par la liberté.
On constate que derrière les cris, c’est une philosophie du pouvoir qui se dessine, où l’on confond liberté et licence, alors que la liberté impose autant de contraintes que n’importe quel système, mais des contraintes consenties, et qui sont expression d’une volonté générale. La liberté impose, au sens rousseauiste, un contrat social.
La deuxième scène du tableau montre l’irruption sur la place du débat qui était dans l’hôtel de ville. On peut supposer que l’hôtel de ville possédait un lieu pour le débat, une salle, une assemblée, les grecs auraient dit une ecclesia, c’est-à-dire un lieu dédié au débat organisé et démocratique, un lieu pensé pour que s’échangent les idées et se prennent les décisions.
L’arrivée sur la place publique du débat montre l’échec de la démocratie organisée, et le début de la guerre civile, puisqu’on va en venir aux mains. Magnard montre clairement d’un côté les « ennemis » de Heurtal, ennemis du Tyran, qu’on pourrait classer sans doute « à gauche », et les partisans de Heurtal dictateur, partisans de l’autorité et de la dictature, « à droite » … Mais il les renvoie dos à dos.
Il n’y a plus d’arguments, on échange des insultes et bientôt des menaces. C’est alors qu’Heurtal va prononcer le discours évoqué plus haut, que Guercœur va tenter d’interrompre : tous vont se liguer contre lui, dans une confusion qui le dépasse. La parole de Guercœur qui renvoie les uns et les autres dos à dos (la honte ou l’esclavage) n’est plus performative. Et tous l’envoient à la mort orchestrée par Heurtal.
La journée se termine dans le sang, les ennemis de Heurtal poursuivis et tués, et le sang célébré avec l’avènement de la dictature, qu’un flot de sang avive encore l’éclat de ta robe triomphale, Heurtal.
Le chœur final célèbre les lendemains qui chantent et le retour du pain, mais aussi le culte de la personnalité qui va entourer Heurtal. C’est le sauveur et c’est le maître…
Heurtal a réussi son 18 Brumaire.
Guercœur meurt conscient de son péché d’orgueil. Vérité pardonne à mon orgueil.
La scène spectaculaire en soi montre les mécanismes de la désagrégation sociale en l’absence d’apprentissage de la liberté et de la démocratie. Il y a chez Magnard une foi authentique dans la démocratie, lui qui vient de vivre le boulangisme, l’affaire Dreyfus, et qui vit les fragilités de la république. S’il y a des naïvetés dans l’expression, rien dans les mécanismes n’est caricatural, c’est la concentration de ce qui se passe quand crise sociale et crise politique amènent la perte de confiance dans les institutions et le désir de se décharger du poids du politique sur un Sauveur. Il peut s’appeler Lohengrin ou Parsifal à l’opéra, Boulanger, ou Mussolini, ou Hitler dans l’histoire.
Il est intéressant de constater comment le jeune empire Allemand naissant et victorieux avait immédiatement, sous l’impulsion de Bismarck, créé un état social qui est encore la colonne portante de l’Allemagne d’aujourd’hui et qui avait eu une fonction fédératrice dans un empire fait d’États divers. Les valeurs seules en effet ne peuvent garantir le fonctionnement d’un système politique, c’est ce que Magnard souligne. Si le peuple a faim et a confondu liberté et licence, c’est d’une part que Guercœur est mort trop tôt pour être le Bismarck nécessaire (en quelque sorte), mais que Heurtal (qui était déjà au pouvoir) n’a pas su ou voulu poursuivre l’œuvre, laissant les choses se déliter pendant deux ans. En réalité, en laissant s’installer le désordre, il pouvait d’autant plus apparaître comme la solution, en prétextant qu’il n’avait pas le pouvoir suffisant (Consul, j’étais sans armes devant le péril. Dictateur, je ramènerai l’ordre). Pur artifice politicien.
Le texte de Magnard est une sorte de radiographie avant la lettre de tous les pièges et les chausse-trappes qui conduisent à l’état autoritaire, une vraie leçon de choses qu’on pourrait méditer de nos jours… étonnant.
C’est pourquoi j’y vois encore une fois un terrible réalisme, sans concessions.
L’acte III
Plus bref, l’acte III vise à proposer un chemin qui ne laisse pas l’amertume de l’acte II envahir le spectateur. Musicalement, c’est un acte essentiellement choral, je l’ai appelé un peu hardiment un Requiem pour Guercœur, qui constitue une marque d’apaisement après les perturbations qui marquent les deux premiers actes.

L’absence de théâtralité et de mouvement, la fixité chorale de l’acte autour de Guercœur a quelque chose de ces visions picturales médiévales de la « Dormition de la vierge », sorte de cérémonie d’adieu à la vie et d’accueil au ciel dans la paix et l’ataraxie éternelles, telle que l’exprime le quatuor final des déesses : Dors en paix ! chantent-elles entre autres d’ailleurs.
Guercœur au centre revêt un caractère plus religieux : lui-même d’ailleurs dans son court discours cite Jésus, et la dernière phrase de Vérité est « Révèle aux héros la passion de Guercœur », qu’il faut évidemment entendre au sens religieux par référence à la Passion du Christ et aux souffrances subies jusqu’au supplice de la Croix. Il y a donc chez Guercœur quelque chose de Christique, qui en fait un modèle, « Gloire à ceux qui devancèrent », dit Vérité.
Nous sommes donc passés dans un autre ordre, qui confirme l’aspect parabolique de l’aventure de Guercœur, renvoyé du Ciel sur la Terre pour souffrir et revenir au Ciel en quelque sorte sanctifié par la souffrance devenu un modèle ou plus, une Icône au sens sacré du terme, à brandir devant les hommes
On est évidemment frappé par la manière dont Magnard dans son livret et sa musique emprunte au fait religieux la plupart des signes de ce troisième acte, et en même temps affirme à travers le discours de Vérité qui en constitue le pivot non la promesse des religions révélées d’un Au-delà résolutif, mais la promesse d’un futur humain quasiment édénique, comme un paradis sur terre, le Ciel sur la Terre en quelque sorte (et l’on comprend mieux l’impression de monde unitaire voulu par Christof Loy dans sa mise en scène, de deux faces d’une même monnaie).
Le discours de Vérité est un Discours programme : Le rêve de ta vie, Guercœur, s’accomplira. Vérité rentre alors concrètement dans les détails de ce rêve :
- L’homme doit grandir dans l’amour et dans la liberté.
C’est la première et c’est la clef des songes, celle que Vérité reprend en fin de discours en confessant que les choses prendront du temps… - La garantie de la paix sur la Terre sera donnée par la fusion des races et des langages.
A l’époque, on pensait encore que les hommes étaient divisés en races, une idée fausse que la science a battu en brèche, mais l’idée est bien d’un universalisme de l’humanité, une idée aujourd’hui combattue fortement par qui vous savez. Quant à la fusion des langages, elle doit être mise en lien à mon avis avec la naissance de l’esperanto (en 1887), dont le nom même contient le mot clef de Magnard, Espoir
- Par le travail il vaincra la misère.
Bien entendu, il faut y voir l’influence de toute la pensée sociale du XIXe, mais aussi, on le dit moins, la pensée voltairienne exprimée par la conclusion de Candide (« le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui le vice et le besoin… »), un des textes fondateurs du libéralisme social (plus loin dans le même texte, « La petite terre rapporta beaucoup »). Nous en sommes encore là (Sarkozy et son travailler plus pour gagner plus…).
- Par la science il vaincra la douleur
Claire référence aux progrès de la médecine, Pasteur a découvert en 1885 le vaccin antirabique et il ne cesse d’être reconnu et fêté jusqu’à sa mort en 1895 et la science s’oppose à l’obscurantisme, en droite ligne de la pensée du positivisme.
- Il unira la Raison à la Foi pour trouver la Vérité
Il y a là quelque chose d’une religion civique, (Raison, Vérité), mais aussi un espace pour la foi tempérée par la Raison, c’est-à-dire évitant le fanatisme et donc la violence. Un programme à méditer de nos jours.
Après avoir parlé de l’homme à la troisième personne, Vérité s’adresse aux hommes à la deuxième personne du pluriel, dans un discours plus direct qui décrit les temps nouveaux et qui semble s’adresser à l’assemblée des spectateurs :
- Où la faune et la flore docilement soumises libèreront vos êtres de la faim
Il est clair que cette vision de la nature « soumise » pour nourrir l’homme n’est plus aujourd’hui un credo entendable, mais traduit une sorte de confiance absolue dans les progrès de la science et de l’esprit humain domptant la nature à son profit et pour sa survie…
- Votre conscience, inondée de lumière, évoluera dans les sphères du Bien
- Votre esprit vainqueur, terme de la matière, comprendra sans effort les lois de l’Univers
…Alors la Terre achèvera son cycle, l’homme saura son destin
… Les jours les ans les âges passeront sans que l’homme révère l’amour et la liberté
On sent bien dans le texte une volonté de ritualiser, d’évoquer une religiosité fortement marquée par les représentations chrétiennes, et en même temps un discours qui en 1931, a suscité l’ironie de la critique :
Jean Chantavoine dans Le Ménestrel (Mai 1931):
Sa seconde mort ramène Guercœur au séjour des idées pures. Vérité l’y accueille avec un sermon laïque où, dans le style de Louise Michel, de Jean Grave et de Séverine, elle prophétise les temps nouveaux. Et ses compagnes les abstractions se joignent à elle pour endormir Guercœur dans le soyeux cocon d’un fort joli quatuor vocal. On peut penser que Guercœur, sorte de ruminant de la béatitude, digérera cette fois pour de bon la fadeur des félicités éternelles.
Ou dans Lyrica (Avril 1931)
Tout cela nous est lointain comme lointaines nous sont ses conceptions sociales dont l’humanitarisme est issu de Fourier, de Comte, des rhéteurs de 48.
En même temps, cette conclusion grandiloquente évoque un futur si lointain qu’on se demande si Magnard ne substitue pas une foi humaine à une foi religieuse avec les mêmes objectifs et les mêmes effets, tenir la société entre des garde-fous, frein social en quelque sorte pour éviter les débandades et traduisant une sorte d’aporie.
Si on parle de rêve ou d’utopie à propos de Guercœur, je me demande si au contraire il ne faudrait pas parler de réalisme qui prend acte de la nature de l’humanité, comme le rappelle ironiquement l’Action Française du 1er mai 1931 toujours à propos de Guercœur:
L’idée est belle. Elle n’est pas d’une foudroyante originalité. Tout le monde sait que les jeunes veuves se consolent vite, que les démocraties sont ingrates et que les peuples livrés à eux-mêmes finissent par se donner ou par subir un dictateur.
Réalisme, certes exprimé ici de manière crue et sarcastique, mais qui est pour moi la marque de ce livret qui de manière précise et scrupuleuse analyse les réflexes et mouvements humains, tout en isolant les éléments (positifs et négatifs) qui constituent le « grand homme ». Et ce Ciel rempli de « valeurs » est une sorte de boite à outils qui n’est pas inscrite dans l’idéal, mais dans le réel que l’humanité a créée elle-même pour vivre sur la Terre : cela s’appelle une civilisation.
Le troisième acte qui doit instiller l’Espoir en l’homme ne propose guère plus, que ce que proposent les religions et dans une forme voisine, c’est-à-dire les moyens qui permettent à la fois de supporter notre état de mortel sur qui pèse la vie. Car le livret commence après la mort du héros. C’est bien du rapport de l’humanité à la mort qu’il s’agit.
Dans la certitude d’une mort irrémédiable, l’individu peut décider de se libérer de toute règle et de toute morale, l’issue étant de toute manière, la même pour tous. C’est un peu le sens de la mise en scène de Claus Guth de Don Giovanni de Mozart, vue comme une agonie devenue course effrénée à la vie libérée de tout contrainte puisque pressée par une fin imminente.
Mais c’est en même temps une dystopie qu’envisager l’humanité comme une universelle anarchie, sans valeurs ni limites puisque de toute manière tout finira en poussière.
Les philosophies et les religions ont donc inventé un mode d’organisation des hommes pour vivre en attendant la mort, voire en la transcendant avec des lois (les Dix commandements sur des Tables de la Lois que Moïse lance au peuple perdu par le Veau d’or), ou des Valeurs chargées de réguler les rapports sociaux, et de transcender la mort par l’espoir d’une vie meilleure ici ou dans l’au-delà.
L’espoir n’est donc qu’une projection chargée de tenir les sociétés, l’idée même que la Terre ne trouvera son paradis que dans des temps lointains et impossibles à mesurer, l’idée que Souffrance doive retourner sur terre « retourne vers le monde où luttent les humains » pour gérer les individus et accompagner les héros, avec l’idée que vivre c’est lutter, et vivre c’est espérer, mais que la solution est sur la Terre… On revient au fatalisme du Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir de Corneille dans Suréna…Aux humains de régler entre eux leur existence le mieux possible. Mais l’idée d’une souffrance nécessaire, impérative même est pétrie de christianisme.
D’où les outils « modérateurs », le pardon, la tolérance, l’absence d’orgueil, les valeurs auxquelles on croit (Beauté bonté etc…) qui limitent les conflits, l’anarchie et pour finir le désespoir. On est là au seuil de Pascal.
Il n’y a pas de rêve dans Guercœur, mais un pari pascalien et fort réaliste sur l’humain, dans sa grande faiblesse et ses petits progrès, le pari de l’acceptation (Spinoza dirait l’acquiescement) qui est le pari de toute civilisation.
Photos de la production de l’Opéra National du Rhin (Ingo Metzmacher/Christof Loy). © Klara Beck









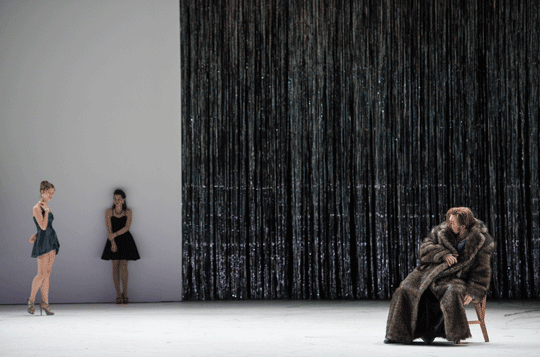
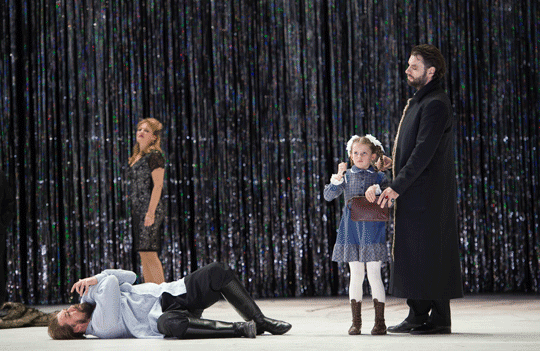

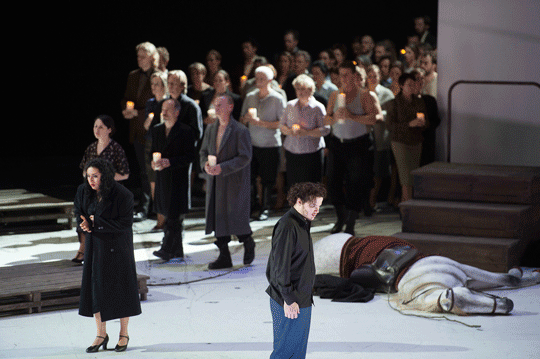























 Pascal Victor / Artcomart
Pascal Victor / Artcomart Pascal Victor / Artcomart
Pascal Victor / Artcomart